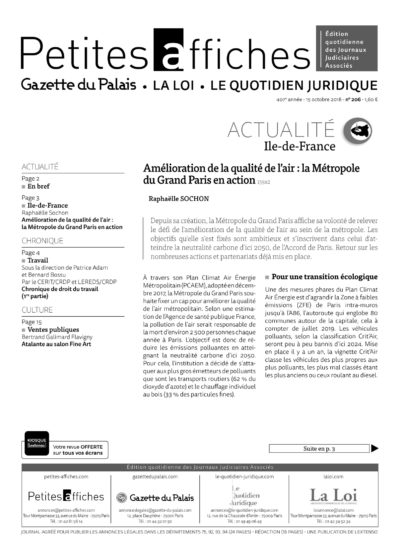Chronique de droit du travail (1re partie)
.
I – Droits et libertés fondamentaux
A – Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : les actions positives sont à prendre au sérieux !
Cass. soc., 12 juill. 2017, n° 15-26262. Un accord collectif d’entreprise peut-il réserver certains des droits qu’il reconnaît aux salariées de sexe féminin et, dans l’affirmative, à quelles conditions ? C’est en substance la question qui a été posée à la Cour de cassation dans le courant de l’été 2017. Dans un contexte où les droits des femmes sont l’objet de toutes les attentions, où leur parole se libère (enfin), où la société s’interroge profondément sur son incapacité à remédier aux inégalités de fait qui les frappent (encore), la décision ne pouvait pas manquer d’attirer l’attention. Elle offre à l’analyste l’occasion de s’interroger sur le cadre de ce qu’il est commun d’appeler les actions positives, cadre pour la compréhension duquel le droit de l’Union européenne est incontournable dès lors que l’égalité entre les travailleurs féminins et masculins est un objectif européen tout autant que national et que l’action menée au premier niveau est à l’origine de celle conduite au second1.
Sur ce point, la haute juridiction ne s’y est pas trompée. C’est une position prise « en application des articles L. 1142-4, L. 1143-1 et L. 1143-2 du Code du travail, interprétés à la lumière de l’article 157, paragraphe 4, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » qu’elle délivre. Les instruments communautaires ont donc été mobilisés et l’on ne peut que saluer la démarche qui illustre ce qui peut désormais être présenté comme une tradition de la chambre sociale visant à donner toute sa place au droit de l’Union. Pour autant, il n’est pas sûr qu’ils aient été parfaitement exploités.
L’affaire mettait en jeu un accord collectif conclu au sein d’une entreprise de transport qui accordait une demi-journée de congé aux salariés de sexe féminin à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes fixée, par résolution de l’Organisation des Nations unies, au 8 mars de chaque année. Un salarié de sexe masculin, à qui le congé avait été refusé, faisait valoir une atteinte injustifiée au principe de l’égalité de traitement aux fins d’obtenir un dédommagement. Ayant été débouté en appel, il demanda à la Cour de cassation de reconnaître que rien ne justifiait que les salariés hommes soient exclus du bénéfice de l’avantage conventionnel, en d’autres termes que l’octroi d’un temps de repos aux salariées femmes lors d’une journée célébrant le combat des femmes pour leurs droits ne pouvait être considéré comme relevant d’une action positive. La position adoptée par la Cour de cassation est toute autre. Elle estime que la mesure conventionnelle ne souffre pas la contestation « dès lors [qu’elle] vise à établir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes ». Difficile d’être pleinement convaincu à la lecture de la décision qui tient plus d’une affirmation que d’une argumentation et ne livre pas les détails de l’analyse menée. Il faut en réalité se référer à la note explicative jointe à l’arrêt pour trouver quelques éléments permettant de comprendre ce qui a déterminé la Cour. Cette dernière y explique en effet que « les inégalités au travail entre les hommes et les femmes sont encore importantes qu’il s’agisse des écarts de rémunération ou de la qualité des emplois » et que « les manifestations de quelque forme qu’elles soient, le 8 mars, permettent de susciter une réflexion sur la situation spécifique des femmes au travail et sur les moyens de l’améliorer », de sorte qu’il existe « un lien entre cette journée et les conditions de travail, légitimant cette mesure, en faveur de l’égalité des chances, prévue par un accord collectif ».
Ces explications sont sans nul doute inspirées par les conditions posées par le droit de l’Union pour qu’une action positive soit admise. Elles ne résistent toutefois pas à l’examen de conformité pour peu que les exigences européennes soient pleinement saisies.
La première d’entre elles tient au constat d’une inégalité dans les faits entre les femmes et les hommes. Il ne saurait en effet y avoir de mesures correctives que pour autant que les femmes sont sous-représentées dans l’exercice d’une activité professionnelle ou désavantagées dans le déroulement de leur carrière, ce qui, s’agissant de « faits », doit se constater et non simplement s’alléguer. Or si la Cour de cassation prend soin de pointer les écarts de rémunération ou de qualité des emplois entre les femmes et les hommes, elle ne fournit aucune donnée à l’appui. On pourra objecter qu’il suffit de se référer aux indicateurs disponibles sur le sujet pour mesurer la réalité de l’allégation2. Pour autant, s’agissant d’une politique d’entreprise, n’aurait-il pas fallu partir de données propres à cette entreprise et ne pas s’en tenir au constat général3 ? Le litige étant né dans une entreprise de transport, il est éminemment probable que la nécessité d’une action corrective aurait été aisée à justifier. L’argumentation n’en aurait été que plus solide.
Ensuite, pour le droit de l’Union, la correction doit intervenir au cours de la vie professionnelle des femmes et uniquement au cours de celle-ci. Comme a pu l’écrire la Cour de justice, « les mesures nationales (…) doivent contribuer à mener leur vie professionnelle sur un pied d’égalité avec les hommes »4, ce qui exclut une condition d’âge différente pour le départ à la retraite ou une bonification de retraite venant, après cessation de l’activité, compenser des désavantages constatés pendant cette activité5. Loin de remédier aux désavantages constatés au cours de la vie professionnelle, de telles mesures ne font que les entériner. Sur ce point, la notice explicative de la Cour de cassation n’apporte pas de précisions, sans qu’il y ait matière à reproche. La mesure corrective prenant la forme d’une autorisation d’absence pour s’associer aux manifestations organisées lors de cette journée, elle avait bien vocation à intervenir au cours de la vie professionnelle.
C’est en réalité confrontée à la troisième exigence européenne que la position de la Cour de cassation échoue à convaincre. En considération de celle-ci, doit être respecté un « principe de proportionnalité qui exige que les dérogations ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché et que soient conciliés, dans toute la mesure du possible, le principe d’égalité de traitement et les exigences du but ainsi poursuivi »6. Or en quoi l’octroi d’une demi-journée de congé pour participer aux manifestations du 8 mars peut-il être considéré comme une mesure « appropriée et nécessaire » pour faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par les femmes ou prévenir ou compenser les désavantages qu’elles subissent dans leur carrière professionnelle ? Le problème existe, mais la réponse apportée – qui relève au mieux du symbole et au pire d’une représentation des femmes et du combat pour leurs droits qui relève d’un autre temps7 – manque cruellement de pertinence. À notre sens, la haute juridiction aurait été bien inspirée de s’en tenir à l’avis de l’avocat général qui estimait que « l’octroi d’une demi-journée de congé aurait pu participer spécifiquement à la lutte contre la discrimination au travail si les salariés de sexe masculin en avaient également bénéficié pour qu’au sein de l’entreprise une réflexion commune aux deux sexes soit menée »8. Au lieu de cela, elle livre une décision décevante qui laisse un goût d’inachevé. D’un côté, il est bon de constater que la logique de correction des inégalités de fait gagne du galon puisque la Cour de cassation entend donner à la règle de l’article L. 1142-4 du Code du travail une plus grande portée. De l’autre, on ne peut que déplorer qu’elle le fasse à propos d’une disposition conventionnelle qui n’est nullement de nature à faire bouger les lignes et évoluer les mentalités. Le sentiment est finalement celui d’une occasion manquée.
Alexia GARDIN
B – Égalité de traitement et transfert conventionnel des contrats de travail, un revirement de jurisprudence
Cass. soc., 30 nov. 2017, nos 15-20532 à 15-20549. Certaines règles et principes juridiques sont bien ancrés mais leur articulation peut s’avérer en revanche plus délicate. Le couplage transfert des contrats de travail et égalité de traitement en constitue une illustration. Si la Cour de cassation a posé en 2012 une solution de laquelle elle ne s’est pas départie en matière de transfert légal des contrats de travail au sens de l’article L. 1224-19, tel n’est pas le cas de l’articulation transfert conventionnel des contrats de travail et égalité de traitement. Dans un arrêt du 15 janvier 201410, confirmé dans une décision du 16 septembre 201511, la Cour de cassation a retenu qu’en cas de transfert conventionnel, l’inégalité qui en résultait entre salariés accomplissant le même travail pour le même employeur sur le même chantier n’était pas justifiée par des raisons pertinentes et méconnaissait le principe d’égalité de traitement. Le raisonnement de la haute cour était à l’époque construit à l’aune des seules règles sur l’égalité de traitement. Autrement dit au nom du principe d’égalité, l’employeur devait, quelles que soient les stipulations conventionnelles applicables, octroyer les mêmes avantages à ses salariés que ceux dont bénéficiaient les salariés entrants. Les solutions jurisprudentielles étaient donc diamétralement opposées selon l’origine du transfert.
Par l’arrêt du 30 novembre 2017 ici commenté, la haute cour revient sur sa jurisprudence12 en cas de transfert conventionnel, ce qui entraîne, par là même, un alignement des solutions sur celles applicables en cas de transfert légal. Les faits étaient les suivants. En application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, la société attributaire d’un marché de nettoyage du site Banque de France avait repris les contrats de travail et les droits afférents des salariés de l’ancien prestataire. Les salariés entrants bénéficiaient d’une prime de treizième mois en vertu de leur contrat de travail. Les salariés de l’entreprise d’accueil affectés sur le même site et effectuant, dans les mêmes conditions, le même travail, avaient saisi la juridiction prud’homale pour bénéficier de cette même prime de treizième mois au nom de l’égalité de traitement. Ils obtinrent gain de cause devant le conseil de prud’hommes mais la Cour de cassation censura la décision sans renvoi.
Par l’arrêt du 30 novembre 2017 soumis à la plus grande publicité et qui sera intégré dans le rapport de la Cour de cassation, cette dernière opère un spectaculaire revirement de jurisprudence en soulignant que « l’évolution générale de la législation du travail en matière de négociation collective et de la jurisprudence en ce qui concerne le principe d’égalité de traitement à l’égard des accords collectifs conduit à apprécier différemment la portée de ce principe à propos du transfert des contrats de travail organisé par voie conventionnelle ».
Elle change de prisme par rapport à l’analyse qu’elle avait effectuée en 2014. Dans l’arrêt du 30 novembre 2017, elle construit son raisonnement en se référant au nouvel ordonnancement des sources en droit du travail et tout particulièrement à la place conférée à la négociation collective. On peut souligner à cet égard qu’elle a fait le choix de placer en premier cet élément dans l’attendu placé en chapeau de l’arrêt.
La Cour de cassation justifie ensuite sa solution par l’évolution de la jurisprudence relative à l’égalité de traitement à l’égard des accords collectifs hors situation spécifique de transfert d’entreprise. L’on sait sur ce point que la Cour de cassation a tâtonné avant de fixer sa jurisprudence. Dans un arrêt du 1er juillet 200913, la haute cour avait affirmé que « la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier pour l’attribution d’un avantage prévu par accord collectif une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives. Par cet arrêt, les partenaires sociaux ne pouvaient plus réserver certains avantages à telles ou telles catégories professionnelles spécifiques dès lors que les salariés étaient placés dans une situation identique au regard dudit avantage. À la suite de l’agitation et de l’inquiétude suscitée par l’arrêt auprès des partenaires sociaux, la Cour de cassation était intervenue à nouveau en cherchant une solution de meilleur compromis14, mais de nombreuses dispositions conventionnelles restaient mises à mal. Pour éviter un hiatus envers un tissu conventionnel important, la Cour de cassation modifia en profondeur sa jurisprudence par quatre arrêts du 27 janvier 201515. Elle précisa que « les différences de traitement entre les catégories professionnelles opérées par voie de convention ou accord collectif négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquels ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées », de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démonter qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Puis la Cour de cassation a poursuivi la construction des solutions (hors hypothèse de transfert d’entreprise) en admettant dans un arrêt du 8 juin 201616 que la présomption de légitimité s’applique non seulement aux différences de traitement entre catégories professionnelles mais aussi aux différences de traitement entre des salariés exerçant au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes. La Cour de cassation étendit encore cette règle au cas de la négociation d’accords d’établissement17.
La solution posée en 2014 et confirmée en 201518 sur l’articulation entre transfert conventionnel des contrats de travail et principe d’égalité de traitement paraissait bien isolée et plus nécessairement en phase avec les solutions posées hors cas de transfert d’entreprise. Au vu de ces évolutions, il semblait assez inévitable que la Cour de cassation fasse évoluer ses solutions sur l’articulation transfert conventionnel des contrats et principe d’égalité de traitement lorsqu’elle serait saisie de cette question. C’est donc désormais chose faite.
Il est même possible d’affirmer que dans l’arrêt du 30 novembre 2017, la Cour de cassation est allée plus loin que dans les solutions posées précédemment sur l’articulation entre égalité de traitement et convention collective hors transfert d’entreprise. Dans le présent arrêt, elle ne s’exprime plus en termes de présomption simple mais retient que la différence de traitement résultant de la garantie d’emploi n’est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle, et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d’égalité de traitement. Il devrait être impossible de pouvoir renverser cette présomption devant les juges du fond.
Le nouvel article L. 1224-3-2 créé par la loi du 8 août 2016 et modifié par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 est inapplicable aux faits de l’espèce. Pour autant, il n’est vraisemblablement pas étranger non plus au revirement de jurisprudence. Cet article dispose que lorsqu’un accord de branche étendu prévoit et organise la poursuite des contrats de travail en cas de succession d’entreprises dans l’exécution d’un marché, les salariés du nouveau prestataire ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d’avantages obtenus, avant le changement de prestataire, par les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis.
Cet article a lui-même été adopté pour contrecarrer ou à tout le moins pour restreindre la position de la Cour de cassation sur les transferts conventionnels. Il vise à donner une certaine respiration aux prestataires19 qui reprennent en application d’un accord collectif des salariés travaillant précédemment pour le compte d’un autre prestataire en ne leur imposant pas une égalité de droits par le haut entre salariés de l’entreprise d’accueil et salariés entrants. Par cet article, la loi rapproche les effets du transfert conventionnel de ceux du transfert légal. En effet, on le sait, cette même latitude est reconnue depuis 201220 aux employeurs qui reprennent des salariés en application de l’article L. 1224-1.
En définitive, seuls les employeurs qui reprennent des contrats de travail par transfert volontaire peuvent bénéficier de cette faculté. Le principe d’égalité de traitement s’impose à eux et des différences de traitement ne sont admises que pour autant qu’elles s’expliquent par des raisons objectives et pertinentes. Le transfert volontaire risque d’apparaître aujourd’hui bien peu attractif.
Pascale ETIENNOT
C – Qu’est-ce qu’une liberté fondamentale en droit du travail ?
Cass. soc., 21 sept. 2017, nos 16-20270 et 16-20277. Dans une décision du 21 septembre 201721, un salarié temporaire, avant l’expiration de sa dernière mission, saisit la formation de référé de la juridiction prud’homale pour, notamment, faire valoir les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée et obtenir la poursuite de la relation contractuelle. Pour ce faire, il invoque sa liberté fondamentale au maintien dans l’emploi. En appel, le juge accède favorablement à sa demande. L’arrêt d’appel est cassé par la chambre sociale de la Cour de cassation au motif que « le droit à l’emploi ne constitue pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat de travail au-delà du terme de la mission de travail temporaire en cas d’action en requalification en contrat à durée indéterminée ». Avec l’arrêt prononcé par la haute juridiction, accompagné d’une note explicative22, est posée la question de ce que sont les libertés fondamentales en droit du travail et de leurs conséquences.
I. Sur les conséquences de la violation des libertés fondamentales en droit du travail, la décision du 21 septembre 2017 réaffirme des solutions bien connues. Classiquement23, la qualification d’une liberté en « liberté fondamentale » présente l’intérêt de préciser les sanctions et procédures à mettre en œuvre.
Ainsi, tout d’abord, sans texte spécifique ou violation d’une liberté fondamentale dûment reconnue, la nullité du licenciement ne peut pas être prononcée par le juge24. Cet énoncé vaut tant pour la rupture du contrat à durée indéterminée que pour celui à durée déterminée25. Au-delà, toujours sur le fond, l’annulation du licenciement ouvre droit au salarié, comme « prolongement naturel »26, à la réintégration au sein de l’entreprise27, au paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité28, ainsi que la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration29. Au contentieux, la présence d’une violation d’une liberté fondamentale emporte également plusieurs conséquences « négatives », à savoir la suppression des barèmes imposés par le Code du travail pour le calcul de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse30 ainsi que l’absence d’obligation de remboursement des indemnités de chômage perçues par le salarié31.
Ensuite, sur le plan procédural32, le juge des référés dispose d’une marge de manœuvre pour faire obstacle temporairement33 aux conséquences de la violation. Cependant, cette intervention est restreinte car « il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner l’arrêt d’une procédure de licenciement et la poursuite du contrat de travail lorsque la nullité du licenciement n’est pas encourue34 ». Par conséquent, comme le rappelle la notice explicative, « ce n’est donc que dans le cas où la nullité de la rupture est encourue que le juge des référés peut ordonner la poursuite du contrat de travail ».
La violation d’une liberté fondamentale entraînant la nullité n’est pas un cas d’école et la jurisprudence a déjà statué sur la base du droit d’agir en justice35 et a énoncé que « le principe de l’égalité des armes s’oppose à ce que l’employeur utilise son pouvoir disciplinaire pour imposer au salarié les conditions de règlement du procès qui les oppose36 ».
II. Sur la question de la fondamentalité des libertés et des droits, l’arrêt du 21 septembre 2017 invite à discerner les critères de distinction de ce qui est fondamental et de ce qui ne l’est pas.
A. En vérité, l’analyse de la jurisprudence de la Cour de cassation n’offre la faculté que d’en dessiner les contours en creux. Qu’est-ce qui n’est pas fondamental ? Une typologie peut être esquissée à la lumière de la jurisprudence antérieure. Ce sont les libertés sans fondements juridiques telles que la liberté de se vêtir37, la liberté de faire usage d’un titre ou d’un grade au temps et lieu de travail38. Ce sont aussi les libertés et droits sans attache avec le bloc de constitutionnalité français comme le droit à une action de formation professionnelle39 ou le principe de non-discrimination en raison de l’âge40.
Dans le prolongement de ces exclusions, sont écartés les droits et libertés « intermédiaires » qui nécessitent la reconnaissance d’un « effet direct », comme le droit à l’emploi. C’est dans cette direction que s’oriente la chambre sociale de la Cour de cassation qui, dans sa note explicative, énonce qu’« un justiciable ne peut pas se prévaloir directement dans le cadre d’un litige d’une violation du droit à l’emploi41 ». Elle ajoute que « le droit à l’emploi, qui résulte de l’alinéa 5 du préambule de la constitution de 1946 n’est pas une liberté fondamentale, mais un droit-créance qui doit être concilié avec d’autres droits ou principes constitutionnels, tels que la liberté d’entreprendre qui fonde, pour l’employeur, le droit de recruter librement ou de licencier un salarié ». De l’avis général, le droit à l’emploi est exclu de la catégorie des libertés fondamentales.
Une telle approche est contestable à plusieurs titres.
Premièrement, on notera à cet égard, l’ambivalence de la formule de l’arrêt du 21 septembre 2017 selon laquelle « le droit à l’emploi ne constitue pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat de travail au-delà du terme de la mission de travail temporaire en cas d’action en requalification en contrat à durée indéterminée ». Il y aurait des libertés fondamentales justificatives et des libertés fondamentales non justificatives établissant une hiérarchie au sein des libertés fondamentales.
Deuxièmement, l’arrêt ne résout pas la question de la fondamentalité d’une liberté. Mais alors qu’est-ce qui est fondamental ? La conception retenue par la jurisprudence est une conception en négatif : les libertés autres que celles pour lesquelles le caractère fondamental est exclu ont un caractère fondamental. En vérité, cela fait fort peu. En font partie assurément la liberté d’association, la liberté syndicale, la liberté d’expression, la liberté d’aller et venir, le droit à la vie privée ou encore la liberté d’opinion, de pensée ainsi que la liberté religieuse. Une telle conception n’est pas incontestable, en ce sens qu’elle ignore que l’État ne peut pas seulement s’abstenir pour qu’une liberté se réalise, comme l’atteste la théorie des obligations positives développée par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH)42. De même, toute liberté et tout droit – hormis les principes d’interdiction tels que la prohibition de l’esclavage43 – commande une conciliation avec d’autres droits et d’autres libertés. La conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale44 ou l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée ne le démontre-t-il pas ? La confrontation de la liberté d’expression et du « secret » des affaires45 n’en est-il pas un autre bon exemple ? Or ces conciliations sont réalisées aussi bien par le juge constitutionnel que par le juge ordinaire.
B. Dans quelles perspectives s’inscrit l’arrêt du 21 septembre 2017 ? La fondamentalité des libertés est devenue centrale pour le déclenchement de nombreux instruments juridiques.
Premièrement, pour l’avenir immédiat, la France a ratifié46 le protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Convention EDH)47 qui institutionnalise un dialogue entre le juge de Strasbourg et le juge français, à l’instar du renvoi préjudiciel de l’Union européenne48. Plus précisément, ce mécanisme donne aux « hautes juridictions nationales » – au rang desquelles figurent le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État et la Cour de cassation – la possibilité de saisir, à l’occasion d’un litige, la CEDH pour avis sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés garantis par la Convention EDH ou de l’un de ses protocoles. On en conviendra : le droit à l’emploi ne figure pas parmi les droits et libertés énoncés par la Convention EDH. Cependant, l’interprétation dynamique de la CEDH – même si elle est en perte de vitesse – a accompagné la consécration de droits et de libertés non prévus expressément par la convention.
Deuxièmement, pour l’avenir lointain – espérons-le hypothétique et fantasmé – le caractère fondamental de la liberté serait l’un des critères de filtrage des pourvois en cassation dont le président de la haute juridiction assure la promotion avec ténacité49 et dont la doctrine la plus autorisée démontre les dangers50. Dans l’optique de l’avènement de ces dispositifs, le caractère fondamental, réduit à peau de chagrin par la chambre sociale de la Cour de cassation, entraînerait une diminution drastique de l’activité juridictionnelle de cette noble institution. Des quelque 8 000 arrêts traités par an51, la chambre sociale serait amenée à statuer sur quelques dizaines d’affaires.
Que la Cour de cassation prenne garde à ces évolutions : à trop jouer le rôle de filtre au profit d’autres juridictions, le risque est celui de sa propre disparition car un filtre – au bout d’un certain temps – s’use et finit par être changé.
Jean-Philippe TRICOIT
D – Réintégration du salarié licencié en raison de son âge et indemnisation du préjudice subi
Cass. soc., 15 nov. 2017, n° 16-14281. En vertu de l’article L. 1132-1 du Code du travail, le licenciement fondé sur l’âge du salarié est nul et celui-ci a le droit d’obtenir sa réintégration dans l’entreprise. Celle-ci va se traduire par la récupération du poste de travail antérieurement occupé par le salarié mais aussi par le versement des salaires perdus entre son licenciement et sa réintégration. Mais comment doit-on calculer le montant de l’indemnité d’éviction ? Faut-il déduire de cette indemnité les éventuels revenus de remplacement perçus entre le licenciement et la réintégration ? La Cour de cassation apporte une réponse positive à cette interrogation dans une décision en date du 4 octobre 2017.
En l’espèce, un responsable des achats informatiques âgé de 57 ans a été licencié par une société d’assurances. Un premier arrêt d’appel, qui avait refusé de reconnaître l’existence d’une discrimination fondée sur l’âge, est censuré par la Cour de cassation le 25 septembre 2013. Sur renvoi, la cour d’appel de Paris admet l’existence d’une discrimination et condamne l’employeur à réintégrer le salarié. Celui-ci se pourvoit néanmoins de nouveau en cassation car il conteste le montant de l’indemnité reçue au titre de la période d’éviction. La cour d’appel de Paris a en effet condamné l’employeur à verser la totalité des salaires non perçus entre la date du licenciement et la date de réintégration « déduction faite des revenus tirés d’une autre activité professionnelle ou des ressources perçues d’un organisme social ». Or, pour le salarié, dans la mesure où son licenciement porte atteinte au principe de non-discrimination garanti par la constitution, il aurait dû recevoir l’intégralité des salaires perdus. Par un arrêt rendu le 15 novembre 2017, la Cour de cassation rejette la demande du salarié. Elle considère que « le principe de non-discrimination en raison de l’âge ne constitue pas une liberté fondamentale consacrée par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ni par la constitution du 4 octobre 1958 qui justifierait, en cas de nullité du licenciement prononcé en violation de cette prohibition, la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration ».
Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence bien établie. En cas de licenciement nul, le salarié qui demande sa réintégration a en principe droit au paiement d’une « somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé »52. Il faut donc déduire de l’indemnisation, comme le rappelle l’arrêt commenté, les « revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration ». Cette analyse est logique car, normalement, la réparation du préjudice subi ne doit pas se traduire par un enrichissement de la victime.
Mais cette solution de principe connaît une exception. Lorsque la nullité sanctionne la violation d’une liberté fondamentale garantie par la constitution, l’indemnisation devient forfaitaire. En conséquence, on n’a pas à tenir compte de la perception de salaires ou de revenus de remplacement pendant la période d’éviction. On se trouve en quelque sorte face à une peine privée appliquée à l’employeur. Cette règle de non-déduction des revenus de remplacement s’est d’abord appliquée à l’occasion du licenciement d’un salarié protégé sans autorisation administrative : il a droit à une indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son licenciement jusqu’à la date de sa réintégration53. Puis l’analyse a été étendue au droit de grève, la Cour de cassation s’appuyant sur l’article 7 du préambule de la constitution de 194654. L’absence de déduction des revenus de remplacement concerne aussi le licenciement qui trouve sa cause dans les activités syndicales du salarié, l’article 6 du préambule de la constitution garantissant à chacun la liberté de pouvoir défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale55. Il y a aussi indemnisation forfaitaire dès lors que le licenciement caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé garanti par l’article 11 du préambule de la constitution de 194656. En revanche, l’indemnisation perd son caractère forfaitaire en cas de nullité d’un licenciement consécutive à l’annulation d’un plan de sauvegarde de l’emploi57 ou en cas de licenciement prononcé en raison de la maternité alors que l’alinéa 3 du préambule de la constitution garantit l’égalité entre les hommes et les femmes58. La déduction des revenus de remplacement a été également retenue lorsque le salarié est licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral alors même qu’il avait invoqué l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui protège la liberté d’expression59. Sans surprise, la Cour de cassation décide d’appliquer cette solution au licenciement nul en raison d’une discrimination fondée sur l’âge : il n’y a pas violation d’une liberté fondamentale consacrée par le préambule de la constitution de 1946 ou par la constitution du 4 octobre 1958.
Qu’est-ce qui justifie une telle différence de traitement entre les nullités ? On a beaucoup de mal à comprendre pourquoi l’indemnité d’éviction n’obéit pas toujours au même mode de calcul. Pour justifier sa position, la Cour de cassation s’appuie sur l’existence ou non d’une liberté fondamentale consacrée par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ou par la constitution du 4 octobre 1958. Mais la loi ne distingue pas entre les nullités du licenciement, elle ne prévoit pas des nullités de « seconde zone ». Faut-il distinguer là où la loi ne distingue pas ? La nullité ne caractérise-t-elle pas toujours une atteinte aux principes supérieurs de la société ?
Au-delà du caractère discutable de la distinction opérée par la Cour de cassation, on peut aussi s’interroger sur le critère retenu : la violation ou non d’une liberté fondamentale constitutionnelle60. Cette distinction peut tout d’abord s’avérer délicate car les libertés garanties par la constitution peuvent être plus ou moins largement entendues. Comme nous l’avons vu précédemment, pourquoi ne peut-on pas considérer que le licenciement prononcé en raison de la maternité viole l’alinéa 3 du préambule de la constitution qui garantit l’égalité entre les hommes et les femmes ? De même, le champ d’application qu’il convient de donner au droit à l’emploi proclamé par le préambule de la constitution est incertain. Ensuite, pourquoi a-t-on retenu uniquement la source constitutionnelle ? Ne peut-on pas aussi trouver dans certains textes internationaux ou européens des libertés fondamentales qui mériteraient aussi d’être prises en compte par la Cour de cassation ? Dans l’arrêt du 15 novembre 2017, pour s’opposer à la déduction des revenus de remplacement de l’indemnité d’éviction, le salarié invoquait notamment le droit de l’Union européenne. L’article 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne posent clairement le principe de non-discrimination en raison de l’âge. Par ailleurs, la directive n° 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail interdit les différences de traitement fondées sur l’âge. Mieux, la Cour de justice de l’Union européenne considère que l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge constitue un principe général de l’Union61 et bénéficie à ce titre d’un effet direct tant horizontal que vertical. Et cette analyse a été expressément reprise par la chambre sociale de la Cour de cassation dans sa jurisprudence62. Dans ces conditions, la solution retenue par l’arrêt commenté ne peut qu’engendrer une certaine perplexité. Qui plus est, la question du champ d’application des libertés fondamentales devient encore plus essentielle avec les ordonnances Macron du 22 septembre 2017. On rappellera que le plafonnement des indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne s’applique pas en cas d’atteinte à une liberté fondamentale63. Comme a pu l’écrire récemment le président de la chambre sociale de la Cour de cassation, à la suite de notre arrêt du 15 novembre 2017, il faut « clarifier les choses quant à la source d’une liberté fondamentale, aucune raison juridique pertinente ne paraissant justifier à cet égard qu’une liberté fondamentale ne puisse résulter que de certains principes constitutionnels et (jamais) d’un droit fondamental ou principe général consacré par le droit de l’Union »64.
Bernard BOSSU
E – Harcèlement moral : de la nécessité de mettre un mot sur les maux !
Cass. soc., 13 sept. 2017, n° 15-23045. Dès les premières années de faculté, les étudiants se voient enseigner que, dans les disciplines juridiques, les mots ont leur importance. La décision rendue par la Cour de cassation le 13 septembre 2017 permet de le rappeler… même si elle appelle la critique.
En l’espèce, un salarié est licencié après avoir adressé un courriel à son employeur afin de l’informer du traitement abject, déstabilisant et profondément injuste qu’il estimait être en train de subir. Dans cet écrit, il sollicitait, dans un premier temps, une rencontre avec son employeur afin de l’informer et, dans un second temps, une vérification de ses propos. À l’appui du licenciement, l’employeur reproche notamment au salarié d’essayer de créer l’illusion d’une brimade et de proférer des accusations diffamatoires. Saisis par le salarié, les juges du fond ont déclaré le licenciement nul après avoir retenu que le courriel du salarié visait des agissements de harcèlement moral même si ces termes n’étaient pas formellement employés. La solution est censurée. Au visa des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle « qu’aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral ». Elle reproche néanmoins aux juges du fond d’avoir violé les textes susvisés dès lors « qu’il résultait de [leurs] constatations que le salarié n’avait pas dénoncé des faits qualifiés par lui d’agissements de harcèlement moral ». La solution paraît difficilement compréhensible. Certes, la chambre sociale de la Cour de cassation réaffirme que le salarié ayant dénoncé des agissements de harcèlement moral est protégé (I). Toutefois, la solution conduit à limiter la protection sans que cela ne soit réellement justifié (II).
I. Une protection affirmée
Dans l’arrêt commenté, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’« aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral ». Il s’agit d’une stricte application de l’article L. 1152-2 du Code du travail qui, dans sa version en vigueur à la date des faits de l’espèce commentée, disposait : « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ». La solution est classique. Tout au plus relèvera-t-on que la haute juridiction prend habituellement le soin de rappeler que la protection implique que le salarié ne soit pas de mauvaise foi65. Pour que celle-ci soit caractérisée, il ne suffit pas d’établir que les faits dénoncés par le salarié n’étaient pas avérés ; il faut démontrer que le salarié avait connaissance de la fausseté des faits évoqués par lui66.
Afin de donner toute sa force à la protection ainsi accordée aux salariés, l’article L. 1152-3 du Code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions protectrices qui viennent d’être évoquées, que toute disposition ou tout acte contraire est nul. À ce stade, la solution de l’arrêt commenté ne surprend pas. Elle s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante. La suite de l’arrêt est plus critiquable dans la mesure où elle vient limiter la protection ainsi accordée aux salariés sans que la motivation retenue ne convainque réellement.
II. Une protection limitée
Sans remettre en cause l’existence d’une protection accordée aux salariés ayant dénoncé des agissements de harcèlement moral, la Cour de cassation censure la solution retenue par les juges du fond qui ont prononcé la nullité du licenciement au motif qu’il ressortait de leurs constatations « que le salarié n’avait pas dénoncé des faits qualifiés par lui d’agissements de harcèlement moral ». Il faut pourtant rappeler que le salarié avait adressé un courriel à son employeur faisant état d’un « traitement abject, déstabilisant et profondément injuste ». Il faut donc comprendre de cette solution que la protection accordée à l’auteur d’une dénonciation de faits de harcèlement moral ne s’applique que si le salarié a préalablement qualifié les faits litigieux d’agissements de harcèlement moral. À défaut, le juge semble privé de tout pouvoir d’appréciation sur la qualification à donner aux faits dénoncés par le salarié. La solution surprend à plusieurs égards.
Tout d’abord, la solution paraît remettre en cause la définition même du harcèlement moral. Celui-ci résulte d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits, à la dignité, d’altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l’avenir professionnel67. En l’espèce, en faisant référence à « un traitement abject, déstabilisant et profondément injuste », le salarié faisait manifestement référence à des agissements répétés ayant eu pour objet et à tout le moins pour effet, une dégradation de ses conditions de travail. Même s’il n’avait pas utilisé les mots, les maux n’en paraissaient pas moins caractérisés ; les agissements évoqués par lui semblaient bien relever de la qualification de harcèlement moral.
Ensuite, la solution ne semble pas en adéquation avec les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 12 du Code de procédure civile. En vertu de ce texte, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. / Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». Il n’y a donc aucune raison d’exiger du salarié qu’il qualifie les faits auxquels il est confronté pour pouvoir revendiquer une protection en lien avec ces faits. C’est au juge qu’il appartient de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits litigieux sans s’arrêter à la dénomination retenue par le salarié. Si le juge estime que les faits dénoncés par le salarié sont constitutifs d’une situation de harcèlement moral, il doit en tirer toutes les conséquences qui s’imposent, conformément aux règles de droit qui sont applicables.
Enfin, la solution surprend par son manque de pertinence. Que le salarié ait qualifié les faits de harcèlement moral ou qu’il ne les ait pas qualifiés comme tels, cela devrait être sans incidence sur l’application des règles d’ordre public instaurées en faveur des personnes ayant dénoncé des agissements de harcèlement moral. En instaurant une protection au bénéfice des dénonciateurs, le législateur a souhaité ne pas dissuader les victimes d’agissements de harcèlement moral de dénoncer les faits auxquels ils ont été ou sont confrontés. Il paraît alors difficile d’expliquer pour quelles raisons il faudrait exiger du salarié qu’il qualifie lui-même les faits de harcèlement moral pour bénéficier d’une protection. Celle-ci s’impose dès lors que la situation la justifiant est acquise. La chambre sociale de la Cour de cassation se garde d’ailleurs de fournir la moindre explication.
En définitive, la solution paraît assez critiquable. La cassation est pourtant acquise. Il appartiendra alors à la cour d’appel de renvoi de se prononcer. Au regard des arguments qui lui seront présentés, peut-être sera-t-elle invitée à faire œuvre de résistance. À défaut, nul doute qu’elle aura vocation à prendre position sur la problématique de la liberté d’expression. On sait en effet, depuis l’arrêt Clavaud68, que la violation de la liberté d’expression à l’occasion d’un licenciement conduit à la nullité de celui-ci, sauf abus du salarié. Dans l’espèce commentée, l’employeur invoquait d’ailleurs un usage abusif de la liberté d’expression. On peut douter du fait qu’un mail par lequel le salarié informe son employeur du traitement particulier auquel il estime être confronté et par lequel il sollicite un échange en vue de la vérification de ses propos puisse être constitutif d’un abus de la liberté d’expression. Ce sera néanmoins aux juges du fond de prendre position.
Alexandre BARÈGE
(À suivre)
F – Nullité du licenciement d’une salariée refusant de prêter serment pour des raisons religieuses
II – Relations individuelles de travail
A – Le contrat de travail
1 – Formation et exécution du contrat de travail
a – Promesse d’embauche : clap de fin ?
2 – Rupture du CDI
a – Le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse en période d’arrêt pour maladie professionnelle ne peut être requalifié en licenciement pour faute grave
b – Rupture conventionnelle : la citadelle imprenable !
B – Le droit disciplinaire et le règlement intérieur
1 – Applicabilité d’un règlement intérieur au sein d’établissements distincts
2 – Le sort d’une sanction disciplinaire appliquée en l’absence d’un règlement intérieur
C – Santé et sécurité au travail
1 – Reclasser le salarié inapte sur un poste de stagiaire ?
2 – Les conséquences de la suspension du contrat de travail sur la qualification juridique de l’accident
3 – Inaptitude médicale : l’employeur peut convoquer les délégués du personnel par voie électronique
III – Les relations collectives de travail
A – Les syndicats
1 – L’obligation de transparence financière du syndicat non représentatif
B – Les salariés protégés
1 – Rupture conventionnelle d’un salarié protégé et principe de séparation des pouvoirs
Notes de bas de pages
-
1.
Le droit de l’Union européenne reconnaît la possibilité pour les États membres de recourir aux actions positives depuis la directive n° 76/207/CEE du 9 février 1976. Elle est aujourd’hui inscrite à l’article 157, paragraphe 4, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 3 de la directive n° 2006/54/CE du 5 juillet 2006 qui ont consolidé la jurisprudence de la Cour à ce sujet.
-
2.
V. l’édition 2017 des chiffres-clés « Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes », accessible sur le site du secrétariat d’État chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes (www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr).
-
3.
En ce sens, JSL 2017, n° 483, p. 10, Lhernould J.-P.
-
4.
CJCE, 13 nov. 2008, n° C-46/04, Commission c/ Italie, pt 57.
-
5.
CJCE, 29 nov. 2001, n° C-366/99, Griesmar.
-
6.
CJCE, 19 mars 2002, n° C-476/99, Lommers, pt 39.
-
7.
Qui pourrait se résumer par l’injonction suivante : « Partez manifester puis revenez travailler dans des conditions inchangées ».
-
8.
« La journée de la femme peut-elle être réservée aux femmes ? », avis contraire de Weissmann R. in Dr. soc. 2017, p. 840.
-
9.
Cass. soc., 11 janv. 2012, n° 10-14614 : Bull. civ. V, n° 15. Par cet arrêt, la Cour de cassation a posé que l’obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d’une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu’ils tiennent d’un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés.
-
10.
Cass. soc., 15 janv. 2014, n° 12-25402.
-
11.
Cass. soc., 16 sept. 2015, n° 13-26788 : JCP S 2015, 140, note Barige.
-
12.
Lhernould J.-P., « Transfert conventionnel des salariés : le nouveau droit à l’inégalité de traitement », JSL 2018, n° 446.
-
13.
Cass. soc., 1er juill. 2009, n° 07-42675.
-
14.
Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-14725 : SSL, n° 1497.
-
15.
Cass. soc., 27 janv. 2015, n° 13-22179 : Bull. civ. V, n° 9.
-
16.
Cass. soc., 8 juin 2016, nos 15-11324, 15-11478 à 15-12021.
-
17.
Cass. soc., 3 nov. 2016, n° 15-18444.
-
18.
V. supra.
-
19.
SSL 2018, n° 1795, Champeaux F., revirement de jurisprudence sur le transfert d’entreprise.
-
20.
Cass. soc., 11 janv. 2012, n° 10-14614, préc.
-
21.
Cass. soc., 21 sept. 2017, nos 16-20270 et 16-20277 : RDT 2017, p. 717, obs. Galy M. ; D. 2018, p. 813, obs. Lokiec P.
-
22.
D. 2017, IR, p. 1923.
-
23.
Cass. soc., 28 avr. 1988, n° 87-41804 : Dr. soc. 1988, p. 428, concl. Ecoutin H. et obs. Couturier G. ; Dr. ouvr. 1988, p. 250, concl. Ecoutin H., note Jeammaud A. et Le Friant M. ; D. 1988, p. 437, note Wagner E. ; RPDS 1988, p. 184, obs. Lyon-Caen G. ; RPDS 1988, p. 218, obs. Cohen M. ; v. not. Roman D., « La justiciabilité des droits sociaux ou les enjeux de l’édification d’un État de droit social », Rev. dr. Homme n° 1/2012 [en ligne].
-
24.
Cass. soc., 13 mars 2001, n° 99-45735 : Dr. soc. 2001, p. 1117, obs. Roy-Loustaunau C.
-
25.
Cass. soc., 30 oct. 2002, n° 00-45608 : Bull. civ. V, n° 331 ; Dr. soc. 2003, p. 134, obs. Roy-Loustaunau C.
-
26.
Radé C., note sous Cass. soc., 31 mars 2004, nos 01-46960 et 01-46961 : Dr. soc. 2004, p. 666.
-
27.
Cass. soc., 30 avr. 2003, n° 00-44811 : Dr. soc. 2003, p. 831, chron. Gauriau B.
-
28.
C. trav., art. L. 1235-3-1, al. 3.
-
29.
Cass. soc., 15 nov. 2017, n° 16-14281 : D. 2017, p. 2375 ; D. 2018, p. 190, chron. Salomon F. ; RDT 2018, p. 132, obs. Mercat-Bruns M. – Cass. soc., 2 févr. 2006, n° 03-47481 : D. 2006, p. 531, obs. Chevrier E. ; RDT 2006, p. 42, obs. Leclerc O.
-
30.
C. trav., art. L. 1235-3-1, al. 1.
-
31.
Cass. soc., 12 avr. 2018, n° 17-10324, D.
-
32.
C. trav., art. R. 1455-5.
-
33.
Cass. soc., 1er avr. 2008, n° 07-40114 : RJS 2008, p. 526, comm. 653 ; JSL 2008, n° 234-5.
-
34.
En ce sens, Cass. soc., 31 mars 2004, nos 01-46960 et 01-46961 : Bull. civ. V, n° 101 ; Dr. soc. 2004, p. 666, obs. Radé C.
-
35.
Cass. soc., 6 févr. 2013, n° 11-11740 : Bull. civ. V, n° 27 ; v. égal. Cass. soc., 21 sept. 2016, n° 15-15165, qui vise « le droit d’accès à la justice ».
-
36.
Cass. soc., 9 oct. 2013, n° 12-17882 : Bull. civ. V, n° 226.
-
37.
Cass. soc., 28 mai 2003, n° 02-40273 : Bull. civ. V, n° 178 ; JCP G 2003, II 10128, note Corrignan-Carsin D. ; JCP G 2004, I 145, note Cesaro J.-F. ; D. 2003, Jur., p. 2718, note Guiomard F.
-
38.
Cass. soc., 23 avr. 2013, n° 12-12411 : JCP S 2013, 1279, note Passerone T. ; AJFP 2014, p. 49.
-
39.
Cass. soc., 5 mars 2014, n° 11-14426 : JCP S 2014, 1216, obs. Cailloux-Meurice L.
-
40.
Cass. soc., 15 nov. 2017, n° 16-14281.
-
41.
D. 2017, IR, p. 1923.
-
42.
Akandji-Kombé J.-F., Les obligations positives en vertu de la Convention EDH, 2006, Conseil de l’Europe, Précis sur les droits de l’Homme, n° 7, 76 p.
-
43.
Conv. EDH, art. 4.
-
44.
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 33.
-
45.
Socle européen des droits sociaux, principe 9.
-
46.
L. n° 2018-237, 3 avr. 2018, autorisant la ratification du protocole n° 16 à la convention EDH : JO n° 78, 4 avr. 2018.
-
47.
Sudre F., « Ratification de la France et entrée en vigueur du protocole n° 16, une embellie pour la Convention EDH ? », JCP G 2018, 473, p. 802-803.
-
48.
TFUE, art. 267.
-
49.
V. « Projet de textes “Filtrage des pourvois” proposés par la Cour de cassation », 26 mars 2018 : JCP G 2018, act. 381 : « Si est en cause une atteinte grave à un droit fondamental, c’est-à-dire une violation d’une intensité particulière d’un droit, d’une liberté ou d’un principe admis comme fondamentaux ».
-
50.
Lokiec P., « Pourvoi en cassation : un droit bientôt supprimé ? », Libération 24 avr. 2018, Idées, p. 22 ; v. aussi SM, USM, FNUJA, AJAC, SAF, communiqué, 13 avr. 2018 : JCP G 2018, 505.
-
51.
Rapp. C. cass. pour 2016, 2017, Paris, La documentation française, p. 316 et s., spéc. p. 336 et s.
-
52.
Cass. soc., 3 juill. 2003, nos 01-44522, 01-44717 et 01-44718 : RJS 2003, n° 1141.
-
53.
Cass. soc., 10 oct. 2006, n° 04-47623 : Bull. civ. V, n° 297 ; RJS 2006, n° 1296.
-
54.
Cass. soc., 2 févr. 2006, n° 03-47481 : RDT 2006, p. 42, note Leclerc O. ; JCP S 2006, 1700, note Olivier J.-M. – Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-20257 : Cah. soc. janv. 2016, n° 117s3, p. 29, obs. Canut F.
-
55.
Cass. soc., 2 juin 2010, n° 08-43277 : RJS 2010, n° 685 ; RDT 2010, p. 592, note Grévy M. – Cass. soc., 9 juill. 2014, n° 13-16434 : RJS 2014, n° 793.
-
56.
Cass. soc., 11 juill. 2012, n° 10-15905 : JCP S 2012, 1482, note Bossu B. ; Dr. ouvr. 2012, p. 802, note Bonnechère M.
-
57.
Cass. soc., 3 juill. 2003, n° 01-44522 : Bull. civ. V, n° 214 – Cass. soc., 12 févr. 2008, n° 07-40413 : Bull. civ. V, n° 24.
-
58.
Cass. soc., 30 sept. 2010, n° 08-44340 : RJS 2010, n° 928.
-
59.
Cass. soc., 14 déc. 2016, n° 14-21325 : RJS 2017, n° 102 ; JCP S 2017, 1057, note Leborgne-Ingelaere C.
-
60.
Tournaux S., « Indemnisation du licenciement nul et libertés fondamentales constitutionnelles », Lexbase Hebdo n° 721, 30 nov. 2017, éd. sociale.
-
61.
CJUE, 22 nov. 2005, n° C-144/04, Mangold : D. 2006, p. 557, note Leclerc O. – CJUE, 19 janv. 2010, n° C-555/07, Kücükdeveci : JCP S 2010, 1082, note Cavallini J. ; RDT 2010, p. 237, note Schmitt M. – CJUE, 19 janv. 2010, n° 555/07 : RJS 2010, n° 393, p. 257, note Lhernould J.-P.
-
62.
Cass. soc., 11 mai 2010, n° 08-45307 : RJS 2010, n° 582 – Cass. soc., 16 févr. 2011, n° 10-10465 : RJS 2011, n° 477.
-
63.
C. trav., art. L. 1235-3-1.
-
64.
Frouin J.-Y., « Quel bilan tirer de la jurisprudence 2017 de la chambre sociale, quelles perspectives pour 2018 ? », FRS 4/18.
-
65.
Cass. soc., 10 mars 2009, n° 07-44092 : JCP S 2009, 1225, note Leborgne-Ingelaere C.
-
66.
Cass. soc., 10 juin 2015, n° 13-25554 : JCP S 2015, 1345, note Leborgne-Ingelaere C. – Cass. soc., 7 févr. 2012, n° 10-18035 : JCP S 2012, 1195, note Corrignan-Carsin D. – Cass. soc., 29 sept. 2010, n° 09-42057 : JCP S 2011, 1028, note Leborgne-Ingelaere C., 1re esp. – Pour un exemple de caractérisation de la mauvaise foi, v. Cass. soc., 28 janv. 2015, n° 13-22378 : JurisData n° 2015-001120.
-
67.
C. trav., art. L. 1152-1.
-
68.
Cass. soc., 28 avr. 1988, n° 87-41804.