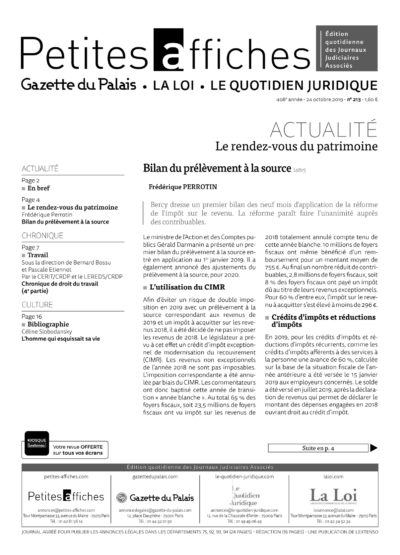Chronique de droit du travail (4e partie)
Cette nouvelle chronique de droit du travail, dirigée par le professeur Bernard Bossu et Pascale Etiennot, maître de conférences, couvre l’année 2018.
I – Droits et libertés fondamentaux
II – Relations individuelles de travail
A – Le contrat de travail
1 – Formation et exécution du contrat de travail
a – L’« ubérisation » est soluble dans le droit du travail
b – Précisions sur les péripéties liées à l’application d’une clause de mobilité géographique
2 – Rupture du CDI
a – Le contrôle administratif du PSE : entre ajustement et perfectionnement. Retour sur les décisions marquantes de l’année 2018
b – Résiliation judiciaire et protection de la maternité
3 – Les contrats spéciaux
4 – La surveillance du salarié
a – Ouverture du disque dur dénommé « données personnelles » de l’ordinateur professionnel du salarié : pas de violation de l’article 8 de la Convention EDH
b – Propos injurieux tenus sur un compte Facebook sécurisé et pouvoir disciplinaire
c – Géolocalisation des salariés : la Cour de cassation et le Conseil d’État au diapason
B – Durée du travail, salaire
1 – Rester joignable par téléphone hors du temps de travail constitue une astreinte
Cass. soc., 12 juill. 2018, n° 17-13029. Un directeur régional du pôle sud-ouest d’une société, précédemment nommé directeur d’agence, est licencié. Il saisit le conseil de prud’hommes de diverses demandes et sollicite notamment le paiement d’heures effectuées dans le cadre d’un dispositif de gestion des appels d’urgence en dehors des heures et jours de travail, dispositif pendant lequel il devait laisser en permanence son téléphone allumé.
Statuant dans cette affaire, la cour d’appel de Montpellier considère, dans un arrêt rendu le 14 décembre 2016, que le salarié était bel et bien soumis à des astreintes. Formant un pourvoi en cassation, l’employeur reproche aux juges du fond de n’avoir pas caractérisé l’obligation du salarié, de par ses fonctions, de tenir une permanence téléphonique à son domicile, invoquant ce faisant l’exigence posée par l’article 26 de la Convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation, dans sa rédaction applicable au litige et selon lequel l’astreinte est prévue « dans le cas où un salarié doit assurer une permanence téléphonique à son domicile ». De plus, l’employeur reproche à la cour d’appel de n’avoir pas respecté la lettre de l’article L. 3121-5 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige. L’enjeu est loin d’être anodin pour les parties puisque, dans cette affaire, la cour d’appel allouait pas moins de 60 000 € au salarié au titre d’astreintes.
Les juges de cassation, pour écarter les prétentions de l’employeur, retiennent plusieurs éléments importants. Notamment, un document intitulé « procédure de gestion des appels d’urgence » prévoyait que les coordonnées des directeurs d’agence étaient communiquées à la société en charge des appels d’urgence et que ces directeurs d’agence devaient en cas d’appel prendre les mesures adéquates. De plus, à partir du moment où le salarié avait été promu directeur d’agence, quoique sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, il avait l’obligation de rester en permanence disponible à l’aide de son téléphone portable pour répondre à d’éventuels besoins et devait se tenir prêt à intervenir. Ce faisant, l’astreinte était caractérisée.
Le présent arrêt mérite l’attention à un double titre. La Cour de cassation souligne en effet l’impossibilité de restreindre conventionnellement le champ de l’astreinte (I) et reconnaît la possibilité d’une astreinte hors du domicile (II).
I. L’impossible restriction conventionnelle du champ de l’astreinte
Un apport intéressant de cet arrêt consiste dans l’exclusion par la Cour d’une trop stricte application de la clause de la convention collective applicable. Rappelons que, selon l’article L. 3121-5 ancien du Code du travail, applicable aux faits de l’espèce, la période d’astreinte « est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ». Restreindre les astreintes aux seules permanences téléphoniques à domicile n’est pas validé par les juges. Notons que les astreintes effectuées par les salariés doivent donner lieu à une compensation sous forme financière ou sous forme de repos. Bien évidemment, les employeurs doivent être très vigilants quant à cette qualification car elle aboutit à distinguer le temps d’attente, ainsi compensé, et la période d’intervention, laquelle constitue du temps de travail effectif et doit être rémunérée comme tel.
En l’espèce, l’employeur considérait que ces périodes ne pouvaient pas être qualifiées d’astreinte dans la mesure où, notamment, la convention collective applicable dans l’entreprise définissait la période d’astreinte par le fait que le salarié assure « une permanence téléphonique à son domicile ». Cet argument est logiquement rejeté par la Cour de cassation. Même si le salarié n’avait pas l’obligation de rester chez lui ou à proximité, le fait de rester joignable via son téléphone, afin d’être éventuellement contacté, constituait une période d’astreinte.
Le rappel est important : une convention collective ne saurait limiter l’astreinte à la permanence téléphonique à domicile. Le champ ouvert à la négociation collective est celui de ses modalités de mise en place et d’organisation et de ses compensations1.
II. La vision étendue du lieu de l’astreinte
La Cour de cassation constate que le salarié n’était pas à disposition immédiate et permanente de son employeur mais qu’il devait être disponible et prêt à intervenir. Le fait que le salarié ne soit pas à la disposition constante de l’employeur est important. D’ailleurs, une période d’astreinte peut être requalifiée en temps de travail effectif si ce n’est pas le cas2.
En outre, cette décision est conforme à certaines rendues antérieurement par la Cour de cassation en la matière. Elle pouvait déjà considérer qu’un salarié est en astreinte dès lors qu’il peut être joint par l’employeur, notamment à l’aide d’un téléphone mobile, en vue de répondre à un appel de celui-ci pour effectuer un travail urgent au service de l’entreprise, peu important le lieu où il se trouve3. De la même manière, la qualification d’astreinte a été retenue dans un cas où l’employeur avait mis en place une « procédure d’appels urgents » l’autorisant à contacter un salarié, en dehors de ses heures de travail, pour qu’il effectue un travail urgent au service de l’entreprise4.
L’essor des moyens de communication ne peut qu’entraîner pareille solution. Limiter l’astreinte au domicile alors même que les salariés sont aujourd’hui dotés de téléphones portables connectés n’aurait pas de sens. Il est d’ailleurs à noter que, depuis la loi du 8 août 2016, le champ de l’astreinte a été étendu. Il ne se limite plus à celles effectuées au domicile du salarié ou à proximité. Désormais, aux termes de l’article L. 3121-9 du Code du travail, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ». Le domicile du salarié n’est donc plus visé par la loi. Cette modification législative s’explique aisément par les nouveaux modes de communication qui permettent de joindre une personne par téléphone portable, SMS, internet, quel que soit l’endroit où elle se trouve. À noter qu’un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut mettre en place les astreintes et fixer le mode d’organisation ; les modalités d’information ; les délais de prévenance des salariés et la compensation (financière ou en repos). À défaut d’accord, il revient à l’employeur de fixer le mode d’organisation des astreintes et leur compensation après avis du CSE et après information de l’inspection du travail5.
Pour bénéficier des contreparties financières liées à l’astreinte, le salarié doit, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Tel était le cas en l’espèce. La solution est justifiée. Elle est en outre conforme à l’idée de droit à la déconnexion instaurée depuis la loi El Khomri6.
Céline LEBORGNE-INGELAERE
2 – La caractérisation de l’abus de confiance par le salarié qui détourne son temps de travail des fins pour lesquelles il perçoit une rémunération
Cass. crim., 3 mai 2018, n° 16-86369. Dans cette affaire, un salarié d’une société commissionnaire de transport avait, avec l’aide d’une autre salariée, créé et développé une activité commerciale pour le compte d’autres sociétés pendant son temps de travail, dans les locaux de son employeur et avec les moyens téléphoniques et informatiques que celui-ci mettait à sa disposition. Il avait alors dans ce cadre détourné certains marchés, tout en cachant l’ensemble de ces faits à la société qui l’embauchait pendant plus d’une année.
Une instruction a été ouverte à son encontre des chefs d’abus de confiance, et de complicité d’abus de confiance concernant la salariée lui ayant prêté son concours. L’affaire a été renvoyée devant le ctribunal correctionnel, qui a reconnu les deux prévenus coupables des faits reprochés, jugement qui s’est vu ensuite confirmer à hauteur d’appel.
Les intéressés se sont alors pourvus en cassation. La question était alors de savoir si l’utilisation par des salariés de leur temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles ils perçoivent une rémunération constitue le délit d’abus de confiance.
Par son arrêt du 3 mai 2018, la chambre criminelle a considéré que le délit d’abus de confiance peut être constitué par l’utilisation par des salariés de leur temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles ils perçoivent une rémunération de leur employeur.
Par cette formule, la Cour de cassation entérine une acception large de l’abus de confiance (I), qui n’apparaissait pas des plus évidentes et ne s’exempte pas de critiques (II).
I. Une acception large de l’abus de confiance commis par le salarié
Selon l’article 314-1 du Code pénal, l’abus de confiance consiste en un détournement par une personne, « au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». La jurisprudence a eu l’occasion de venir préciser les contours du sens de l’expression « bien quelconque », en indiquant qu’il peut s’agir de tout bien, même incorporel7, dès lors qu’il est susceptible d’appropriation8. Pouvait dès lors légitimement se poser la question de savoir ce qu’il en était d’un détournement de « temps de travail ».
La solution retenue, qui englobe le temps de travail dans les objets susceptibles de détournement, est de nature à considérablement élargir le champ de l’incrimination, en s’affranchissant du critère de l’appropriation. L’intérêt de cette décision réside dans la confirmation d’une solution antérieure puisqu’elle s’inscrit dans la droite ligne d’un précédent rendu le 19 juin 20139, qui à l’époque avait surpris la doctrine et suscité la controverse. Les hauts magistrats avaient en effet déjà considéré en des termes quasi identiques que « l’utilisation, par un salarié, de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur constitue un abus de confiance » au sens de l’article 314-1 du Code pénal.
« La solution s’inscrit du reste dans une tendance à l’élargissement de l’objet de l’infraction, en particulier dans les situations impliquant des salariés. L’on songe notamment à l’extension du délit d’abus de confiance au détournement de la clientèle d’une société par un salarié »10.
Le présent arrêt comme son prédécesseur suscite la circonspection au regard des éléments constitutifs de l’abus de confiance. La Cour semble en effet considérer que le seul détournement du temps de travail rémunéré suffit à constituer l’élément matériel de l’infraction. Elle ne fait aucune référence directe au détournement des objets qui avaient par ailleurs été mis à disposition par l’employeur (téléphone, messagerie, locaux…). La reprise de ces éléments par la Cour aurait permis de penser plus strictement le champ d’application de l’infraction, revenant à une conception essentiellement patrimoniale de l’objet du détournement. Il n’en est rien, la chambre criminelle maintenant sa position, laquelle mérite d’être sérieusement discutée au plan de sa cohérence.
II. Une solution critiquable
Cet arrêt confirme la dilution de la patrimonialité de l’objet du détournement constituant le délit d’abus de confiance.
L’objet du détournement tel qu’il ressort de la décision peut être compris de deux manières, toutes aussi contestables l’une que l’autre.
Il pourrait d’abord s’agir de considérer que le salarié qui n’exécute pas les tâches qui lui sont confiées pendant son temps de travail rémunéré opère ipso facto un détournement de la rémunération qu’il perçoit. Une telle acception n’est que difficilement concevable, puisque l’abus de confiance suppose classiquement remise d’une chose ou valeur que l’auteur avait « acceptée à charge de la rendre, de la représenter ou d’en faire un usage déterminé ». La rémunération, contrepartie du travail fourni par un salarié, coïncide mal avec cette exigence, à plus forte raison lorsque l’on admet que la rémunération dès lors qu’elle est remise au salarié devient sa propriété exclusive.
La seule voie admissible semble dès lors de considérer que l’objet du détournement n’est pas le salaire lui-même, mais l’échelle qui permet de le quantifier, à savoir le temps de travail. Or autant il peut être admis que des choses immatérielles puissent être appropriées, fussent par le truchement d’un support physique11, autant concevoir l’appropriation juridique du temps nous paraît, à l’aune du droit de propriété en tout cas, tout à fait malvenu. Doit-on en effet rappeler que la déclaration de Philadelphie qui redéfinit les buts et objectifs de l’Organisation internationale du travail mentionne dans son article premier que « le travail n’est pas une marchandise ».
Cette conception vient par ailleurs heurter un élément caractéristique de l’abus de confiance qui permet de l’en distinguer du vol. L’abus de confiance n’est en effet en principe caractérisé que lorsque le détournement porte sur une chose préalablement remise à titre précaire à l’auteur, lequel a accepté de recevoir à charge de le rendre, de le représenter ou d’en faire un usage déterminé. Or comment peut-on raisonnablement considérer que le salarié se serait vu à titre précaire remettre par son employeur son temps de travail ou sa propre force de travail, avant de les détourner ? Non content de prendre des libertés avec le principe de légalité criminelle et le principe d’interprétation stricte de la loi pénale qui en découle, cette solution nous apparaît opérer une redéfinition dangereuse de l’objet protégé par l’infraction. Alors que le délit d’abus de confiance avait vocation à prévenir les atteintes à la propriété, le cas échéant de l’employeur, la formulation retenue par les hauts magistrats conduit à opérer un glissement vers la prévention des atteintes à la bonne exécution contractuelle, qui est certes connexe mais ouvre la porte à une potentielle répression tous azimuts des salariés. Si l’on décline le raisonnement tenu ici, il devient possible de poursuivre pour abus de confiance le salarié qui, sans aller jusqu’à développer une activité privée, prendrait des pauses excessivement longues, consulterait sa messagerie personnelle ou les réseaux sociaux privés pendant son temps de travail. Une telle déviance n’entrerait alors pas en cohérence avec la reconnaissance progressive en droit du travail d’une protection de la sphère de vie privée du salarié, y compris sur le lieu de travail. Il n’est pas non plus question d’autoriser tous les abus de la part des salariés, et d’autres sanctions plus adaptées peuvent être prises, notamment sur le terrain du droit disciplinaire en cas de violation d’une obligation professionnelle, sans qu’il ne soit nécessaire de mobiliser la répression pénale, à plus forte raison lorsque cette mobilisation implique un tel travestissement de ce que constituait jusqu’alors l’abus de confiance.
Il aurait probablement été beaucoup plus cohérent au regard de la structure de l’infraction d’asseoir la qualification non sur le détournement par le salarié de son temps de travail rémunéré par l’employeur, mais plutôt sur les moyens mis à disposition par l’employeur pendant ce temps de travail. Cette démarche n’aurait nullement empêché la répression des auteurs et complices et aurait préservé l’intégrité des éléments matériels constitutifs tels qu’ils ressortent de l’article 314-1 du Code pénal.
Loïc MALFETTES
3 – L’opposition de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires est inefficace, lorsqu’elles sont rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié
Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 17-16959 et Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 17-20659. Alors que les questions de pouvoir d’achat arrivaient au cœur des préoccupations de nos concitoyens et au moment où le politique s’interrogeait sur la suppression des cotisations sociales sur les heures supplémentaires12, la Cour de cassation était amenée à prendre parti sur la reconnaissance ou non d’heures supplémentaires effectuées par le salarié et ce malgré l’opposition de l’employeur.
Si les heures supplémentaires sont en principe accomplies à la demande explicite de l’employeur, en vertu de son pouvoir de direction, on sait aussi que la jurisprudence admettait jusqu’alors le paiement majoré pour heures supplémentaires dans deux autres grandes séries d’hypothèses.
-
Elle les reconnaît en cas d’accord implicite de l’employeur. Cette solution a été posée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 198013. Elle fut confirmée à maintes reprises depuis lors et fut encore réaffirmée récemment dans un arrêt du 12 septembre 201814. Dans cette dernière affaire, une salariée avait alerté son employeur du surcroît d’activité auquel elle devait faire face afin de pallier le départ d’une collègue non remplacée et de la nécessité d’effectuer une réorganisation du service afin de remédier à la situation. Face à l’absence de réaction de l’employeur et au surcroît de travail qui en résultait pour la salariée, cette dernière avait dû réaliser des heures supplémentaires. Selon la Cour de cassation, les heures supplémentaires induites par ce surcroît d’activité sont considérées comme réalisées avec l’accord implicite de l’employeur.
-
La Haute cour a également infléchi sa position et a ouvert un second cas. Par un arrêt du 19 avril 200015, elle a reconnu que des heures supplémentaires puissent être réalisées sans nécessité d’un accord de l’employeur lorsqu’elles sont imposées par la nature ou la quantité du travail demandé au salarié.
Les deux arrêts du 14 novembre 201816 destinés à être publiés au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation ne remettent pas en cause ces deux grandes hypothèses. En revanche, la Cour de cassation apporte des précisions utiles sur le second cas. Elle revient en premier lieu sur la rédaction et énonce que le paiement des heures supplémentaires est dû lorsqu’« elles étaient rendues nécessaires par les tâches confiées par l’employeur ». Ainsi la Cour de cassation ne renvoie plus explicitement et seulement – serions-nous tentés de dire – à la nature du travail ou à la quantité de travail, ce qui pouvait laisser penser que certaines professions étaient par nature plus exposées que d’autres aux heures supplémentaires. Elle lui substitue une formulation plus large et retient que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies lorsqu’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui sont confiées. Mais l’apport essentiel des arrêts ne réside pas exactement là. Dans les deux décisions, la Cour de cassation balaie un argument de défense fréquemment utilisé par les entreprises pour ne pas avoir à supporter de paiement majoré pour les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires. Elle pose comme règle que l’opposition de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires ne suffit pas à priver le salarié de leur paiement lorsqu’elles ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié. Dans la décision n° 17-16959, le salarié s’était engagé contractuellement à solliciter l’autorisation de l’employeur avant d’effectuer des heures supplémentaires. Un avenant à son contrat de travail avait été signé en ce sens. Par la suite, le salarié avait néanmoins persisté à effectuer des heures supplémentaires sans autorisation. Face à cette situation, l’employeur avait mis en demeure le salarié de cesser son comportement puis il l’avait sanctionné et avait refusé de les rémunérer. En réaction, le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. Malgré le non-respect de la clause contractuelle par le salarié, la cour d’appel d’Orléans a fait droit à la demande du salarié après avoir retenu que les heures supplémentaires étaient rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié. La Cour de cassation approuve cette solution.
Dans la seconde espèce (n° 17-20659), il n’existait aucun engagement contractuel sur les modalités d’accomplissement des heures supplémentaires. Toutefois, par différents courriels, l’employeur avait rappelé à un consultant qu’il devait respecter la durée légale de travail hebdomadaire de 35 heures et que l’accomplissement d’heures supplémentaires nécessitait l’accord préalable du supérieur hiérarchique. La cour d’appel de Paris avait rejeté la demande du salarié en paiement d’heures supplémentaires en arguant du fait qu’il n’avait pas « à placer l’employeur devant le fait accompli, sauf abus de sa part ce qui n’était ni établi ni même allégué ». La Cour de cassation casse cette décision, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si ces heures supplémentaires étaient rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
Ainsi, par ces deux arrêts, la Cour de cassation affirme clairement que l’opposition de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires est évincée, elle devient dépourvue d’efficacité lorsqu’elle entre en concurrence avec des heures supplémentaires rendues nécessaires eu égard à la charge de travail demandée par l’employeur. Les solutions sont dénuées d’ambiguïté. La Cour de cassation n’hésite pas à faire prévaloir la réalité du terrain sur le contrat de travail. Peu importe les exigences contractuelles fixées pour la réalisation de telles heures. Ces arrêts nous montrent que le débat judiciaire afférent à cette question continue de se déplacer sur le terrain de la charge réelle de travail. Pour autant, il faut se garder d’y voir une atteinte au pouvoir de gestion de l’employeur. La Cour de cassation ne dénie absolument pas à l’employeur le pouvoir de fixer la charge de travail, mais par ces deux arrêts elle vient éviter les abus. Nous entrevoyons dans l’arrêt n° 17-16959 que le salarié consciencieux avait déployé des efforts supplémentaires et avait travaillé au-delà de sa durée quotidienne habituelle de travail pour terminer le travail demandé. Dans la décision, il est spécifié que « le salarié a souhaité terminer en urgence les réparations au sein d’une cuisine de restaurant, qui ne pouvaient attendre, en sorte qu’il préférait achever ses réfections, le jour même, plutôt que de les reporter au lendemain, ce qui aurait vivement déplu aux clients et qui l’aurait contraint à rester une journée supplémentaire sur place ». Par ses solutions, la Cour de cassation signifie à l’employeur qu’il est en droit d’attendre un travail réaliste et réalisable de son salarié au cours d’une journée de travail, c’est-à-dire un travail réalisable sans prouesse exceptionnelle mais qu’il doit en même temps être prudent dans ces attentes et ne peut exiger une démesure du travail de son salarié ou qu’il fournisse une charge exorbitante. L’employeur doit être vigilant pour évaluer correctement la charge de travail de ses collaborateurs. Sans grande surprise, la Cour de cassation renvoie aux juges du fond le soin d’apprécier si la charge est réaliste. Dans la décision du 14 novembre 2018 (n° 17-16959), ces derniers ont relevé que le fait que l’employeur ait accepté de rémunérer des heures supplémentaires pour la période de mai à décembre 2012 et le fait que la charge de travail du salarié ait été maintenue puis accrue pendant la période postérieure rendaient nécessaire la réalisation de nouvelles heures supplémentaires par les tâches confiées à l’intéressé. Si la surcharge de travail demandé ne faisait pas de doute dans la présente affaire, il va sans dire que la ligne de partage ne sera pas toujours aisée à déterminer en pratique.
De fait, l’employeur est désormais placé devant différents choix, soit il adapte en amont la charge de travail de ses salariés afin que ceux-ci ne dépassent pas la durée légale hebdomadaire de travail, soit il rémunère les heures supplémentaires ou plus négativement pour les salariés, l’entreprise peut encore démontrer que les missions confiées pouvaient être réalisées dans le temps normalement imparti. Enfin, lorsque l’activité même de l’entreprise est connue comme étant irrégulière, il lui reste la voie de l’aménagement du temps de travail mais ce sont des règles autres qui s’imposeront à l’entreprise.
Cette jurisprudence n’est pas sans présenter une forte ressemblance avec les solutions adoptées en matière de contreparties versées au salarié pour les temps consacrés aux opérations d’habillage et déshabillage. La Cour de cassation retient, en ce domaine, que si l’obligation de se changer à l’intérieur de l’entreprise (génératrice de contreparties obligatoires) naît le plus fréquemment d’une décision de l’employeur, elle peut également résulter de circonstances de faits17. La Haute cour privilégie la prise en compte des circonstances de fait sur la décision de l’employeur.
Pascale ETIENNOT
C – Santé et sécurité au travail
Responsabilité ordinale d’un médecin du travail pour avoir établi un certificat médical sans avoir constaté personnellement le lien entre l’état de santé du salarié et ses conditions de travail
CE, 6 juin 2018, n° 405453. Dans cette affaire, un médecin du travail avait rédigé un certificat médical en faveur d’un salarié, relatif à des faits qui s’étaient déroulés 7 mois plus tôt, époque à laquelle le salarié travaillait sur un autre site de la société (dans lequel le médecin n’intervenait pas). Dans le cadre d’une action prud’homale, le salarié a produit ce certificat qui faisait mention d’un « enchaînement délétère de pratiques maltraitantes » de la part de son employeur. S’estimant lésé par ce certificat, ce dernier a porté plainte contre le praticien devant la chambre disciplinaire du Conseil régional de l’ordre des médecins. L’employeur a fait valoir qu’en établissant ce certificat, le médecin avait méconnu ses obligations déontologiques relatives d’une part à l’interdiction de délivrer un certificat de complaisance ou tout rapport tendancieux18 et d’autre part l’établissement de certificats conformément aux constatations médicales19.
Le praticien se voit sanctionné par un avertissement en première instance. Cette sanction sera confirmée en appel par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins puis par le Conseil d’État. Avant de s’assurer du bien-fondé de la sanction infligée au regard des principes déontologiques (II), les juges administratifs reviennent d’abord sur la recevabilité de la plainte déposée par un employeur à l’encontre d’un médecin du travail devant le conseil de l’ordre (I).
I. La recevabilité d’une plainte déposée par l’employeur
Le Code de la santé publique20 fixe une liste de certaines personnes autorisées à introduire une action disciplinaire contre un médecin, devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil de l’ordre, parmi lesquelles figurent, « notamment », les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé…
La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins avait indiqué en 2014 que cette liste de personnes habilitées à déposer plainte contre un médecin devant l’ordre des médecins n’était pas limitative, du fait du terme « notamment »21. Ainsi, toute personne, lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques, a la faculté d’introduire une telle action.
Par conséquent, un employeur, qui n’est certes pas expressément visé par la liste, mais qui parvient à démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain par l’établissement d’un certificat ou une attestation d’un médecin du travail, est légitime à déposer une plainte disciplinaire à son encontre. Cette solution a été soutenue pour la première fois par le Conseil d’État en 201722.
Dans son arrêt du 6 juin 2018, la haute juridiction administrative fournit une nouvelle illustration de ce principe en apportant en plus deux précisions. D’abord, le Conseil d’État prend le soin d’indiquer que la faculté pour un employeur de porter une action disciplinaire n’a pas pour effet d’imposer au praticien poursuivi de méconnaître le secret médical23 pour assurer sa défense ou de limiter son droit à se défendre24. En outre, une autre difficulté était soulevée dans cette affaire, puisque le médecin du travail concerné exerçait ses fonctions dans une entreprise chargée de missions de service public. Or, selon le Code de la santé publique25, seuls le ministre chargé de la Santé, le représentant de l’État dans le département, le procureur de la République ou le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peuvent traduire devant la chambre disciplinaire de première instance les médecins chargés d’un service public. Toutefois, le Conseil d’État rappelle que la délivrance par un médecin du travail d’un certificat médical à un salarié dans une telle entreprise ne revêt pas le caractère d’un acte de fonction publique accompli par un médecin chargé d’un service public26.
La plainte de l’employeur étant donc bien recevable, il revenait ensuite au conseil de l’ordre d’apprécier le respect des obligations déontologiques qui s’imposent au médecin du travail.
II. Le respect des obligations déontologiques par le médecin du travail
Les obligations déontologiques résultant du Code de la santé publique27 s’imposent aux médecins du travail comme à tout médecin, y compris dans l’exercice des missions qui leur sont confiées par le Code du travail28.
Dans cette espèce du 6 juin 2018, le Conseil d’État rappelle que, pour se prononcer sur le manquement, ou non, du médecin à ses obligations déontologiques, il est nécessaire de tenir compte des conditions dans lesquelles le praticien exerce. Or, le rôle du médecin du travail, essentiellement préventif, consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail29. À cette fin, il est doté d’un droit de libre accès aux lieux de travail30 afin d’y réaliser toute visite à son initiative dans son objectif de suivre la santé et la sécurité des salariés au travail.
Dès lors, la rédaction d’un certificat par un médecin du travail prenant parti sur le lien entre l’état de santé d’un salarié et ses conditions de vie et de travail dans l’entreprise n’est pas, par elle-même, de nature à méconnaître les règles déontologiques31. Toutefois, pour établir un tel certificat, le médecin est tenu de prendre en considération des constats qu’il a personnellement opérés, tant sur la personne du salarié que sur son milieu de travail. C’est ainsi que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a déjà approuvé par le passé le droit pour le médecin du travail d’attester d’un lien entre une souffrance et les conditions de travail. Le praticien, qui ne se bornait pas à faire siennes les déclarations du salarié, se fondait en effet sur la connaissance personnelle qu’il avait acquise des conditions de travail dans l’entreprise32.
En l’occurrence dans l’arrêt du 6 juin 2018, le médecin du travail, qui reprochait notamment à l’entreprise des « pratiques maltraitantes », n’exposait pas les faits qu’il aurait lui-même constatés ; et ce d’autant plus qu’il ne connaissait pas le site sur lequel travaillait le salarié. Par conséquent, en se basant sur des faits qu’il n’avait pas personnellement observés pour établir un certificat, le médecin du travail a bien méconnu ses obligations déontologiques.
Céline CZUBA
D – Le contentieux du travail
CPH de Nice : 1 – tribunal du travail de Monaco : 0
Cass. soc., 5 déc. 2018, n° 17-19935
Faits. L’arrêt prononcé par la chambre sociale de la Cour de cassation le 5 décembre 201833 traite de la situation rencontrée par un masseur-kinésithérapeute qui a exercé ses fonctions au profit d’un célèbre club de football monégasque. Dans cette espèce, la chambre sociale avait à trancher un litige ayant trait à la détermination de la juridiction compétente visant un contentieux individuel du travail. En soi, cette situation ne posait pas grande difficulté. Cependant, l’originalité de cette décision réside notamment dans le fait que, pour la première fois, la chambre sociale de la Cour de cassation donne application aux nouvelles dispositions issues du règlement européen du 12 décembre 201234.
Fondement juridique. Entre en lice le règlement du 12 décembre 2012 dédié à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dans l’Union européenne. Ce dernier vient à la suite du règlement Bruxelles I du 20 décembre 200035, succédant lui-même, dans une certaine mesure, à la convention de Bruxelles du 27 septembre 196836 d’où il tire son surnom. Globalement, le règlement du 12 décembre 2012 « codifie » la jurisprudence prononcée par la Cour de justice de l’Union européenne sur le fondement du règlement Bruxelles I. L’arrêt du 5 décembre 2018 donne quelques précisions sur les conditions d’applicabilité de ce texte rénové.
Tout d’abord, sur le champ d’application temporel, il sera relevé que ledit règlement est applicable « à partir du 10 janvier 201537 ». Plus précisément, l’événement à prendre en considération se rapporte non pas au contrat de travail38 – comme cela peut être le cas pour la détermination de la loi applicable au contrat de travail international39 – mais à la date de l’introduction de l’instance. En somme, le règlement est applicable aux actions judiciaires introduites « à partir du 10 janvier 2015 ». Avant cette date, le règlement du 20 décembre 2000 demeure temporellement applicable.
Ensuite, quant au champ d’application territorial, le texte est applicable sous réserve que le défendeur soit domicilié sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne. En l’espèce, le club monégasque ayant son domicile sur le Rocher, force est de constater que ladite condition n’est pas remplie. Toutefois, l’article 6 du règlement prévoit une exception à la condition de la domiciliation du défendeur. Selon cette disposition, « si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, § 1, de l’article 21, § 2, et des articles 24 et 25 ». Or, l’article 21, § 2 – situé dans la section 5 du règlement consacré aux conflits individuels du travail constituant une « section autonome, un système de compétence fermé »40 – correspond à la situation rencontrée en l’espèce. Cette disposition énonce qu’« un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait devant les juridictions d’un État membre conformément au paragraphe 1, point b) ». Ce faisant, le paragraphe 2 de l’article 21 du règlement renvoie aux règles classiques de la détermination de la juridiction compétente en matière de contrat individuel de travail avec quelques restrictions. En effet, dans l’hypothèse où l’employeur « n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre41 », il peut être attrait devant deux sortes de juridictions. Premièrement, peut être saisie « la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail42 ». Deuxièmement, il peut être présenté « lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur43 ». En revanche, dans la même hypothèse où l’employeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la saisine de la juridiction du lieu de domicile du défendeur est exclue.
En l’espèce, la principauté de Monaco est un État qui n’est pas membre de l’Union européenne même si cette cité-État est liée à la France44 par un traité conclu le 24 octobre 2002 qui adapte le cadre juridique aux réalités d’aujourd’hui, remaniant de la sorte le traité antérieur du 17 juillet 1918.
Solution. In fine, la chambre sociale de la Cour de cassation énonce, sur ce fondement, qu’« un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait, dans un État membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ». Sur cette base, la chambre sociale entérine l’appréciation des juges du fond selon laquelle le contrat de travail a été principalement exécuté sur le sol français. À cet égard, il a été relevé que, certes, le salarié « exerçait ses fonctions de masseur-kinésithérapeute, essentiellement lors d’entraînements, au centre de formation du club, auquel il était contractuellement rattaché, qui se trouvait sur le territoire français, dans la commune de la Turbie, laquelle est située dans le ressort », mais « qu’un nombre important de rencontres sportives auxquelles [le salarié] a pu participer se déroulaient sur le territoire français, [et] que la circonstance que des matchs requérant la présence [du salarié] se sont déroulés au stade Louis II, à Monaco, n’infirme pas la constatation selon laquelle l’essentiel de la prestation de travail a été réalisée sur le territoire français ». D’où la reconnaissance de la compétence juridictionnelle au profit du juge français, à savoir du conseil de prud’hommes de Nice.
Appréciations. La chambre sociale a-t-elle pris des libertés avec la notion de « lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail » ?
De prime abord, on pourrait le penser : ce salarié – masseur-kinésithérapeute – n’est-il pas rattaché à un club sportif implanté sur un Rocher d’un peu plus de 8 km2 souverain vis-à-vis de la France ?
La chambre sociale ne nous a-t-elle pas habitués à retenir comme lieu de travail – au titre du centre effectif des activités45 – le lieu de l’entraînement s’agissant d’un sportif professionnel46 ou du lieu de retour après chaque transport pour le chauffeur routier47 ?
On pourrait le penser.
Cependant, ce serait faire fi de la réalité de l’activité professionnelle de l’intéressé qui comporte de nombreux déplacements dans leur très grande majorité sur le territoire français. C’est cette appréciation réaliste qui amène la chambre sociale à entériner la compétence du conseil de prud’hommes de Nice au détriment des juridictions monégasques.
Ceci étant dit, peut-on considérer que le juge de cassation français a opéré un tour de passe-passe interprétatif pour donner compétence aux juridictions nationales ? Pour notre part, les décisions les plus récentes nous semblent montrer une mise en œuvre objective des règles de conflits de juridictions par la haute juridiction française. À cet égard, il n’y a pas loin à chercher. Un arrêt rendu le même jour par la même juridiction48 estime que « l’article 14 du Code civil n’ouvre au demandeur français qu’une simple faculté et n’édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence d’un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n’est pas frauduleux ». En d’autres termes, elle reconnaît qu’une juridiction étrangère – en l’occurrence une juridiction monégasque – est compétente pour statuer sur un contrat de travail conclu par un français à l’étranger. Pourtant, dans une optique malicieuse, le privilège de juridiction de l’article 14 du Code civil aurait pu, au contraire, fonder la compétence du juge français.
Jean-Philippe TRICOIT
(À suivre)
III – Relations collectives de travail
A – La définition de l’établissement distinct après les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 : la fin de l’approche fonctionnelle
B – Parité femmes-hommes : application effective pour les syndicats
C – Revirement de jurisprudence à propos de l’assiette de calcul des subventions et contributions du comité d’entreprise
D – Contestation de la régularité de la désignation de l’expert-comptable du comité d’entreprise
Notes de bas de pages
-
1.
C. trav., art. L. 3121-7 dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce. L’article L. 3121-11 vise aujourd’hui le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
-
2.
Concernant un gardien de musée qui ne pouvait sortir de l’établissement que sur autorisation de son supérieur : Cass. soc., 17 sept. 2015, n° 14-11940.
-
3.
Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-27971, F-D.
-
4.
Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-14919, F-D.
-
5.
C. trav., art. L. 3121-11 et C. trav., art. L. 3121-12.
-
6.
C. trav., art. L. 2242-17.
-
7.
Cass. crim., 14 nov. 2000, n° 99-84522 : RSC 2001, p. 385, obs. Ottenhof R. ; RTD civ. 2001, p. 912, obs. Revêt T. ; où il avait été retenu que le détournement d’un numéro de carte bancaire pouvait consommer le délit.
-
8.
Cass. crim., 16 nov. 2011, n° 10-87866 : AJ pénal 2012, p. 163, obs. Lasserre Capdeville J. ; RSC 2012, p. 169, obs. Francillon J.
-
9.
Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-83031 : D. 2013, p. 1936, note Beaussonie G. ; D. 2013, p. 2713, obs. Roujou de Boubée G., Garé T., Gozzi M.-H., Mirabail S. et Potaszkin T. ; RDT 2013, obs. Malabat V. ; AJ pénal 2013, p. 608, obs. Gallois J. ; Dr. soc. 2013, p. 1008, étude Saenko L. ; RDT 2013, p. 767, obs. Malabat V. ; RSC 2013, p. 813, chron. Matsopoulou H. ; RTD com. 2013, p. 600, obs. Bouloc B. ; JCP S 2014, 1128, note Duquesne F. ; JCP G 2013, 933, note Détraz S. ; Gaz. Pal. 15 oct. 2013, n° 150b1, obs. Dreyer E. ; RDC 2013, p. 1479, obs. Ollard R. ; Dr. pén. 2013, comm. 158, obs. Véron M. ; Rev. pénit. 2013, p. 650, obs. Conte P.
-
10.
Cass. crim., 22 mars 2017, n° 15-85929.
-
11.
L’on songe ici à l’extension de l’abus de confiance au détournement du numéro de carte bancaire ou encore d’une clientèle de société par un salarié, v. arrêts précités.
-
12.
À l’époque où les arrêts furent rendus, la défiscalisation des heures supplémentaires était exclue. C’est au soir du 10 décembre 2018 que le président de la République a annoncé à la fois la défiscalisation et la désocialisation des heures supplémentaires. Cette annonce fut traduite dans la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales publiée au Journal officiel du 26 décembre 2018. Elle acte l’exonération de charges salariales des heures supplémentaires dès le 1er janvier 2019 et leur exonération d’impôt sur le revenu jusqu’à 5 000 € par an, majorations incluses. Le nouveau texte modifie les dispositions qui figurent à l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
-
13.
Cass. soc., 20 mars 1980, n° 78-40979.
-
14.
Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 17-15924.
-
15.
Cass. soc., 19 avr. 2000, n° 98-41071.
-
16.
Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 17-16959 et Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 17-20659.
-
17.
Cass. soc., 21 nov. 2012, n° 11-15696 : RJS 2013, n° 130 – Cass. soc., 20 déc. 2017, n° 16-22330 : JSL, n° 449.
-
18.
CSP, art. R. 4127-28.
-
19.
CSP, art. R. 4127-76.
-
20.
CSP, art. R. 4126-1, 1°.
-
21.
Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, 15 mai 2014, n° 11843.
-
22.
CE, 11 oct. 2017, n° 403576.
-
23.
CSP, art. L. 1110-4.
-
24.
Conv. EDH, art. 6.
-
25.
CSP, art. L. 4124-2.
-
26.
En 2016, le Conseil d’État avait également précisé que le médecin du travail qui délivre un certificat d’inaptitude n’exerçait pas une mission de service public, nonobstant le contexte de souffrance au travail et la menace d’un salarié de se suicider : CE, 10 févr. 2016, n° 384299.
-
27.
Notamment ici CSP, art. R. 4127-28 et CSP, art. R. 4127-76.
-
28.
Titre II du Livre VI de la Partie IV dédiée à la santé et la sécurité au travail.
-
29.
C. trav., art. L. 4622-3.
-
30.
C. trav., art. R. 4624-3.
-
31.
À savoir, l’interdiction de délivrer un certificat de complaisance ou tout rapport tendancieux et l’établissement de certificats conformément aux constatations médicales.
-
32.
Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, 15 mai 2014, n° 11843.
-
33.
Cass. soc., 5 déc. 2018, n° 17-19935 : JCP S 2019, 1009, note Lhernould J.-P.
-
34.
Règl. (UE) n° 1215/2012, 12 déc. 2012 (refonte) : JOUE L 351, 20 déc. 2012, p. 1 ; v., pour une présentation, Nord N., « Refonte du règlement Bruxelles I et protection du travailleur », JCP S 2014, 1488.
-
35.
Règl. (CE) n° 44/2001 du Cons., 22 déc. 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale : JOCE L 012, 16 janv. 2001, p. 1-23.
-
36.
Convention du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
-
37.
Règl. (UE) n° 1215/2012, art. 66.
-
38.
V. not. Cass. soc., 31 janv. 2007, n° 05-44203 : Bull. civ. V, n° 17 – dans le même sens, Cass. soc., 5 janv. 2011, n° 08-42795, D.
-
39.
Règl. (CE) n° 593/2008 du PE et du Cons., 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) : JOCE L 177, 4 juill. 2008, p. 6-16 – ainsi que la convention n° 80/934/CEE sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 : JOCE L 266, 9 oct. 1980, p. 1-19.
-
40.
Jault-Seseke F., « Contrat de travail international », Rép. trav. Dalloz, § 36.
-
41.
Règl. (UE) n° 1215/2012, art. 21, § 2.
-
42.
Règl. (UE) n° 1215/2012, art. 21, § 1er, b, i.
-
43.
Règl. (UE) n° 1215/2012, art. 21, § 1er, b, ii.
-
44.
V., pour un historique, Duhamel J., « Le statut international de Monaco », Le Monde diplomatique, avr. 1959, p. 5.
-
45.
Pour les bases de cette notion, v. CJCE, 9 janv. 1997, n° C-383/95, Petrus Rutten.
-
46.
Cass. soc., 3 déc. 2008, n° 06-45117, D ; dans le même sens, Cass. soc., 25 avr. 2007, n° 05-43392, D.
-
47.
Par ex., Cass. soc., 20 sept. 2006, n° 05-40490 : Bull. civ. V, n° 277, p. 263.
-
48.
Cass. soc., 5 déc. 2018, n° 17-19820, F-PB : JCP S 2019, 1016, note Brissy S.