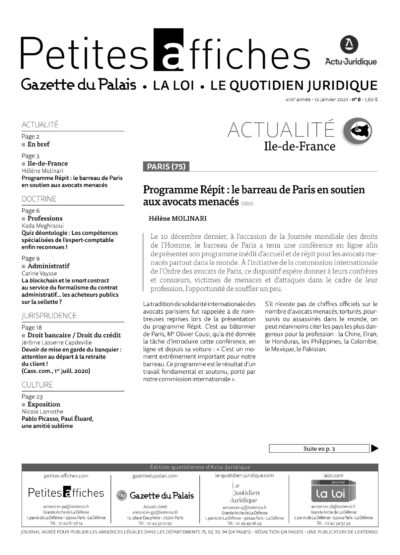La blockchain et le smart contract au service du formalisme du contrat administratif… les acheteurs publics sur la sellette ?
Le développement du « tout démat’ » est un de ces phénomènes technico-juridiques qui ébranle les pratiques. La commande publique se trouve ainsi soumise à une exigence globale de dématérialisation impliquant la mise en place de procédés de gestion interfacés et interconnectés. C’est dans ce contexte que les étapes procédurales de l’achat public se trouvent peu à peu appréhendées par l’économie du logiciel et de l’algorithme. Or en cette période de bouleversement des méthodes de travail, il apparaît intéressant de s’attarder sur la blockchain et le smart contract en droit du contrat administratif. Surtout, il convient de prendre acte d’une évolution face à laquelle le droit, et notamment le droit du contrat administratif, ne sortiront pas indemne. La blockchain et le smart contract, loin d’être antagonistes au droit administratif, jugé parfois trop empreint de formes et de lourdeurs procédurales, viennent au contraire embrasser ces caractéristiques dans une logique de rationalisation conforme avec l’esprit de la nouvelle gestion publique.
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Cette citation de Rabelais illustre parfaitement le paradoxe d’une évolution sans limite des technologies du numérique et de l’intelligence artificielle dont il est incontestable que la conscience, propre de l’espèce humaine, fait défaut1. L’évolution est d’une telle ampleur qu’elle côtoie la crise ; la crise du système précédent. À ce sujet, il convient de rappeler après Thomas Samuel Kuhn que « toutes les crises commencent par l’obscurcissement du paradigme et par un relâchement consécutif des règles de la recherche normale »2. Pour l’auteur, leur issue peut se résumer en trois hypothèses : soit le postulat de base se relève in extremis, soit le problème non résolu est mis de côté, soit un nouveau paradigme apparaît. En matière contractuelle, Jean-Pascal Chazal s’appuie sur l’œuvre de Thomas Samuel Kuhn et explique qu’une crise se manifeste lorsque le paradigme dominant se voit concurrencé par « de nouvelles hypothèses [qui] sont émises et peuvent conduire, après être passées par une phase hostile de marginalisation, à une révolution scientifique par l’avènement d’un nouveau paradigme »3. N’y faisant pas exception, le droit administratif fait l’objet d’un renouvellement permanent4, laissant présager de la « déstabilisation d’un système de pensée juridique »5.
Ce mouvement scientifique permanent et global affecte le contrat administratif à plus d’un titre et particulièrement si l’on s’intéresse au « tout démat’ » dont le dogme trouve une légitimité toute faite dans la crise sanitaire actuelle. La commande publique est d’une part soumise à un phénomène global de dématérialisation imposé et dans cet objectif, fait l’objet progressivement d’une gestion interfacée et interconnectée. D’autre part, les étapes procédurales de l’achat public se trouvent peu à peu appréhendées par l’économie du logiciel et de l’algorithme. Il serait ainsi tentant de céder aux sirènes de l’automatisation numérique en matière juridique, et ainsi de rationaliser encore davantage l’achat public – dès sa genèse cette fois-ci – et pourquoi pas… se passer du juriste-acheteur public ! C’est alors avec une acuité particulière en cette période de bouleversement des méthodes de travail qu’il apparaît intéressant de s’attarder sur la blockchain et le smart contract6 en droit du contrat administratif eu égard à tous les fantasmes7 qu’ils peuvent susciter en terme de gouvernance par les nombres8. Surtout, il convient de prendre acte de cette évolution de laquelle le droit, et notamment le droit du contrat administratif, ne sortira pas indemne dans un mouvement non pas tant de révolution que d’adaptation. La blockchain, loin d’être antagoniste au droit administratif, jugé parfois trop empreint de formes9 et de lourdeurs procédurales, vient au contraire embrasser ces caractéristiques dans une logique de rationalisation conforme avec l’esprit de la nouvelle gestion publique. À ce titre, la blockchain et le smart contract s’insèrent dans la vie du contrat et, plus généralement, dans la technique juridique, cette activité volontaire10 qui, « partant des données naturelles acquises, tendra à les mettre en œuvre, les transformer ou les assouplir, de façon à les modeler sur les besoins mêmes de l’ordre juridique, pour lequel elles sont destinées »11. Caractéristiques d’une rencontre entre technique juridique contractuelle et technique informatique dont les rapports restent à définir, la blockchain et le smart contract en droit du contrat administratif constituent ainsi des outils au service de la technique contractuelle (I) tandis que la technique contractuelle reste incontestablement au fondement de leur développement (II).
I – La blockchain et le smart contract au service de la technique contractuelle
Le contrat est un acte à procédures, le contrat administratif encore plus. Sa conclusion suppose l’intervention de nombreuses étapes pour lesquelles la manifestation formelle est déterminante. En ce qui concerne le contrat soumis au Code de la commande publique, il est possible de mentionner l’expression du besoin, l’offre, la vérification des qualités de celle-ci, son analyse objective sur la base de critères prédéterminés ou encore l’acceptation. Son exécution recèle également de moments-clés qu’il s’agisse de délais d’exécution et de garantie ou encore de délais de paiements pour le respect desquels un traitement est prévu ab initio. Or le développement de procédés de gestion informatique et automatique dans tous les domaines de l’activité économique mêlé au processus de dématérialisation de l’achat public invite à s’intéresser à la blockchain et au smart contract (A) en tant qu’avatars du formalisme du contrat administratif (B).
A – Le développement de la blockchain et du smart contract
Le smart contract découle d’un phénomène apparu à partir de la seconde moitié du XXe siècle avec le développement de l’« automation »12, et concrètement l’automatisation des moyens de production. Sa consécration en qualité d’algorithme intervenant dans la sphère contractuelle est généralement attribuée en doctrine à l’article de Nick Szabo paru en 199713 développant une conception automatisée et sécurisée informatiquement des opérations contractuelles. Le perfectionnement du smart contract donne ensuite lieu par implémentation à la constitution de blockchains – sortes de systèmes publics ou privés au sein desquels gravitent ces smart contracts –, ensembles algorithmiques au premier rang desquels figurent notamment dans le secteur financier la cybermonnaie, monnaie cryptée et hors réseau bancaire du bitcoin14 ou encore de l’Ethereum. Le système de la blockchain est complexe et fait intervenir différents acteurs – les « mineurs » – garants de la confiance des utilisateurs de la chaîne qui procèdent à des opérations de vérification et de validation des transactions. Ces transactions étant généralement émises au moyen de clés privées réceptionnées par le destinataire via une clé publique donnent lieu, après vérification des acteurs de la chaîne via le « minage » et notamment au niveau des « nœuds miniers », à la publication sur la blockchain. Le passage des nœuds se matérialise par la constitution de blocs et l’opération se réalise progressivement dans une chaîne de blocs, la blockchain15. Ainsi que l’expliquent Yves Moreau et Chloé Dornbierer, la blockchain caractérise l’enregistrement dans un réseau de transactions en blocs reliées entre elles dans une chaîne numérique dotée de qualités en termes de sécurité juridique (authentification par signature électronique, horodatage, caractère inaltérable et infalsifiable des données) et organisant un circuit doté d’une « empreinte cryptographique » propre et unique16. La blockchain bouleverse les pratiques : comme l’explique Mustapha Mekki, elle permet la circulation et le stockage sécurisés de données en vue de la réalisation d’opérations sur un système automatisé ne faisant – en principe et dans sa version la plus aboutie – pas intervenir de « tiers de confiance »17. Son développement concerne au premier titre les opérations financières et plus précisément la cybermonnaie18. L’ordonnance du 28 avril 201619, par création de l’article L. 223-12 du Code monétaire et financier, prévoit par exemple l’inscription de l’émission et de la cession de minibons, bons de caisse dématérialisés, via un « dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant l’authentification de ces opérations », autrement dit, une blockchain. Plus globalement, le système de la blockchain apparaît comme une réalité technico-financière qu’il convient d’encadrer juridiquement. À cet effet, la loi du 9 décembre 2016 dite loi Sapin II20 a entendu habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relatives aux « titres financiers et aux valeurs mobilières afin de permettre la représentation et la transmission, au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé, des titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d’un dépositaire central, ni livrés dans un système de règlement et de livraison d’instruments financiers » (art. 120). Caractéristique de son développement, une définition de la blockchain est proposée dans le Vocabulaire de l’informatique publiée au Journal officiel du 23 mai 2017 en référence à un « mode d’enregistrement de données produites en continu, sous forme de blocs liés les uns aux autres dans l’ordre chronologique de leur validation, chacun des blocs et leur séquence étant protégés contre toute modification ». Plus récemment, la loi PACTE du 22 mai 201921, par création notamment des articles L. 552-1 à L. 552-7 du Code monétaire et financier, est venue réglementer l’offre au public de jetons définis à l’article L. 552-2 comme « tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé » et précise la notion d’actifs numériques à l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier.
Au-delà du secteur de la finance, il semble que les processus de dématérialisation, d’automatisation, d’interconnexion des objets du quotidien – de distanciation sociale ? – ouvrent des perspectives infinies à l’algorithmisation, au premier rang desquelles figure le commerce juridique. En matière contractuelle en effet, chacun des usages de la blockchain trouve une potentielle application, qu’il s’agisse de la transmission de monnaies participant à la réalisation des paiements, de la sécurisation des informations par conservation et horodatage ou de la mise en place de smart contracts par automatisation des étapes de la vie d’un contrat22. Le smart contract peut potentiellement se développer dans le cadre de blockchains contractuelles en tant qu’« automates numériques » concourant à la réalisation d’obligations préprogrammées23 incluses dans un vrai contrat, dit contrat fiat.
Intéressant la technique contractuelle, le smart contract consiste en un « algorithme de gestion des opérations contractuelles »24 ou, autrement dit, « un programme informatique qui établit des règles de calcul (…) composé d’une série de conditions d’exécution qui déclenchent des actions dès que les conditions sont remplies »25. Toutefois, le smart contract, malgré son appellation, n’est pas le contrat mais il l’accompagne car ce sont les différents moments de la vie du contrat susceptibles d’automatisation qui sont appréhendés par ce premier26. Néanmoins, le changement de paradigme est notable. Comme le souligne Jean-Christophe Roda, « le smart contract serait intelligent, ce qui semble induire que le contrat classique ne le serait pas »27. Une nouvelle représentation de la technique contractuelle se dégage ici, empreinte de qualités qui rappellent beaucoup les trois « E » : efficacité, efficience, économie, dont on peut légitimement se demander si elles sont en capacité de concurrencer les principes législatifs du droit de la commande publique fraîchement consacrés à l’article L. 3 de son code. En d’autres termes, la blockchain et son corollaire, le smart contract, peuvent-ils se substituer au formalisme du contrat de la commande publique ?
B – La blockchain et le smart contract, avatars du formalisme du contrat administratif ?
Fréquemment, le formalisme en droit administratif est appréhendé en termes de lourdeur, de contrainte et d’absence de modernité ; tandis que cette dernière notion est davantage l’apanage de l’automaticité, l’interconnexion, l’instantanéité, etc. Pourtant, appréhendé à la lumière de la blockchain, le formalisme du contrat administratif pourrait se révéler formidablement moderne. Si l’on s’intéresse aux contrats soumis au Code de la commande publique, force est de reconnaître que l’apologie du « tout démat’ » s’accorde parfaitement avec le smart contract et la blockchain. Lors de la conclusion du contrat, de nombreuses phases procédurales, aujourd’hui dématérialisées, pourraient être appréhendées à l’aune des smart contracts intégrant ainsi une blockchain administrative. Tel est le cas par exemple, de la candidature à un marché public faisant intervenir la remise de nombreux documents (attestations fiscales et sociales, déclaration sur l’honneur de non-exclusion de la commande publique, chiffre d’affaires, attestations diverses témoignant de la capacité technique de l’opérateur économique, etc.) dont l’analyse est moins substantielle que formelle et objective, pour se résumer globalement au contrôle de l’authenticité et de la date des justificatifs voire de leur conformité avec des exigences exactes prédéterminées. De même lors de l’exécution, l’intervention de sanctions telles que les pénalités de retard pourraient dans l’absolu faire l’objet d’un traitement automatisé établi sur la dialectique « if… then… » suivant lequel le constat d’un retard d’exécution entraîne de facto l’application des pénalités. C’est également la libération de la retenue de garantie dans les marchés publics qui doit intervenir en principe dans un délai de 30 jours suivant le terme de la garantie de parfait achèvement, conformément à l’article R. 2191-35 du Code de la commande publique.
L’intérêt, et non le moindre, est une vision « smart contractualisée » des procédures administratives se mesurant en un gain de temps28 mais également de sécurité juridique puisque les données qui entrent dans la blockchain deviennent infalsifiables et indélébiles29. En effet, l’intégration d’une procédure dans ce type de système algorithmique permet d’une part d’horodater de façon certaine la remise de documents – délais aux sujets desquels on sait que le droit de la commande publique est exigeant. Elle permet d’autre part de garantir le respect du principe de transparence par son caractère généralement public et d’authentifier au cours du passage d’un block à l’autre les documents remis dans le cadre des procédures de mise en concurrence. La blockchain et le smart contract sont ainsi étonnamment reproductibles de leur milieu d’origine postulant d’une finance sans État, au droit de la commande publique. Ils deviennent ainsi des garants incorporels et digitalisés du respect des principes de la commande publique, et principalement du principe d’égalité grâce à l’automatisation du traitement et du principe de transparence, ce système informatisé étant intégralement traçable. Plus généralement, ces technologies sont susceptibles de contribuer à l’efficacité de la commande publique et à la bonne utilisation des deniers publics30. L’algorithme appliqué au formalisme du contrat administratif présente ainsi des qualités tenant à la satisfaction des exigences du commerce juridique et plus spécifiquement, au respect du droit de la commande publique en termes de « vitesse accrue, meilleure efficacité et certitude que le contrat sera exécuté comme convenu »31. Plus encore, une blockchain suffisamment étendue mettant en application autant de smart contracts que d’étapes procédurales dans la vie d’un contrat administratif fiat postule d’une logique de rationalisation au sein d’un système (la chaîne) dématérialisé et pourrait concourir à la cohérence d’ensemble du démat’-formalisme du contrat administratif.
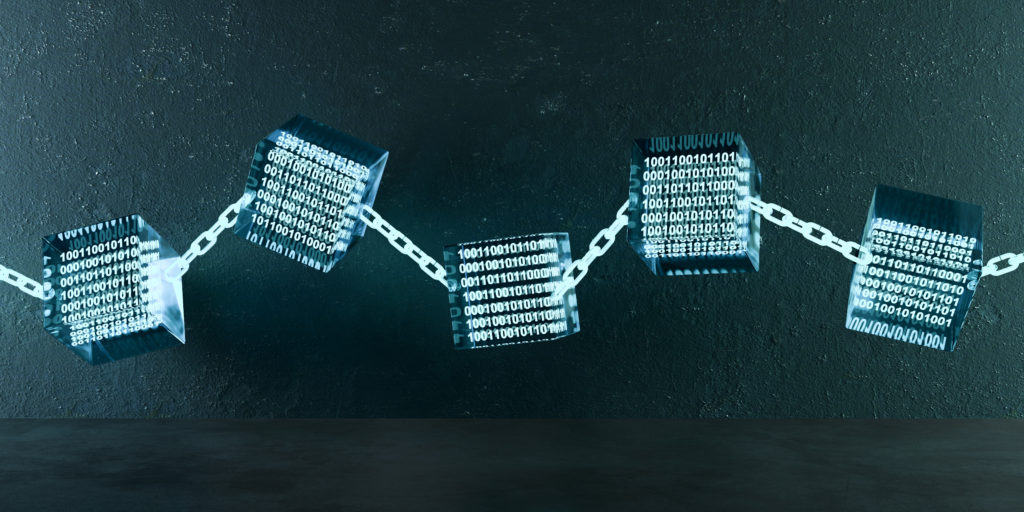
II – La technique contractuelle au fondement de la blockchain et du smart contract
Si l’algorithme trouve un terrain propice à son expansion en droit des contrats de la commande publique en tant qu’opérations à procédures désormais massivement dématérialisées, la technique contractuelle doit rester au fondement de la blockchain et du recours au smart contract. La perspective ne doit pas être inversée de sorte que la technologie reste au service de l’humain ; défions-nous de céder à l’apparente ingénuité d’une « gouvernance algorithmique » constitutive d’un « niveau normatif clandestin »32 dont on perçoit déjà les limites. Le programme informatique automatique est un outil pour l’humain et non l’inverse d’autant plus que son développement en matière de commande publique reste atomisé en de multiples procédés en quête de conformation (A) et ne saurait se passer de cet humanoïde qu’est l’acheteur public (B).
A – La blockchain et le smart contract administratif, paradigmes en quête de conformation
Le plan Transformation numérique de la commande publique 2017-202233, lequel vise l’avènement de « l’État-plateforme » se révèle complexe à deux niveaux : réglementairement, une multitude de textes répondent à des motivations disparates et donnent lieu à la prolifération d’outils institutionnels dédiés, tandis que plus spécifiquement, les acteurs de la commande publique recourent à des instruments complémentaires de telle sorte que la commande publique en « tout démat’ », érigée en idéal, dissimule difficilement un enchevêtrement immatériel en manque de coordination. Dans une volonté d’uniformisation, l’État a en effet mis en place différents dispositifs participant à la dématérialisation de la commande publique34. C’est ainsi que, dans le jargon des acheteurs publics et peu à peu dans celui des entreprises, ont fait leur entrée :
-
le DUME, visant à rationaliser la fourniture de nombreux documents dans un seul, électronique35 et standardisé36 ;
-
Chorus Pro37, pour la gestion dématérialisée et interfacée des paiements ;
-
le REAP38, intéressant le reporting dans l’achat public ;
-
ETALAB œuvrant à la généralisation de l’open data des données publiques39 ;
-
ou encore l’exigence de diffusion de données essentielles relatives aux marchés publics.
Dans une relation plus directe avec le système en blockchain, se diffuse aussi le recours à la signature électronique – suggéré sans être encore imposé par le Code de la commande publique40 – pour laquelle le règlement eIDAS traite de l’identification électronique, des services de confiance et des documents électroniques dans un objectif d’interopérabilité participant d’un marché de la confiance numérique41. C’est aussi le projet PES Marchés visant à accompagner les collectivités territoriales et les établissements publics de santé dans leur transition numérique. Ce service numérique renferme en un flux unique de données, la faculté pour l’acheteur public de satisfaire simultanément à plusieurs de ses obligations réglementaires. La direction générale des Finances publiques met ainsi à disposition un outil comparable à un système en chaîne dont l’objet est la transmission de données nécessaires aux comptables publics, de données du recensement économique de l’achat public (REAP) ainsi que de données essentielles à récupérer pour diffuser sur le profit d’acheteur. Cette procédure présente ainsi l’avantage de la saisie unique en vue de la réutilisation des informations dans trois dimensions. Ne pouvant pas exactement s’assimiler à une blockchain, par ses propriétés, elle peut cependant s’apparenter à une sorte de block-constellation de la commande publique, au sein et autour de laquelle gravitent différentes plateformes plus ou moins interconnectées42. S’il s’agit ici d’instruments institutionnels, dont l’interconnexion est encore embryonnaire et soumise aux initiatives étatiques, le développement concret d’une blockchain en droit du contrat administratif dépend surtout de la volonté des acheteurs publics.
En effet, dans le cadre de la dématérialisation des procédures de la commande publique, de nombreuses interfaces souffrent d’une absence criante de cette interconnexion indispensable à la création et l’enchaînement de smart contracts dans une blockchain. Sans prétendre à l’exhaustivité, il est possible de mentionner les outils de gestion électronique des documents ou de rédaction des marchés publics dont disposent les acheteurs publics, rarement reliés avec les logiciels de signature électronique et encore moins avec les profils d’acheteur sur lesquels ces documents transitent. C’est aussi le dédoublement des interfaces lorsqu’un opérateur économique met en œuvre la faculté prévue à l’article R. 2143-14 du Code de la commande publique appelée aussi « Dites-nous le une fois »43 ou celle issue de l’article R. 2143-13 du Code de la commande publique suivant laquelle « les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l’acheteur peut obtenir directement par le biais : 1° D’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel (…) ; 2° D’un espace de stockage numérique ». De même, les outils de suivi juridiques et/ou comptables des marchés publics utilisés en interne restent souvent hermétiques – quand ce ne sont pas de simples fichiers Excel – et la transmission vers notamment la plate-forme Chorus pro dédiée aux processus de facturation électronique des acheteurs publics ou vers les interfaces de télétransmission au contrôle de légalité supposent toujours une intervention humaine, en dépit du fait que certaines actions sont manifestement automatiques et… potentiellement smart contractualisables. La rationalisation des procédures et la recherche d’harmonie dans la dématérialisation de la commande publique nécessitent incontestablement de travailler sur l’interopérabilité des outils utilisés. Et bien que dématérialisation ne signifie pas traitement automatique, le succès de celle-ci suppose le déploiement de celui-là. Le jeu des instruments de dématérialisation de la commande publique gagnerait d’ailleurs en efficience si une vision d’ensemble informatico-technico-juridique, traduite en termes d’interconnexion et de compatibilité des interfaces voire de fusion, permettait de faire émerger cette blockchain latente, dissimulée sous un matériel informatisé hétéroclite susceptible de smart contractualisation.
Évidemment, l’incorporation dans une blockchain des procédures relevant de la commande publique suppose en outre de prendre la mesure des enjeux en termes de protection des données44 auxquels les acheteurs publics, et plus globalement, les collectivités publiques, sont de plus en plus sensibles. Se pose notamment la question du caractère en principe ineffaçable45 des données figurant dans une blockchain. La recherche d’impartialité dans les procédures de passation des contrats de la commande publique implique certes une relative anonymisation, le respect du règlement général sur la protection des données46 implique surtout de prévoir un algorithme de déchiffrement dépendant de la détention d’une clé d’accès pour l’utilisateur et d’une clé de permanence dont la suppression constitue le respect du droit à l’effacement des données47.
Nonobstant les intérêts que peut représenter le recours à l’algorithme dans les pans de la technique contractuelle les plus automatiques, il ne saurait s’agir que d’une démarche active et volontaire faisant intervenir le juriste.
B – La blockchain administrative, le smart contract et la place irréductible de l’acheteur public
Progrès pour certains, dérive pour d’autres, il faut admettre que certaines notions contractuelles ne sauraient se fondre dans un algorithme. Il en va de toutes ces notions juridiques flexibles à contenu variable, ces standards juridiques48 auxquels la réglementation tout comme la jurisprudence font appel49. En droit administratif, il s’agira du célèbre service public qui, comme le contrat, est un pavillon susceptible de couvrir toutes sortes de marchandises50 mais aussi de l’intérêt général ou encore, plus spécifique à la matière contractuelle, de la bonne foi ou de la loyauté dans les relations contractuelles. De la sorte, en cas d’algorithmisation des sanctions contractuelles se pose la question suivante : « L’automaticité de la sanction permet-elle l’exécution de bonne foi de la clause ? »51. Si la formation du contrat semble foncièrement smart contractualisable et susceptible d’incorporation dans une blockchain – exception faite par exemple du cas des vices du consentement, cependant largement objectivés en droit du contrat administratif, ou du déroulé de négociations –, au stade de l’exécution, force est de reconnaître que le smart contract trouve une limite substantielle dans l’imprévu ; le smart contract exécutant tout ce pour quoi il a été programmé et uniquement cela. Ainsi que le souligne Mustapha Mekki, « la force du smart contract est aussi sa faiblesse : son automaticité »52. Or, les éléments prédéterminés dans le smart contract sont en principe définitifs et auto-exécutoires, ce qui est d’ailleurs conforme à une lecture particulièrement stricte du droit de la commande publique. Ce caractère se révèle toutefois inadapté à la notion même de contrat administratif et spécifiquement à la règle générale de mutabilité essentielle à la satisfaction de l’intérêt général et au respect du principe de bonne gestion des deniers publics dont les acheteurs publics sont garants. Une fine contractualisation des aléas dans des smart contracts ne saurait incontestablement suffire à prévoir tout l’imprévisible qui reste par nature, et cela relève de la tautologie, imprévisible. Là est la limite du smart contract et de la blockchain, avatars du formalisme du contrat administratif, ils ne se substituent jamais à l’acte au fondement de leur propre existence et ne suffisent à absorber toutes les vicissitudes de son exécution. Il faut alors distinguer ce qui peut être appréhendé de façon automatique par un algorithme de ce qui suppose une intervention humaine. En d’autres termes, l’irruption de cette dynamique juridico-numérique suppose de déterminer les clauses automatisables des autres clauses et, comme l’explique Fabien Gillioz, « les contrats juridiques intelligents exigeront donc un mélange entre codage numérique et langage juridique traditionnel »53. Il s’avère indispensable que des « oracles » fassent le relais entre le monde matériel – celui de la formation et de l’exécution de l’acte – et la sphère virtuelle de la blockchain et du smart contract54. Cette réunion entre deux mondes qu’a priori tout oppose est essentielle puisque c’est par l’intervention de ce « tiers de confiance » – en la matière incontournable55 – que les éléments concrets s’incorporent à la blockchain pour donner lieu à la réalisation des smart contracts qui concourent à la formation puis à la réalisation des contrats fiat.
En définitive, oracles, tiers de confiance, mineurs, etc., penser la blockchain et le smart contract en matière de contrat administratif met en lumière le besoin de revalorisation du métier d’acheteur public souvent occupé par des instructeurs-marchés ou des gestionnaires-marchés exécutant les procédures et ne disposant pas forcément d’une solide formation en droit public des affaires, là où un « juriste-commande publique » constitue un rouage nécessaire de l’achat public dans sa dimension moins formelle, répétitive et systématique que substantielle et finaliste. L’algorithme constitue alors un outil au service de l’efficacité administrative dans l’accomplissement de tâches automatisables – souvent de pure procédure – dont il serait erroné de penser qu’il puisse remplacer la logique et le raisonnement juridiques à l’œuvre dans tous les pans du droit administratif. La gestion par algorithme est une illusion à laquelle il convient de ne pas céder, bien que les questions que soulèvent les potentialités du traitement automatique dans les matières juridiques et les métiers du droit soient nombreuses. Se pose d’ailleurs la question de la justiciabilité du smart contract au regard de son irréversibilité dans la blockchain56 ou celle relative à la responsabilité administrative engagée du fait de décisions gouvernées par algorithmes défectueux ou à l’inverse… trop efficaces dans leur non-conformité57.
Notes de bas de pages
-
1.
Pour une approche globale de la question, v. le rapport Villani, Donner un sens à l’intelligence artificielle : pour une stratégie nationale et européenne, mars 2018, Doc. Fr.
-
2.
T.S. Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, 2008, Paris, Champ Sciences, Flammarion, trad. L. Meyer, p. 123-124.
-
3.
J.-P. Chazal, « De la théorie générale à la théorie critique du contrat », RDC 2003, p. 27.
-
4.
F. Beroujon, « Évolution du droit administratif : avancée vers la modernité ou retour aux Temps modernes ? », RFDA 2008, p. 449.
-
5.
J. Caillosse, « Sur quelques problèmes actuels du droit administratif français », AJDA 2010, p. 931.
-
6.
Pour une présentation globale, v. not. G. Guerlin, « Considérations sur les smart contracts », D. 2017, IP/IT, p. 512.
-
7.
M. Mekki, « Blockchains : entre mystères et fantasmes », D. 2019, IP/IT, p. 415 ; v. aussi M. Mekki, « Les mystères de la blockchain », D. 2017, p. 2160 ; P. Ginestie, « La robotisation des contrats – par mes juristes eux-mêmes – sera leur prochain eldorado », D. 2017, IP/IT, p. 527 ; O. Hielle, « La technologie Blockchain : une révolution aux nombreux problèmes juridiques », Dalloz actualité, 31 mai 2016 ; X. Delpech, « La délicate appréhension de la Blockchain par le droit », AJ contrat 2017, p. 244 ; A. Bensoussan, « Blockchain : de la technologie des algorithmes à la technique juridique », D. 2019, IP/IT, p. 420 ; D. Guevel, « Les chaînes de blocs déjà dépassées ? », D. 2018, p. 409 ; A. Portmann, « Des robots et des avocats », Dalloz actualité, 31 mars 2017 ; S. Drillon, « La révolution Blockchain, La redéfinition des tiers de confiance », RTD com. 2016, p. 893 ; E.A. Caprioli, « Mythes et légendes de la blockchain face à la pratique », D. 2019, IP/IT, p. 429.
-
8.
A. Supiot, La gouvernance par les nombres, 2015, Fayard, p. 216.
-
9.
Pour une étude globale, v. S. Saunier, Recherche sur la notion de formalisme en droit administratif français, 2007, Aix-en-Provence, PUAM.
-
10.
F. Geny, Science et technique en droit privé positif, t. 3, 1921, Paris, Sirey, p. 2.
-
11.
F. Geny, Science et technique en droit privé positif, t. 1, 1921, Paris, Sirey, p. 97.
-
12.
G. Guerlin, « Considérations sur les smart contracts », D. 2017, IP/IT, p. 512 ; G. Tournier, Babel ou le vertige technique, 1959, Fayard.
-
13.
N. Szabo, « Smart Contracts, Formalizing and Securing Public Networks », First Monday, sept. 1997, n° 9.
-
14.
S. Nakamoto, « Bitcoin, A Peer-to-Peer Electronic Cash System », 31 oct. 2008.
-
15.
Pour une explication du mécanisme, v. Y. Cohen-Hadria, « Blockchain : révolution ou évolution ? », D. 2016, IP/IT, p. 537.
-
16.
Y. Moreau et C. Dornbierer, « Enjeux de la technologie de blockchain », Recueil Dalloz 2016, p. 1856, les auteurs poursuivent : « Les applications des blockchains sont nombreuses, comme les cryptomonnaies (bitcoin), la compensation interbancaire (Ripple, R3 consortium), les contrats intelligents (smart contracts, tel Ethereum), l’enregistrement authentique de documents (BitProof) ou encore l’identité numérique (ShoCard) ».
-
17.
M. Mekki, « Le contrat, objet des smart contracts (Partie 1) », D. 2018, IP/IT, p. 409.
-
18.
Cybermonnaie définie par le Vocabulaire de l’informatique publié au Journal officiel du 23 mai 2017, texte n° 20, comme une « monnaie dont la création et la gestion reposent sur l’utilisation des techniques de l’informatique et des télécommunications ».
-
19.
Ord. n° 2016-520, 28 avr. 2016, relative aux bons de caisse : JO n° 0101, 29 avr. 2016.
-
20.
L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, spéc. art. 120 : JO n° 0287, 10 déc. 2016.
-
21.
L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, spéc. art. 85 et 86 : JO n° 0119, 23 mai 2019.
-
22.
M. Mekki, « Le contrat, objet des smart contracts (Partie 1) », D. 2018, IP/IT, p. 409.
-
23.
G. Cattalano, « Smart contracts et droit des contrats », AJ contrat 2019, p. 321.
-
24.
G. Guerlin, « Considérations sur les smart contracts », D. 2017, IP/IT, p. 512.
-
25.
Y. Cohen-Hadria, « Blockchain : révolution ou évolution ? La pratique qui bouscule les habitudes et l’univers juridique », D. 2016, IP/IT, p. 537.
-
26.
M. Mekki, « Le contrat, objet des smart contracts (Partie 1) », D. 2018, IP/IT, p. 409.
-
27.
J.-C. Roda, « Smart contracts, dumb contracts ? », D. 2018, IP/IT, p. 397.
-
28.
M. Mekki, « Le contrat, objet des smart contracts (Partie 1) », D. 2018, IP/IT, p. 409, pour l’auteur : « Les documents peuvent être égarés, expédiés aux mauvaises personnes, falsifiés, incomplets. Les échanges sont ralentis en raison du manque de célérité de certains ou de la complexité des opérations », ce que permet d’éviter la blockchain.
-
29.
G. Guerlin, « Considérations sur les smart contracts », D. 2017, IP/IT, p. 512.
-
30.
Principes consacrés à l’article L. 3 du Code de la commande publique.
-
31.
F. Gillioz, « Du contrat intelligent au contrat juridique intelligent », D. 2019, IP/IT, p. 16.
-
32.
J.-B. Auby, « Le droit administratif face aux défis du numérique », AJDA 2018, p. 835.
-
33.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/dematerialisation/plan-transform-numeriq-cp/Feuillet_Plan-Transfo-Num-CP.pdf.
-
34.
Depuis le 1er octobre 2018 – D. n° 2016-360, 25 mars 2016, relatif aux marchés publics, art. 41 – le principe est la dématérialisation des procédures de passation de leurs marchés publics et la publication des données essentielles de ces contrats sur leur profil d’acheteur. Les différentes étapes de la passation sont concernées : publication des avis, mise en ligne des documents de la consultation (cahier des charges…), réception des candidatures/offres, toutes demandes des entreprises et des acheteurs, négociations et informations (courrier de rejet, attribution, notification, etc.).
-
35.
Candidature établie fréquemment via la fourniture des formulaires DC1 et DC2 accompagnés d’attestations diverses au nombre desquelles une déclaration sur l’honneur visée à l’article R. 2143-3 du Code de la commande publique et des documents permettant à l’acheteur de vérifier l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, la capacité économique et financière et les capacités techniques et professionnelles du candidat.
-
36.
V. instruction en annexe au règlement d’exécution (UE) n° 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016, établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen : JOUE, 6 janv. 2016.
-
37.
Ord. n° 2014-697, 26 juin 2014, relative au développement de la facturation électronique : JO n° 0147, 27 juin 2014.
-
38.
PE et Cons. UE, dir. n° 2014/24/UE, 26 févr. 2014, et PE et Cons. UE, dir. n° 2014/25/UE, 26 févr. 2014 ; CCP, art. L. 2196-3 et CCP, art. R. 2196-2 à CCP, art. D. 2196-7 ; le Code de la commande publique codifie notamment le décret n° 2006-1071 du 28 août 2006 relatif au recensement des marchés publics et de certains contrats soumis à des obligations de mise en concurrence, ainsi que l’arrêté du 21 juillet 2011, relatif au recensement économique de l’achat public ; v. aussi https://www.reap.economie.gouv.fr/reap/servlet/authentificationAcheteur.html ; https://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/recense/guide_recensement.pdf. Deux modalités de transmission existent : pour les uns, les services centraux et déconcentrés de l’État via l’interface CHORUS et, pour les autres acheteurs via le site dont l’adresse est indiquée ci-dessus (REAP) pour l’usage duquel l’acheteur public se crée un compte actif sous 48 heures.
-
39.
D. n° 2011-194, 21 févr. 2011, portant création d’une mission « Etalab » chargée de la création d’un portail unique interministériel des données publiques : JO n° 0044, 22 févr. 2011.
-
40.
V. en ce sens l’article R. 2182-3 du Code de la commande publique renvoyant à l’arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique : JO n° 0077, 31 mars 2019.
-
41.
V. PE et Cons. UE, règl. n° 910/2014, 23 juill. 2014, sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS).
-
42.
V. en ce sens Chorus pro, le site dédié au recensement économique des marchés publics, les profils d’acheteurs performants en termes d’interconnexion, API Recensement mis à disposition par l’agence pour l’informatique financière de l’État (AIFE) ainsi que les multiples logiciels comptables utilisés par les acheteurs dont les interfaces doivent être adaptées par les éditeurs à ces nouveaux enjeux de rationalisation immatérielle.
-
43.
CCP, art. R. 2143-14 : « Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis au service acheteur concerné lors d’une précédente consultation et qui demeurent valables, même si celui-ci ne l’a pas expressément prévu. »
-
44.
V. not. A., 27 juill. 2018, relatif aux exigences minimales des outils et dispositifs de communication et d’échanges d’information par voie électronique dans le cadre de la commande publique.
-
45.
Y. Cohen-Hadria, « Blockchain : révolution ou évolution ? La pratique qui bouscule les habitudes et l’univers juridique », D. 2016, IP/IT, p. 537.
-
46.
PE et Cons. UE, règl. n° 2016/679, 27 avr. 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive n° 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) : JOUE L. 119/1, 4 mai 2016 ; v. aussi F. Chafiol et A. Barbet-Massin, « La Blockchain à l’heure de l’entrée en application du règlement général sur la protection des données », D. 2017, IP/IT, p. 637 ; W. O’Rorke, « L’émergence d’un droit de la blockchain », D. 2019, IP/IT, p. 422 ; CNIL, Blockchain et RGPD : quelles solutions pour un usage responsable en présence de données personnelles ?, 24 sept. 2018 ; T. Douville, « Blockchain et protection des données à caractère personnel », AJ contrat 2019, p. 316.
-
47.
G. Cattalano, « Smart contracts et droit des contrats », AJ contrat 2019, p. 321.
-
48.
S. Rials, Le juge administratif français et la technique du standard (essai sur le traitement juridictionnel de l’idée de normalité), 1980, Paris, LGDJ.
-
49.
M. Mekki, « Le contrat, objet des smart contracts (Partie 1) », D. 2018, IP/IT, p. 409.
-
50.
L. Josserand, « L’essor moderne du concept contractuel », in Recueil d’études sur les sources du droit en l’honneur de François Gény, t. 2, Les sources générales des systèmes juridiques actuels, 1977, Paris, Sirey, p. 340.
-
51.
G. Guerlin, « Considérations sur les smart contracts », D. 2017, IP/IT, p. 512.
-
52.
M. Mekki, « Le smart contract, objet du droit (Partie 2) », D. 2019, IP/IT, p. 27.
-
53.
F. Gillioz, « Du contrat intelligent au contrat juridique intelligent », D. 2019, IP/IT, p. 16.
-
54.
M. Mekki, « Le smart contract, objet du droit (Partie 2) », D. 2019, IP/IT, p. 27 ; J. Gossa, « Les blockchains et smart contracts pour les juristes », D. 2018, IP/IT, p. 393.
-
55.
Les définitions de la blockchain entendent fréquemment se passer du tiers de confiance privilégiant une relation désintermédiée.
-
56.
G. Cattalano, « Smart contracts et droit des contrats », AJ contrat 2019, p. 321.
-
57.
J.-B. Auby, « Le droit administratif face aux défis du numérique », AJDA 2018, p. 835.