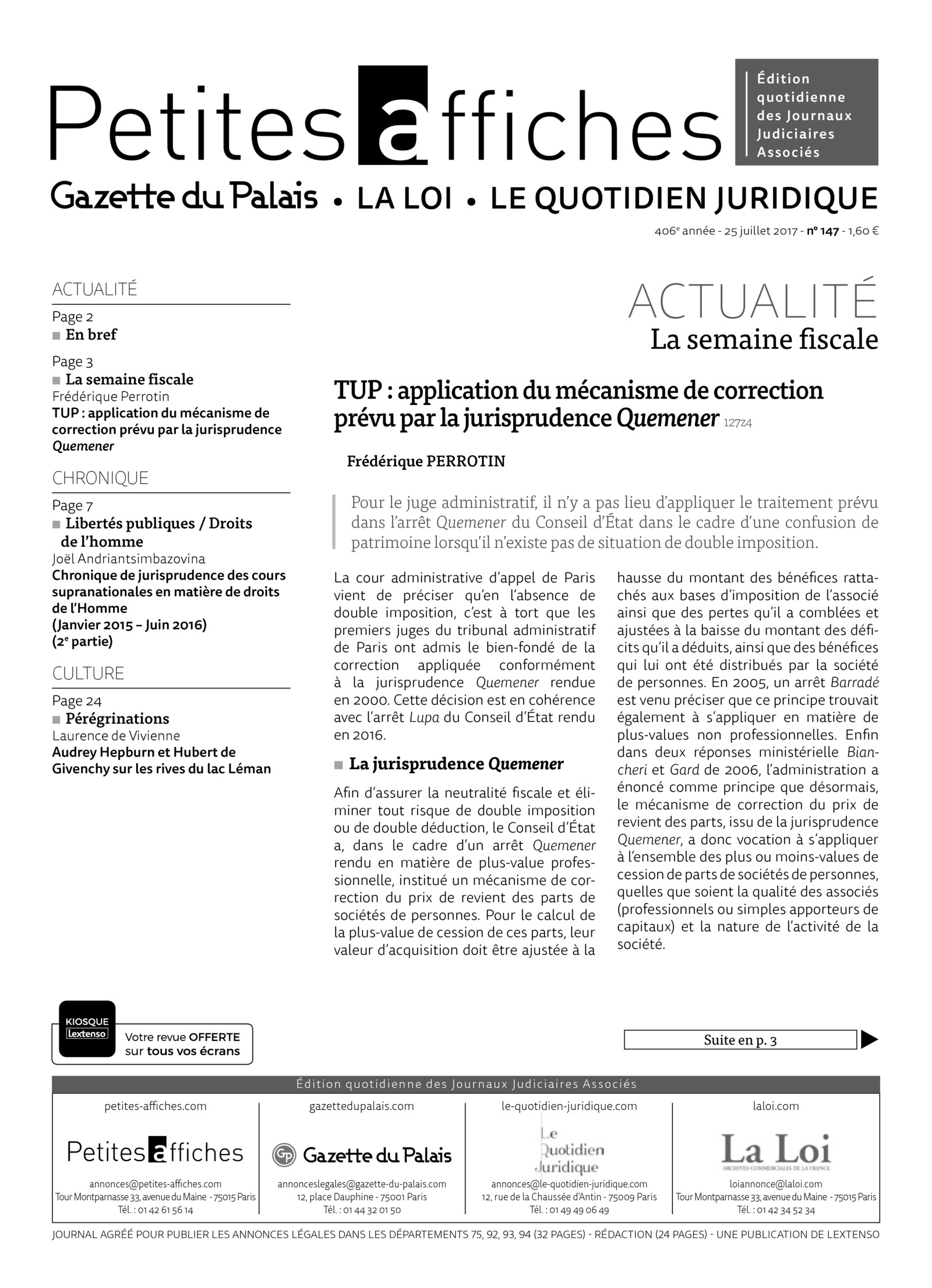Chronique de jurisprudence des cours supranationales en matière de droits de l’Homme (Janvier 2015 – Juin 2016) (2e partie)
I – Cours supranationales et rapports entre systèmes juridiques
II – Cours supranationales et conflits armés
III – Cours supranationales et questions sociétales
A – Lutte contre la discrimination
B – Lutte contre les violences faites aux femmes
IV – Cours supranationales et questions pénales
A – Cours supranationales et coopération pénale
Charte des droits fondamentaux de l’Union et mandat d’arrêt européen : le standard de protection européen doit primer sur l’exécution du mandat (CJUE, gde ch., nos C-404/15 et C-659/15 PPU, Aranyosi et Caldararu)
Le mandat d’arrêt européen (MAE) est décidément au cœur de bien des décisions importantes. C’est précisément sur l’articulation entre la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE) et le MAE que se prononce ici la Cour, en permettant le report d’un mandat d’arrêt dans le cas où il existe un risque concret de traitement inhumain ou dégradant dans l’État d’émission du mandat. Le standard européen de protection des droits de l’Homme prime donc, selon certaines modalités, sur la coopération en matière judiciaire1.
À l’origine de la décision, deux questions préjudicielles similaires posées par le tribunal régional supérieur de Brême. Un ressortissant hongrois et un ressortissant roumain, tous deux objets d’un MAE et résidant en Allemagne, contestent l’exécution du mandat en ce qu’ils considèrent que les détentions qu’ils risquent dans leur État respectif seraient effectuées dans des conditions violant l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv. EDH) ainsi que l’article 4 de la CDFUE, interdisant les traitements inhumains et dégradants.
En résumé, les questions préjudicielles, distinctes mais jointes, portent sur l’interprétation de la décision-cadre relative au MAE. Il s’agit de savoir si la remise est licite même s’il existe des risques qu’une détention dans l’État d’émission se fera dans des conditions violant les droits fondamentaux, plus particulièrement l’interdiction des traitements inhumains et dégradants.
La réponse de la Cour est mesurée. Elle accepte que l’exécution du mandat soit reportée, sous des conditions strictes. Il faut ainsi des « éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés » montrant que la personne visée par un MAE courra, par sa détention, « un risque réel de traitement inhumain et dégradant ». La fourniture d’informations complémentaires pour évaluer le risque doit être demandée à l’autorité judiciaire d’émission du mandat, et l’autorité d’exécution du mandat doit reporter sa décision relative à la remise de la personne jusqu’à obtention de ces informations, prenant finalement la décision de reporter la procédure de remise dans l’hypothèse où l’existence du risque de traitements inhumains et dégradants ne peut pas être écartée.
La Cour de justice était ainsi confrontée à deux dispositions normatives possiblement contradictoires selon leur(s) interprétation(s). D’une part la Charte impose le respect absolu des droits fondamentaux, et notamment de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants. D’autre part, et sous certaines réserves très limitées, la décision-cadre relative au MAE impose la remise des personnes visées par un mandat. Quid alors si la remise obligatoire entraîne la violation des droits fondamentaux reconnus par la Charte dont le respect est lui aussi obligatoire ? La Cour de justice interprète ici la décision-cadre dans un sens permettant d’assurer tant le respect de la Charte, et donc des droits fondamentaux, que du MAE, proposant ainsi une jurisprudence moins stricte que celle de l’arrêt Melloni. Elle propose une interprétation conciliatrice des dispositions normatives en présence, permettant le report du MAE afin de garantir au mieux tant le respect des droits fondamentaux que la coopération judiciaire entre États (I), tout en posant des conditions strictes pour ce report, qui ne peut être motivé que par un risque réel et concret de violation de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants (II).
I. L’interprétation conciliatrice d’énoncés potentiellement contradictoires
Les énoncés normatifs ont plusieurs significations possibles, et il arrive que la combinaison de plusieurs énoncés puisse aboutir à des normes contradictoires selon les interprétations choisies. C’était ici le risque, entre la Charte d’une part et la décision-cadre d’autre part. La Cour rappelle les exigences du droit de l’Union (A) en conciliant ces exigences, permettant ainsi de respecter les droits fondamentaux (B).
A. Le rappel des exigences du droit de l’Union
La Cour commence par rappeler les exigences du droit de l’Union tant sur le plan des droits fondamentaux que sur celui de l’exécution des MAE. Se rapprochant de la Conv. EDH, elle constate que l’article 4 de la Charte recouvre le même droit garanti à l’article 3 de la Conv. EDH. Or puisque l’article 15 de la Conv. EDH interdit toute dérogation à ce droit, il ne peut pas non plus connaître de dérogation en droit de l’Union, par la transitivité de l’article 52, § 3, de la Charte.
En ce qui concerne le MAE, la décision-cadre se place dans le cadre de la coopération judiciaire entre les États membres, reposant sur la confiance entre les États et notamment sur le standard des droits fondamentaux en vigueur. L’article 1, § 2, impose l’exécution des mandats. La seule réelle réserve à l’exécution se retrouve dans l’article 1, § 3, qui la subordonne au respect des droits fondamentaux consacrés à l’article 6 du TUE, soit la Charte et les principes généraux. Cette brèche est utilisée par la Cour pour permettre la conciliation entre la Charte et la décision-cadre.
B. La conciliation des exigences du droit de l’Union
Si la décision-cadre semble imposer l’exécution d’un MAE licite sans aucune réserve de la part de l’État d’exécution, l’article 1, § 3 ouvre une possibilité de conciliation avec la Charte. En effet, il précise que « la présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux ». C’est cet article qui permet de concilier le MAE avec les droits fondamentaux garantis par l’Union. En effet, la Cour utilise cette condition de respect des droits, et donc de la Charte, pour autoriser une limite temporaire à l’exécution du mandat en cas de risques de violation de l’interdiction posée par l’article 4 de la Charte, qualifié de « l’une des valeurs fondamentales de l’Union et de ses États membres » par la Cour, concrétisant ainsi la possibilité de « circonstances exceptionnelles » évoquées dans le point 191 de l’avis 2/13 pour qu’un État membre contrôle le respect des droits fondamentaux par un autre État membre.
Au-delà des conditions du report du MAE (v. infra II), c’est le principe même de la possibilité de ce report qu’il faut souligner. Si les faits des deux affaires ne sont probablement pas étrangers à cette permission donnée par la Cour (condamnation de la Hongrie et de la Roumanie par la CEDH pour les conditions de détention dans leurs prisons), la Cour accepte ici qu’un État refuse de reconnaître l’existence d’une « protection équivalente et effective » des droits fondamentaux garantis au niveau de l’Union au sein d’un autre État membre. Si les conditions sont remplies, un État peut alors refuser d’exécuter un MAE qui aboutirait à violer les droits fondamentaux de l’Union. À la différence de l’arrêt Melloni, les droits fondamentaux ici violés sont ceux du standard européen, et pas ceux d’un standard national supérieur au standard posé par le droit de l’Union, ce qui peut expliquer la différence.
De plus, si le report de l’exécution du MAE n’est ici permis qu’en cas de risque de traitements inhumains et dégradants, il n’y a pas de raison que seul ce droit soit invocable. L’interprétation proposée par la Cour, qui s’inscrit d’ailleurs en plein dans la possibilité permise par les énoncés, permet un report de tout MAE dont l’exécution entraînerait la violation de n’importe quel droit garanti par la Charte, ou même par les autres droits fondamentaux garantis à l’article 6 du TUE. Les conditions de report du mandat proposées par la Cour sont cependant strictes.
II. Les conditions strictes du report de l’exécution du MAE
Les conditions de report de l’exécution du MAE posées par la Cour sont strictes. Il faut non seulement des « éléments attestant d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant des personnes détenues dans l’État membre d’émission » (A) et une appréciation in concreto de la situation des requérants pour évaluer « si, dans les circonstances de l’espèce, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que (…) cette personne courra un risque réel » (B).
A. L’exigence d’un risque abstrait
Pour autoriser le report – et pas l’abandon – de l’exécution du MAE, il faut d’abord qu’il existe un risque de violation de l’article 4 de la Charte. L’évaluation de ce risque, précisée au point 89 de l’arrêt, se base sur des éléments objectifs attestant de la violation de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants en détention par l’État d’émission du mandat. La Cour évoque, à titre d’exemple, des condamnations par la CEDH, des décisions internationales ou même des décisions internes à l’État d’émission du mandat. La mesure de ce risque abstrait doit reposer sur des éléments tangibles, mais elle n’est pas suffisante. S’il est nécessaire qu’il existe un risque de violation, ce risque de violation doit être évalué concrètement pour l’affaire traitée par les autorités de l’État d’exécution.
B. L’exigence d’un risque concret
Le risque de violation de l’article 4 de la Charte doit être apprécié in concreto. Pour reporter licitement l’exécution d’un MAE, il ne suffit pas que, dans l’absolu, l’État d’émission du mandat ait été condamné, ou qu’il existe des rapports internationaux critiquant ses pratiques. Il faut en plus que les autorités de l’État d’exécution recherchent si le requérant risque concrètement de subir de tels traitements. Ainsi, des informations complémentaires peuvent être demandées à l’État d’émission, notamment en ce qui concerne le lieu d’incarcération du requérant. Les délais de 30 ou 60 jours doivent en outre être maintenus pour exécuter le mandat, ce qui implique, le cas échéant, que l’État d’émission fournisse rapidement les informations demandées.
Respectant un principe de subsidiarité, c’est aux juridictions de l’État d’exécution qu’il appartient, in fine, de trancher sur l’existence du risque, et donc sur le report du MAE. Le cas échéant, l’État d’exécution ne peut pas non plus maintenir en détention la personne visée par le mandat, ses autorités pouvant assortir la libération de toutes mesures à même d’éviter la fuite, et à assurer la remise effective tant qu’aucune décision définitive n’est prise concernant le mandat d’arrêt.
Cette double exigence semble n’être qu’une interprétation possible, et constructive, de l’article 1, § 3, de la décision-cadre relative au MAE. C’est cependant celle de la Cour que les juridictions nationales devront suivre si elles ne veulent pas craindre de s’attirer les foudres de la Cour de Luxembourg.
Sacha Sydoryk
B – Cours supranationales et grands principes de la loi pénale
Le respect du principe ne bis in idem et de la présomption d’innocence : loin d’être un mythe hellénique
La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) n’a pas dit son dernier mot quant au respect des garanties conventionnelles qu’elle consacre. Le principe ne bis in idem2, trouvant son fondement à l’article 4 du protocole n° 7 annexé à la Convention européenne et le principe de la présomption d’innocence, consacré à l’article 6, paragraphe 2, de ladite Convention, ne cessent d’être énoncés, confirmés et réaffirmés par cette dernière. Les arrêts s’amoncellent au point de former un amas de garanties toujours plus effectives. Ces allégations ne demeurent pas sans conséquences sur le droit interne des États parties3. La France et d’autres, n’ont qu’à bien se tenir : il est à nouveau inconcevable de prononcer des sanctions administratives après un acquittement au pénal au regard des deux principes énoncés. À cet égard, la Grèce est à nouveau condamnée par un arrêt de la CEDH Sismanidis et Sitaridis c/ Grèce en date du 9 juin dernier4.
Faits et procédures peuvent être ainsi résumés. Deux requérants respectivement poursuivis devant le juge pénal, du chef de contrebande en 1994 et 1998 sont définitivement acquittés en appel au regard de l’impossibilité d’établir leur culpabilité. Parallèlement, les services des douanes les ont condamnés à payer des taxes incluant une majoration importante pour les mêmes faits. Or, au regard de ces sanctions, les requérants ont exercé de multiples recours administratifs. Le premier évoque simplement la violation du principe ne bis in idem alors que le second allègue principalement la violation de la présomption d’innocence5. Le Conseil d’État hellénique a rejeté les arguments des deux défendeurs qui ont saisi alors la CEDH.
La question principale posée à la Cour était celle de savoir si un individu acquitté pénalement pouvait être poursuivi et condamné à l’issue d’une procédure, en apparence, administrative, au regard des mêmes faits.
Dans la lignée de l’arrêt Kapetanios6, la CEDH réaffirme didactiquement que ces condamnations administratives constituent tant une violation du principe ne bis in idem qu’un manquement au respect de la présomption d’innocence.
Avant d’en arriver à cette conclusion, la juridiction strasbourgeoise s’efforce de vérifier l’applicabilité du concept « d’accusation en matière pénale » aux procédures administratives, afin de les soumettre aux principes pénaux protégés par la Convention (I) nécessitant à leur tour le respect de certaines conditions (II).
I. L’accusation en matière pénale : condition nécessaire à l’application des garanties pénales
Avant de s’interroger sur l’application des garanties pénales conventionnelles (B), il est nécessaire de vérifier, préalablement, si les procédures administratives pouvaient être rattachées à la « matière pénale » (A).
A. L’accusation en matière pénale applicable
Afin d’éviter les fraudes à la Convention, la CEDH a dégagé pour la première fois dans l’arrêt Engel7 une notion autonome dont la pertinence n’est plus à démontrer. Il s’agit de « l’accusation en matière pénale » ayant pour objectif d’englober, par l’établissement de critères, ce qui n’est ni formellement ni organiquement du droit pénal stricto sensu mais qui relève du droit répressif. En définitive, l’intérêt de cette qualification prétorienne est de permettre l’application des garanties pénales conventionnelles à des matières, de prime abord, extra-pénales. À cet égard, la Cour analyse le célèbre triptyque alternatif : la qualification juridique de la mesure litigieuse en droit national, l’intérêt protégé et la gravité de la sanction encourue (§ 31). Elle affirme alors qu’eu égard « à la nature grave de l’infraction de contrebande, au caractère dissuasif et répressif de la sanction infligée, ainsi qu’au montant très élevé de l’amende », les sanctions administratives encourues ressortaient de la matière pénale (§ 34). Cette conclusion n’est pas sans conséquences sur la suite de la décision, elle est même déterminante car elle permet l’application pleine et entière des principes protecteurs de la Convention prévus à l’article 6 et à l’article 4 du protocole n° 7 annexé à celle-ci (B).
B. L’accusation en matière pénale appliquée
À défaut d’une procédure relevant de la matière pénale, les principes précités n’auraient pas dû être nécessairement respectés. En effet, le cumul des poursuites et des sanctions pénales et extra-pénales pour les mêmes faits reste admissible mais demeure conditionné : d’une part, à l’existence de poursuites étant de nature réellement différente ; d’autre part, à un cumul de sanctions proportionné. Dans cette perspective, la CEDH contrôle, en l’espèce, la nature réelle de la sanction qui aurait à son sens une coloration punitive. Les poursuites étant, par une fiction juridique, de même nature, elles ne peuvent en aucun cas se cumuler. En d’autres termes, la Cour limite le recours aux répressions pénales et administratives lorsque ces dernières font double emploi. S’agissant de la présomption d’innocence et plus largement du procès équitable, le raisonnement demeure le même. L’application de ces principes dépasse, depuis 1976, le cadre du pénal dans un but toujours plus protecteur des droits de l’Homme. Cet arrêt en est une parfaite illustration. Les circuits de dérivations internes aux États qui voudraient s’extirper des garanties fondamentales conventionnelles ne peuvent plus tricher sous peine d’être condamnés. Or, la qualification de matière pénale est insuffisante car elle est une simple condition préalable (II).
II. L’accusation en matière pénale : condition imparfaite à l’application des garanties pénales
Il faut dès lors analyser si le principe ne bis in idem (A) ainsi que celui de la présomption d’innocence (B) sont réellement contournés en l’espèce.
A. Le double critère permettant l’application de ne bis in idem
Au regard du principe ne bis in idem, l’arrêt met en exergue, en citant sa jurisprudence antérieure, qu’il « doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde “infraction” pour autant que celle-ci a pour origine des faits qui sont en substance les mêmes » (§ 46). Au-delà du fait que le cumul entre ces procédures n’est proscrit qu’à compter de la survenance d’une décision définitive, il est nécessaire, en outre, de déterminer ce qu’est « l’idem ». En effet, la présence d’une identité de faits ou plus techniquement la notion de cause qui revêt au sens processuel deux interprétations doit être analysée : elle peut soit faire référence à la qualification juridique soit au fait matériellement commis. Depuis l’arrêt Zolotoukhine8, plus aucun doute ne peut être fait quant à l’acception de la cause choisie par la CEDH. Elle considère le fait comme l’acte matériel réalisé. Par conséquent, elle affirme avec certitude que la double poursuite provient d’un comportement unique. Ne bis in idem est donc violé. L’analyse, de la Cour peut donc se poursuivre s’agissant de la présomption d’innocence (B).
B. L’acquittement préalable du juge pénal pris en compte au regard de la présomption d’innocence
Au regard de la présomption d’innocence, la Cour fait à nouveau référence à l’arrêt Kapetanios pour qui « la présomption d’innocence signifie que si une accusation en matière pénale a été portée et que les poursuites ont abouti à un acquittement, la personne ayant fait l’objet de ces poursuites est considérée comme innocente au regard de la loi et doit être traitée comme telle » (§ 85). Le pénal tiendrait l’administratif en l’état et inversement. Ce dénouement original ne surprend plus et semble devenir récurrent. Selon la Cour, il est strictement prohibé de présenter un individu acquitté comme « coupable ». Cette solution vient restreindre à nouveau la portée du cumul. Il apparaît en effet légitime que l’individu n’ait pas à être soumis à de multiples reprises à une procédure de nature pénale pour des faits identiques, quelle que soit la solution apportée au litige.
En définitive, les États membres n’ont plus qu’à…
Hélène Christodoulou
V – Cours supranationales et procéduralisation des droits substantiels
Le droit au logement sous l’angle procédural : bien un droit mais pas de droit au bien
La Cour de Strasbourg s’est prononcée dans un arrêt du 9 avril 20159, devenu définitif le 9 juillet 2015, sur le dispositif de la loi Dalo10 du 5 mars 2007, visant à garantir le droit au logement décent par l’intervention du juge administratif. La Cour a considéré que le mécanisme prévu par la loi n’était pas de nature à satisfaire les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention. C’est selon ces dispositions que le logement qu’occupaient Mme Tchokontio Happi et une partie de sa famille, s’est vu reconnaître, par une décision de la Commission de médiation de Paris du 12 avril, notifiée le 12 mars, le statut de « logement indécent et insalubre », propulsant ses occupants au rang prioritaire des personnes devant être relogées. Sans offre de relogement, Mme Tchokontio Happi saisit le tribunal administratif de Paris à l’issue du délai de 6 mois que prévoyait les dispositions de la loi Dalo. Le juge administratif, condamne le préfet d’Île-de-France, par un jugement du 28 décembre 2010, à une astreinte par mois de retard, équivalente au montant d’un loyer moyen, versée au profit du fonds d’aménagement urbain d’Île-de-France. L’inertie des autorités administratives conduit les demandeurs à saisir la Cour européenne des droits de l’Homme le 8 octobre 201211. Si l’approche de la Cour est procédurale, l’intérêt de l’arrêt réside bien davantage dans la garantie de l’effectivité du droit au logement. En effet, il est possible de considérer que l’effectivité d’un droit participe à la définition même du concept de liberté selon lequel, pour exister et être effective, la liberté doit être consacrée, définie, et juridiquement et juridictionnellement garantie.
En ce sens, sans véritable difficulté sur les conditions de recevabilité du recours12, bien qu’il ne soit pas expressément consacré par la Convention, la Cour est amenée à se prononcer pour la première fois sur le droit au logement. Elle en profite d’ailleurs pour préciser que le « droit au bail » ne peut être assimilé à un bien au sens de l’article 1 du protocole n° 113. Ainsi, sur fond de procès équitable, la Cour constate-t-elle que les mesures de la loi du 5 mars 2007, visant à la bonne exécution des jugements en matière de droit au logement, privent de leur effet utile les garanties de l’article 6, § 1, de la Convention (I). Si cette condamnation de la France aurait pu permettre une belle illustration d’un dialogue des juges, au regard des positions antérieures du Conseil d’État et récentes du Conseil constitutionnel faisant suite à cet arrêt, il n’en est rien (II).
I. Le support procédural de l’effectivité du droit au logement
La Cour a en premier lieu estimé que le mécanisme de la loi du 5 mars 2007 privait de leur substance les garanties dont avait pu bénéficier Mme Tchokontio Happi pendant la « phase judiciaire »14 (A). C’est également, dans cette approche, davantage procédurale que substantielle, du droit au logement, que la Cour va préciser que l’État ne peut s’exonérer de sa responsabilité en raison d’une pénurie de logements (B).
A. La bonne exécution d’un jugement comme support de l’effectivité du droit au logement
Si le droit à l’exécution d’une décision de justice est « l’un des aspects du droit à un tribunal »15, la Cour considère que le moyen coercitif mis en place par la loi de 2007 ne suffit pas à garantir l’exécution du jugement prononcé par le tribunal administratif de Paris. En effet, si les États disposent d’une marge d’appréciation quant à la détermination de mesures permettant l’exécution forcée des jugements, la Cour, depuis une jurisprudence constante16, vérifie que ces mesures soient « adéquates et suffisantes »17 afin de ne pas priver l’article 6, § 1, de tout effet utile. L’exécution de la décision doit en outre être « complète, parfaite et non partielle »18. En l’espèce, les juges de Strasbourg ont considéré que si l’astreinte a bien été prononcée, elle ne constitue pas une véritable injonction pour l’État, tout au plus peut-elle être considérée comme une incitation. Aussi, versée au fonds d’aménagement urbain d’Île-de-France, l’astreinte n’a-t-elle, de fait, aucune fonction compensatoire pour la requérante. Ces défaillances dans le mécanisme de la loi conduisent logiquement à engager la responsabilité de la France, ce dont elle ne peut s’exonérer.
B. La pénurie des logements, une cause exonératoire ?
S’il tente de s’exonérer en faisant valoir qu’une pénurie des logements est à l’origine de la carence de ses autorités, la Cour rappelle à l’État que ses explications ne se fondent sur « aucune justification valable au sens de sa jurisprudence constante »19. En effet, seules des limitations proportionnées à la poursuite d’un but légitime seraient susceptibles d’exonérer l’État de sa responsabilité. En la matière, l’absence de fonds ou de ressources suffisantes – ou la pénurie des logements – ne permettent en aucun cas à un État de se soustraire à une obligation dont il aurait la charge, alors que celle-ci serait reconnue par une décision de justice. En définitive il semble davantage que, sur fond de procès équitable, l’État soit sanctionné de l’absence d’une mise en place de mécanisme procéduraux satisfaisant l’effectivité du droit au logement.
II. Le droit au logement et le dialogue des juges : la réponse du berger à la bergère
S’il était possible de déduire de l’arrêt la nécessité d’une réforme de la loi Dalo, sur le terrain d’une prestation compensatoire en cas de retard (A), la résistance des juges français en la matière est une malheureuse illustration de l’absence d’un véritable dialogue des juges (B).
A. Le fondement du droit au logement, l’explication de la condamnation
Ignoré de la Convention, le seul support du recours en matière de droit au logement est ici procédural et non substantiel, sur le fondement de l’article 6, § 1. Cela explique que, d’après l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, la seule garantie de l’effectivité du droit au logement réside dans la fonction compensatoire que devrait jouer l’astreinte. En ce sens, c’est en raison du choix du destinataire de l’astreinte que celle-ci ne semble pas satisfaire l’exigence posée par la Cour. Dès lors il aurait été possible de s’attendre à une révision de la loi Dalo, ou tout du moins, à une évolution de la jurisprudence administrative postérieure, mettant en conformité la conception française de l’effectivité du droit au logement avec celle de la Cour de Strasbourg et écartant le dispositif inconventionnel.
B. L’absence de complémentarité entre la consécration effective française et la garantie effective du droit au logement par la Cour
La solution retenue par les juges français fait œuvre d’une certaine résistance qui peut être expliquée par le fait qu’au sein de l’ordre juridique français, le droit au logement est effectivement consacré à défaut d’être garanti. À diverses reprises, tant le Conseil constitutionnel20 que le Conseil d’État21, ont validé le dispositif relatif à l’astreinte et à son destinataire, considérant qu’il ne porte pas atteinte aux garanties de l’article 6, § 1, de la Convention. Pourtant la fonction compensatoire de l’astreinte visait à réparer le préjudice résultant d’une carence dans l’exécution du jugement, conformément à la jurisprudence bien établie de la Cour de Strasbourg22. Un tel résultat est à déplorer en ce qu’il poursuit une absence de dialogue des juges et conduit assurément à une confrontation des ordres juridiques, quand ceux-ci, dans l’intérêt d’un fonctionnement en bonne intelligence, devraient être articulés.
Pierre Roujou de Boubée
VI – Cours supranationales et droits et libertés relatifs au fonctionnement de la démocratie
A – Cours supranationales et liberté d’expression des avocats
L’arbitrage par la Cour entre liberté d’expression des avocats et préservation du pouvoir judiciaire : l’affaire Morice c/ France
Le 23 avril 2015, la Cour a précisé la portée de l’article 10 de la Convention pour les avocats en dehors des prétoires, leur accordant une liberté d’expression renforcée23.
Me Morice s’était opposé, dans deux affaires distinctes (dites Scientologie et Borrel), à la juge d’instruction. L’affaire Borrel avait un retentissement médiatique très fort : en effet, un juge retrouvé mort, une enquête de police concluant au suicide, une veuve contestant ces conclusions, deux juges d’instructions dessaisis et un communiqué pour le moins tardif du procureur de la République abandonnant publiquement la thèse du suicide au profit de l’acte criminel constituaient autant d’éléments qui ne pouvaient qu’attirer l’attention des médias.
Plus particulièrement, l’année 2000 constitua un moment-clé dans la compréhension de l’affaire Morice puisqu’en quelques mois, la juge était dessaisie des deux dossiers et poursuivie disciplinairement pour sa gestion du dossier Scientologie, jugée laxiste et non professionnelle.
Le dessaisissement de la juge M. de l’affaire Borrel avait été initié à la demande de Me Morice, qui, dans un courrier adressé à la garde des Sceaux, s’était plaint « du comportement parfaitement contraire aux principes d’impartialité et de loyauté des magistrats madame M. et Monsieur L. L. »24 ; or, ce passage fut repris dans un article du journal Le Monde, qui citait en parallèle la réaction de Me Morice évoquant la « connivence qui existe entre le procureur de Djibouti et les magistrats français »25. Ces propos aboutirent à la condamnation pour diffamation publique envers un fonctionnaire de l’avocat qui attaqua cette décision sur le fondement des articles 6, § 1 et 10 de la Convention.
Si la question du droit au procès équitable a fait l’objet de développements par la Cour, c’est plus l’interprétation que celle-ci fait de la liberté d’expression des avocats qui a retenu l’attention. En effet, la Cour a eu la difficile tâche de préciser sa position sur la conciliation entre la protection de la liberté d’expression des avocats et la sauvegarde de l’institution judiciaire, faisant la part belle à la première.
Elle rappelle alors le rôle spécifique de l’avocat (I) l’amenant à une protection renforcée de sa liberté d’expression en dehors du prétoire (II).
I. Le rôle spécifique de l’avocat mis en valeur par la Cour
La Cour, bien qu’attachée à la préservation des intérêts du pouvoir judiciaire, ne conteste pas pour autant le rôle spécifique de l’avocat (A), lui accordant même un rôle d’information du public dans certaines hypothèses (B).
A. Le rappel de la nécessité de protection de l’institution judiciaire mise en équilibre avec le rôle spécifique de l’avocat
Dans le cadre de l’affaire Morice, la Cour rappelle son attachement à la garantie de l’autorité du pouvoir judiciaire, considérant que « les questions concernant le fonctionnement de la justice (…) relèvent de l’intérêt général »26 et développe sur la nécessité de protéger une telle institution, tant en raison de sa mission que de la spécificité de celle-ci. Le gouvernement français avait par exemple soulevé la question du devoir de réserve des magistrats, qui ne pouvaient répondre aux attaques soulevées contre eux27, dont la Cour considère cependant qu’il ne peut « avoir pour effet d’interdire aux individus de s’exprimer, par des jugements de valeur reposant sur une base factuelle suffisante »28.
Plus précisément, le « rôle particulier des avocats »29 dans le système judiciaire est ainsi détaillé par la Cour, qui rappelle les obligations auxquelles ils sont soumis, tout en réaffirmant leur liberté d’expression30 qui ne peut qu’être limitée par la protection du pouvoir judiciaire « d’attaques gratuites ou infondées »31. Celle-ci confirme ainsi ses jurisprudences Nikula32 et Kyprianou33 considérant que « ce n’est qu’exceptionnellement qu’une limite touchant la liberté d’expression de l’avocat de la défense (…) peut passer pour nécessaire dans une société démocratique »34.
B. Le rôle d’information du public dévolu aux avocats
La Cour s’était déjà prononcée sur la question de la liberté d’expression des avocats, la protégeant dans la limite du raisonnable. L’affaire Morice est l’occasion pour elle de préciser les conditions d’exercice de cette liberté : l’avocat ne peut être « assimilé à un journaliste »35 car il ne « parle qu’en son nom et en celui de ses clients »36. Cependant, elle considère qu’« un avocat doit pouvoir attirer l’attention du public sur d’éventuels dysfonctionnements judiciaires, l’autorité judiciaire pouvant tirer bénéfice d’une critique constructive »37.
Tout en rejetant l’argument selon lequel l’avocat défendait les intérêts de sa cliente en livrant son opinion aux médias38, elle précise que « les propos reprochés au requérant, qui concernait également (…) le fonctionnement du pouvoir judiciaire et le déroulement de l’affaire Borrel, s’inscrivait dans le cadre d’un débat d’intérêt général, ce qui implique un niveau élevé de protection de la liberté d’expression allant de pair avec une marge d’appréciation des autorités particulièrement restreinte »39. L’avocat devient ainsi un rouage clé des débats d’envergures.
II. Les contours de la liberté d’expression des avocats précisée
La Cour, tout en rappelant la nécessité de distinction entre liberté d’expression dans et hors prétoire (A), précise l’importance de la distinction entre faits et jugement de valeur (B).
A. Le rappel de la distinction entre liberté d’expression dans et hors prétoire
La Cour rappelle ainsi l’importance de la distinction entre liberté d’expression dans et en dehors du prétoire : au-delà d’une jurisprudence abondante dans la première hypothèse, les propos tenus en dehors du prétoire peuvent « se poursuivre avec une apparition dans un journal télévisé ou une intervention dans la presse (…) et un avocat ne saurait être tenu responsable de tout ce qui figurait dans “l’interview” publiée »40. Cependant, un certain « devoir de prudence »41 est attendu de la part des avocats, qui doivent par ailleurs s’astreindre à ne pas tenir « des propos d’une gravité dépassant le commentaire admissible sans solide base factuelle »42. Cette question de la base factuelle devient alors un élément pivot du raisonnement de la Cour, qui l’applique aussi à la question du jugement de valeur.
B. La distinction entre déclaration de fait et jugement de valeur
La Cour fonde une partie de son analyse sur la distinction qu’elle opère entre déclaration de fait et jugement de valeur, la première impliquant un élément de preuve tandis que le second en serait exonéré, en raison de sa nature même43. La Cour s’attache alors à rappeler les critères de distinction entre les deux : la prise en compte des « circonstances de l’espèce »44 et de « la tonalité générale des propos »45, tout en précisant, point essentiel dans l’affaire Morice, que « des assertions sur des questions d’intérêt général peuvent constituer à ce titre des jugements de valeur plutôt que des déclarations de fait »46, reprenant ainsi sa jurisprudence Paturel47. Dans ce contexte, les propos tenus par Me Morice deviennent un jugement de valeur, étayé par une base factuelle suffisante au regard (entre autres) de l’enquête disciplinaire menée à l’encontre de la juge d’instruction. Le contrôle de proportionnalité exercé ici par la Cour, à l’aune de l’article 10, renforce ainsi la protection de la liberté d’expression des avocats en dehors du prétoire.
Gaëlle Lichardos
B – Cours supranationales et droit à des élections libres
La CEDEAO : pour des élections inclusives au Burkina
Très attendue à Ouagadougou, la décision de la Cour de justice de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CJCEDEAO) a finalement été rendue le 13 juillet 201548. Elle invalide le Code électoral burkinabè promulgué le 7 avril 2015 par les autorités de transition, suite à la chute du président Compaoré en poste depuis 27 ans.
Pour une affaire de droit électoral, le contexte de cette décision reste très politique. L’article 135 de la loi n° 005-2015 portant modification de la loi n° 014-2001/AN du 3 juillet 2001 rend « inéligibles » toutes les personnes ayant « soutenu un changement inconstitutionnel portant atteinte au principe de l’alternance démocratique, notamment au principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels ayant conduit à une insurrection ou à une toute autre forme de soulèvement ». Avec une telle disposition, il apparaît clair que l’objectif poursuivi était d’exclure les soutiens de Blaise Compaoré des prochaines élections présidentielles et législatives.
Le nouveau Code électoral a immédiatement déclenché une vive polémique au Burkina. C’est dans ce contexte de tension politique que la CJCEDEAO a été saisie par « un groupe de partis politiques et de citoyens » alliés du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP – ancien parti de feu le président Compaoré) et par quelques personnalités politiques engagées au côté du CDP. Les requérants ont demandé à la Cour l’abrogation de l’ajout au nouvel article 135, celui-ci violant leur droit à participer librement aux élections au titre de nombreux textes internationaux et régionaux opposables au Burkina Faso49.
Toute la question est donc de savoir si la modification de la loi électorale burkinabè, telle qu’elle est appliquée, méconnait le droit de certains partis politiques et citoyens à se présenter et à participer aux élections.
Statuant au fond, la Cour vient dénoncer l’illégalité de l’exclusion de la compétition électorale (I), avant de statuer en faveur de la protection exclusive des droits et libertés individuels (II).
I. La dénonciation de l’illégalité de l’exclusion de la compétition électorale
La Cour vient constater sa compétence et la recevabilité de la requête (A) avant de condamner la mesure comme discriminatoire (B).
A. L’affirmation de la compétence ratione materiae de la CJCEDEAO et la recevabilité de la requête
L’une des questions centrales dans pareil contexte semble être la question de compétence et de recevabilité. Pour le défendeur, l’État du Burkina Faso, l’instance de justice ouest-africaine est incompétente, et par ailleurs la requête est irrecevable, et mal fondée. Ainsi il n’y aurait pas de violation avérée des droits de l’Homme car le droit de participer librement à des élections serait individuel et non collectif, d’où une irrecevabilité de la requête des partis (mais pas des citoyens). L’État du Burkina ajoute que le droit de participer librement à des élections n’est pas absolu et que l’État était en droit d’y apporter des restrictions, ici justifiées par le soutien « anticonstitutionnel » des partisans de la révision constitutionnelle.
Sur la question de l’incompétence, la CJCEDEAO a rappelé qu’elle « peut valablement se préoccuper de violations non encore réalisées, mais très imminentes »50. Elle utilise le fait qu’elle soit saisie en urgence comme un argument : « si elle devait attendre que des dossiers de candidature soient éventuellement rejetés pour agir, si elle devait attendre l’épuisement des effets d’une transgression pour dire le droit, sa juridiction dans un contexte d’urgence n’aurait aucun sens, les victimes présumées de telles violations se retrouvant alors inexorablement lésées dans la compétition électorale »51.
Sur l’irrecevabilité cette fois, la Cour reconnaît qu’elle n’est pas saisie que par des partis politiques et que des citoyens sont également requérants. De plus, elle a soutenu que le droit de participer à des élections peut très bien être reconnu à des partis politiques, et juger l’inverse serait « purement artificiel et déraisonnable »52.
Sur le fond enfin, la Cour a souligné ne pas être juge de la légalité interne des États. Par conséquent, elle écarte aisément toute référence au droit interne burkinabè et considère les références à la Constitution burkinabè et à la Charte de transition comme inappropriées dans son prétoire : « Juridiction internationale, elle n’a vocation à sanctionner que la méconnaissance d’obligations résultant de textes internationaux opposables aux États ».
En raison de son champ de compétence bien précis, elle précise également ne pas interpréter le texte en question ; les juridictions nationales étant les seules compétentes à ce titre. On peut ne pas être convaincu, notamment à la lumière du considérant 25 : « Mais la Cour retrouve sa compétence dès lors que l’interprétation ou l’application d’un texte national a pour objet ou pour effet de priver des citoyens de droits tirés d’instruments internationaux auxquels le Burkina Faso est partie »53.
B. Une mesure nécessairement discriminatoire pour la CJCEDEAO
Selon l’instance de justice ouest-africaine, « il ne fait aucun doute que l’exclusion d’un certain nombre de formations politiques et de citoyens de la compétition électorale qui se prépare relève d’une discrimination difficilement justifiable en droit ». Elle ajoute plus loin, « il ne s’agit pas de nier que les autorités actuelles du Burkina Faso aient, en principe, le droit de restreindre l’accès au suffrage, mais c’est le caractère ambigu des critères de l’exclusion, et l’application expéditive et massive qui en est faite, que la Cour juge contraire aux textes »54. En principe, est considérée comme discriminatoire une différence de traitement entre des personnes placées dans la même situation et reposant sur une justification illicite ou illégitime. Or, en l’espèce, la Cour affirme ici une discrimination dont elle ne démontre pas l’existence et elle aboutit à cette conclusion sans démontrer que l’opération de modification de la Constitution porte atteinte à l’ordre démocratique et c’est un motif légitime qui justifie l’exclusion de certaines formations politiques. Elle reste également silencieuse quant à savoir si ceux qui ont conduit l’opération de modification de la Constitution sont dans la même situation que le reste du peuple burkinabè. La Cour admet uniquement que la restriction de ce droit d’accès à des charges publiques doit être justifié, notamment par la commission d’infractions particulièrement graves. Il ne s’agit donc pas de nier que les autorités Burkinabè aient le droit de restreindre l’accès au suffrage, mais c’est le caractère ambigu des critères de l’exclusion, et l’application expéditive et massive qui en est faite, que la Cour juge contraire aux textes. Il ressort ainsi de l’analyse de la décision un gênant sentiment d’absence de justification dans les appréciations des juges de la CJCEDEAO.
Ainsi, après avoir dénoncé l’illégalité de l’exclusion de la compétition électorale, la CEDEAO statue en faveur de la protection exclusive des droits et libertés individuels.
II. Le parti pris de la protection exclusive des droits et libertés individuels
Dans sa décision, la Cour rejette l’application indiscriminée de mesures coercitives (A) tout en recherchant l’appui de décisions internationales (B).
A. Le rejet de l’application indiscriminée de mesures coercitives
Il n’est pas sans rappeler que le contexte de la réforme du Code électoral est celui d’une véritable transition politique. Dans un second argument, la partie défenderesse justifie l’inéligibilité de certains partis par « le caractère illégal des changements anticonstitutionnels ». On peut se demander si le motif tenant à l’atteinte à l’ordre constitutionnel était en lui-même admissible et si la tentative de modification alors engagée par le régime du président Compaoré pouvait passer pour une telle atteinte. Mais là encore, la Cour rappelle simplement que « la sanction du changement anticonstitutionnel de gouvernement vise des régimes, des États, éventuellement leurs dirigeants, mais ne saurait concerner les droits des citoyens ordinaires. Ni l’esprit des sanctions des changements anti constitutionnels de gouvernements, ni l’évolution générale du droit international tendant à faire des “droits de l’Homme” un sanctuaire soustrait aux logiques des États et des régimes, n’autorise une application brutale et indiscriminée des mesures coercitives que l’on pourrait à cet égard concevoir »55. Elle invalide ainsi un dispositif hostile au régime précédent. Les juges vont plus loin en décidant de ne pas statuer sur le « caractère consensuel » ou non de l’exclusion du clan « Compaoristes ».56 Ceci est d’autant plus déplaisant quand on a en mémoire les heurts et les affrontements à la suite du projet de réforme constitutionnelle. Des faits tragiques que la Cour elle-même rappelle au début de sa décision.
B. Des références internationales maladroites en appui à la décision de la Cour
Après avoir pris position sur le point de droit, la Cour fait appel à deux références internationales, une observation du Comité des droits de l’Homme des Nations unies57 et un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme58. On peut valablement se demander quels sont les motifs de ces obiter dicta : la CEDEAO souhaite-t-elle s’insérer dans un réseau de juridictions internationales pour s’attirer le respect dont elles bénéficient et gagner en influence, ou est-ce pour ancrer davantage sa décision dans la continuité des décisions prises par ces dernières. Souhaite-t-elle « sanctuariser » les droits de l’Homme en les soustrayant aux logiques des États ou nous livre-t-elle ici avec un peu d’audace, un « principe général du droit “international” des transitions politiques/du droit électoral transitoire ».
Autre singularité qu’il convient de souligner : l’interprétation sélective de la CEDEAO. La Cour cite l’arrêt Paksas c/ Lituanie 06/01/2011 afin de démontrer que sa position est en accord avec celle d’autres instances juridictionnelles, telle que la CEDH. Or, cette dernière adopte une approche plus prudente quant à la question des restrictions au droit de vote. Elle recommande aux juges européens de mettre en équilibre les droits et libertés individuelles et le droit à « l’autoprotection » démocratique. Il est ainsi embarrassant de voir que la CEDEAO semble ne pas les avoir mis en balance, ayant choisi de protéger exclusivement les droits et libertés individuels alors même qu’il existe de nombreux textes susceptibles d’accréditer l’existence, dans le droit continental africain, de l’exigence de protection de l’ordre démocratique59.
Cyrine Jhinaoui
VII – Cours supranationales et enfermement
L’apport du pragmatisme au droit d’espérance des détenus condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité (CEDH, gde ch., 26 avr. 2016, n° 10511/10, Murray c/ Pays-Bas)
« La certitude d’une punition, même modérée, fera toujours plus d’impression que la crainte d’une peine terrible si à cette crainte se mêle l’espoir de l’impunité ; les moindres maux, s’ils sont inévitables, effraient les hommes, tandis que l’espoir, ce don du ciel qui souvent nous tient lieu de tout, écarte la perspective des pires châtiments »60.
Le droit d’espoir des détenus condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité doit-il revêtir une assise factuelle effective, y compris pour un détenu ayant une déficience mentale ? C’est à cette question qu’a dû répondre la CEDH dans un arrêt de Grande chambre le 26 avril 201661.
En l’espèce, le requérant avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre d’une fillette. L’examen des circonstances entourant ce drame démontrait que celui-ci avait des facultés mentales amoindries n’ayant toutefois pas entraîné une atténuation de sa peine62. L’exécution de la sentence a toutefois révélé que le requérant n’avait jamais reçu un traitement psychiatrique lui permettant de bénéficier d’un espoir de libération, écartant, dès lors, toutes ses demandes de grâce au motif de lutter contre la récidive. La CEDH a ainsi été amenée à confronter les dispositions de l’article 3 de la Convention à l’enfermement perpétuel de facto d’une personne atteinte d’un trouble du discernement n’ayant jamais reçu un traitement lui permettant d’espérer un élargissement, concluant ainsi, à l’unanimité, à la violation de l’article 3.
La question de la compatibilité des peines perpétuelles avec la Convention a reçu un accueil subtil par les juges de Strasbourg ; tout en admettant l’existence de cette peine, la CEDH a été amenée à considérer que la perpétuité incompressible sans espoir de sortie constitue un traitement inhumain et dégradant63.
La Cour venant ainsi ériger le droit d’espoir des détenus perpétuels comme un droit concret devant avoir des répercussions pratiques. L’arrêt traduit cette réaffirmation de l’existence du droit à l’espoir (I) tout en garantissant son exercice (II).
I. La confirmation de l’existence du droit d’espérance
L’existence du droit à l’espoir des détenus perpétuels démontre que la Convention européenne des droits de l’Homme est un « instrument vivant » (A) permettant de qualifier la perpétuité incompressible comme contraire à l’article 3 (B).
A. L’illustration de l’interprétation dynamique et évolutive de la Convention
L’objectif de l’interprétation dynamique et évolutive des juges strasbourgeois traduit une appréciation à la lumière de conditions de la vie actuelle. L’arrêt Murray se situe au sein d’une jurisprudence bien établie de la CEDH tout en lui apportant des garanties. Ce positionnement ayant cependant fait l’objet d’une évolution épisodique. Dans un premier temps, les juges strasbourgeois usaient du conditionnel lorsqu’ils étaient confrontés à cette interrogation64, ouvrant la porte aux futurs contentieux. Dans un deuxième temps, la Cour commença à asseoir une jurisprudence faisant émerger un droit à l’espérance des détenus condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité en s’intéressant à l’existence dans les arsenaux législatifs internes de mécanismes prévoyant les libérations65. Dans un troisième (et dernier ?) temps, la Cour appréhenda, dans l’arrêt Vinter66, l’application même de ces arsenaux, faisant émerger l’appréciation de jure et de facto des possibilités de libération. L’arrêt Murray se situerait dans cette perspective, venant assoir la jurisprudence Vinter tout en mettant en relief les obligations pour les États de disposer de moyens visant à la réinsertion des détenus ayant des déficiences mentales afin de lutter contre une mesure constituant un traitement inhumain et dégradant.
B. La reconnaissance du caractère inhumain et dégradant de la perpétuité incompressible
L’arrêt Murray se fonde sur l’interdiction des traitements inhumains et dégradants pour les États. Cette interdiction constitue un droit inconditionnel faisant partie du « noyau dur » de la Convention. Corollaire du droit à la vie, l’interdiction des traitements inhumains et dégradants consacre « l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques »67. « Peine de mort à petit feu » et « déni d’humanité » pour un auteur68, la perpétuité incompressible a fait l’objet d’une étude approfondie par les juges de Strasbourg. La CEDH étant ici sensible aux objectifs de réclusion mais également d’amendement du détenu69. Ce dernier objectif est particulièrement appréhendé dans l’arrêt Murray70 puisque la CEDH voit dans la réinsertion des détenus une application même du principe de dignité humaine. L’analyse de la peine perpétuelle à l’aune de l’article 3 de la Convention revêt donc un droit d’espoir du détenu de bonne foi. Ne devant être perçu comme une position « angélique » ; la Cour rappelle que « le simple fait qu’une peine perpétuelle puisse en pratique être purgée dans son intégralité ne la rend pas incompressible »71. Autrement dit, l’analyse du mauvais traitement se perçoit ici comme le fait pour un détenu présentant, ou voulant présenter, des gages de réinsertion, de ne pouvoir bénéficier d’un élargissement eu égard à sa situation entravant sa liberté d’aller et venir, alors que les États doivent pouvoir garantir la réinsertion dudit détenu. L’arrêt Murray présente en l’occurrence un détenu voulant présenter ces gages, sans que l’État ne mette en œuvre les moyens d’y parvenir, violant dès lors, l’article 3 de la Convention.
Aussi, la CEDH met en avant l’exercice même du droit d’espoir auquel les détenus perpétuels doivent pouvoir accéder.
II. Le contrôle de l’exercice du droit d’espérance
Si l’existence d’un droit est invoquée par la CEDH, encore faut-il qu’il puisse être exercé. C’est pourquoi les juges de Strasbourg ont renforcé les obligations positives incombant aux États (A), tout en appréhendant la question de la grâce (B).
A. Le renforcement des obligations positives des États
Les obligations positives traduisent une obligation d’agir de la part des États. Ces obligations se retrouvent, essentiellement, dans l’obligation de protection de la vie découlant de l’article 2. Toutefois, la Cour a étendu l’application des obligations positives sur le fondement de l’article 3 en appréhendant le cas de la réinsertion des détenus. Si cette dernière n’a pas à s’ingérer dans les dispositifs mis en place par les États72, les juges de Strasbourg vont venir contrôler l’existence de mécanismes, mais aussi estimer si ces mécanismes existants sont suffisamment sérieux et permettent la mise en œuvre concrète du droit d’espoir inhérent aux détenus perpétuels. Les États étant astreints à une obligation de moyens quant à l’effectivité des mécanismes de réinsertion des détenus perpétuels73, l’arrêt Murray présente une originalité dans la mesure où les demandes de grâces et les demandes de libération du requérant furent refusées au motif d’une lutte contre la récidive due aux déficiences mentales du requérant. Aussi, les juges de Strasbourg ont exprimé l’obligation de la part des États de dispenser aux détenus ayant des problèmes de santé, y compris mentaux, des soins adéquats74. Cette analyse, venant corroborer la violation de l’article 3 doit être approuvée ; si les États sont soumis à une obligation de moyens quant à l’amendement des détenus, il serait choquant de distinguer les détenus « sains d’esprit » des détenus nécessitant des soins leur permettant d’accéder à l’amendement alors que les voies d’élargissement de jure leur sont ouvertes. Cet apport pragmatique de la Cour doit être salué puisque l’existence d’un droit ne serait qu’un leurre si son exercice était remis intégralement en cause !
Il convient de préciser également que le requérant bénéficia d’une grâce pour motif humanitaire.
B. Une précision apportée quant à la grâce
Si la Cour n’a pas à s’ingérer dans la création et dans la mise en œuvre des dispositifs offerts aux détenus pour bénéficier d’une libération, elle peut toutefois apprécier la compatibilité de ladite mesure avec les perspectives d’élargissement que doivent présenter les États. En l’espèce, le requérant bénéficia d’une grâce pour raison humanitaire au motif d’une grave maladie entraînant son décès. Toutefois, la Cour précisa que les perspectives d’élargissement doivent être impérativement fondées sur des règles précises ayant un degré certain de clarté et de certitude75 et décider qu’un mécanisme de grâce présidentielle pouvait satisfaire à ces exigences76. Cet emploi du conditionnel n’était pas sans incidence ; la Cour ayant retenu dans la présente décision une incompatibilité entre la mesure de grâce octroyée au requérant et la mesure d’élargissement. En effet, cette grâce ne présentait pas les garanties juridiques nécessaires étant fondée uniquement sur un motif humanitaire et non sur l’amendement.
Fabien Romey
VIII – Cours supranationales et nouvelles technologies
L’arrêt Schrems : la Cour de justice gardienne des droits fondamentaux en matière de transfert et de protection des données à caractère personnel
Le 6 octobre 2015, la Cour de justice a rendu un arrêt Schrems77 ayant eu d’importantes conséquences politiques78. Saisie d’une demande de décision préjudicielle introduite par la High Court79, la Cour de justice a estimé que la décision n° 2000/520 de la Commission80 qui stipulait que les États-Unis assuraient un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel transférées était invalide. Cette demande de décision préjudicielle a été introduite à l’occasion d’un litige qui opposait Maximillian Schrems, ressortissant autrichien, au commissaire à la protection des données en raison du refus de ce dernier d’enquêter sur la plainte que M. Schrems avait déposée afin d’interdire que Facebook Ireland continue de transférer ses données aux États-Unis. Il considérait en effet que le droit et les pratiques en vigueur dans cet État, ne garantissaient pas un niveau de protection suffisant des données81. Le commissaire a rejeté la demande d’enquête au motif que dans sa décision, la Commission avait établi que les États-Unis assuraient un niveau adéquat de protection. Face à ce refus, M. Schrems a introduit un recours devant la High Court qui, en substance, a demandé à la Cour de justice si la décision n° 2000/520 constatant qu’un pays tiers assure un niveau de protection adéquat, fait obstacle à ce qu’une autorité de contrôle d’un État membre puisse examiner la demande d’une personne faisant valoir que le droit et les pratiques en vigueur dans cet État n’assurent pas un niveau de protection suffisant de ses droits et libertés dans le cadre du traitement de données à caractère personnel transférées.
Confrontée à la nécessité d’articuler le couple libre circulation des données et protection de ces données, la Cour de justice, dans la droite lignée de son arrêt Digital Rights Ireland82, a fait le choix de s’ériger en « défenseur des libertés fondamentales des citoyens européens face aux États »83. Grâce à une interprétation audacieuse de la directive n° 95/46/CE, le juge de l’Union a reconnu que les autorités nationales étaient compétentes pour procéder à l’examen du transfert de données au regard des exigences du droit de l’Union (I). De surcroît, il s’est livré à un examen minutieux de la validité de la décision de la Commission, s’engageant dès lors fermement en faveur de la promotion de la protection des droits fondamentaux des citoyens de l’Union (II).
I. La reconnaissance d’une compétence au profit des autorités nationales de contrôle pour examiner le transfert de données vers un État tiers
La Cour de justice en reconnaissant une compétence au profit des autorités nationales pour soulever les défaillances affectant la protection des données dans un État tiers a donc neutralisé le caractère contraignant de la décision n° 2000/520 (A). Elle a par ailleurs livré un guide de l’examen de compatibilité de la décision avec les droits fondamentaux (B).
A. La neutralisation partielle du caractère contraignant de la décision n° 2000/520
La Cour de justice après avoir rappelé que les règles en matière de données personnelles devaient être interprétées à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Charte, a développé un raisonnement audacieux lui permettant de favoriser la protection des droits fondamentaux au détriment de l’application automatique de la décision. Après avoir souligné qu’en vertu de l’article 288, alinéa 4, TFUE, une décision était obligatoire dans tous ses éléments et s’imposait donc aux États membres ; elle a procédé à une interprétation systématique et téléologique de la directive afin de pouvoir annihiler pour partie le caractère contraignant de la décision prise sur son fondement. Relevant dès lors que l’objectif de la directive était de garantir un niveau élevé de protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes, elle a finalement estimé que le fait d’empêcher les particuliers de pouvoir saisir les autorités nationales compétentes pour contrôler le transfert de leurs données serait contraire aux prescriptions contenues dans l’article 8, § 1 et § 3 de la Charte des droits fondamentaux. Mais au-delà d’avoir consacré la compétence des autorités nationales, la Cour de justice a pris le soin d’exposer les principes régissant l’examen de la compatibilité de la décision avec les libertés et droits fondamentaux des personnes.
B. La définition du cadre de l’examen de compatibilité de la décision avec les libertés et droits fondamentaux des personnes
Après avoir reconnu qu’il incombait aux autorités nationales d’examiner la demande relative à la protection des droits et libertés à l’égard du traitement de données à caractère personnel ayant été transférées vers un pays tiers ; la Cour de justice, en substance, a rappelé que la garantie de l’effectivité du droit de l’Union imposait que le requérant et l’autorité de contrôle puissent, dans tous les cas, avoir accès au prétoire du juge national afin que celui-ci puisse contrôler si ledit transfert respectait les exigences du droit de l’Union. Dans la plus pure orthodoxie communautaire84, la Cour a ensuite rappelé qu’elle disposait d’un monopole juridictionnel pour invalider les actes du droit de l’Union et qu’en cas de doute, la juridiction nationale était donc tenue de procéder à un renvoi préjudiciel en appréciation de validité.
Après avoir défini le cadre de cet examen de compatibilité de la décision avec les exigences tirées du droit de l’Union, la Cour de justice a procédé à l’examen de la validité de la décision.
II. L’engagement de la Cour de justice en faveur de la promotion de la protection des droits fondamentaux des personnes
La Cour de justice en retenant une conception exigeante de la notion de protection adéquate (A), a été conduite à condamner sans appel le mécanisme du Safe Harbor (B).
A. Le développement d’une conception exigeante de la notion de protection adéquate
Afin d’apprécier la validité de la décision n° 2000/520, la Cour de justice devait examiner sa conformité aux exigences de la directive, lue à la lumière de la Charte. Or, pour qu’une telle conformité soit reconnue, il devait être établi que les États-Unis assuraient un niveau de protection adéquat des données personnelles85. S’interrogeant sur cette notion, la Cour de justice en a retenu une conception exigeante tant du point de vue de sa substance que de son contrôle. En premier lieu en effet, bien qu’estimant qu’un niveau adéquat n’impliquait pas une identité de protection avec celle garantie au sein de l’ordre juridique de l’Union, elle a néanmoins relevé que la notion de protection adéquate devait être entendue comme une protection substantiellement équivalente. En second lieu, elle a estimé que l’examen par la Commission de l’existence d’une protection adéquate, devait être effectué de manière périodique dans la mesure où le degré de protection était susceptible d’évoluer. Une fois ce cadre théorique esquissé, la Cour de justice a procédé à un contrôle du Safe Harbor afin de déterminer si celui-ci était compatible avec les exigences tirées du droit de l’Union.
B. Une condamnation sans appel du mécanisme du Safe Harbor
Procédant dès lors à l’analyse du système de traitement des données des États-Unis, la Cour de justice a, d’une part, souligné que les principes de la « sphère sécurité » ne s’appliquaient pas aux autorités publiques américaines et d’autre part, elle a relevé que le système mis en place autorisait des ingérences dans la protection des droits fondamentaux des personnes dont les données étaient transférées. La mise en exergue de ces défaillances l’a donc conduit à estimer que la réglementation américaine contrevenait aux articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux. Elle en a donc déduit que la Commission avait commis une erreur dans l’examen du niveau de protection des données offert par le système américain, que de ce fait sa décision était invalide. Si l’œuvre jurisprudentielle de la Cour de justice en matière de droits fondamentaux est parfois critiquée, on ne peut que se féliciter de la place centrale qu’elle accorde aux exigences liées à la protection des droits des personnes en matière de transfert et de protection des données à caractères personnel.
Julie Teyssedre
IX – Cours supranationales et terrorisme
À catégorie spéciale de criminalité, exigences conventionnelles résiduelles ? (CEDH, 20 oct. 2015, n° 5201/11, Sher et a. c/ Royaume-Uni)
À l’heure où les démocraties européennes renforcent leurs législations en matière de lutte contre le terrorisme86, la Cour européenne des droits de l’Homme (la Cour) dans l’affaire Sher et a. c/ Royaume-Uni87, vient apporter d’importantes précisions quant à la délicate question de la proportionnalité entre lutte effective contre ce phénomène et protection des droits fondamentaux88.
Les requérants, trois ressortissants pakistanais séjournant au Royaume-Uni, furent arrêtés et placés en détention dans le cadre d’une opération antiterroriste. Prolongée à deux reprises, leur détention dura treize jours. Ils furent ensuite libérés sans être inculpés. La conformité de la procédure suivie, aux articles 5, § 4 et § 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (la Convention), fut contestée par les requérants. Ils se plaignirent de ne pas avoir eu accès à certains éléments de preuve et de s’être vus écartés d’une partie de la première audience de prolongation de leur détention. De même, ils attaquèrent la proportionnalité des perquisitions réalisées à leurs domiciles, estimant le mandat de perquisition trop vague. Enfin, ils invoquèrent l’article 5, § 2 et § 489 mais la Cour refusa de se prononcer, les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées90. Néanmoins, elle accepta de statuer quant aux deux autres griefs et conclut à la non-violation de la Convention.
En effet, la Cour réaffirme la spécificité de la criminalité terroriste et en explicite les critères (I). Une fois la notion cernée et caractérisée, elle procède à un contrôle de conformité restreint en ce qu’elle abaisse sensiblement les standards de protection communément garantis (II).
I. La démonstration d’une catégorie spécifique de criminalité
L’affirmation selon laquelle la criminalité terroriste relève d’une catégorie spéciale n’est pas nouvelle (A), cela étant, la Cour semble dégager un critère déterminant, l’urgence (B).
A. La réaffirmation de la spécificité de la criminalité terroriste
Selon la Cour, « le terrorisme entre dans une catégorie spéciale » (§ 149). Déjà, dans les arrêts Fox, Campbell et Hartley91 et Murray92, elle avait avancé cet argument pour justifier certaines restrictions aux droits garantis par l’article 5, § 1 et § 2 de la Convention. De jurisprudence constante93, la Cour précise les éléments fondant l’originalité de la criminalité terroriste : elle relève, en l’espèce, le risque de pertes de vies et de souffrances humaines ainsi que la complexité des affaires terroristes (§ 149).
À l’analyse de la jurisprudence de la juridiction strasbourgeoise, deux critères sont soulignés : la gravité et la complexité des poursuites. Cela étant, il ne s’agit pas de brandir la spécificité de la criminalité terroriste pour justifier toutes exceptions aux garanties procédurales et, in fine, aux droits fondamentaux. Aussi, la Cour exerce toujours une appréciation in concreto. Elle relève, en l’espèce, que les allégations « concernaient une attaque terroriste à grande échelle qui, si elle était réalisée, était susceptible d’entraîner une perte importante de vies et des blessures graves » (§ 150) et souligne la complexité des poursuites en cause (§ 174). Néanmoins, un nouveau critère d’importance semble être mis en exergue, l’urgence.
B. La mise en exergue d’un nouveau critère : l’urgence
Outre la gravité et la complexité des affaires terroristes, la Cour souligne l’importance de l’urgence liée à ce type de criminalité. En effet, elle soutient « que la menace d’une attaque terroriste imminente, identifiée dans le cadre de l’opération Pathway, justifiait amplement l’imposition de certaines restrictions » (§ 150) aux garanties de l’article 5, § 4. De la même façon, en se prononçant sur l’article 8, elle affirme que « l’urgence de la situation ne peut pas être ignorée » (§ 174).
La Cour a fait usage de ce critère, plus timidement, dans l’arrêt Ibrahim et a. en considérant que « la menace exceptionnellement grave et imminente » de nouveaux attentats justifiait le report de l’intervention d’un avocat94. Si ce nouveau critère semble pertinent, il présente l’inconvénient, dans un contexte où l’urgence semble permanente, de conduire à un postulat difficilement contestable. Les attentats successifs frappant les États parties pouvant conduire la Cour à affirmer, mécaniquement, que le terrorisme relève d’une catégorie spéciale95. S’il est important que la Cour veille à s’assurer de la présence de circonstances impérieuses contextuelles c’est en ce qu’elles permettent l’application d’un régime plus permissif.
II. L’application d’un régime protecteur résiduel
La Cour apporte d’importantes restrictions aux garanties procédurales des individus (A) tout en veillant à ne pas les livrer à l’arbitraire le plus total (B).
A. Une spécificité justifiant des restrictions substantielles aux garanties procédurales
La Cour se prononce sur l’article 5, § 4 garantissant le droit d’introduire un recours pour contester la légalité d’une détention. Véritable Habeas Corpus de la Convention, il implique que la procédure suivie respecte les garanties du procès équitable. Néanmoins, si l’article 5, § 4 oblige la procédure à revêtir un caractère judiciaire, il n’impose pas le respect « de garanties identiques à celles de l’article 6 » (§ 147)96. Surtout, l’argument de la spécificité de la criminalité terroriste prenant alors tout son intérêt, dans ce cadre on ne saurait imposer « des difficultés disproportionnées dans l’action des autorités de police visant à prendre des mesures efficaces pour lutter contre le terrorisme organisé » (§ 149). Dès lors, la Cour admet la tenue d’une audience à huis-clos, faisant exception à l’exigence selon laquelle les pièces fondant « le soupçon raisonnable », justifiant à la fois la mise en détention que son éventuelle prolongation, doivent être présentées aux requérants97.
S’agissant de l’article 8, la question portait sur le caractère « nécessaire dans une société démocratique » des perquisitions. Rappelant une jurisprudence constante, la Cour nous livre les éléments pris en considération : la perquisition doit être effectuée conformément à un mandat délivré par un juge, sur la base de soupçons raisonnables, dont la portée doit être raisonnablement limitée98. La Cour reconnaît que le mandat de perquisition était rédigé en des termes larges mais affirme que « les spécificités d’une liste d’éléments susceptibles d’être saisis dans une perquisition réalisée par les forces de l’ordre peuvent varier d’un cas à l’autre, en fonction de la nature des allégations en question » (§ 174).
B. Le contrôle de garanties minimales contre l’arbitraire
En conséquence, la criminalité terroriste suppose qu’une certaine souplesse soit accordée à la police afin qu’elle puisse mener à bien ses enquêtes. Cela étant, l’intervention d’un juge, en amont et en aval, semble avoir été déterminante dans la solution de conventionnalité de la Cour99, bien qu’un doute subsiste sur la teneur des preuves présentées au juge lors du huis-clos, aucune charge n’ayant finalement été retenue contre les requérants100. De la même manière, dans l’arrêt Ibrahim, la Cour avait mis en avant l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants pour compenser l’atteinte aux droits de la défense des requérants. Aussi, sous réserve du respect de certaines garanties minimales contre l’arbitraire, les États semblent avoir les mains libres dans leur lutte contre la crise actuelle mais, attention, comme l’affirmait Guy Braibant, « les crises laissent derrière elles comme une marée d’épais sédiments de pollution juridique »101.
Alice Mornet
Notes de bas de pages
-
1.
Berlin D., « Les limites du mandat d’arrêt européen », JCP G, 2016, 15, spéc. n° 440 ; Broussy E., Cassagnabère H. et Gänser C., « Mandat d’arrêt européen », in « Chronique de jurisprudence de la CJUE », AJDA 2016, p. 1059 ; Devouèze N., « Exécution d’un mandat d’arrêt européen en cas de risque de traitement inhumain en détention », Dalloz actualité, 9 mai 2015 ; Gazin F., « Droits fondamentaux », Europe juin 2016, comm. 192.
-
2.
V. Parizot R., « Le principe ne bis in idem dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme », AJ pénal 2015, p. 173.
-
3.
V. en ce sens l’exemple français. Cons. const., 18 mars 2015, nos 2014-454 et 2015-662 QPC, M. John L. et a. V. not. de Lamy B., « Le non cumul des sanctions par la non constitutionnalisation du principe ne bis in idem », RSC 2015, p. 705. Cette évolution doit être, toutefois, relativisée par Cons. const., 24 juin 2016, nos 2016-546 et 2016-545 QPC, M. Jérôme C. V. not. Collet M. et Collin P., « Le cumul de sanction pénale et fiscale face aux exigences constitutionnelles et européennes », JCP G 2016, p. 847.
-
4.
CEDH, 9 juin 2016, nos 6662/09 et 71879/12, Sismanidis et Sitaridis c/ Grèce. V. not. Andriantsimbazovina J., « Des personnes acquittées par les juridictions pénales ne peuvent plus faire l’objet de sanctions administratives pour les mêmes faits », Gaz. Pal. 19 juill. 2016, n° 270u0, p. 22.
-
5.
À cet égard, l’arrêt met en exergue l’importance de soulever devant les juridictions nationales tous les griefs tirés de la violation de la Convention européenne au risque de se voir opposer l’irrecevabilité de leur requête pour non-épuisement des voies de recours internes au regard de l’article 35.
-
6.
CEDH, 30 avr. 2015, nos 3453/12, 42941/12 et 9023/13, Kapetanios et a. c/ Grèce. V. not. Andriantsimbazovina J., « Des personnes acquittées par les juridictions pénales ne peuvent plus faire l’objet de sanctions administratives pour les mêmes faits », Gaz. Pal. 12 sept. 2015, n° 238r1, p. 16.
-
7.
CEDH, 8 juin. 1976, n° 51000/71, Engel et a. c/ Pays-Bas.
-
8.
CEDH, gde ch., 10 févr. 2009, n° 14939/03, Sergueï Zolotoukhine c/ Russie. V. not. Pradel J., « Principe ne bis in idem, poursuites successives de nature différentes et Cour européenne des droits de l’Homme », D. 2009, p. 2014.
-
9.
CEDH, 9 avr. 2015, n° 65829/12, Tchokontio Happi c/ France, définitif le 9 juillet 2015, en vertu de l’article 44, § 2, de la Convention de sauvegarde européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Andriantsimbazovina J., « L’inexécution d’un jugement définitif qui octroie un logement dans le cadre de la loi Dalo est contraire à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme », Gaz. Pal. 12 sept. 2015, n° 238r1, p. 15 ; Gonzalez G., « Pour un droit effectif au logement opposable », JCP G 2015, 480 ; Fricero N., « Attribution effective d’un logement social et procès équitable », Procédures juin 2015, comm. 191 ; de Monteclerc M.-C., « La France condamnée par la CEDH pour non application du droit au logement », AJDA 2015, p. 720 ; Noguellou R., « Le droit au logement opposable devant le Cour européenne des droits de l’Homme », Dr. adm. 2015, alerte n° 43.
-
10.
L. n° 2007-290, 5 mars 2007, art. 9, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : JO n° 55, 6 mars 2007, p. 4190.
-
11.
CEDH, 8 oct. 2012, n° 65829/12.
-
12.
En vertu de l’article 35 de la Convention, la mise en œuvre du principe de subsidiarité ne semble soulever aucune difficulté.
-
13.
Écartant une « espérance légitime » d’acquérir la propriété d’un logement pour la requérante, la Cour estime que le droit au bail oblige l’État, tout au plus, à mettre à la disposition de la requérante un logement, § 59.
-
14.
§ 44.
-
15.
CEDH, 19 mars 1997, n° 18357/91, Hornsby c/ Grèce : Rec. CEDH 1997, p. 510, § 40 – CEDH, 31 mars 2009, n° 22644/03, Simaldone c/ Italie, § 42.
-
16.
CEDH, 17 juin 2003, n° 34647/97, Ruianu c/ Roumanie, § 66.
-
17.
§ 39.
-
18.
CEDH, 31 mars 2005, n° 62740/00, Matheus c/ France, § 58 – CEDH, 2 mars 2004, n° 48102/99, Sabin Popescu c/ Roumanie, § 68-76.
-
19.
§ 50, CEDH, 15 janv. 2009, n° 33509/04, Bourdov c/ Russie, § 70 – CEDH, 26 sept. 2006, n° 57516/00, Sté de gestion du port de Campoloro et Sté fermière de Campoloro c/ France, § 62.
-
20.
V. not. Cons. const., 6 mars 2015, n° 2014-455 QPC : JO n° 57, 8 mars 2015, p. 4313.
-
21.
V. not. CE, 2 juill. 2010, n° 332825 : JCP A 2010, 2305, note Zitouni F.
-
22.
CEDH, 29 mars 2006, n° 36813/97, Scordino c/ Italie (n° 1), § 198.
-
23.
CEDH, 23 avr. 2015, n° 29369/10, Morice c/ France : Dr. et procéd. 1er mai 2015, p. 2-7, obs. Fricero N. ; RLDI 1er mai 2015, p. 41, Costes L. ; JCP G 2015, p. 889, Blay-Grabarczyk K. ; Gaz. Pal. 21 mai 2015, n° 223v5, p. 30, Berlaud C. ; Royer G., Lexbase Hebdo n° 194, 21 mai 2015 ; Dr. pén. 1er juin 2015, étude n° 14, Marechal J-Y. ; Dr. pén. 1er juin 2015, p. 17-28, Mouysset O. ; JCP G 2015, p. 1129, Levy D. ; Gaz. Pal. 18 juin 2015, n° 228j8, p. 19-21, Piot P. ; RLDI 1er juill. 2015, p. 28-33, Lyn F. ; RSC 1er juill. 2015, p. 740-746, Roets D. ; Rev. pénit. 1er juill. 2015, p. 693-713, Lepage A. ; Gaz. Pal. 10 juill. 2015, n° 232w6, p. 20-21, De Belval B. ; JCP G 2015, 1384-1390, Sudre F. ; Légipresse 1er sept. 2015, p. 485-494, Ader B. ; Légipresse 1er sept. 2015, pp. 501-508, Bigot C. ; AJDP 1er sept. 2015, p. 428-430, Poteron C. ; Gaz. Pal. 12 sept. 2015, n° 239b2, p. 21, Andriantsimbazovina J. ; AJDA 28 sept. 2015, p. 1732, Burgorgue-Larsen L. ; JCP G 2015, 2014-2021, Tricoire E. ; Journal du droit des jeunes 2015/4, p. 58-64, Ronge J.-L. ; D. 2016, p. 225-233, Renucci F. ; Légipresse 1er mars 2016, p. 183-192, Guerder P. ; Dr. pén. 1er avr. 2016, p. 17-23, Dreyer E.
-
24.
Lettre adressée par M. Morice et son confrère au garde des Sceaux, citée par CEDH, Morice c/ France, préc., § 33.
-
25.
Le Monde, 3 juill. 2000, cité par CEDH, Morice c/ France, préc., § 34.
-
26.
CEDH, Morice c/ France, préc., § 128.
-
27.
Idem.
-
28.
Idem., § 168.
-
29.
Idem, § 133.
-
30.
Idem, § 134.
-
31.
Idem.
-
32.
CEDH, 21 mars 2002, n° 31611/96, Nikula c/ Finlande, § 55 : Gaz. Pal. 11 juill. 2006, n° G1643, p. 2-6, obs. Renaudie V. ; Gaz. Pal. 21 juin 2007, n° G4118, p. 2-8, Francois L.
-
33.
CEDH, 15 déc. 2005, n° 73797/01, Kyprianou c/ Chypre, § 174 : JDI, 1er juill. 2006, p. 1100-1102, obs. Maurice C. ; Gaz. Pal. 11 juill. 2006, n° G1643, p. 2-6, obs. Renaudie V. ; JCP G 2006, 2159-2164, Dreyer E. ; D. 2007, p. 825-834, note Blanchard B.
-
34.
CEDH, Morice c/ France, préc., § 134.
-
35.
Idem, § 148.
-
36.
Idem, § 168.
-
37.
Idem, § 167.
-
38.
Idem, § 148.
-
39.
Idem, § 153.
-
40.
Idem, § 138
-
41.
Idem.
-
42.
Idem, § 139.
-
43.
Idem, § 126.
-
44.
Idem.
-
45.
Idem.
-
46.
Idem.
-
47.
CEDH, 22 déc. 2005, n° 54968/00, Paturel c/ France, § 37 : JCP A 2006, 453-462, obs. Dubos O ; JDI 1er juill. 2006, p. 1149-1150, de La Hougue C. ; JCP G 2006, 2159-2164, Dreyer E.
-
48.
CJCEDEAO, 13 juill. 2015, n° /CCJ/APP/19/15, Congrès pour la démocratie et le progrès c/ Burkina Faso.
-
49.
DUDH, 1948, art. 2, al. 1er et art. 21, al. 1 et 2 ; Pacte international relatif aux droits civil et politiques de 1966 des Nations unies, art. 26 ; Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples art. 2 et 13, al. 1 et 2 ; Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, art. 3.7, 3.11, 4.2, 8.1 et 10.3 ; Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance-CEDEAO, art. 1er, i).
-
50.
CJCEDEAO, 18 nov. 2010, Hissène Habrè c/ État du Sénégal : « indices raisonnables et convaincants de probabilité de réalisation d’actions » susceptibles de violer les droits de la personne.
-
51.
§ 18 de l’arrêt en commentaire.
-
52.
§ 20 de l’arrêt en commentaire.
-
53.
§ 25 de l’arrêt en commentaire.
-
54.
§ 28 de l’arrêt en commentaire.
-
55.
§ 30 de l’arrêt en commentaire.
-
56.
§ 37 de l’arrêt en commentaire.
-
57.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques – Comité des droits de l’Homme des Nations unies, obs. 25, art. 40, § 4.
-
58.
CEDH, 6 janv. 2001, Paksas c/ Lituanie.
-
59.
Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, art. 25, § 4 ; Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO, art. 45.
-
60.
Beccaria C., Des délits et des peines, 1991, Flammarion, p. 123.
-
61.
D. 2016, p. 1542, obs. Renucci J.-F. ; Dr. pén. 2016, comm. n° 120, obs. Peltier V. ; AJ pénal 2016, p. 322, obs. Vouleli V. et Van Zyl Smit D. ; JCP G, 569, spéc. n° 19, obs. Sudre F. Un premier arrêt ayant été rendu dans cette affaire ayant retenu la non violation de l’article 3 en raison de l’insertion par le législateur hollandais d’une voie de réaménagement de la peine en 2011.
-
62.
Le requêtant avait été condamné en première instance à une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Cette sentence fût aggravée en appel à la réclusion criminelle à perpétuité retenant des agissements délibérés et prémédités commis « avec calme » et « sang-froid » (§ 15).
-
63.
Renucci J.-F., Droit européen des droits de l’Homme, 6e éd., 2015, LGDJ, n° 134.
-
64.
CEDH, 21 févr. 1996, Singh c/ Royaume-Uni, n° 23389/94.
-
65.
CEDH, 9 févr. 2009, A et a. c/ Royaume-Uni, n° 3455/05.
-
66.
CEDH, gde ch., 9 juill. 2013, Vinter et a. c/ Royaume-Uni, n° 66069/09 : D. 2013, p. 2081, obs. Renucci J.-F.
-
67.
CEDH, 7 juill. 1989, Soering c/ Royaume-Uni, n° 14038/88.
-
68.
Danet J., « La peine perpétuelle comme horizon ? », in Mélanges Lazerges, p. 557.
-
69.
Gatto C., Le pardon en droit pénal, 2014, PUAM, nos 812 et s.
-
70.
§ 101 et s.
-
71.
§ 99.
-
72.
§ 103.
-
73.
§ 104.
-
74.
§ 105 et 117.
-
75.
§ 100.
-
76.
§ 99.
-
77.
CJUE, 6 oct. 2015, n° C-362/14, Schrems : Castets-Renard C., « Invalidation du Safe Harbor par la CJUE : tempête sur la protection des données personnelles aux États-Unis », D. 2016, p. 88 ; Debet A., « L’invalidation du Safe Harbor par la CJUE : tempête sur les transferts de données vers les États-Unis », JCP G 2015, n° 46-47, p. 1258 ; Guédon J.-P., « Renforcement de la protection des données personnelles », AJ pénal 2016, p. 53 ; Haftel B., « Transferts transatlantiques de données personnelles : la Cour de justice invalide le Safe Harbour et consacre un principe de défiance mutuelle », D. 2016, p. 111 ; Sauron J.-L., « L’affaire Schrems », Gaz. Pal. 29 oct. 2015, n° 244v8, p. 7 ; Simon D., « Protection des données personnelles », Europe déc. 2015, comm. 468.
-
78.
Suite à l’invalidation du Safe Harbor, de nouvelles négociations ont été entamées entre la Commission et les autorités américaines afin que soit conclu un nouvel accord en matière de transfert et de protection des données personnelles. Le 12 juillet 2016, la Commission a ainsi adopté le « EU-U.S. Privacy Shield ».
-
79.
Haute cour de justice d’Irlande.
-
80.
Décision n° 2000/520/CE de la Commission du 26 juillet 2000. Cette décision avait été prise sur le fondement de l’article 25, § 6 de la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 oct. 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003.
-
81.
Monsieur Schrems se fondait sur les révélations d’Edward Snowden relatives aux activités de renseignement des États-Unis.
-
82.
CJUE, 8 avr. 2014, n° C-293/12, Digital Rights Ireland.
-
83.
Castets-Renard C., « Invalidation du Safe Harbor par la CJUE : tempête sur la protection des données personnelles aux États-Unis », D. 2016, p. 88.
-
84.
CJCE, 22 oct. 1987, n° C-314/85, Foto-Frost.
-
85.
En vertu de l’article 25, § 1, de la directive n° 95/46/CE.
-
86.
Notamment, en France, la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.
-
87.
CEDH, 20 oct. 2015, n° 5201/11, Sher et a. c/ Royaume-Uni.
-
88.
Andriantsimbazovina J., « La lutte contre le terrorisme justifie des restrictions des droits procéduraux substantiels de suspects », Gaz. Pal. 28 nov. 2015, n° 248s5, p. 20 ; Benelbaz C., « La lutte contre le terrorisme justifie des restrictions aux droits procéduraux », commentaire de l’arrêt de la CEDH, 20 oct. 2015, n° 5201/11, Sher et a. c/ Royaume-Uni, in Chronique, Correia V. (dir.), « Le point sur l’Europe – Décisions d’octobre à décembre 2015 », JCP A 2016, 23-24, n° 15 ; Blay-Grabarczyk K., « Surveillance secrète, visites domiciliaires et autres intrusions des pouvoirs publics dans la vie privée » in Sudre F., Gonzalez G., Blay-Grabarczyk K., Milano L. et Surrel H., « Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (2015) », Revue du droit public n° 3, p. 1013 ; Cerda-Guzman C., « “Le crime terroriste entre dans une catégorie spéciale” ou l’acceptation par la Cour européenne d’une atténuation des droits au nom de la lutte contre le terrorisme », commentaire de l’arrêt CEDH, 20 oct. 2015, n° 5201/11, Sher et a. c/ Royaume-Uni : Journal d’actualité des droits européens (JADE), 5 janv. 2016, (en ligne), http://jade.u-bordeaux.fr/ ?q=node/1039 ; Labayle H., « Le terrorisme, une “catégorie spéciale” du droit, vraiment ? », in ELSJ, 18 janv. 2016, [En ligne], http://www.gdr-elsj.eu/2016/01/18/droits-fondamentaux/le-terrorisme-une-categorie-speciale-du-droit-vraiment/ ; Labayle H. et Sudre F., « Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et droit administratif », RFDA 2016, p. 761 ; Milano L., « Garanties du procès équitable et lutte contre le terrorisme » RDLF 2015, chron. n° 7, www.revuedlf.com, http://www.revuedlf.com/, http://www.revuedlf.com/auteurs/laure-milano/ ; Sudre F., « Droit de la Convention européenne des droits de l’Homme », JCP G 2016, 65, spéc. n° 3 ; Sudre F., « Convention européenne des droits de l’Homme – Droits garantis – Droit au respect de la vie privée et familiale – Principes directeurs. Protection de la vie privée », in Encyclopédie du JurisClasseur, Europe Traité, LexisNexis, 10 mars 2016, fasc. n° 6524.
-
89.
Les requérants estimèrent ne pas avoir été suffisamment informés des motifs de leur arrestation et de leur placement en détention.
-
90.
La Cour rappelle l’importance d’épuiser les voies de recours internes, sur le fondement de l’article 35.
-
91.
CEDH, 30 août 1990, nos 12244/86, 12245/86 et 12383/86, Fox, Campbell et Hartley c/ Royaume-Uni, § 32.
-
92.
CEDH, 28 oct. 1994, n° 14310/88, Murray c/ Royaume-Uni, § 51.
-
93.
CEDH, Fox, Campbell et Hartley, préc., § 32 ; CEDH, Murray, préc., § 51.
-
94.
CEDH, 16 déc. 2014, nos 50541/08, 50571/08, 50573/08 et 40351/09, Ibrahim et a. c/ Royaume-Uni, § 203.
-
95.
V. en ce sens, Labayle H., « Le terrorisme, une “catégorie spéciale” du droit, vraiment ? », in ELSJ, 18 janv. 2016, [En ligne], http://www.gdr-elsj.eu/2016/01/18/droits-fondamentaux/le-terrorisme-une-categorie-speciale-du-droit-vraiment/.
-
96.
CEDH, 19 févr. 2009, n° 3455/95, A. et a. c/ Royaume-Uni, § 203.
-
97.
CEDH, 12 avr. 2009, n° 67175/01, Reinprecht c/ Autriche, § 31 ; CEDH, 20 févr. 2014, n° 1346/12, Ovsjannikov c/ Estonie, § 72.
-
98.
CEDH, 3 juill. 2012, n° 30457/06, Robathin c/ Autriche, § 44, CEDH, 16 oct. 2007, n° 74336/01, Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c/ Autriche, § 57.
-
99.
La Cour insiste sur le rôle joué par le juge lors du huis-clos ainsi que sur sa faculté à nommer un avocat spécial. S’agissant de l’article 8, la Cour souligne le fait que le mandat avait été délivré par un juge et qu’un recours ex post facto était ouvert aux requérants.
-
100.
V. en ce sens, Cerda-Guzman C., « “Le crime terroriste entre dans une catégorie spéciale” ou l’acceptation par la Cour européenne d’une atténuation des droits au nom de la lutte contre le terrorisme », commentaire de l’arrêt CEDH, 20 oct. 2015, n° 5201/11, Sher et a. c/ Royaume-Uni : Journal d’actualité des droits européens (JADE), 5 janv. 2016, http://jade.u-bordeaux.fr/ ?q=node/1039.
-
101.
Braibant G., « L’État face aux crises, Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et politiques », in Les pouvoirs de crise, Pouvoirs n° 10, 1979, p. 8.