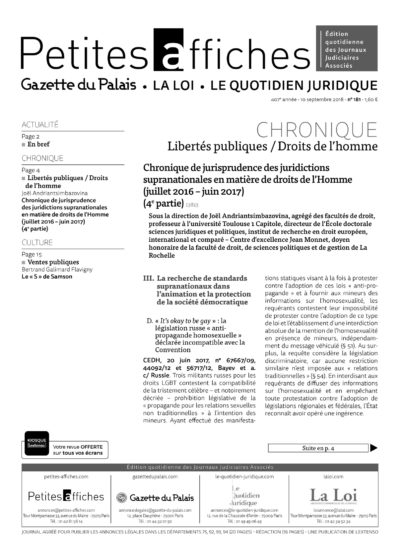Chronique de jurisprudence des juridictions supranationales en matière de droits de l’Homme (juillet 2016 – juin 2017) (4e partie)
PAS DE CHAPEAU
I – La recherche de standards supranationaux dans l’élaboration d’un espace pénal supranational
A – Nouvelles précisions sur le principe non bis in idem de l’article 4 du protocole n° 7 de la Convention EDH
B – Le principe ne bis in idem dans l’arrêt Orsi et Baldetti : entre autonomie formelle et harmonisation matérielle
C – L’arrêt Atanas Ognyanov ou la dialectique des principes
D – La libre circulation, le mandat d’arrêt européen et l’extradition
E – La notion de « détention » mentionnée dans le mandat d’arrêt européen doit s’interpréter comme une notion autonome
F – Les droits de la défense à l’épreuve de la terreur
II – La recherche de standards supranationaux dans la résolution des questions de société
A – La Cour interaméricaine des droits de l’Homme et l’affaire du village de Chichupac au Guatemala : la qualification de la disparition forcée par la constatation de violations multiples des droits de l’Homme
B – Surpopulation carcérale et lutte contre le traitement dégradant des détenus : l’audace est vaine !
C – La répression du terrorisme face aux droits à la vie et au recours effectif garantis par la CEDH
D – Exclusion de certains délinquants de la réclusion à perpétuité : une mesure non discriminatoire
E – Les rapports entre accident du travail, handicap et discriminations
III – La recherche de standards supranationaux dans l’animation et la protection de la société démocratique
A – L’absence de violation de la vie privée et familiale dans une affaire de gestation pour autrui, une solution curieuse de la CEDH ?
B – Le changement d’état civil : fruit d’une réalité sociale
C – Non à la surveillance électronique de masse
D – « It’s okay to be gay » : la législation russe « anti-propagande homosexuelle » déclarée incompatible avec la Convention
CEDH, 20 juin 2017, n° 67667/09, 44092/12 et 56717/12, Bayev et a. c/ Russie. Trois militants russes pour les droits LGBT contestent la compatibilité de la tristement célèbre – et notoirement décriée1 – prohibition législative de la « propagande pour les relations sexuelles non traditionnelles » à l’intention des mineurs2. Ayant effectué des manifestations statiques visant à la fois à protester contre l’adoption de ces lois « anti-propagande » et à fournir aux mineurs des informations sur l’homosexualité, les requérants contestent leur impossibilité de protester contre l’adoption de ce type de loi et l’établissement d’une interdiction absolue de la mention de l’homosexualité en présence de mineurs, indépendamment du message véhiculé (§ 51). Au surplus, la requête considère la législation discriminatoire, car aucune restriction similaire n’est imposée aux « relations traditionnelles » (§ 54). En interdisant aux requérants de diffuser des informations sur l’homosexualité et en empêchant toute protestation contre l’adoption de législations régionales et fédérales, l’État reconnaît avoir opéré une ingérence. Le gouvernement excipe toutefois du fait que l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique (§ 45-50). Après examen de la nécessité de l’ingérence, la Cour se contente de démontrer qu’aucun des buts légitimes invoqués – protection de la morale, de la santé et des droits d’autrui – ne peut être accueilli (§ 83).
L’arrêt Bayev et autres constitue le deuxième temps d’une valse engagée entre des associations pour les droits des homosexuels et la Russie3. À travers une décision prise sans ménagement4, la Cour européenne des droits de l’Homme conclut à la violation des articles 10 et 14 de la Convention. Par une déclaration ferme de l’incompatibilité de cette mesure générale (I), la Cour confirme l’inclusion totale de la personne homosexuelle dans la société démocratique européenne (II).
I. La législation « anti-propagande homosexuelle », une mesure générale incompatible avec la Convention
Malgré un raisonnement critiquable du fait d’une économie de moyens peu conventionnelle (A), la Cour ne retient aucune des justifications avancées par le gouvernement (B) et conclut qu’en adoptant et en appliquant ces mesures générales, les autorités russes ont outrepassé la marge d’appréciation accordée par l’article 10 (§ 83).
A. Le refus du contrôle complet de proportionnalité, un acte manqué ?
La Cour procède à une économie de moyens qui participe d’une rétention du contrôle de proportionnalité. Il est en effet paradoxal de ne pas évaluer directement le critère de la qualité de la loi compris dans le contrôle de la légalité de la mesure5, qui aurait à lui seul suffi pour démontrer que l’ingérence n’avait pas de base légale. Selon la Commission de Venise6, la requête (§ 53), et la Cour elle-même (§ 76), la législation était trop vague et imprévisible dans son application. En un sens, ne pas effectuer un contrôle complet constitue un réel acte manqué par rapport à un État qui campe sur ses positions et propose la même argumentation depuis 2010 (§ 78). Surtout, l’incomplétude du raisonnement de la Cour, relevée par le juge Dedov dans son opinion dissidente, pourrait justifier une demande de renvoi de l’affaire à la grande chambre7.
Le cœur de cette affaire tenant à l’existence même de cette législation (§ 61), la Cour se concentre sur l’étude de la nécessité de la législation en tant que mesure générale (§ 63-64). Tout en se dédouanant de procéder à un contrôle abstrait8, elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle plus les justifications de la mesure générale sont convaincantes, moins la Cour attache d’importance à son impact sur la situation particulière du requérant9. Or, en l’espèce, les justifications de l’adoption de la législation n’emportent pas la conviction de la juridiction.
B. Une double ingérence injustifiable dans l’exercice de la liberté d’expression
La Cour rejette d’abord l’invocation de la protection de la morale comme but légitime étatique pour justifier la nécessité de l’ingérence, au motif que la reconnaissance de l’homosexualité n’est pas incompatible avec le maintien des valeurs familiales comme fondement de la société (§ 67) et que le soutien populaire à une législation ne saurait permettre de réduire le champ matériel de la protection accordée par la Convention. En effet, une telle interprétation reviendrait à conditionner les droits de la minorité à son acceptation par la majorité et rendrait ces droits théoriques et illusoires plutôt que concrets et effectifs (§ 70).
Elle écarte ensuite la justification fondée sur la protection de la santé publique, le gouvernement n’ayant pas démontré que les informations diffusées prônaient un comportement irresponsable (§ 72), ni que la suppression de ces informations aurait pu permettre l’inversion d’une tendance démographique négative en Russie (§ 73).
Enfin, le but légitime de protection de la vie privée des mineurs et du droit de leurs parents de choisir leur éducation ne constitue pas un moyen opérant. En s’appuyant sur ses conclusions précédentes10, la Cour rappelle que le gouvernement n’a pas fourni d’élément démontrant que la simple mention de l’homosexualité pouvait affecter négativement les mineurs (§ 77), ni que ceux-ci étaient plus vulnérables dans le cadre de relations homosexuelles plutôt que dans celui de relations hétérosexuelles (§ 79). Si elle reconnaît le droit des parents de choisir l’éducation de leurs enfants, la Cour rappelle que la Convention ne garantit pas un droit de ne pas être confronté à une opinion contraire à ses propres convictions (§ 81)11. Les messages diffusés n’étant ni erronés, sexuellement explicites ou agressifs, ni incitatifs à s’adonner à quelconque pratique, l’action des requérants n’a pu, selon la Cour, interférer avec le droit des parents (§ 82).
II. Une confirmation de l’inclusion de la personne homosexuelle dans la société démocratique européenne
En adoptant la même position que le Comité des droits de l’Homme12, la Cour prend soin de rejeter la vision conservatrice du gouvernement (B) pour rappeler la protection accordée à la personne homosexuelle par la Convention (A) et ainsi confirmer que l’orientation sexuelle ne saurait conditionner l’exercice des droits.
A. Un rappel de la protection accordée par la Convention à la personne homosexuelle
La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie en matière de protection des droits des minorités sexuelles. En rappelant que les relations homosexuelles sont protégées par le droit à la vie familiale13 et qu’elles doivent être reconnues légalement14, la Cour procède implicitement à une interprétation de l’article 10 à la lumière de l’article 8 (§ 67). En adoptant ce type de lois, les autorités renforcent la stigmatisation et les préjugés, et encouragent l’homophobie. Leur adoption est donc incompatible avec les notions d’équité, de pluralisme et de tolérance inhérentes à la société démocratique (§ 83).
L’orientation sexuelle constitue un élément de l’identité individuelle. Par conséquent, celle-ci constitue une situation qui ne peut être l’unique fondement d’une distinction objective et raisonnable au sens de l’article 1415 et la marge d’appréciation accordée à l’État en matière de distinction fondée sur l’orientation sexuelle est réduite16. La législation en cause « traduit [des] préjugés d’une majorité hétérosexuelle envers une minorité homosexuelle »17 qui ne peuvent pas en soi justifier une différence de traitement (§ 68 et 90-91). La Cour conclut ainsi à une violation de l’article 14 combiné avec l’article 10.
B. Le rejet d’une vision conservatrice et stigmatisante de l’homosexualité
Dans une optique pluraliste, la Cour accepte ce discours intrinsèquement incompatible avec la Convention. La décision de la Cour constitutionnelle (§ 25), la tierce intervention de la Fondation pour la famille et la démographie (§ 58) et l’opinion dissidente du juge Dedov ont pour intérêt de faire vivre un débat ayant pour objet de disqualifier ces arguments. L’opinion dissidente est tout à fait révélatrice des deux éléments que la Cour souhaite écarter. La position du seul juge minoritaire, d’une part, étonne par un ton « illibéral »18 qui s’inscrit dans une tendance à qualifier de « propagande » toute expression qui ne coïncide pas avec la position officielle19. D’autre part malgré une condamnation claire par la Cour20, la position minoritaire laisse poindre une vision « homophobe »21 qui trouve son paroxysme dans une assimilation malsaine entre homosexualité et pédophilie22.
Pierre DURAND
E – Licenciées pour avoir refusé de retirer leur voile : la frontière entre différence de traitement justifiée et discrimination tient à peu de choses
CJUE, gde ch., 14 mars 2017, n° C-157/15, Achbita, Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding c/ G4S Secure Solutions NV ; CJUE, gde ch., 14 mars 2017, n° C-188/15, Bougnaoui et Association de défense des droits de l’Homme (ADDH) c/ Micropole SA. La doctrine trépignait d’impatience : la CJUE s’est enfin prononcée sur la question du port du voile dans l’entreprise dans ses deux arrêts G4S Secure Solutions et Micropole SA du 14 mars 2017. Les faits sont proches : deux requérantes de confession musulmane sont toutes deux licenciées par leur employeur pour avoir refusé d’ôter leur voile sur leur lieu de travail. Dans la première espèce (C-157/15), Mme Achbita exerçait la fonction de réceptionniste dans l’entreprise qui connaissait une règle non écrite interdisant aux employés de porter tout signe de leurs convictions religieuses, philosophiques ou politiques. Après que la requérante a fait connaître à son employeur sa volonté de porter le voile islamique sur son lieu de travail, le règlement intérieur de l’entreprise est modifié, faisant clairement apparaître l’interdiction pour tout salarié de porter un quelconque signe, d’une quelconque conviction. La requérante est licenciée la veille de l’entrée en vigueur de ladite interdiction. Dans la seconde espèce (C-188/15), Mme Bougnaoui, qui portait le voile islamique, avait été engagée en qualité d’ingénieure d’études par Micropole SA. Au début de la relation de travail, il lui avait été signalé que le port du foulard ne saurait être toléré. À la suite de la volonté manifestée par un client qu’il n’y ait « pas de voile la prochaine fois » et au refus de la requérante de le retirer, cette dernière est licenciée. Les questions préjudicielles posées étaient toutes deux relatives à l’interprétation de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Siégeant en grande chambre, la Cour a répondu aux juges belge et français. Dans la première affaire, elle devait déterminer si le règlement litigieux constituait une discrimination directe ; dans la seconde affaire, la question était de savoir si la volonté d’un employeur de prendre en compte le souhait d’un client de ne pas voir une prestation de service accomplie par une employée portant le voile constituait une « exigence professionnelle essentielle et déterminante », faisant perdre à la différence de traitement son caractère discriminatoire. Les questions posées étaient ainsi relatives au potentiel caractère discriminatoire des politiques de neutralité mises en cause (I), qui peut toutefois être justifié (II).
I. La recherche d’une différence de traitement aboutissant à une discrimination
Dans ses deux décisions, la Cour commence par rappeler que la liberté de religion, telle qu’elle est entendue par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la Cour européenne des droits de l’Homme, vise à la fois la liberté de croire (« forum internum ») et de manifester cette croyance (« forum externum »). La religion étant l’un des motifs interdits visés par la directive, la Cour s’attache à vérifier la présence d’une discrimination (A), dont le caractère direct ou indirect a son importance (B).
A. La recherche d’une discrimination
Dans la première espèce (C-157/15), la Cour commence par vérifier si l’interdiction en question constitue une différence de traitement entre les travailleurs en fonction de leur religion ou de leurs convictions, et si, le cas échéant, elle constitue une discrimination directe. Elle relève que tous les salariés de l’entreprise sont soumis à cette même exigence de neutralité. La règle ne vise en effet pas seulement l’interdiction du port de signes religieux, mais de toutes convictions, qu’elles soient politiques ou philosophiques. Partant, la Cour considère que Mme Achbita n’a pas été traitée différemment des autres salariés, et que la règle litigieuse ne constitue pas une différence de traitement fondée sur la religion de la requérante. Dans la seconde espèce en revanche (C-188/15), la Cour ne se prononce pas sur l’existence d’une discrimination car elle a été reconnue par la juridiction de renvoi. La question préjudicielle interroge en effet la Cour à propos de l’interprétation à donner à une justification que la directive autorise, et qui ferait perdre à la différence de traitement son caractère discriminatoire.
B. La qualification de la discrimination
Le caractère direct ou indirect de la discrimination a son importance quant à sa justification. Dans la seconde espèce, la question préjudicielle porte non pas sur l’existence d’une différence de traitement, mais sur une potentielle justification qui pourrait être apportée à une différence de traitement fondée sur la religion de la requérante. La Cour relève d’ailleurs que la formulation de la question ne permet pas de savoir si est en cause une discrimination directe ou indirecte. Dans cette espèce, peu importe finalement, car il est question de l’« exigence professionnelle essentielle et déterminante »23 qui peut justifier tant une discrimination directe qu’indirecte. En revanche, dans la première espèce, le caractère direct ou indirect de la discrimination a son importance. La Cour refuse de voir la politique litigieuse comme constituant une discrimination directe, mais elle admet que la juridiction nationale puisse y voir une discrimination indirecte. Elle lui adresse donc des recommandations quant à l’interprétation de cette notion, et des éventuelles justifications à envisager. Et pour cause : la discrimination indirecte peut en effet être justifiée par un objectif légitime et par la mise en œuvre de moyens appropriés et nécessaires.
II. Les possibles justifications des différences de traitement
Toute différence de traitement n’aboutit pas nécessairement à une discrimination. C’est ce que prévoit la directive, qu’il convient désormais d’envisager à la lumière de ces deux décisions. L’étude des éventuelles justifications (B) nécessite toutefois d’établir si, en l’espèce, une règle de neutralité était en vigueur au sein de l’entreprise (A).
A. La prise en compte de l’existence d’une règle interne
La mise en perspective des deux arrêts à l’étude laisse entrevoir l’importance de la présence d’une règle de neutralité préexistante au sein de l’entreprise. Dans la première espèce, une telle règle existait, et la Cour ne semble pas accorder d’importance à son caractère écrit ou oral, pourvu qu’elle constitue une politique « véritablement poursuivie de manière cohérente et systématique »24. Rappelons en effet que la règle litigieuse n’a été véritablement inscrite au sein du règlement intérieur que le lendemain du licenciement de Mme Achbita. L’idée est ici de ne pas permettre aux employeurs de prendre de manière intempestive des règlements qui seraient neutres en apparence, mais en réalité destinés à licencier à raison de motifs discriminatoires. Dans le deuxième arrêt, la Cour expose qu’il convient de déterminer l’existence d’une règle de neutralité : si une telle règle existe, elle renvoie à son raisonnement dans l’affaire n° C-157/15, qui invite le juge national à vérifier que la règle en question n’aboutit pas, en fait, à une différence de traitement indirectement fondée sur un motif interdit. Il n’existait pas de telle règle dans l’affaire n° C-188/15 : la Cour reprend donc la question telle qu’elle a été renvoyée par la juridiction française, et s’attache à déterminer s’il existe en l’occurrence une « exigence professionnelle essentielle et déterminante » qui pourrait faire perdre à la différence de traitement son caractère discriminatoire.
B. Le contrôle des justifications
Dans le premier arrêt, la Cour guide la juridiction de renvoi pour le cas où cette dernière retiendrait l’existence d’une discrimination indirecte. La directive établit que si cette différence de traitement est motivée par un objectif légitime et que les moyens employés pour y parvenir sont appropriés et nécessaires, la différence de traitement ne constitue pas une discrimination. En l’espèce, la Cour détermine que la volonté de l’employeur d’afficher une neutralité à l’égard de ses clients fait partie de la liberté d’entreprise, consacrée par l’article 16 de la Charte et constitue ainsi un objectif légitime. Elle relève que le moyen employé, soit l’interdiction de tout port de signes de convictions, est approprié pour atteindre cet objectif. Reste à déterminer si toutefois l’interdiction se limite à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre le but avancé. Un certain scepticisme se fait sentir : la Cour estime que cette politique, qui visait la neutralité de l’entreprise dans ses relations avec les clients, ne saurait être limitée au strict nécessaire si elle s’appliquait aussi aux employés qui n’étaient pas au contact de la clientèle. Dès lors, au vu des intérêts en présence, proposer à la requérante un reclassement vers un poste qui n’impliquait pas de contact visuel avec le client semblait plus judicieux que de la licencier. Dans le deuxième arrêt, la Cour précise les strictes conditions dans lesquelles peut être admise la justification de l’article 4 de la directive : elle ne peut être admise qu’« en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice », soit des considérations objectives, pour peu que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. En l’espèce, la Cour relève que la volonté d’un employeur de tenir compte du souhait de son client de ne pas voir « de voile la prochaine fois » est une considération subjective, qui ne saurait constituer une « exigence professionnelle essentielle et déterminante ». Finalement, la différence de traitement imposée par l’employeur via une politique de neutralité générale ne constituerait pas une discrimination ; en revanche, le licenciement motivé par un souhait du client serait discriminatoire. Dans les deux cas pourtant, il s’agit d’un choix de l’employeur mû par une volonté d’afficher une neutralité à l’égard du client… La frontière est mince, et la motivation de la Cour difficile à discerner.
Leslie NARDARI
F – Liberté de religion et intégration par l’instruction : la primauté de l’intérêt public sur l’intérêt privé
CEDH, gde ch., 10 janv. 2017, n° 29086/12, Osmanoglu et Kocabas c/ Suisse. Aux yeux d’un observateur français, l’arrêt Osmanoglu semble adopter une position difficilement compatible avec la conception juridique nationale de la laïcité dont découle la neutralité des services publics25. La Cour, en acceptant l’utilisation du burkini par des élèves comme moyen d’intégration, tranche avec l’idée française de « signe distinctif à l’école ». Cette solution trouve d’ailleurs un écho particulier pour les juristes français au vu des affaires défrayant la chronique concernant les arrêtés « anti-burkini »26 qui ravivent depuis quelques mois le débat identitaire. Si certains commentateurs se sont interrogés sur l’utilisation par la Cour du burkini comme facteur de socialisation en Suisse27, le juge européen a en réalité tranché une question plus profonde.
À l’origine, le litige naît du refus par les autorités scolaires d’une école suisse de Bâle-Ville de dispenser deux jeunes filles des cours de natation obligatoires dans leur cursus scolaire. La demande des parents était motivée par les convictions religieuses d’un islam fondamentaliste qui, à la puberté des jeunes filles, entraînerait le respect d’une morale stricte ne coïncidant pas avec les cours de natation mixte. Les requérants voulaient ainsi préparer leurs filles aux préceptes qui leur seraient appliqués dans le futur.
La Cour se trouve alors saisie par les parents des jeunes filles qui dénoncent une ingérence dans leur liberté de manifester leur religion violant les conditions fixées par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
La réponse de la Cour est nette puisqu’après avoir reconnu une ingérence au sens de l’article 9, l’arrêt expose une confirmation de l’intégralité de la solution précédemment retenue par le Tribunal fédéral suisse considérant l’ingérence comme nécessaire et proportionnée. Suivant la droite ligne de la décision Kokkinakis28, la Cour rappelle l’importance de la liberté de religion comme « assise d’une société démocratique ». Mais après un examen de la situation spécifique du pays et notamment de l’évolution des mœurs, la Cour concède que l’intérêt public lié à l’éducation des enfants pour favoriser leur intégration dans la société l’emporte sur l’intérêt privé tiré des convictions religieuses. La Cour rappelle que l’éducation des enfants peut être protégée par l’article 9 de la Convention (I), ce qui lui permet de confirmer l’importance de l’école comme facteur d’intégration à la société autorisant une marge d’appréciation considérable pour les États (II).
I. L’acceptation d’une application de l’article 9 dans le domaine de l’éducation
L’application de l’article 9 de la Convention n’allait pas de soi. La Cour, obligatoirement liée par la volonté souveraine des États, insiste pour rappeler que l’article 2 du protocole 1 était la lex specialis dans l’éducation (A) en acceptant toutefois que l’article 9 protège l’adaptation de l’éducation aux croyances (B).
A. Le rappel par la Cour de l’article 2 du protocole 1 comme lex specialis
L’article 2 du protocole 1 reconnaît un droit à l’instruction et notamment un droit pour les parents d’assurer une instruction conforme à leurs principes religieux. La Suisse n’ayant pas ratifié le protocole, elle ne pouvait être tenue par ses dispositions. Cependant, la Cour a tenu à rappeler en reprenant le considérant de l’arrêt Lautsi29, qu’en l’espèce, l’article 2 du protocole 1 était la lex specialis concernant l’éducation religieuse. L’article 9 est donc applicable en tant que norme générale mais la Cour interprète implicitement ce dernier à la lumière du premier protocole, inversant la logique de l’arrêt Lautsi où le protocole était lu à la lumière de l’article 9.
Cette interprétation éclairée n’est pas sans effet car elle sert à la Cour pour garantir une unité de la Convention qui doit être lue comme un tout (§ 90). Par cela, les juges considèrent que sous l’article 2 du protocole, il est de jurisprudence constante que les parents ne sauraient exiger une certaine forme d’organisation des cours30. Dans un souci d’assurer l’unicité de sa jurisprudence, cette interprétation s’applique par analogie à l’article 9 de la Convention édictant une solution d’espèce valable sous les deux normes. La Cour évite par cela toute revendication ultérieure qui pourrait survenir envers un État ayant ratifié le protocole 1.
B. L’interprétation extensive de l’idée de « manifestation » au sens de l’article 9
Pour accepter l’application de l’article 9 de la Convention, la Cour va définir le concept de « manifestation » religieuse dans un sens large. Elle reprend d’abord une interprétation déjà extensive de la manifestation religieuse en considérant que l’acte « doit être étroitement lié à la religion ou à la conviction » (§ 41) mais que la personne n’est pas obligée d’établir qu’elle a agi conformément à un commandement de la religion.
L’estimation du lien entre la manifestation et la religion est donc retenue au cas par cas. Le lien devient encore plus tendu puisque la Cour va plus loin que le choix des parents d’éduquer les enfants sous des préceptes religieux. Elle considère que même si la religion n’oblige pas encore l’enfant à être soumis à des restrictions particulières, il est du droit des parents de préparer par avance l’enfant à une religion imposée dans le futur. La Cour accepte donc un lien indirect entre la religion et l’acte prescrit ou les parents manifestent leur religion d’abord au travers de leurs enfants et ensuite sans qu’aucun commandement ne les y oblige.
La manifestation religieuse ainsi établie, l’ingérence dans les droits protégés par l’article 9 en découle logiquement. L’ingérence reconnue par la Cour lui permettra de poser une limite aux revendications religieuses à l’école en mettant en avant l’intérêt public de l’instruction pour l’intégration des enfants à la société.
II. La prééminence de l’intégration scolaire face aux convictions religieuses individuelles
La Cour affirme que l’école poursuit un but légitime d’intégration et notamment d’égalité entre les sexes (A). Néanmoins, elle considère également que la marge d’appréciation considérable laissée aux États et qui n’exclut pas le phénomène religieux permet un refus catégorique de tout communautarisme (B).
A. La légitimité de l’école comme moyen d’intégration
Les requérants reprochent notamment « au Tribunal fédéral de placer l’intégration au-dessus de la croyance » (§ 59). La Cour, elle, soutient les arguments du gouvernement en affirmant que « la mesure litigieuse avait pour but l’intégration des enfants étrangers de différentes cultures et religions (…) et l’égalité entre les sexes » (§ 64). Par là même, la Cour considère que l’école n’est pas seulement un facteur d’acquisition de compétences. Ainsi, elle confirme la solution rendue par le Tribunal fédéral le 7 mars 2012 qui rejetait déjà les arguments des requérants. En effet, la Cour reconnaît en l’espèce que l’intégration scolaire constitue bien un but légitime au sens de l’article 9, § 2 de la Convention.
Les motifs invoqués par la Cour, l’égalité des sexes ou l’intégration des enfants étrangers par exemple, peuvent donc constituer des buts légitimes permettant de restreindre, dans le cadre de l’article 9, § 2, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions. En d’autres termes, la Cour reconnaît ici que l’intégration scolaire doit être favorisée par rapport à des croyances religieuses individuelles qui, bien qu’elles doivent être respectées et protégées, doivent s’écarter en présence d’un but légitime. Elle rattache donc, comme dans l’arrêt Dahlab c/ Suisse et afin de respecter le texte de l’article invoqué, ces motifs légitimes à « la protection des droits et libertés d’autrui ou à la protection de l’ordre » prévues par l’article31.
B. Une marge d’appréciation étatique n’excluant pas le phénomène religieux à l’école
La Cour affirme, avant de procéder au contrôle de proportionnalité qui lui incombe en l’espèce, que « les États jouissent d’une marge d’appréciation considérable s’agissant des questions relatives aux rapports entre l’État et les religions (…), et ce d’autant plus lorsque ces questions se posent dans le domaine de l’éducation » (§ 95). En effet, il est impossible pour la Cour de procéder à une systématisation des comportements au sein de l’Europe. Ainsi, elle doit laisser ces questions à l’appréciation des différents États mais toutefois opérer un contrôle.
Néanmoins, cette marge d’appréciation « considérable » selon la Cour, n’exclut pas le phénomène religieux dans le domaine de l’instruction publique. En effet, il s’agit simplement de respecter une égalité parfaite entre tous les groupes religieux. Pour ce faire, une directive précise même que « pour qu’il soit tenu compte de la manière dont l’islam conçoit la morale, les élèves doivent avoir la possibilité de couvrir leurs corps ». Des précautions sont donc prises dans les textes organisant l’éducation. Par ce biais, l’école permet non seulement une intégration des enfants de toutes confessions mais, en prenant en compte les différents phénomènes religieux, met à mal le communautarisme pouvant être revendiqué.
Matthieu GAYE-PALETTES et Zakia MESTARI
G – « L’article 10, § 1 de la Convention peut être interprété comme incluant un droit d’accès à l’information »
CEDH, gde ch., 8 nov. 2016, n° 18030/11, Magyar Helsinki Bizottság c/ Hongrie32. « Le temps est venu de clarifier les principes classiques »33 relatifs au droit d’accès à l’information qui ne figure expressément pas dans les matières régies par la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après la Convention). Telle a été l’ambition de la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après la Cour) dans l’affaire Magyar Helsinki Bizottság c/ Hongrie du 8 novembre 2016. Appelée à examiner la question de savoir si et dans quelle mesure l’article 10 de la Convention garantit un droit d’accès à des informations détenues par l’État, la Cour se livre à un rare exercice de pédagogie pour juger que désormais « (…) rien ne l’empêche d’interpréter l’article 10, § 1 de la Convention comme incluant un droit d’accès à l’information (§ 149) tout en se défendant de s’être écartée de sa « position jurisprudentielle standard »34 formulée dans les arrêts Leander c/ Suède, Gaskin c/ Royaume-Uni, Guerra et autres c/ Italie ou encore plus récemment Roche c/ Royaume-Uni. C’est pourquoi dans cet « arrêt d’une importance certaine pour l’interprétation de la Convention »35, la Cour n’assume pas avoir consacré dans le silence de la Convention un nouveau droit d’accès à l’information mais dit avoir simplement procédé à une clarification des principes classiques en la matière. Cette « attitude schizophrénique »36 de la Cour s’explique en partie au regard des faits de l’espèce sous commentaire.
L’organisation non gouvernementale requérante demanda l’accès à des dossiers des services de police contenant des informations sur les commissions d’office et le nom des avocats commis d’office dans le but de mener une étude à l’appui de propositions de réforme des commissions d’office des avocats de la défense. Si la plupart des services de police communiquèrent les informations demandées, deux d’entre eux ne le firent pas. La requérante engagea alors une procédure devant les juridictions internes en vue d’obtenir l’accès à ces informations, mais elle fut déboutée. Elle alléguait que ce refus d’accès avait emporté violation de ses droits découlant de l’article 10 de la Convention. C’est donc la question de l’applicabilité de l’article 10 au grief de la requérante qui justifie la volonté de la grande chambre de clarifier les principes classiques relatifs au droit d’accès à l’information. En effet, dans les affaires précitées, la Cour avait jugé que les informations sollicitées concernaient la vie privée et/ou familiale des requérants de sorte qu’elles entraient dans le champ d’application de l’article 8 et non de l’article 10. Il est vrai que dans certaines affaires relatives à des demandes d’accès à des informations pouvant contribuer à un débat d’intérêt public général, la Cour avait jugé que le refus des autorités de donner accès à certains documents constituait une ingérence dans l’exercice de leur droit de recevoir des informations garanti par l’article 10 de la Convention37. Elle avait ainsi amorcé une reconnaissance progressive d’un « droit de recevoir » des informations inhérent à l’exercice de la liberté d’expression dans une société démocratique. L’espèce sous commentaire lui donne l’opportunité de vérifier si un « droit à recevoir » des informations – autrement dit un droit de rechercher des informations – pouvait être déduit de l’article 10 de la Convention.
Convoquant la doctrine de « l’instrument vivant » et l’exigence d’effectivité de l’article 10, la Cour juge que l’article 10 de la Convention garantit un droit à recevoir des informations détenues par l’État (I). Mais « effrayée par sa propre audace »38 interprétative, la Cour s’empresse de préciser l’appréciation de ce « nouveau » droit doit se faire au cas par cas à la lumière des circonstances particulières de chaque cause (II).
I. La consécration d’un droit à recevoir des informations détenues par l’État
La consécration d’un droit à recevoir des informations détenues par l’État procède d’abord d’une interprétation évolutive de la Convention notamment de son article 10 (A). À cette exigence de développement des droits garantis par la Convention, s’ajoute celle d’effectivité de la liberté d’expression parachevant ainsi l’effort d’interprétation de la Convention à la lumière des conditions actuelles (B).
A. Un droit né d’une interprétation évolutive de l’article 10 de la Convention
Il est désormais acquis que le recours à la doctrine de « l’instrument vivant » peut répondre à une stratégie jurisprudentielle de légitimation d’un revirement de jurisprudence entérinant une interprétation évolutive de la Convention39. On sait aussi qu’à la lumière des règles prévues aux articles 31 et 33 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, la Cour doit rechercher le sens ordinaire à attribuer aux termes de la Convention et tenir compte de l’objet et du but de celle-ci. C’est sous ces auspices que se place la grande chambre pour dépasser la difficulté résultant d’une interprétation littérale et d’un recours aux travaux préparatoires de l’article 10 qui – comme le soutient le gouvernement britannique, tiers intervenant – indiquent clairement que l’intention de ses rédacteurs n’était pas d’inclure dans la Convention le droit de rechercher des informations auprès des autorités publiques. Toutefois, s’appuyant d’abord sur les travaux préparatoires du protocole n° 6 ainsi que sur les avis de la Cour et la Commission sur ce projet, la Cour révèle « une conception partagée par les organes et les institutions du Conseil de l’Europe selon laquelle l’article 10, § 1 de la Convention, tel qu’il était libellé à l’origine, pourrait raisonnablement être considéré comme comprenant déjà la « liberté de rechercher des informations » (§ 136). La Cour fait ensuite appel au droit comparé et international pour conclure à l’existence d’« un large consensus, en Europe et au-delà, quant à la nécessité de reconnaître un droit individuel d’accès aux informations détenues par l’État afin d’aider le public à se forger une opinion sur les questions d’intérêt général » (§ 148). Ce « large consensus » est fondé sur plusieurs sources tant nationales (la majorité des États contractants reconnaissent dans leur législation nationale un droit d’accès à l’information) qu’internationales (l’article 19 du Pacte sur les droits civiques et politiques, la jurisprudence du Comité des droits de l’Homme, l’article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents publics, la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, la Déclaration de principes sur la liberté d’expression en Afrique adoptée par la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples en 2002 ainsi que les conclusions du rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression).
Compte tenu de tous ces éléments, elle estime que rien ne l’empêche d’interpréter l’article 10, § 1 de la Convention comme incluant un droit d’accès à l’information. Elle répond de ce fait à l’évolution de la situation dans les États contractants et au large consensus international qui militent en faveur d’une plus grande effectivité de la liberté d’expression comprenant également un droit à recevoir des informations détenues par les autorités publiques.
B. Un droit né d’une exigence d’effectivité de l’article 10 de la Convention
Lorsque la Cour fait appel à la doctrine de l’« instrument vivant », elle souligne habituellement la spécificité de la Convention, instrument de protection des droits de l’Homme, qui doit être appliquée de manière à rendre ses exigences concrètes et effectives et non théoriques et illusoires (§ 121). En matière de protection de la liberté d’expression, le principe selon lequel les droits protégés par la Convention doivent être garantis de manière concrète et effective commande d’interpréter l’article 10 de la Convention comme intégrant un droit d’accès à l’information. C’est cette exigence d’effectivité qui la conduit à juger en l’espèce qu’un droit d’accès aux informations détenues par l’État doit être considéré comme inhérent à la liberté d’expression dans deux situations où est en jeu l’exercice effectif de la liberté d’expression : « premièrement, lorsque la divulgation des informations a été imposée par une décision judiciaire devenue exécutoire (…) et deuxièmement, lorsque l’accès à l’information est déterminant pour l’exercice par l’individu de son droit à la liberté d’expression, en particulier « la liberté de recevoir et de communiquer des informations » et que refuser cet accès constitue une ingérence dans l’exercice de ce droit » (§ 156). Il n’y a véritablement là rien d’inédit puisque pour rendre effectif le droit à la liberté d’expression, la jurisprudence de la Cour montrait déjà une évolution en faveur de la reconnaissance, sous certaines conditions, d’un droit à la liberté à recevoir des informations. Ce fut notamment le cas dans certaines affaires où le droit national prévoit un droit d’accès aux documents demandés, en particulier par des journalistes. Dans l’affaire Dammann c/ Suisse par exemple, la Cour a jugé que la collecte d’informations par les journalistes était une étape préparatoire essentielle du travail de journalisme et qu’elle était inhérente à la liberté de la presse et, à ce titre protégée par l’article 10 de la Convention40. Elle a également étendu la protection de l’article 10 au profit d’associations de la société civile cherchant à collecter des informations sur un sujet d’importance générale41 ou destinées à être communiquées au public et ainsi contribuer au débat public42.
Eu égard à ces éléments, la Cour a donc naturellement déduit d’une interprétation évolutive de l’article 10, un droit d’accès à des informations détenues par l’État et l’obligation correspondante pour celui-ci. Elle précise néanmoins – sans doute à l’attention des juridictions nationales – les critères entraînant l’application de ce droit d’accès aux informations.
II. Les conditions entraînant l’application du droit à recevoir des informations détenues par l’État
Le droit à recevoir des informations consacré par la Cour n’est en réalité qu’un droit conditionné. La Cour le rappelle elle-même : en dehors des deux hypothèses présentées plus haut, « l’article 10 n’accorde pas à l’individu un droit d’accès aux informations détenues par une autorité publique, ni n’oblige l’État à les lui communiquer » (§ 156). C’est d’ailleurs pour cette raison que l’application du droit d’accès aux informations détenues par l’État doit s’apprécier au cas par cas. Les conditions d’application du droit d’accès à l’information rappelées par la Cour en l’espèce sont relatives d’une part à l’information demandée (A) et au demandeur de celle-ci d’autre part (B).
A. Les conditions tenant à l’information demandée
Le droit d’accès aux informations détenues par l’État ne s’applique qu’aux informations répondant à un critère d’intérêt public. D’après la jurisprudence de la Cour, ont trait à un intérêt public les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité (§ 162). Peuvent ainsi relever de la catégorie des informations considérées comme étant d’intérêt public, « des informations factuelles concernant l’utilisation de mesures de surveillances électroniques »43, des « informations relatives à un recours constitutionnel et portant sur un sujet d’importance générale »44, des décisions concernant des commissions sur des transactions immobilières45 ou encore des sources documentaires originales utilisées à des fins de recherche historique légitime46. En outre, il ne suffit pas que l’information demandée soit d’intérêt public pour entraîner une application du droit d’accès aux informations. La Cour tient également compte du fait que les informations recherchées étaient déjà disponibles et ne nécessitent donc aucun travail de collecte des données de la part des autorités47.
Appliquant ces deux critères en l’espèce, la Cour relève le caractère d’intérêt public des informations recherchées par la requérante. La question de l’efficacité du système des commissions d’office est étroitement liée à celle du droit à un procès équitable, droit fondamental reconnu en droit hongrois et d’importance primordiale dans la Convention. En conséquence, toute critique ou proposition d’amélioration d’un service aussi directement lié au droit à un procès équitable doit être considérée comme un sujet d’intérêt public légitime. Dès lors, en refusant à la requérante l’accès aux informations demandées, qui étaient déjà disponibles, les autorités internes ont entravé son exercice de sa liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’une manière portant atteinte à la substance même de ses droits protégés par l’article 10 (§ 180).
B. Les conditions tenant au demandeur de l’information
Une preuve supplémentaire de la consécration en demi-teinte du droit d’accès aux informations réside dans la volonté de la Cour de limiter le bénéfice de ce droit à une catégorie d’acteurs fonctionnellement bien définis. Dans l’arrêt sous commentaire, elle « estime que le point de savoir si la personne qui demande l’accès aux informations a pour but d’informer le public en sa qualité de “chien de garde” est une considération importante » (§ 168). Elle reconnaît un tel rôle aux journalistes48 et aux organisations non gouvernementales dont les activités portent sur des questions d’intérêt public49. Au critère tenant au rôle du demandeur des informations, s’ajoute « une première condition préalable [qui] doit être que la personne demandant l’accès à des informations détenues par une autorité publique a pour but d’exercer sa liberté de “recevoir et de communiquer des informations et des idées” » (§ 158).
La Cour ne s’est pas échinée à établir que la démarche professionnelle de l’ONG requérante était d’intérêt public en ce qu’elle œuvrait pour la diffusion d’informations sur des sujets relatifs aux droits de l’Homme et à l’État de droit. Aussi a-t-elle jugé que l’intéressée avait besoin d’accéder aux informations demandées pour accomplir cette tâche (§ 178). Partant, la rétention par l’État défendeur des informations demandées constituait une ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10.
Enfin, pour déterminer si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la grande chambre a procédé à la mise en balance du droit de la requérante à la liberté d’expression et la protection à accorder aux informations recherchées. Se référant à la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des données et à sa jurisprudence, la Cour conclut que les intérêts invoqués par le gouvernement, qui se réfère à l’article 8 de la Convention, « ne sont pas d’une nature et d’un degré » propres à justifier l’application de cette disposition et leur prise en compte dans l’exercice de mise en balance (§ 196). À cet égard, la Cour prend en considération le contexte (les données se rapportaient principalement à la conduite d’activités professionnelles d’avocats dans le cadre de procédures publiques, n’avaient pas trait à la substance de la tâche des avocats et n’avaient donc pas porté atteinte à la jouissance par les avocats concernés de leur droit au respect de la vie privée) et le fait que la divulgation de ces informations pouvait passer pour prévisible.
Bien que l’article 8 n’entre donc pas en jeu, la protection des données demeure un but légitime n’autorisant qu’une restriction proportionnée à la liberté d’expression. Estimant que l’intérêt public en jeu l’emporte sur la nécessité de protéger les informations « se trouvant hors du domaine public » (§ 198), la grande chambre conclut à la violation de l’article 10.
Wenceslas MONZALA
H – La Cour européenne des droits de l’Homme face au discours de haine
Notes de bas de pages
-
1.
Commission de Venise, On the issue of the prohibition of so-called « Propaganda of homosexuality »in the light of recent legislation in some Council of Europe Member States, 14-15 juin 2013 ; APCE, Lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et sur l’identité de genre, Rés.1948(2013), 27 juin 2013.
-
2.
Issaeva M. et Kiskachi M., « Immoral Truth vs. Untruthful Morals ? – Attempts to render rights and freedoms conditional upon sexual orientation in light of Russia’s international obligations », Russian Law Journal, 2014, p. 82-105.
-
3.
CEDH, 21 oct. 2010, nos 4916/07, 25924/08 et 14599/09, Alekseyev c/ Russie. Dans un premier temps, la Cour a reconnu que la prohibition de la Moscow Pride constituait une violation des articles 11, 13 et 14. Le troisième temps de la valse est encore à venir. Le 22 mars 2017, quatre requêtes, concernant l’application de la loi « sur les agents de l’étranger » à des associations LGBT qui allèguent des violations des articles 10, 11 et 14, ont été communiquées à la Russie (Rakurs, n° 44403/15 ; Maximum Centre, n° 49258/15 ; Perm Human Rights Centre (Perm HRC), n° 25816/16 ; Coming Out, n° 4798/15).
-
4.
Istrefi K. et Irving E., « A Sermon from the Bench : Some Thoughts on the ECtHR Judgment in Bayev and Others v Russia », EJIL :Talk !, 27 juin 2017, https://www.ejiltalk.org/a-sermon-from-the-bench-some-thoughts-on-the-ecthr-judgment-in-bayev-and-others-v-russia ; Cannoot P. et Poppelwell-Scevak C., « ECtHR finds Russia’s gay propaganda law discriminatory in strong-worded judgement », Strasbourg Observers, 11 juill. 2017, https://strasbourgobservers.com/2017/07/11/ecthr-finds-russias-gay-propaganda-law-discriminatory-in-strong-worded-judgment/.
-
5.
CEDH, 24 avr. 1990, n° 11801/85, Kruslin c/ France, § 30.
-
6.
Commission de Venise, On the issue of the prohibition of so-called « Propaganda of homosexuality », préc., § 31-37.
-
7.
Prokopkin S., « “Ehe für alle” eher nicht : Traditionalismus und Staatshomophobie – Russlands Weg im Umgang mit Diskriminierung », Verfassungsblog, 10 juill. 2017, http://verfassungsblog.de/ehe-fuer-alle-eher-nicht-traditionalismus-und-staatshomophobie-russlands-weg-im-umgang-mit-diskriminierung.
-
8.
CEDH, gde ch., 15 oct. 2015, n° 27510/08, Perinçek c/ Suisse, § 136.
-
9.
CEDH, gde ch., 22 avr. 2013, n° 48876/08, Animal Defenders International c/ Royaume-Uni, § 108-109 ; v. en ce sens, Afroukh M., « Le contrôle de la norme nationale par la Cour européenne des droits de l’Homme », in Bonis E. et Malabat V. (dir.), La qualité de la norme. L’élaboration de la norme, 2016, Paris, Mare & Martin, p. 299-312.
-
10.
CEDH, Alekseyev c/ Russie, § 86.
-
11.
CEDH, 6 oct. 2006, n° 45216/07, Appel-Irrgang et a. c/ Allemagne ; CEDH, 13 sept. 2011, n° 319/08, Dojan et a. c/ Allemagne.
-
12.
CDHNU, 31 oct. 2012, n° 1932/2010, Fedotova c/ Fédération de Russie, Fond, pt 10.8. La requérante avait effectué un « picket » à Ryazan le même jour que N. Bayev.
-
13.
CEDH, 24 juin 2010, n° 30141/04, Schalk et Kopf c/ Autriche, § 91-94.
-
14.
CEDH, 21 juill. 2015, nos 18766/11 et 36030/11, Oliari et a. c/ Italie, § 95.
-
15.
CEDH, gde ch., 22 janv. 2008, n° 43546/02, E.B. c/ France, § 96 et 98.
-
16.
CEDH, gde ch., 19 févr. 2013, n° 19010/07, X et a. c/ Autriche, § 99.
-
17.
CEDH, 9 janv. 2003, n° 45330/99, S.L. c/ Autriche, § 44.
-
18.
Armas-Cardona G., « The Dissent in Bayev and Others v. Russia : A Window into an Illiberal World View », EJIL :Talk !, 7 juill. 2017, https://www.ejiltalk.org/the-dissent-in-bayev-and-others-v-russia-a-window-into-an-illiberal-world-view.
-
19.
Selon le gouvernement, la propagande se définit comme une « active dissemination of information aimed at inducing others to subscribe to a particular set of values, or patterns of behaviour, or both, or prompting others to commit, or to abstain from, certain actions » (§ 46). V. aussi, op. diss. Dedov : « When you disseminate your views, you expect to convince others so that they accept your position and agree with you ».
-
20.
CEDH, 9 févr. 2012, n° 1813/07, Vejdeland et a. c/ Suède ; CEDH, 17 avr. 2014, n° 20981/10, Mladina D. D. Ljubljana c/ Slovénie.
-
21.
Lavrysen L., « Bayev and Others v. Russia : on Judge Dedov’s outrageously homophobic dissent », Strasbourg Observers, 13 juill. 2017, https://strasbourgobservers.com/2017/07/13/bayev-and-others-v-russia-on-judge-dedovs-outrageously-homophobic-dissent/.
-
22.
Au sujet des messages diffusés, le juge Dedov : « would agree with the applicants that this is just a neutral dissemination of information if the problem of paedophilia were completely resolved ».
-
23.
V. art. 4, § 1 de la directive n° 2000/78.
-
24.
Pt. 40.
-
25.
CEDH, 26 nov. 2015, Ebrahimian c/ France, contextualisant l’idée de neutralité.
-
26.
CE, ord., 26 août 2016, nos 402742 et 402777, Ligue des droits de l’Homme et a. – assoc. de défense des droits de l’Homme collectif contre l’islamophobie en France.
-
27.
Couard J., « Le burkini, instrument du vivre ensemble… en Suisse ! », RJPF avr. 2017, n° 4, p. 19-20.
-
28.
CEDH, 25 mai 1992, n° 14307/88, Kokkinakis c/ Grèce, § 40.
-
29.
CEDH, gde ch., 18 mars 2011, n° 30214/06, Lautsi et a. c/ Italie, § 59.
-
30.
CEDH, 30 nov. 2004, Lautsi et a., préc. ; CEDH, nos 46254/99 et 31888/02, Bulski c/ Pologne.
-
31.
La Cour avait procédé de même dans l’arrêt Dahlab c/ Suisse du 15 février 2001 en affirmant que « la mesure poursuivait des buts légitimes au sens de l’article 9, § 2 : la protection des droits et libertés d’autrui, la sécurité publique et la protection de l’ordre ».
-
32.
Piot P., « La remise de documents publics par les autorités peut être une exigence conventionnelle fondée sur le droit à exercer sa liberté d’expression », Gaz. Pal. 14 févr. 2017, n° 286z1, p. 32, note sous CEDH, 8 nov. 2016, n° 18030/11, Magyar Helsinki Bizottság c/ Hongrie ; Husson-Rochcongar C. et Afroukh M., « Évolutions de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme – Second semestre 2016 », Revue des droits et libertés fondamentaux, n° 2017-13.
-
33.
Arrêt commenté, § 156.
-
34.
Dans ces différentes espèces, la Cour avait jugé que « la liberté de recevoir des informations [protégées par l’article 10] « interdit (…) à un gouvernement d’empêcher quelqu’un de recevoir des informations que d’autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir » et « ne saurait se comprendre comme imposant à un État, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, des obligations positives (…) de diffusion motu proprio, des informations » (V. CEDH, 26 mars 1987, Leander c/ Suède, § 29 ; CEDH, 7 juill. 1989, Gaskin c/ Royaume-Uni, § 52 ; CEDH, 19 févr. 1998, Guerra et a. c/ Italie, § 53 ; CEDH, gde ch., n° 32555/96, Roche c/ Royaume-Uni, § 172.
-
35.
Opinion concordante du juge Sicilianos à laquelle se rallie le juge Raimondi, § 1.
-
36.
Husson-Rochcongar C. et Afroukh M., op. cit.
-
37.
V. par ex. CEDH, 25 avr. 2006, n° 77551/01, Dammann c/ Suisse, § 52 ; CEDH, 26 mai 2009, n° 31475/05, Kenedi c/ Hongrie, § 43 ; CEDH, 25 juin 2013, n° 48135/06, Youth Initiative for Human Rights c/ Serbie, § 24 ; CEDH, 24 juin 2014, n° 27329/06, Roşiianu c/ Roumanie, § 64, etc.
-
38.
Husson-Rochcongar C. et Afroukh M., op. cit.
-
39.
V. Szymczak D., « La manipulation par la Cour européenne des droits de l’Homme de ses propres précédents », in Hourquebie F. et Ponthoreau M.-C. (dir.), La motivation des décisions des cours suprêmes et cours constitutionnelles, 2012, Bruxelles, Bruylant, p. 71 ; v. Burgorgue-Larsen L., « De l’art de changer de cap. Libres propos sur les nouveaux revirements de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme », in Mélanges en hommage au Doyen Cohen-Jonathan, vol. I, 2004, Bruxelles, Bruylant, p. 335.
-
40.
CEDH, 25 avr. 2006, n° 77551/01, Dammann c/ Suisse, § 52.
-
41.
V. par ex. CEDH, 14 avr. 2009, n° 37374/05, Társaság a Szabadságjogokert c/ Hongrie, § 28, concernant une collecte d’informations susceptibles de contribuer au débat public sur la législation pénale en matière de drogue ou encore CEDH, 28 nov. 2013, n° 39534/07, Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung c/ Autriche, § 36, concernant la collecte d’informations sur les commissions sur des transactions immobilières.
-
42.
V. par ex. CEDH, 26 mai 2009, n° 31475/05, Kenedi c/ Hongrie, § 43, concernant l’accès à des sources documentaires originales à des fins de recherche historique légitime ; CEDH, 25 juin 2013, n° 48135/06, Youth Initiative for Human Rights c/ Serbie, § 24, pour une demande d’accès à des informations factuelles concernant l’utilisation de mesures de surveillance électronique ; CEDH, 24 juin 2014, n° 27329/06, Roşiianu c/ Roumanie, § 64, concernant la collecte d’informations sur la bonne gouvernance dans une mairie ; CEDH, 17 févr. 2015, n° 6987/07, Guseva c/ Bulgarie, portant sur l’accès à des informations relatives au traitement des animaux abandonnés.
-
43.
CEDH, 25 juin 2013, n° 48135/09, Youth Initiative for Human Rights c/ Serbie, § 24.
-
44.
CEDH, 14 avr. 2009, n° 37374/05, Társaság a Szabadságjogokért c/ Hongrie, § 37-38.
-
45.
CEDH, 28 nov. 2013, n° 39534/07, Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung c/ Autriche, § 42.
-
46.
CEDH, 26 mai 2009, n° 31475/05, Kenedi c/ Hongrie, § 43.
-
47.
CEDH, 14 avr. 2009, n° 37374/05, Társaság a Szabadságjogokért c/ Hongrie, § 36.
-
48.
CEDH, 24 juin 2014, n° 27329/06, Roşiianu c/ Roumanie, § 61.
-
49.
Társaság a Szabadságjogokért c/ Hongrie, Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung c/ Autriche et Youth Initiative for Human Rights c/ Serbie, préc.