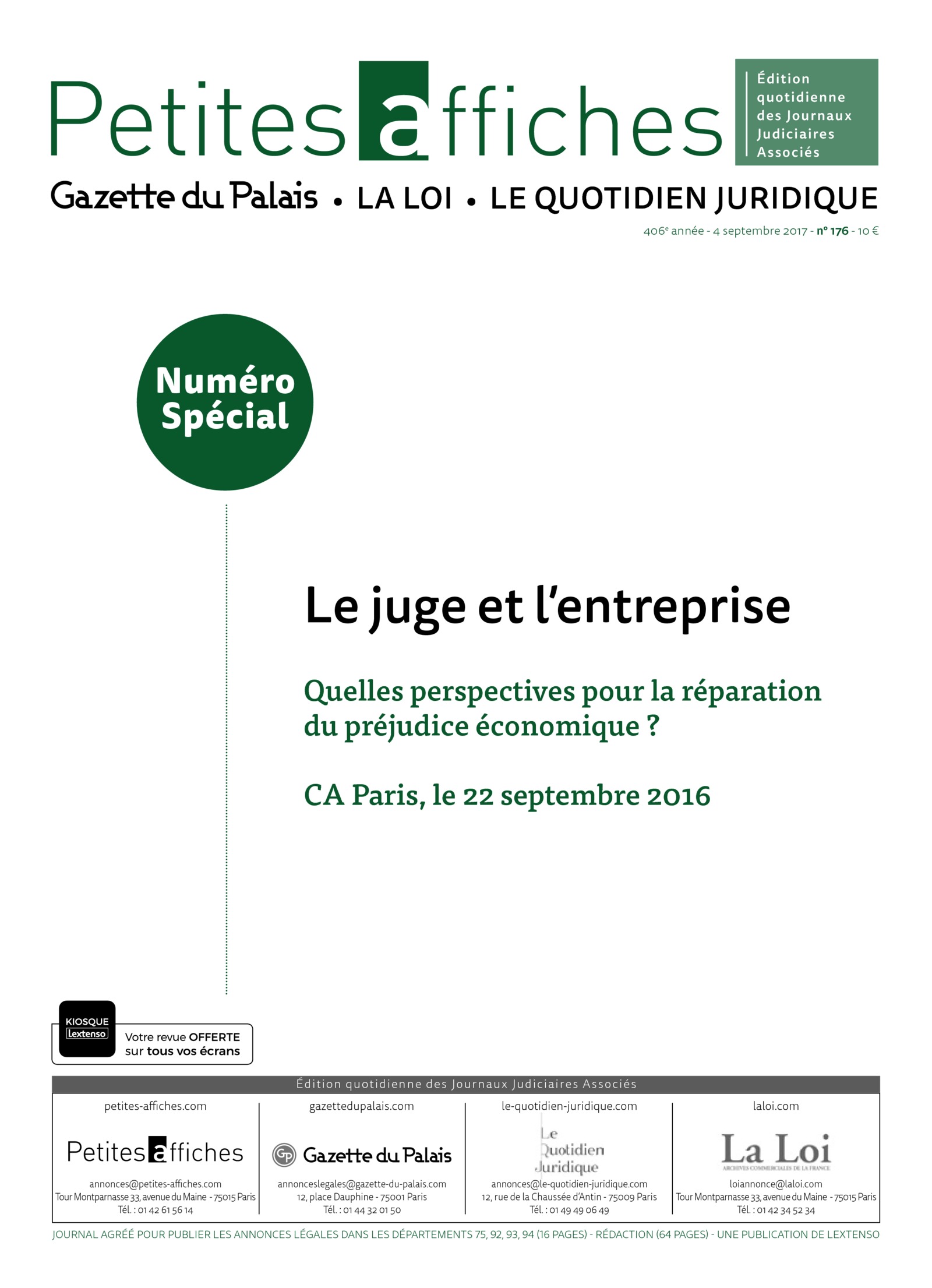Le juge et l’indemnisation du préjudice
Les retours d’expérience auxquels ont donné lieu les travaux préparatoires de cette table ronde ont fait ressortir une conviction généralement partagée : l’indemnisation du préjudice économique subi par l’entreprise, comme celle de toute autre espèce de préjudice, doit remplir pleinement sa fonction réparatrice et les juges eux-mêmes entendent que les dommages et intérêts qu’ils accordent compensent au mieux ce préjudice ; mais en même temps, ces retours d’expérience ont fait apparaître un constat, non moins unanime : les éléments qui sont soumis au juge par les parties, au vu desquels il doit statuer, ne lui permettent pas toujours de parvenir à cet objectif et d’appréhender le préjudice économique dans toute son étendue. Il y a là une application vécue de la logique et des contraintes du procès civil : ce qu’on attend du juge, c’est-à-dire la pleine compensation du préjudice, est toujours déterminé par les éléments d’évaluation et de calcul fournis par les parties ou issus d’une expertise, dans le respect du principe dispositif (le procès civil est « la chose des parties ») et du principe de la contradiction.
Ces éléments d’évaluation et de calcul – les seuls que le juge puisse prendre en compte – procurent-ils toujours les moyens d’indemniser avec certitude et précision le préjudice ? Probablement pas, et on connaît à cet égard la pratique – qui n’est pas sans traduire un certain embarras – consistant pour le juge à accorder un montant de dommages et intérêts « tous chefs de préjudice confondus ». C’est dans ce contexte que le constat évoqué plus haut cache en réalité une interrogation récurrente des juges : faut-il déplorer une sous-évaluation judiciaire du préjudice économique subi par l’entreprise ? Cette interrogation ne procède pas, loin s’en faut, que d’un ressenti personnel, nécessairement subjectif ; elle est largement partagée par les praticiens et la doctrine : on ne compte plus les travaux de toute sorte qui s’interrogent sur la concordance entre la réalité du préjudice et son évaluation judiciaire. Pour beaucoup d’observateurs d’ailleurs, la cause est entendue et l’interrogation devient une certitude : en présence des éléments de chiffrage du préjudice, le juge aurait une « tendance naturelle » à opter toujours pour la plus basse évaluation de la fourchette et à quasi systématiquement sous-évaluer le préjudice, de sorte que l’évaluation du préjudice serait « le talon d’Achille du droit de la responsabilité civile »1. Dans notre domaine, ce constat a d’ailleurs été formulé dans des termes très sévères par la Commission européenne qui n’a pas hésité à considérer que les dispositifs d’indemnisation mis en place par les États membres, en matière de préjudice résultant de pratiques anticoncurrentielles, étaient caractérisés « par un total sous-développement »2.
Ce jugement sévère est paradoxal, puisque s’il est en matière de responsabilité civile un principe traditionnel et indiscuté, celui de la réparation intégrale du préjudice : la victime a droit à ce que l’indemnité qui lui est accordée compense tout le préjudice qu’elle a subi, « le propre de la responsabilité » étant alors « de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu (…) »3. Ce principe cardinal de notre droit est aussi consacré par le droit communautaire, ainsi par la Cour de justice de l’Union qui rappelle que la victime doit pouvoir demander réparation « non seulement du dommage réel (damnum emergens), mais également du manque à gagner (lucrum cessans) ainsi que le paiement d’intérêts »4.
Si l’évaluation du damnum emergens peut s’avérer relativement aisée, il n’en va pas de même du lucrum cessans dont l’évaluation est par définition plus délicate, puisqu’il s’agit de compenser non pas une perte effectivement subie, qui s’apprécie donc par l’observation de la réalité, mais la perte ou l’insuffisance d’un revenu futur, en la déterminant par rapport à une situation qui n’a pas eu lieu, celle qui serait survenue si la faute dommageable n’avait pas été commise. Cette difficulté est d’autant plus sensible s’agissant du préjudice économique subi par l’entreprise que dans ce domaine, le gain manqué occupe une place certainement plus importante que dans d’autres domaines de la responsabilité civile ; il est même des cas dans lesquels le lucrum cessans constitue à lui seul tout le préjudice subi par la victime, s’agissant par exemple du préjudice résultant d’une rupture brutale de relations commerciales établies ou de pratiques anticoncurrentielles de barrière à l’entrée sur un marché. Dans de telles hypothèses, il s’agit alors, faute de pouvoir apprécier directement la réalité et l’étendue du préjudice, de reconstituer une situation qui ne s’est pas produite et de la comparer avec la situation qui s’est produite afin de mesurer l’écart avec les revenus qui auraient normalement dû être perçus si le fait dommageable n’était pas survenu ; le juge doit donc retenir un scénario de référence, sur la base d’estimations, compte tenu de ce qui était attendu, ou de ce qui était raisonnablement attendu, ce qui ne va pas sans soulever des interrogations au regard de l’exigence traditionnelle de « certitude » du préjudice réparable.
Une fois cette étape franchie, d’autres difficultés apparaissent : ainsi, quand l’infraction consiste en une pratique de cartel faussant la concurrence par les prix au préjudice des entreprises clientes des membres de ce cartel. Dans ce cas, le préjudice, c’est le « surprix », c’est-à-dire la différence entre le prix qui a été effectivement payé et celui qui aurait été payé, si la concurrence par les prix n’avait pas été faussée par le cartel. Cette situation, qui appelle a priori une indemnisation égale au surprix, soulève plusieurs problèmes, parmi lesquels la prise en compte d’un éventuel « passing on », s’il est démontré que les entreprises clientes ont répercuté tout ou partie de ce surprix sur leurs propres clients. La Cour de cassation a très clairement affirmé que dans une telle hypothèse, une indemnisation à la hauteur du surprix, qui ne tiendrait pas compte de la répercussion, serait un enrichissement sans cause5. Pour traiter de telles problématiques, le juge doit s’appuyer sur l’expertise des économistes qui ont mis au point des méthodes susceptibles d’y répondre ; c’est le cas, en particulier, de la méthode contrefactuelle, dont il a été beaucoup question au cours de cette journée.
Le respect du principe de réparation intégrale du préjudice emporte une autre conséquence : il faut réparer tout le préjudice, mais rien que le préjudice, les dommages et intérêts ayant une fonction compensatoire, mais nullement punitive. De l’application de ce principe, peut résulter un sentiment d’iniquité en cas de faute lucrative, c’est-à-dire, selon une définition couramment admise, lorsque malgré le paiement de dommages et intérêts venant compenser l’intégralité du préjudice de la victime, la faute laisse néanmoins à son auteur un bénéfice.
Dans une telle hypothèse, le juge dispose déjà, ou va disposer, de nouveaux outils issus d’évolutions législatives récentes ou à venir. Ainsi, s’agissant des règles de fixation des dommages et intérêts en matière de préjudice de contrefaçon, la directive de 2004, transposée en 2007, prévoit que pour fixer le montant de ces dommages et intérêts, les tribunaux prennent en considération les « conséquences économiques négatives » de la contrefaçon, notamment le manque à gagner, le cas échéant le préjudice moral, mais aussi – et c’est l’innovation de ce texte –, « les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant », de sorte que le montant judiciairement accordé peut être supérieur au préjudice. La réforme annoncée de la responsabilité civile pourrait aller dans le même sens, puisque l’avant-projet mis en consultation par le ministère de la Justice en avril 2016 fait dans le Code civil une place nouvelle au traitement de la faute lucrative, entendue comme la « faute lourde délibérée ayant généré un gain ou une économie pour son auteur ». Ce texte sanctionne cette faute, en privant son auteur du gain ou de l’économie que l’indemnisation n’aurait pas absorbée, mais il le fait d’une façon originale : non pas, comme la directive, en portant le montant de l’indemnisation à hauteur des bénéfices injustes – et donc, le cas échéant, au-delà du préjudice –, mais en infligeant une amende civile proportionnée à la gravité de la faute, aux facultés contributives de l’auteur et au profit qu’il en aura retiré. Le lien avec l’indemnisation n’est cependant pas totalement rompu, puisque l’avant-projet prévoit que le produit de cette amende peut être affecté, non pas au Trésor public, mais à un fonds d’indemnisation des victimes.
Ces dispositifs soulèvent avec évidence de nombreuses questions, eu égard, par exemple, au secret des affaires ou à l’office et aux prérogatives du juge dans l’administration de la preuve. Aussi la question se pose-t-elle de savoir si la refonte annoncée du fond du droit de la responsabilité civile doit s’accompagner d’un aménagement de la procédure judiciaire de mise en œuvre de cette responsabilité. Si tel devait être le cas, peut-être trouvera-t-on alors dans les travaux de notre colloque d’utiles pistes de réflexion pour une future réforme.
Notes de bas de pages
-
1.
Anziani A. et Béteille L., « Responsabilité civile : des évolutions nécessaires », Rapp. Sénat, juill. 2009, p. 101.
-
2.
Livre vert n° COM(2005) 672 final, 19 déc. 2005, Actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante.
-
3.
Cass. 2e civ., 16 déc. 1970.
-
4.
CJCE, 13 juill. 2006, nos C-295/04 à C-298/04, Manfredi.
-
5.
Cass. com., 15 juin 2010, n° 09-15816, Ajinomoto Eurolyne (aff. dite « de la Lysine »).