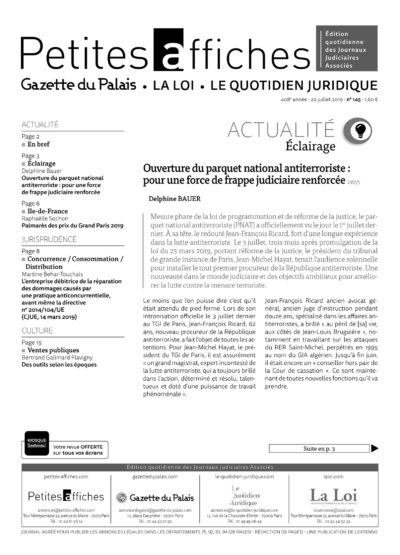L’entreprise débitrice de la réparation des dommages causés par une pratique anticoncurrentielle, avant même la directive n° 2014/104/UE
« La question de la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction à l’article 101 TFUE est directement régie par le droit de l’Union » (§ 28).
« La notion d’“entreprise”, au sens de l’article 101 TFUE, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction, par la Commission, d’amendes au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union » (§ 47).
CJUE, 14 mars 2019, no C-724/17, Vantaan kaupunki c/ Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy
1. Quel est le débiteur de la réparation de dommages causés par une pratique anticoncurrentielle ? S’agit-il de l’entreprise (ou plus précisément de toutes les personnes juridiques composant l’entreprise), ou s’agit-il de la seule société qui a commis l’acte poursuivi ?
La question s’est posée dans la présente affaire, alors même que la directive n° 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne1 n’était pas applicable.
2. Entre les années 1994 et 2002, une entente sur le marché de l’asphalte a été mise en œuvre en Finlande. Cette entente entre cinq sociétés finlandaises portait sur la répartition des marchés, sur les tarifs et sur la soumission d’offres pour les forfaits, et couvrant l’ensemble de cet État membre, elle était susceptible d’affecter le commerce intra-européen. Trois de ces cinq sociétés finlandaises sur le marché de l’asphalte ont fait l’objet de procédures de liquidation volontaire en 2002 et 2003, après que leurs actions eurent été rachetées et leurs activités transférées à trois autres sociétés (Skanska SIS, NCC, Asfaltmix).
Ces dernières ont été condamnées pour entente, et on leur a imputé les actes des participantes à l’entente dont elles avaient repris l’activité.
Par la suite, la ville finlandaise de Vantaa, se prétendant victime de surfacturations du fait de l’entente, a intenté une action en réparation à leur encontre.
Les sociétés Skanska SIS, NCC, Asfaltmix ont alors prétendu qu’au plan civil, ce n’est pas l’entreprise qui est responsable, mais les personnes morales qui ont effectivement causé le dommage par leur faute, et que la demande d’indemnisation aurait dû être formée dans le cadre des procédures de liquidation.
Le tribunal finlandais de première instance (käräjäoikeus) les a pourtant condamnées, en décidant qu’il convenait, afin d’assurer l’effectivité de l’article 101 du TFUE, d’appliquer le critère de la continuité économique à l’imputation de la responsabilité de l’indemnisation de ce préjudice de la même manière qu’en ce qui concerne l’infliction d’amendes.
Ce jugement a été infirmé par la cour d’appel (le hovioikeus) qui a considéré que le principe d’effectivité du droit de l’Union ne pouvait remettre en cause les caractéristiques fondamentales du régime finlandais de responsabilité civile et que le critère de la continuité économique, appliqué en matière d’infliction d’amendes, ne pouvait, en l’absence de modalités ou de dispositions plus précises, être transposé aux actions en dommages et intérêts.
La ville de Vantaa s’est alors pourvue en cassation devant la Cour suprême de Finlande (le Korkein oikeus), qui, estimant qu’il ne ressortissait pas clairement du droit de l’Union de l’époque que la détermination des personnes appelées à indemniser un tel préjudice doive être opérée sur le fondement d’une application directe de l’article 101 du TFUE ou bien qu’elle doive l’être en vertu des modalités fixées par l’ordre juridique interne de chaque État membre, a posé plusieurs questions préjudicielles à la CJUE.
La réponse de celle-ci est limpide : « L’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle toutes les actions des sociétés ayant participé à une entente interdite par cet article ont été acquises par d’autres sociétés, qui ont dissous ces premières sociétés et ont poursuivi leurs activités commerciales, les sociétés acquér(eur)s peuvent être tenues responsables du préjudice causé par cette entente ».
Cet arrêt permet donc d’affirmer que, dès avant la directive de 2014, c’est l’entreprise qui est le sujet du private enforcement (I). Cette solution sort renforcée des textes adoptés par la suite (II).
I – L’entreprise, sujet du private enforcement, dès avant la directive de 2014
3. Pour admettre cela, la CJUE admet que la notion de responsable civil du dommage causé par une pratique anticoncurrentielle est une notion européenne. Ce n’est pas la première fois, avant même la directive de 2014, que la CJUE a dégagé des notions européennes relatives au private enforcement (A). Il s’agit finalement d’une notion européenne de plus (B).
A – Les règles européennes applicables au private enforcement avant la directive de 2014
4. De nombreux arrêts de la CJUE avaient commencé à poser les pierres d’un droit européen du private enforcement. On peut ici en citer quelques-uns.
Ce fut tout d’abord l’arrêt Courage du 20 septembre 20012 qui admit qu’une partie membre d’une entente peut néanmoins obtenir une protection juridictionnelle contre l’autre partie au contrat, et que « l’article 85 du traité [devenu 101 du TFUE] s’oppose à une règle de droit national interdisant à une partie à un contrat susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, au sens de ladite disposition, de demander des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice occasionné par l’exécution dudit contrat au seul motif que l’auteur de la demande est partie à celui-ci ». L’arrêt Courage ajouta que le droit de l’Union « ne s’oppose pas à une règle de droit national qui refuse à une partie à un contrat susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence de se fonder sur ses propres actions illicites aux fins d’obtenir des dommages et intérêts, dès lors qu’il est établi que cette partie a une responsabilité significative dans la distorsion de la concurrence ».
Étaient ainsi posées les premières pierres d’un édifice européen de private enforcement. Il faut en effet comprendre que le private enforcement peut rendre plus effective l’action publique, en rendant la sanction globale dissuasive. Si avant de commettre une faute anticoncurrentielle lucrative3, l’entreprise fait un bilan de ce qu’elle gagnera et de ce qu’elle risque, elle mettra dans le côté négatif de la balance non seulement l’amende encourue, mais aussi les dommages et intérêts à payer aux victimes, ce qui pourrait la conduire à changer de stratégie. Il est dès lors très compréhensible que la CJUE considère qu’il lui appartient de poser des règles minimales concernant le private enforcement, afin de le rendre effectif, et par là même d’assurer l’effectivité des articles 101 et 102 du TFUE.
L’arrêt Courage a été un certain temps isolé. Mais l’arrêt Manfredi du 13 juillet 20064 est venu renforcer l’analyse en décidant que « (…) L’article 81 CE doit être interprété en ce sens que toute personne est en droit de faire valoir la nullité d’une entente ou d’une pratique interdite par cet article et, lorsqu’il existe un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice subi, de demander réparation dudit préjudice. En l’absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de fixer les modalités d’exercice de ce droit, y compris celles de l’application de la notion de “lien de causalité”, pour autant que les principes de l’équivalence et d’effectivité soient respectés ».
On trouve là les prémices de l’arrêt commenté. La compétence de principe est celle de l’ordre juridique national, « pour autant que les principes de l’équivalence et d’effectivité soient respectés ».
L’arrêt Manfredi poursuit en admettant qu’il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes pour connaître des recours en indemnité fondés sur une violation des règles européennes de concurrence et de fixer les modalités procédurales de ces recours. Il reconnaît également qu’il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de fixer les critères permettant de déterminer l’étendue de la réparation du préjudice causé par une entente, et de fixer les règles de la prescription. Toutefois, outre le fait que ces dispositions ne doivent pas être moins favorables que celles relatives aux recours en indemnité fondés sur une violation des règles nationales de concurrence, il affirme que le droit national ne doit pas rendre « excessivement difficile l’exercice du droit de demander réparation du dommage causé par une entente ou une pratique interdite par l’article 81 CE ».
L’arrêt Pfleiderer du 14 juin 20115 va parfaire cet édifice, en décidant que le droit de l’Union, et en particulier le règlement n° 1/2003/CE du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE, ne s’opposent pas à ce que la victime d’une pratique anticoncurrentielle obtienne l’accès aux documents relatifs à une procédure de clémence concernant l’auteur de cette infraction. Il appartient toutefois aux juridictions des États membres, sur la base de leur droit national, de déterminer les conditions dans lesquelles un tel accès doit être autorisé ou refusé en mettant en balance les intérêts protégés par le droit de l’Union. L’arrêt Donau du 6 juin 20136 ajoutera que le droit de l’Union, en particulier le principe d’effectivité, s’oppose à une disposition du droit national en vertu de laquelle l’accès aux documents figurant dans le dossier afférent à une procédure nationale relative à l’application de l’article 101 du TFUE, y compris aux documents communiqués dans le cadre d’un programme de clémence, de tiers n’étant pas parties à cette procédure et envisageant d’engager des recours en dommages et intérêts à l’encontre de participants à une entente est subordonné au seul consentement de toutes les parties à ladite procédure, sans qu’aucune possibilité d’effectuer une mise en balance des intérêts en présence soit laissée aux juridictions nationales.
On peut encore citer l’arrêt Otis du 6 novembre 20127, un peu particulier, en ce qu’il concerne un cas où c’est la Commission européenne qui a été victime d’une pratique anticoncurrentielle. Il décide que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce que la Commission européenne intente, au nom de l’Union européenne, devant une juridiction nationale, une action en réparation du préjudice subi par l’Union à la suite d’une entente ou d’une pratique dont la contrariété à l’article 81 du CE ou à l’article 101 du TFUE a été constatée par une décision de cette institution.
5. Ces quelques arrêts montrent à tout le moins que des principes européens étaient dégagés en matière de private enforcement, et que, si pour certaines notions, la Cour renvoyait aux droits nationaux (lien de causalité, étendue du préjudice, prescription, juges compétents), les éléments d’une protection minimale européenne étaient petit à petit dégagés (droit à la protection juridictionnelle contre son cocontractant, même quand on est un membre de l’entente, sauf exception ; droit d’accès aux documents de la procédure de public enforcement, sauf exception).
L’arrêt commenté ne fait qu’ajouter une règle de plus, en consacrant la notion européenne de responsable civil des dommages causés par une pratique anticoncurrentielle.
B – La consécration de la notion européenne de responsable civil des dommages causés par une pratique anticoncurrentielle
6. Cette consécration est fondée sur le principe d’effectivité (1), et n’est pas remise en cause en l’espèce par le principe de sécurité juridique (2).
1 – Consécration foncée sur le principe d’effectivité
7. C’est afin de sauvegarder « la pleine efficacité de l’article 101 TFUE et, en particulier, (son) effet utile » que la CJUE va consacrer cette notion européenne de responsable civil des dommages causés par une pratique anticoncurrentielle. Elle relève qu’« en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités d’exercice du droit de demander réparation du préjudice résultant d’une entente ou d’une pratique interdite par l’article 101 TFUE, pour autant que les principes d’équivalence et d’effectivité sont respectés [voir, en ce sens, l’arrêt n° C-557/12 du 5 juin 2014, Kone e.a., (…) pt 24 ainsi que la jurisprudence citée] ». On reconnaît là l’arrêt Manfredi précité.
De ce principe d’effectivité, la CJUE retient que la question de la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction à l’article 101 du TFUE est directement régie par le droit de l’Union (§ 28). Or la responsabilité du préjudice résultant des infractions aux règles de concurrence de l’Union ayant un caractère personnel, il incombe à l’entreprise qui enfreint ces règles de répondre du préjudice causé par l’infraction (§ 31). « Les entités tenues de réparer le préjudice causé par une entente ou par une pratique interdite par l’article 101 TFUE sont les entreprises, au sens de cette disposition, qui ont participé à cette entente ou à cette pratique » (§ 32).
Sans doute inspirée malgré tout par le texte de la directive de 2014 inapplicable en l’espèce8, la CJUE va appliquer ici la même notion d’entreprise qu’en matière de public enforcement.
Plus précisément, elle va appliquer le principe de la continuité économique de l’entreprise.
En matière de public enforcement, « la restructuration d’entreprise, entraînant la disparition de la personne juridique restructurée, n’a pas nécessairement pour effet de créer une nouvelle entreprise dégagée de la responsabilité des comportements contraires aux règles de concurrence de la précédente entité si, du point de vue économique, il y a identité entre celle-ci et la nouvelle entité [voir, en ce sens, les arrêts n° C-280/06 du 11 décembre 2007, ETI e.a., (…) pt 42 ; n° C-448/11 P du 5 décembre 2013, SNIA c/Commission, (…) pt 22, ainsi que n° C-434/13 P du 18 décembre 2014, Commission c/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin, (…) pt 40] » (§ 38)9.
Cette même règle de la continuité de l’entreprise s’applique ici en matière de private enforcement.
La CJUE ajoute qu’« il n’est pas incompatible avec le principe de responsabilité personnelle d’imputer la responsabilité d’une infraction à une société en sa qualité de société absorbante ». En effet, c’est l’entreprise qui est responsable de l’infraction au droit de la concurrence (et donc toutes les personnes juridiques qui la composent).
Quand la personne juridique auteure a disparu par suite d’une restructuration, l’entreprise, elle, peut avoir survécu. Dans ce cas, le responsable étant toujours là, peut être poursuivi.
On voit tout de suite sinon, quel serait le moyen d’échapper aux actions privées. Il suffirait d’utiliser astucieusement les montages sociétaires, pour que la personne juridique qui a participé à l’entente disparaisse, rendant bien plus difficile l’exercice des droits de la victime, qui se découvre souvent victime une fois la liquidation de l’entité en question terminée.
Dans ce cas, « il peut se révéler nécessaire, aux fins de la mise en œuvre efficace des règles de concurrence de l’Union, d’imputer la responsabilité pour infraction à ces règles à l’acquéreur de l’entreprise ayant commis cette infraction, lorsque cette dernière entreprise cesse d’exister en raison du fait qu’elle a été absorbée par cet acquéreur, lequel reprend, en tant que société absorbante, ses actifs et ses passifs, y compris ses responsabilités pour cause d’infraction au droit de l’Union [arrêt n° C-448/11 P du 5 décembre 2013, SNIA c/Commission, (…) pt 25] ».
8. Cette jurisprudence laisse d’ailleurs augurer que toute la jurisprudence de la CJUE sur l’entreprise rendue à propos d’action de public enforcement, pourrait être étendue au private enforcement.
D’ailleurs, la CJUE l’affirme en l’espèce en termes très clairs : « la notion d’“entreprise”, au sens de l’article 101 du TFUE, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction, par la Commission, d’amendes au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union » (§ 47).
Dès lors, on peut s’attendre à ce que toute la jurisprudence de public enforcement sur la notion d’entreprise, s’applique au private enforcement, et en particulier la très controversée présomption parentale. Ainsi, quand une société-mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société-mère exerce effectivement une telle influence (CJUE, 19 juill. 2012, n° C-628/10 P, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco c/ Commission et Commission c/ Alliance One International e.a., (…) pt 46). C’est alors à la société-mère qu’il incombe de renverser cette présomption, et de démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché10. Mais c’est une preuve impossible en fait.
Le paragraphe 47 de cet arrêt de la CJUE invite incontestablement à appliquer cette présomption, dans le cadre des actions privées.
De la même façon, même si en l’espèce l’action privée est une action en follow on (action privée après la condamnation de l’entreprise par une autorité de concurrence), la même solution s’appliquera à une action en stand alone (une action autonome)11. En effet, le paragraphe 47 de l’arrêt qui affirme l’identité du responsable, entre le public enforcement et le private enforcement l’impose. Si ce n’est que la victime aura quelques peines à établir qui fait partie de l’entreprise dans une action en stand alone, car elle ne sera pas aidée par la décision de l’autorité de concurrence.
Mais la notion européenne ainsi dégagée était-elle prévisible ? La consacrer ne venait-il bafouer le principe de sécurité juridique ?
2 – Consécration non remise en cause par le principe de sécurité juridique
9. En l’espèce, l’acquéreur NCC a demandé à la CJUE de différer dans le temps les effets de cette jurisprudence, qu’elle considérait comme imprévisible.
Le principe est toutefois que la jurisprudence est rétroactive, puisqu’elle vient toujours régir des situations passées. La CJUE précise ainsi que « la règle ainsi interprétée (par la CJUE) peut et doit être appliquée par le juge même à des rapports juridiques nés et constitués avant l’intervention de l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite règle se trouvent réunies [arrêt n° C‑110/15 du 22 septembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e.a., (…) pt 59 ainsi que la jurisprudence citée] » (§ 55).
Certes, comme bien des cours suprêmes, la CJUE peut déroger par exception à cette règle et limiter dans le temps l’effet d’un revirement ou de la consécration d’une jurisprudence. Mais, « pour qu’une telle limitation puisse être décidée, il est nécessaire que deux critères essentiels soient réunis, à savoir la bonne foi des milieux intéressés et le risque de troubles graves [arrêt n° C‑110/15 du 22 septembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e.a., (…) pt 60 ainsi que la jurisprudence citée] » (§ 56).
Or en l’espèce, ces exigences n’étaient pas remplies.
10. Il faut approuver ici la CJUE.
On a déjà montré supra qu’il existait des notions européennes en matière de private enforcement, dès avant la directive de 2014. NCC ne pouvait donc affirmer qu’il était absolument imprévisible que la CJUE adopte une notion européenne du responsable des dommages causés par une pratique anticoncurrentielle.
Certes, au moment où le CJUE statue en 2019, elle ne peut toutefois faire abstraction de ce que la directive de 2014 a consacré cette notion européenne de responsable civil des dommages causés par des pratiques anticoncurrentielles. Il n’est pas exclu que l’interprétation du droit antérieur à la directive de 2014, l’ait été en contemplation de cette dernière.
Or l’entente litigieuse a eu lieu entre les années 1994 et 2002, à une date bien antérieure à ces développements récents.
Mais la liquidation en 2002 et 2003 (juste après la fin de l’entente) de trois des cinq sociétés finlandaises membres de l’entente a de quoi surprendre. N’y avait-il pas là une stratégie d’évitement de leur éventuelle responsabilité, que la CJUE a voulu déjouer ?
D’ailleurs, la CJUE relève également que « si des entreprises, responsables du préjudice causé par une infraction aux règles de concurrence de l’Union, pouvaient échapper à leur responsabilité par le simple fait que leur identité a été modifiée par suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels, l’objectif poursuivi par ce système ainsi que l’effet utile desdites règles seraient compromis (voir, par analogie, l’arrêt n° C-280/06 du 11 décembre 2007, ETI e.a., (…) pt 41 ainsi que la jurisprudence citée) » (§ 46).
Certes, rien dans l’arrêt ne prouve explicitement cette stratégie d’évitement, mais la CJUE relève que NCC « n’a pas démontré que les critères visés au point 56 du présent arrêt sont réunis en l’espèce ». En d’autres termes, elle constate implicitement qu’il n’y a ni bonne foi des milieux intéressés, ni risque de troubles graves. La CJUE a sans doute soupçonné que les liquidations avaient bien eu pour objectif un évitement de la responsabilité des membres de l’entente.
Dans ces conditions, il n’y avait aucune raison de moduler les effets dans le temps de la consécration de cette jurisprudence.
Si l’arrêt commenté pose clairement la règle selon laquelle l’entreprise est le débiteur de la réparation des dommages causés par une pratique anticoncurrentielle, cette solution a été encore confortée par la directive de 2014 et les textes qui l’ont suivie.
II – L’entreprise sujet du private enforcement depuis la directive de 2014
11. La solution de l’espèce est donc confortée par les textes nouveaux (A), même s’il faut toujours tenir compte de contraintes procédurales (B).
A – L’entreprise sujet du private enforcement dans les textes récents
12. Dans la directive n° 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, c’est l’entreprise qui est débitrice de la réparation. Plusieurs textes de la directive montrent que c’est bien l’entreprise qui doit les dommages et intérêts.
Tout d’abord, l’article 1 de la directive, qui s’intitule « Objet et champ d’application », précise en son paragraphe 1 que « la présente directive énonce certaines règles nécessaires pour faire en sorte que toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence commise par une entreprise ou une association d’entreprises puisse exercer effectivement son droit de demander réparation intégrale de ce préjudice à ladite entreprise ou association… ».
L’article 2 de la directive définit, quant à lui, les termes essentiels. La définition n° 2 concerne l’« auteur de l’infraction » qui est défini comme étant « l’entreprise ou l’association d’entreprises ayant commis l’infraction au droit de la concurrence ».
Ces termes clairs12 ont cependant été contestés par certains13.
13. Les auteurs de l’ordonnance ont eu à trouver une solution14. Leurs obligations européennes leur imposaient de rendre responsable l’entreprise, mais celle-ci n’a pas la personnalité juridique. Ils ont donc consacré le fait que toutes les personnes physiques ou morales composant l’entreprise sont responsables des dommages causés par l’entreprise.
Plusieurs articles de la nouvelle ordonnance permettent là encore de l’affirmer.
En premier lieu, l’article L. 481-1 nouveau du Code de commerce dispose que « toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L. 464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
En second lieu, l’article L. 481-10 nouveau du Code de commerce, dispose que « par dérogation à l’article L. 481-9, une petite ou moyenne entreprise n’est pas tenue solidairement de réparer le préjudice subi par les victimes autres que ses contractants directs ou indirects (sous certaines conditions)… ». La petite ou moyenne entreprise devient ici, même à travers les mots employés, le responsable des dommages causés à la victime. Fréquemment d’ailleurs, elle ne sera composée que d’une personne morale.
On peut donc en conclure que là encore, ces textes ont véhiculé une notion européenne de responsable civil des dommages causés par la pratique anticoncurrentielle. Si certains avaient encore des doutes à la lecture de ces textes, l’arrêt commenté les lèveraient certainement.
Mais il reste que cette affirmation n’exclut pas de tenir compte de contraintes procédurales.
B – La prise en compte des contraintes procédurales
14. Mais malgré tout, procéduralement, l’entreprise n’existe pas. L’entreprise ne peut être poursuivie en tant que telle. L’entreprise ne peut être condamnée en tant que telle, car elle n’a pas la personnalité juridique.
C’est pourquoi, à un moment donné, il va bien falloir que soient poursuivies et condamnées des personnes juridiques. C’est là une contorsion à laquelle ce raisonnement au travers de la notion d’entreprise nous conduit.
C’est ainsi que l’imputabilité à la société-mère du comportement de sa filiale conduit en effet à une condamnation solidaire des deux personnes juridiques constituant l’entreprise15.
La solidarité est ici utilisée comme la manière de rendre les personnes juridiques constituant l’entreprise, responsables ensemble du comportement infractionnel de l’entreprise, qui ne peut pourtant pas être poursuivie en justice. La CJUE avait en effet relevé que « la notion du droit de l’Union de solidarité pour le paiement de l’amende n’(est) qu’une manifestation d’un effet de plein droit de la notion d’entreprise » (CJUE, 10 avr. 2014, nos C-231/11, C-232/11 et C-233/11, Siemens Österreich et a. c/ Commission, pts 51 et 57).
Et de la même façon, en matière de private enforcement, alors que, dans la directive n° 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, c’est l’entreprise qui est débitrice de la réparation, les auteurs de l’ordonnance du 9 mars 2017, qui ont transposé cette directive, ont consacré le fait que toutes les personnes physiques ou morales composant l’entreprise sont responsables des dommages causés par l’entreprise, anticipant ainsi les aspects procéduraux.
Donc, pour ce qui concerne le public enforcement, tous les actes de poursuite de la Commission seront faits à l’encontre des personnes morales. En matière de private enforcement, ce sont aussi des personnes physiques ou morales qui seront assignées en justice par la victime.
On voit poindre ici la distinction entre les règles de fond, qui s’appliquent à l’entreprise et qui concerneront donc de la même façon toutes les personnes juridiques qui la composent, et les règles de poursuite, ou de mise en œuvre, qui s’appliquent aux personnes morales, et qui peuvent s’appliquer distinctement aux différentes personnes juridiques poursuivies.
Ainsi, la disparition de la personnalité juridique de la filiale absorbée par une nouvelle mère, n’empêchera pas la société-mère qui était sa mère au temps de l’infraction de répondre de l’entente. Et pourtant, la filiale, elle, ne peut plus être poursuivie, puisqu’en tant que personne morale, elle n’existe plus. La disparition de la personne morale de la filiale n’a pas fait disparaître l’infraction (règle de fond), ce dont il résulte que la mère au temps de cette infraction doive toujours en répondre. Mais la disparition de la personne morale de la filiale empêche bien évidemment les poursuites contre la filiale qui n’existe plus (règle de procédure), et la mère ne peut se fonder là-dessus pour échapper à la sanction.
C’est aussi ce qui explique un arrêt controversé rendu en matière de prescription de l’action publique, en d’autres termes, selon l’arrêt, sur « la prescription du pouvoir de la Commission d’infliger des sanctions » aux filiales16. La prescription ne met fin qu’au droit de poursuite de la Commission (ou d’une autorité de concurrence) à l’encontre de la filiale. Elle ne fait pas disparaître l’infraction dont doit répondre la mère. Et si le droit de poursuite contre la mère n’est pas éteint, rien n’empêche d’invoquer, lors de cette poursuite, l’infraction qui a été commise directement par la filiale, et donc par l’entreprise.
C’est ce qui explique, puisque les poursuites sont dirigées contre chaque personne morale, que, si elles sont prescrites contre l’une, elles ne le sont pas forcément contre l’autre.
Et comme la solidarité en matière de public enforcement ne joue pas le rôle de la solidarité en matière civile ou commerciale, mais a une autre fonction, celle de faire « condamner l’entreprise » à travers la condamnation solidaire de ses membres, on ne saurait invoquer une sorte de représentation mutuelle des coobligés qui existe en matière civile, mais qui est totalement étrangère au débat s’il se situe sur le plan répressif.
D’ailleurs en matière de private enforcement, a priori, si la société-mère est condamnée définitivement par une autorité de concurrence alors que l’action publique contre la filiale était prescrite, une action en follow on sera ouverte contre la mère, et la victime pourra se fonder sur l’autorité de chose décidée de la décision de l’autorité de concurrence, nonobstant la prescription de l’action contre la filiale.
15. En définitive, en décidant explicitement que le débiteur de la réparation est l’entreprise, avant même que la directive de 2014 ne soit applicable, l’arrêt commenté apporte une très belle pierre à l’édifice du private enforcement. De belles questions sont encore devant nous, et le développement des actions privées depuis la directive de 2014 permettra certainement à la CJUE de parfaire cette construction.
Notes de bas de pages
-
1.
JOUE L 349, 5 déc. 2014, p. 1.
-
2.
CJUE, 20 sept. 2001, n° C-453/99.
-
3.
V. Fournier de Crouy N., La faute lucrative, Behar-Touchais M. (dir.), 2018, Economica.
-
4.
CJUE, 13 juill. 2006, n° C-295-04.
-
5.
CJUE, 14 juin 2011, n° C-360/09.
-
6.
CJUE, 6 juin 2013, n° C-536/11.
-
7.
CJUE, 6 nov. 2012, n° C-199/11.
-
8.
Cf. infra.
-
9.
V. sur ces questions l’atelier organisé à la DGCCRF sur les restructurations d’entreprises et le droit de la concurrence, sous la dir. de Behar-Touchais M. et Lemaire C., https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/atelier-dgccrf-restructuration-dentreprises-et-concurrence ; Lemaire C., « Responsabilité concurrentielle des groupes de sociétés », Contrats, conc. consom. 2017, étude 5.
-
10.
CJUE, 10 sept. 2009, n° C-97/08 P, Akzo Nobel, pt 61 ; CJUE, 19 juill. 2012, n° C-628/10 P, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco c/ Commission et Commission c/ Alliance One International e.a., pt 47.
-
11.
Sur cette distinction, v. la thèse de Amaro R., Le contentieux privé des pratiques anticoncurrentielles. Étude des contentieux privés autonomes et complémentaires devant les juridictions judiciaires, Behar-Touchais M. (dir.), 2014, Larcier.
-
12.
V. Behar-Touchais M. et Carval S., « Le débiteur des dommages et intérêts dus en cas de pratique anticoncurrentielle », Concurrences 2015, p. 84-100, n° 18.
-
13.
Saint-Esteben R., « La question de la responsabilité civile des sociétés mères du fait des infractions aux règles de concurrence commises par leurs filiales : la voix du silence, 23 juin 2014 », Concurrences 2014, n° 3, art. n° 67244, p. 5-7.
-
14.
V. nos obs. in « Du débiteur de la réparation dans l’ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles », RDC 2017, n° 114f3, p. 310 et s.
-
15.
CJUE, 10 avr. 2014, nos C-231/11, C-232/11 et C-233/11, Siemens Österreich et a. c/ Commission : Behar-Touchais M., « Imputabilité : la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles en cas de succession de sociétés mères et sur la solidarité des amendes en cas de succession de sociétés mères dans les restructurations d’entreprises (Siemens, Areva, Alstom) », Concurrences 2014, n° 3, art. n° 68023, p. 69 à 74.
-
16.
CJUE, 27 avr. 2017, n° C-516/15 P, Akzo Nobel NV et a. c/ Commission européenne : Behar-Touchais M., « Les poursuites contre la mère, responsable personnellement des actes de sa filiale, peuvent ne pas être prescrites, même si celles contre la filiale le sont », RDC 2017, n° 114n8, p. 505.