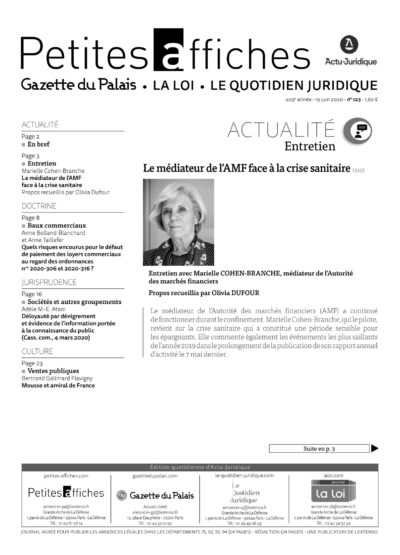Déloyauté par dénigrement et évidence de l’information portée à la connaissance du public
La divulgation par une société d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit fabriqué et commercialisé par d’autres acteurs économiques constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.
C’est l’idée essentielle qui ressort de cet arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation admettant la déloyauté par dénigrement d’une société : évoquant le caractère dangereux de composants utilisés dans la fabrication des plans de travail (en marbre, en granit et pierre naturelle et en quartz de synthèse), cette société avait tenté de mettre en garde notamment les consommateurs en diffusant largement les résultats d’une étude sur le quartz de synthèse.
Cass. com., 4 mars 2020, no 18-15651

En matière de concurrence déloyale, le dénigrement consiste en des pratiques ou comportements par lesquels un opérateur jette le discrédit12 sur les produits ou services généralement d’un concurrent, en répandant des informations malveillantes, exagérées ou infondées sur son entreprise, ses employés, ses produits ou services, sa solvabilité, ses méthodes de travail… Mais il est admis depuis longtemps que cet acte de déloyauté peut exister même en l’absence d’une situation concurrentielle directe entre les parties, le dénigrement ne visant pas toujours à détourner des clients d’un autre opérateur économique vers soi. Le diffuseur de l’information qualifiée de dénigrante peut effectivement mettre en avant la simple publication d’une vérité scientifique.
L’arrêt ci-après de la chambre commerciale du 4 mars 20203 rendu au visa des articles 1240 du Code civil et 873, alinéa premier, du Code de procédure civile nous en donne une illustration.
Des faits de l’arrêt, il ressort que la société X qui fabrique et commercialise des plans de travail en marbre, en granit et pierre naturelle et en quartz de synthèse, soupçonnait ce dernier matériau d’être dangereux pour la santé de ses employés. Elle a alors fait réaliser une étude par l’Institut de recherche et d’expertise scientifique de Strasbourg (l’IRES). L’étude réalisée par l’IRES confirmant la présence de composants dangereux dans le quartz de synthèse, les deux rapports établis par cet organisme sont publiés sur le site internet de la société et sur les réseaux sociaux de son dirigeant. Ce dernier publie sur son compte Twitter et sur son blog des articles faisant état du danger présenté par les plans de cuisine en quartz de synthèse, car ayant des composants cancérigènes et mutagènes.
La société X a par ailleurs lancé une alerte auprès du magazine 60 millions de consommateurs en indiquant que ce matériau était dangereux pour la santé, non seulement lors du façonnage, mais aussi « lors de l’utilisation quotidienne en cuisine ».
L’interpellation en un sens intempestive n’est pas du goût de tout le monde, notamment de l’association Y, qui a pour objet de promouvoir la réalisation de plans de travail de cuisines et salles de bain en quartz de synthèse et qui regroupe plusieurs fabricants de pierres agglomérées.
L’association adresse une mise en demeure à la société X de cesser cette campagne qu’elle juge dénigrante ; sans succès. Invoquant alors l’existence d’un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, elle assigna en référé la société X pour qu’elle soit condamnée sous astreinte à des mesures conservatoires de retrait et d’interdiction de diffusion des informations relatives aux études menées par l’IRES sur le quartz de synthèse. Mais l’ordonnance de référé est infirmée en appel. La cour d’appel de Versailles écarte (par un arrêt rendu le 22 février 2018) en effet la nécessité d’un référé par une argumentation qui met en avant l’objectif de mise en garde de la diffusion de l’information malgré la critique de l’étude.
D’une part, l’arrêt admet certes l’existence de critiques contre la méthodologie employée par l’IRES pour émettre ses conclusions mais estime que le caractère potentiellement dangereux du matériau litigieux apparaît au regard de certaines constatations. Il résulte des analyses de cet organisme que « le matériau de quartz de synthèse comporte de nombreuses substances potentiellement dangereuses pour la santé, tel le cadmium retrouvé en concentration importante, et que le risque d’un danger pour la santé des consommateurs qui utilisent au quotidien un plan de travail de cuisine en quartz de synthèse ne peut être écarté en l’état actuel des connaissances scientifiques sur la question, d’autant moins qu’il est, à ce jour, démontré que des salariés de différents pays, qui façonnent et découpent les plaques de quartz de synthèse et les installent chez des particuliers, dont il ne peut être exclu qu’ils procèdent par eux-mêmes à ces découpes, ont présenté des troubles graves et, pour certains, sont atteints de silicose, l’Agence nationale de la santé et de la sécurité alimentaire (l’ANSES) s’étant autosaisie de la question des dangers et risques relatifs à la silice cristalline, menant actuellement une étude de filière afin d’identifier les différents usages de cette substance, y compris au stade de la commercialisation de produits en contenant et à l’égard du consommateur ».
D’autre part, le droit d’alerte est invoqué par les juges d’appel au soutien de la décision. Ce droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement qui autorise toute personne physique et morale à diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action dont la méconnaissance lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement. Pour les juges d’appel, « si l’association Y produit aux débats des analyses critiques des rapports de l’IRES, elle ne fournit aucune expertise en condition d’utilisation réelle qui permettrait d’écarter tout risque sanitaire pour les consommateurs ». La mise en garde publique faite par la société X sur un matériau qu’elle a cessé de vendre « convaincue du risque de sa nocivité, en alertant parallèlement la ministre des Affaires sociales et de la Santé, par un courrier du 1er février 2017, et la direction de l’évaluation des risques de l’ANSES », apparaît alors comme la nécessaire information du consommateur, qui doit être mise en regard avec le droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement.
En définitive, la cour d’appel estime qu’au regard de ce droit d’alerte et des interrogations persistantes et légitimes sur la nocivité pour la santé du consommateur du quartz de synthèse utilisé pour les plans de travail de cuisine, le caractère manifeste du dénigrement reproché à la société X n’est pas établi avec l’évidence que requiert le référé.
Cette position de la cour d’appel n’est pas celle de la Cour de cassation qui censure l’arrêt au double visa des articles 1240 du Code civil et 873, alinéa premier, du Code de procédure civile. L’attendu de principe est d’une clarté limpide : « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ».
Il y a tout d’abord dans cette décision la confirmation du caractère indifférent de la situation classique de concurrence entre les parties pour reconnaître la déloyauté par dénigrement.
Il est évident que la question du dénigrement n’a pas de sens immédiat si on la rapporte à l’intérêt propre de la société : quel intérêt aurait la société X qui fabrique et commercialise des plans de travail également avec la matière incriminée, le quartz de synthèse, à diffuser une telle information qui suscite la crainte d’utiliser la marchandise ? L’affirmation impacte également la pérennité de son activité à moins de modifier sa fabrication au regard de ce risque sanitaire.
On pourrait donc voir dans sa démarche a priori le souci d’une pure information objective, la diffusion d’une vérité scientifique ; une sorte de vertu de transparence qui la pousse à mettre en garde les consommateurs. Si une telle démarche peut être comprise, la vraie question reste en définitive celle du crédit à porter au message diffusé et c’est là que se trouve le nœud du problème.
D’une part, les rapports de l’IRES, invoqués au soutien du message diffusé, étaient critiqués tant par les deux experts mandatés par l’association Y que par un organisme administratif de contrôle de la concurrence, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il était reproché à l’IRES de ne pas avoir réalisé ces tests dans des conditions normales d’utilisation par des consommateurs.
D’autre part et surtout, l’organisme scientifique lui-même reconnaissait que son étude ne portait pas sur l’évaluation des migrations de substances contenues dans l’air ou les denrées alimentaires en contact avec le matériau incriminé. De quoi faire douter de la pertinence de l’information diffusée. Au regard de ces observations, se pose la question de savoir si c’est vraiment pour le bien de tout le monde que l’information est diffusée ? N’y aurait-il pas une faute voire peut-être une intention de nuire à autrui lorsqu’on diffuse une information incertaine ? En tout cas un comportement contraire aux usages « honnêtes » des affaires ?
Les juges du droit concluent, à cause de ces observations, que l’information divulguée ne reposait pas sur une base factuelle suffisante au regard de la gravité des allégations. La cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes visés, la sanction de la déloyauté fondée sur la responsabilité civile délictuelle ou extracontractuelle de l’article 1240 du Code civil et l’exercice du référé de l’article 873, alinéa premier, du Code de procédure civile.
L’absence d’évidence de l’information diffusée établit en un certain sens l’évidence requise pour l’obtention des mesures par la procédure des référés.
L’évidence et le référé. Les référés sont des procédures d’urgence : il s’agit de faire statuer provisoirement et avec rapidité sur des difficultés relatives aux actes exécutoires et aux affaires urgentes ; cette dernière situation étant celle rencontrée dans l’arrêt. L’évidence est en quelque sorte consubstantielle au référé ; la rapidité que requiert la procédure excluant de facto des analyses trop longues et minutieuses ; les faits doivent parler d’eux-mêmes. En fait, le juge doit être convaincu de la nécessité de statuer rapidement afin d’ordonner éventuellement, et ce « même en présence d’une contestation sérieuse », des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (CPC, art. 873, al. 1er). L’existence d’un trouble manifestement illicite (résultant de la divulgation des informations litigieuses) et/ou d’un dommage imminent (de nature à perturber les ventes ou autres opérations commerciales en cours avec les conséquences financières qu’on imagine lourdes) peut être caractérisée dans cet arrêt par les circonstances entourant l’information divulguée.
Le message diffusé publiquement par la société X faisait état du danger présenté par les plans de cuisine en quartz de synthèse, qui contiennent, soutient la société, des composants cancérigènes et mutagènes. Ainsi par exemple, l’article intitulé « Alerte de nocivité : les plans de cuisine en quartz de synthèse sont dangereux », publié le 2 février 2017, relayé dans le magazine 60 millions de consommateurs du 8 mars 2017, affirme sans réserve que « cette matière est non seulement dangereuse pour la santé lors du façonnage mais également lors de l’utilisation quotidienne en cuisine ». Or une telle affirmation claire se révèle à l’analyse discutable et est discutée. Au regard de l’incertitude entourant l’information « scientifique », la mise en garde apparaît mensongère4 et doit être sanctionnée par des mesures empêchant la persistance de sa diffusion en attendant sa rectitude. Cette position peut être rapprochée de l’attendu d’un arrêt dans lequel la Cour de cassation a affirmé au visa de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil et de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales que « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la publication, par l’une, de propos de nature à jeter le discrédit sur un produit fabriqué ou commercialisé par l’autre, peut constituer un acte de dénigrement, sans que la caractérisation d’une telle faute exige la constatation d’un élément intentionnel ; que, cependant, lorsque les appréciations portées sur un produit concernent un sujet d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, leur divulgation relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu’elles soient exprimées avec une certaine mesure ; qu’en revanche, l’éditeur de presse, tenu de fournir des informations fiables et précises, doit procéder à la vérification des faits qu’il porte lui-même à la connaissance du public ; qu’à défaut, la diffusion d’une information inexacte et dénigrante sur un produit est de nature à engager sa responsabilité »5.
En somme, de telles décisions expriment l’idée qu’on ne saurait se contenter de la seule liberté pour quiconque de diffuser, une information sans responsabilité aucune. Même la bonne foi et l’absence d’intention de nuire ne suffisent pas.
On se rend compte, qu’en définitive, il est toujours question de tenir ensemble la liberté d’expression qui implique la libre critique et une responsabilisation nécessaire de la personne qui diffuse une information. Dans la décision qui vient d’être citée, la Cour de cassation avait ainsi censuré la décision des juges d’appel qui avaient écarté la responsabilité d’une société d’édition, la société Éditions périodiques du Midi, ayant publié une critique peu élogieuse des millésimes d’un vin. La motivation de l’arrêt de cassation fait ressortir la nécessité d’une vigilance certaine à la charge de cette société, qui avait publié dans le numéro de novembre/décembre 2012 de la revue Terre de vins, un article exposant la critique d’un dégustateur spécialisé dans les grands crus bordelais, à l’issue d’une dégustation en public et à l’aveugle en Suisse. Or même s’il s’est avéré que l’article comportait une information inexacte (en affirmant qu’un millésime l’aurait emporté sept fois), les juges d’appel avaient écarté la responsabilité de la société éditrice ; selon eux, celle-ci « n’avait aucun devoir de vérification de la qualité ni même de l’exactitude de la chronique dont [le dégustateur] (…) est l’auteur, dès lors qu’il est admis que celui-ci est un critique en œnologie reconnu dans le milieu averti des lecteurs de cette revue spécialisée et que l’éditeur n’avait pas connaissance de l’erreur matérielle résultant de l’inversion de notes attribuées aux bouteilles de la dégustation ».
Les juges du droit ont écarté un tel raisonnement : sans méconnaître le droit à la liberté d’expression de l’œnologue dont les appréciations « au demeurant non incriminées, ne faisaient qu’exprimer son opinion et relevaient, par suite, du droit de libre critique », la Cour de cassation affirme nettement qu’il incombait à la société éditrice de la chronique « en sa qualité d’éditeur de presse, de procéder à la vérification des éléments factuels qu’elle portait elle-même à la connaissance du public et qui avaient un caractère dénigrant ».
Pour revenir à l’affaire qui concerne la société X, on voit bien que chacun (et à plus forte raison, les professionnels) est appelé à la prudence, tenu d’observer une vigilance nécessaire ; notamment du fait de la caisse de résonance que constituent les réseaux sociaux.
Il devient de plus en plus facile aujourd’hui par le canal de ces réseaux (Facebook, Twitter…) de dénigrer, de détruire en quelque sorte la réputation ou l’image d’un produit, d’un service, d’une entreprise… sans fondement, sans éléments factuels véritablement solides.
Face à ce risque exponentiel, il faut fortement inciter à cette prudence devenue totalement incontournable. En réalité, entendre ainsi ces textes juridiques généraux du Code civil comme l’est celui de l’article 1240, « tout fait quelconque de l’homme » ne crée pas de nouvelles obligations. La faute, l’écart de conduite sanctionné demeure une imprudence, une négligence… Simplement dans ces cas de diffusion d’informations, ce devoir général de prudence vient acter une évidence déterminante. Contraindre à la vérification de l’exactitude de l’information portée à la connaissance d’autrui c’est éviter notamment la manipulation de l’opinion par des informations qui reposent sur des bases évasives et sujettes à contestation ; c’est surtout rejoindre l’esprit de la mission de la diffusion de l’information lorsqu’elle est dite scientifique : porter à la connaissance du public (avisé ou pas) une information vérifiée et vérifiable entraînant parfois des prises de décision, un changement de comportement…
Bien sûr, la réflexion doit avoir pour ancre l’absence d’un terme définitif en cette matière. La formule classique « en l’état actuel des connaissances scientifiques » permet de ne pas fermer définitivement le questionnement. Ainsi à l’avenir, si d’autres recherches permettent d’établir clairement que ce matériau présente un risque sanitaire pour les consommateurs, on peut (voire on doit) se raviser. Les temps particuliers d’épreuve du Covid-19 que nous vivons ont ainsi montré la suspension parfois de certaines autorisations qui avaient été obtenues pour des essais cliniques6. Des informations complémentaires, une analyse approfondie… doivent permettre d’écarter la suspicion de risques manifestes pour la vie que feraient courir les actions envisagées. Ce qui signifie qu’intégrer la donnée de vigilance permet de ne pas se laisser complètement aveugler voire engloutir par des visées commerciales, économiques… La vérité dite scientifique est comme un outil qui doit permettre de décortiquer les causes, les conséquences d’une réalité pour inviter à une prise de décision éclairée. L’arrêt est ici une cassation avec renvoi, c’est aussi un appel fait à la juridiction de renvoi d’utiliser cet outil.
Notes de bas de pages
-
1.
Cass. 1re civ., 5 juill. 2006, n° 05-16614 : Bull. civ. I, n° 356, jugeant comme dénigrante l’assimilation du vin du groupement foncier agricole du domaine de Château de Valdition à un « picrate à peine buvable » alors que ces vins avaient été régulièrement récompensés.
-
2.
Les italiques dans le texte sont de l’auteur.
-
3.
Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15651.
-
4.
V., à propos du caractère paradoxal du mensonge par sincérité, un récent article revenant sur différents types de mensonges en justice, Viaut L., « Le mensonge en justice : aspects juridiques, historiques et psychologiques », LPA 21 avr. 2020, n° 152q4, p. 8.
-
5.
Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-31758.
-
6.
L’Agence nationale de la sécurité du médicament, l’ANSM, a ainsi suspendu l’accord qu’avait obtenu l’entreprise de biotechnologie Hemarina pour des essais cliniques (avec du sang de vers marins) sur des patients atteints du Covid-19 au regard des résultats d’une étude préalable réalisée sur des porcs en 2011 et qui avait révélé une létalité forte des porcs testés. Voir le communiqué de presse du 4 avril 2020 de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris sur www.aphp.fr. L’organisme explique que « suite à la décision de suspension de l’ANSM du 8 avril 2020 faisant état de résultats négatifs d’une étude préalable non portée à la connaissance de l’ANSM et de l’AP-HP, l’AP-HP a décidé de ne plus être promoteur de l’essai clinique de phase 1 visant à évaluer le produit de la société Hemarina M101 portant sur une protéine issue du sang de vers marins. L’essai n’avait pas débuté et aucun patient n’a donc reçu ce produit expérimental ».