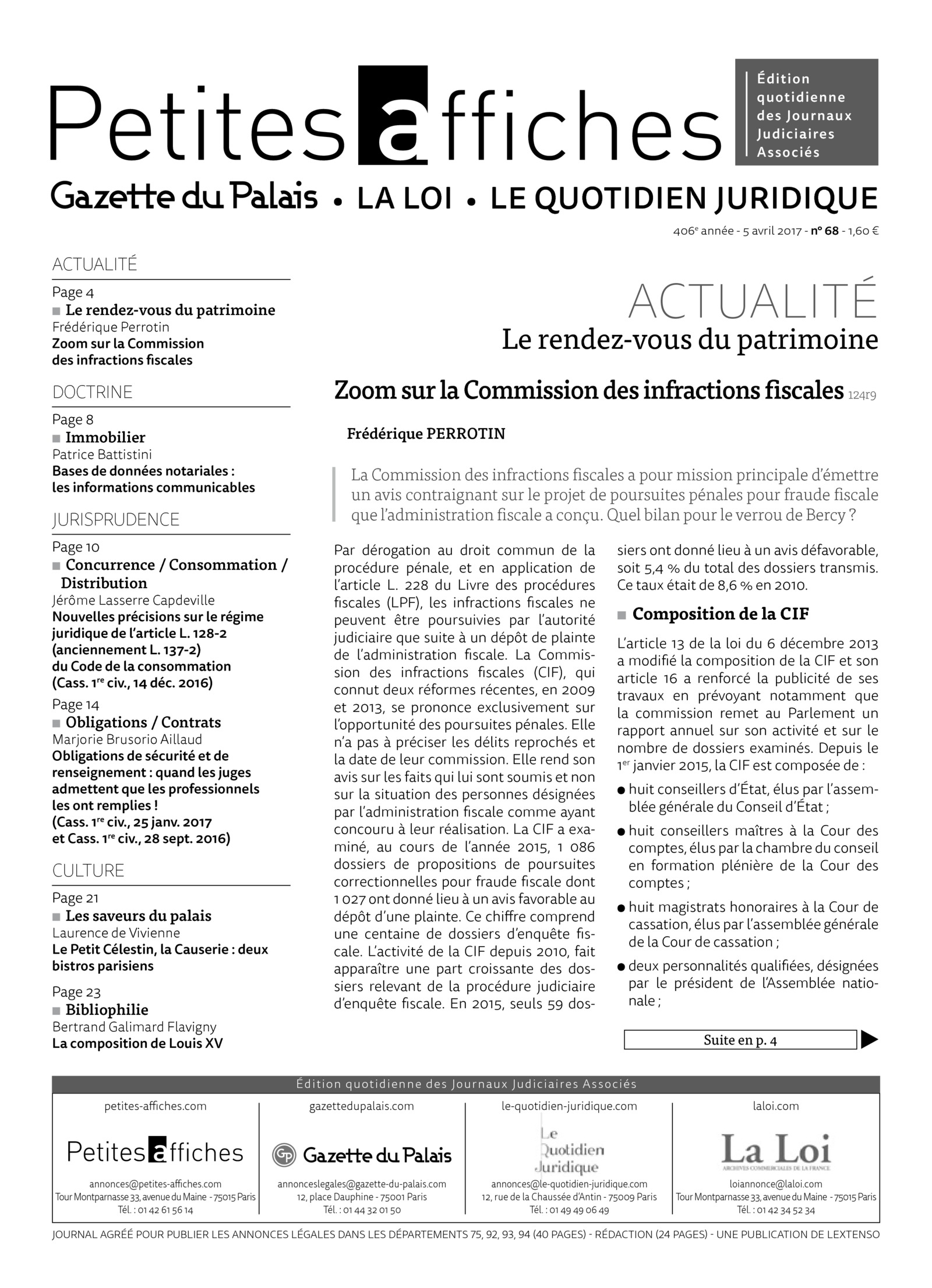Obligations de sécurité et de renseignement : quand les juges admettent que les professionnels les ont remplies !
Les obligations de sécurité et de renseignement donnent souvent lieu à des décisions sévères pour les professionnels, dans le but, certes louable, d’indemniser les victimes. Dans deux arrêts, rendus en septembre et janvier derniers, la Cour de cassation a estimé que l’exploitant d’une salle d’escalade et une agence de voyages avaient respectivement rempli leur obligation de sécurité et de renseignement. Peut-être regrettables pour les victimes, ces décisions illustrent une application équilibrée des règles de la responsabilité civile.
Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, no 16-11953, PB
Sous couvert de son pouvoir d’interprétation du contrat et de l’ancien article 1135 du Code civil, selon lequel « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature » (dispositions reprises, depuis le 1er octobre 2016, au nouvel article 1194), les juges ont parfois créé de nouvelles obligations et procédé à ce que la doctrine1 a appelé le « forçage » du contrat. L’objectif n’est pas, dans de telles hypothèses, de constater ce que les parties ont voulu, mais de le deviner, au regard de ce qui paraît juste.
Parmi les obligations accessoires aux obligations principales, auxquelles les parties se trouvent engagées, la jurisprudence a par exemple visé l’obligation de prudence, imposée à des sociétés de travail temporaire, dans le choix du personnel qu’elles mettent à disposition2 ; le devoir d’efficacité pesant sur les agences de voyages3 ; l’obligation de ponctualité de… la SNCF4 et, surtout, les obligations de sécurité et de renseignement de nombreux professionnels.
Il est vrai que, dans plusieurs domaines, si elles n’avaient pas été « imaginées » et imposées par les juges, ces obligations n’auraient pas été spontanément acceptées, et encore moins proposées par les professionnels. Néanmoins, cette attitude de la jurisprudence, basée sur des considérations d’opportunité et d’équité, peut être source de divergence et d’insécurité juridique. Elle a été critiquée comme alourdissant considérablement la responsabilité de certains professionnels, voire de faire le jeu des consommateurs de mauvaise foi.
Dans deux arrêts, rendus à quelques mois d’intervalle, la Cour de cassation a rejeté les actions en responsabilité engagées à l’encontre de l’exploitant d’une salle d’escalade et d’une agence de voyages, estimant que ceux-ci avaient rempli, respectivement, leur obligation de sécurité et de renseignement. Ces décisions méritent d’être retenues, voire saluées, comme une application équilibrée des règles de la responsabilité.
I – L’obligation de sécurité de l’exploitant d’une salle d’escalade
Au début du XXe siècle, fut découverte et consacrée : l’obligation de sécurité5. Dans un premier temps, elle fut limitée aux contrats de transport, afin de dispenser les victimes, qui n’étaient pas arrivées à destination « saines et sauves », d’avoir à prouver la faute du transporteur pour obtenir réparation. Puis, peu à peu, elle fut étendue à de nombreux contractants (exploitant de téléskis ou de toboggans aquatiques, centres de loisirs, cliniques et médecins, garagistes…). La Cour de cassation a même retenu l’obligation de sécurité d’un vendeur professionnel à l’égard des tiers utilisateurs de la chose vendue (un cerceau dont la rupture avait blessé une jeune élève, dans une cour de récréation), imposant ainsi une obligation extracontractuelle de sécurité6.
La jurisprudence distingue l’obligation de sécurité de résultat (le débiteur ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’un cas de force majeure) et l’obligation de sécurité de moyens (le débiteur peut également s’exonérer en démontrant que la victime a commis une faute). Le contrat de transport contient, par exemple, une obligation de sécurité de résultat pour le trajet, lorsque « l’utilisateur » a un rôle passif, mais seulement une obligation de sécurité de moyens pour l’embarquement et le débarquement, dès lors que « l’utilisateur » a un rôle actif. La qualification exacte de chaque étape du transport est parfois délicate. Il a été jugé que l’exploitant d’un parcours d’aventure dans les arbres7 ou d’un parc à voitures8 n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard de ses clients.
Les associations sportives, tels les clubs d’escalade, sont tenues d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans leurs locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité. Leur responsabilité peut être retenue même si un pratiquant devient paraplégique, à la suite d’une chute, alors qu’il pratiquait l’activité sans formation, qu’il avait refusée, et sans encadrement9.
Dans une décision rendue par la Cour de cassation le 25 janvier dernier10, une femme a été heurtée par un autre grimpeur, alors qu’elle venait de descendre la paroi d’un mur artificiel dans une salle d’escalade. Ayant subi une fracture lombaire avec tassement vertébral, elle a assigné l’exploitant de la salle et le grimpeur, en réparation de son préjudice.
A – Sur la responsabilité du grimpeur qui a décroché
S’agissant du grimpeur, la cour d’appel a infirmé le jugement qui avait retenu sa responsabilité. Elle a conclu qu’aucune faute n’était démontrée à son encontre et a donc débouté la victime de l’ensemble de ses demandes dirigées contre lui. En effet, les blessures subies permettaient d’établir que la victime tournait le dos au mur d’escalade, lorsqu’elle avait été heurtée. Or, le règlement intérieur de la salle, dont la victime ne contestait pas avoir eu connaissance, conforme aux règles de sécurité applicables en matière d’escalade en salle et sur structure artificielle, selon le règlement de la Fédération française de montagne et d’escalade, prévoyait qu’il était demandé aux adhérents « de ne pas se tenir sous une personne qui grimpe ». Un grimpeur peut décrocher volontairement, lorsqu’il estime que son ascension devient risquée, ou chuter involontairement en cas de mauvaise prise.
Aucun élément du dossier ne permettait de constater que le grimpeur n’avait pas fait preuve de vigilance avant de décrocher et de tomber sur la victime qui, venant juste de « désescalader » la paroi, devait immédiatement s’éloigner du grimpeur se trouvant à proximité, afin de ne pas se trouver dans sa zone de réception. Contrairement à ce qu’avait retenu les premiers juges, le seul fait que le grimpeur ait chuté sur une personne au sol ne pouvait suffire à démontrer qu’il n’avait pas suffisamment vérifié la disponibilité de la zone de réception avant de décrocher. Le grimpeur qui décroche ne peut, d’ailleurs, le faire en ayant la tête tournée en direction de la zone de réception, sauf à risquer une blessure au niveau des vertèbres cervicales. Il est prioritaire. Aucune faute d’imprudence ou de négligence n’était donc démontrée selon la cour d’appel.
À l’appui de son pourvoi, la victime soutenait que le grimpeur avait commis une faute en s’abstenant de se faire parer, en méconnaissance des règles édictées par le règlement de sécurité relatif à l’escalade sur structure artificielle et site sportif, et que l’accident n’aurait pas eu lieu s’il avait pris les précautions nécessaires. Elle reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions et d’avoir violé l’article 455 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation a rejeté la demande, en estimant que ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Il est vrai que les seuls documents produits au dossier des parties, de façon à établir le déroulement chronologique de l’accident, consistaient dans les déclarations écrites des intéressés faites dans les semaines qui suivirent, aucun témoin n’ayant rapporté dans quelles circonstances le grimpeur était tombé sur la victime.
L’escalade, en salle ou en milieu naturel, est un sport dans lequel les accidents sont rarement anodins. La responsabilité des participants est souvent recherchée et il convient de faire une stricte application des règles de la responsabilité civile. Il a par exemple été jugé que le fait, pour un grimpeur, de provoquer la chute d’un autre, en tombant au cours d’une escalade non encordée, constituait une faute11. En revanche, n’a pas été considéré comme fautif le déclenchement de la chute d’une pierre, par un alpiniste en précédant un autre, dans un parcours pierreux, où un tel risque était évident12. Dans l’affaire commentée, le grimpeur dont la chute était à l’origine de l’accident n’avait pas commis de faute. Sa responsabilité ne pouvait donc pas être retenue.
B – Sur la responsabilité de l’exploitant de la salle d’escalade
S’agissant de l’exploitant de la salle, la cour d’appel a également rejeté la demande. Elle a retenu que l’accident ne résultait ni de la configuration des lieux, ni d’un quelconque manquement de l’exploitant à son obligation de sécurité, mais était la conséquence de la faute d’imprudence de la victime.
À l’appui de son pourvoi, la grimpeuse faisait valoir :
-
d’une part, que l’exploitant d’une salle d’escalade manque à son obligation de sécurité de moyens à l’égard de ses clients, en mettant à leur disposition des locaux ou des installations dont la configuration ou l’aménagement les rendent dangereux. Or en l’espèce, la salle de pan, d’une hauteur maximale de quatre mètres, où était exercée une activité d’escalade de bloc sans baudriers et sans assurance des grimpeurs, et qui était équipée de prises permettant à ces derniers d’évoluer tant sur les côtés qu’au plafond, ne comportait aucune zone de réception des grimpeurs pouvant être identifiée par avance et matérialisée au sol. Les clients ne disposaient donc d’aucune voie de circulation sécurisée qui, ne se trouvant pas sous des prises, leur aurait permis de se déplacer au sol sans risquer d’être heurtés et blessés, lors de la chute ou du décrochage d’un grimpeur. En retenant, néanmoins, qu’il n’était pas démontré que la configuration des lieux caractérisait un manquement de l’exploitant de la salle, à son obligation de sécurité, la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et avait violé l’ancien article 1147 du Code civil. En ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, s’il ne résultait pas des photographies des lieux que la disposition des salles ne permettait pas aux sportifs de se déplacer et de les quitter en toute sécurité, sans risquer d’être heurtés par un grimpeur en cas de décrochage, la cour d’appel avait également privé sa décision de base légale au regard de l’ancien article 1147 du Code civil ;
-
d’autre part, la victime avançait que l’exploitant d’une salle d’escalade doit surveiller l’activité de ses utilisateurs. Or en relevant qu’il n’était pas établi que d’autres grimpeurs se trouvaient dans la salle au moment de l’accident et que ces derniers auraient gêné la victime lorsqu’elle avait été heurtée, pour dire qu’aucun défaut de surveillance ne pouvait être retenu en l’espèce, sans rechercher si, de fait, l’exploitant ne s’était pas abstenu d’exercer la moindre surveillance de l’activité, lors de l’accident, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale au regard de l’ancien article 1147 du Code civil.
La haute juridiction n’a pas retenu ces arguments. Elle a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que l’exploitant n’avait « qu’une » obligation de sécurité de moyens et que celle-ci avait été remplie. D’une part, le règlement intérieur de la salle d’escalade, conforme aux règles de sécurité applicables en matière d’escalade en salle et sur structure artificielle, dont la victime ne contestait pas avoir eu connaissance, informait clairement celle-ci de l’interdiction de se tenir au sol sous un grimpeur. D’autre part, il n’était pas établi qu’au moment de l’accident, d’autres grimpeurs se trouvaient dans la salle qui auraient gêné la victime pour s’éloigner de la paroi où se trouvait encore celui qui avait décroché. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que ce dernier n’aurait pas suffisamment vérifié la disponibilité de la zone de réception avant de décrocher, alors même que le grimpeur qui décroche est prioritaire.
L’accident ne résultait ni de la configuration des lieux, ni d’un quelconque manquement de l’exploitant à son obligation de sécurité, ni de la faute du grimpeur qui a décroché. Il était la conséquence d’une faute d’imprudence de la victime. Celle-ci se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Elle en avait été informée, ce qui rendait sa présence imprudente… fautive.
Et oui ! il arrive que des accidents n’aient pas de responsables auxquels demander réparation. Il arrive que des accidents résultent de l’imprudence de la victime. Il arrive même que des personnes « jouent de malchance ». Aussi regrettable que cela puisse être pour celles-ci, d’un point de vue pratique et financier, les règles de la responsabilité civile doivent être strictement appliquées. L’équilibre entre « recherche d’un responsable » et « indemnisation de la victime », souvent approximatif, est parfois atteint !
II – L’obligation de renseignement d’une agence de voyages
Une autre obligation symbolise le « forçage » du contrat : l’obligation de renseignement, voire de conseil ou de mise en garde, mise à la charge des assureurs, banquiers, notaires, médecins, architectes… et des agences de voyages.
Dans une affaire jugée par la Cour de cassation en septembre dernier13, une société avait organisé un voyage en Équateur pour un groupe d’amis et leurs familles. Au cours d’une excursion à un volcan, un des voyageurs, médecin, est décédé d’un œdème pulmonaire. Sa veuve et ses filles ont recherché la responsabilité contractuelle de la société pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices personnels.
La cour d’appel a écarté cette demande. Elle a estimé que la société avait commis une faute délictuelle à leur égard et que cette faute avait entraîné une perte de chance de 25 % de conserver en vie le voyageur défunt. Elle a condamné la société à leur payer diverses sommes, en réparation de leurs préjudices.
A – Sur la responsabilité contractuelle de l’agence
À l’appui de son pourvoi, la famille du défunt faisait valoir que l’agence de voyages était responsable de plein droit de l’inexécution de l’obligation de sécurité de résultat issue du contrat. En jugeant que la société n’était responsable que d’un manquement à son obligation de conseil, ayant entraîné « une perte de chance d’éviter le décès », si le voyageur avait renoncé à participer à l’excursion, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que la victime était décédée au cours d’une excursion organisée par l’agence de voyages, de sorte que celle-ci, ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat, devait répondre de l’intégralité des conséquences dommageables en résultant, la cour d’appel avait violé l’article L. 211-16 du Code du tourisme.
Cependant, ce texte instaure une responsabilité légale de plein droit au seul profit de l’acheteur du voyage. Les ayants droit de celui-ci ne peuvent agir contre l’agence de voyages, pour leur préjudice personnel, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à un manquement contractuel, exigeant la preuve d’une faute du voyagiste. La cour d’appel, qui avait examiné l’existence d’un manquement de l’agence de voyages à son obligation de conseil ayant contribué au décès, avait, selon les hauts magistrats, légalement justifié sa décision.
La solution n’est pas nouvelle, et parfaitement logique. Il a déjà été jugé, dans une affaire où une personne inscrite en stage collectif de ski de randonnée avait fait une chute mortelle, que la victime par ricochet d’un accident survenu dans l’exécution d’un contrat doit agir sur le terrain délictuel14. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage15.
En l’espèce, l’agence de voyages n’avait aucun lien contractuel avec les demandeurs. Sa responsabilité contractuelle ne pouvait pas être retenue. Seule sa responsabilité délictuelle pouvait être recherchée à condition, alors, de prouver qu’elle avait commis une faute et que cette faute avait un lien de causalité avec le décès.
B – Sur la responsabilité délictuelle de l’agence
À l’appui de son pourvoi, l’agence faisait valoir deux arguments.
D’abord, elle invoquait que le voyageur décédé était médecin et ainsi, a priori, un homme conscient des dangers dus au mal aigu des montagnes. La cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de cette constatation en faisant peser sur l’agence de voyages une obligation de conseil relativement à ces dangers. Elle avait violé les anciens articles 1147 et 1382 du Code civil.
Ensuite, l’agence reprochait à la cour d’appel d’avoir retenu que rien, dans la documentation de voyage qu’elle avait donnée, n’avertissait les voyageurs sur le danger du mal aigu des montagnes lié à cette excursion vers le volcan. Cela avait constitué, selon la famille, un manquement de l’agence à son obligation de conseil, lequel avait contribué pour partie au décès, dès lors que le voyageur aurait pu renoncer à l’excursion. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les informations pratiques données par l’agence de voyages, lesquelles contenaient une rubrique relative au mal des montagnes et donnaient pour conseil de faire un bilan médical, étaient suffisantes, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision. Il ressort des moyens annexes de l’arrêt, en effet, que les informations pratiques relatives à l’Équateur et remises au client précisaient : « À propos du mal des montagnes ou soroche, il est provoqué par une élévation trop rapide du niveau d’altitude lorsque l’organisme n’a pas le temps de s’adapter à la raréfaction de l’oxygène ; il se traduit par un certain malaise, une gêne respiratoire ou des maux de tête. NOUS VOUS CONSEILLONS DE FAIRE UN BILAN AVEC VOTRE CARDIOLOGUE ».
Les hauts magistrats n’ont pas retenu le premier argument. Ils ont estimé que les compétences professionnelles ou personnelles du voyageur ne dispensaient pas l’agence de voyages de son obligation d’information envers lui. La cour d’appel avait retenu à bon droit que, même médecin, le défunt devait, comme tout autre voyageur, être prévenu par l’agence du danger que présentaient ce voyage et cette excursion en haute altitude. Le moyen n’était pas fondé.
En revanche, la Cour de cassation a estimé qu’en se déterminant sur la base de la seule affirmation selon laquelle la documentation donnée par l’agence n’avertissait pas les voyageurs sur le danger du mal aigu des montagnes lié à l’excursion, notamment vers un volcan, sans rechercher si l’information générale donnée n’était pas suffisante, spécialement en considération de la profession de médecin du défunt, la cour d’appel avait privé son arrêt de base légale au regard des anciens articles 1147 et 1382 du Code civil. L’arrêt d’appel a donc été cassé.
Cette décision aussi fait une stricte application des règles de droit et présente une modération appréciable :
-
la responsabilité contractuelle suppose un contrat…
-
les voyageurs doivent tous recevoir une information adéquate à la situation, quelles que soient leur profession et leurs compétences…
-
les juges du fond doivent, pour retenir ou écarter un manquement à une obligation de renseignement de la part d’une agence de voyages, vraiment vérifier si les informations pratiques données par cette dernière étaient suffisantes.
Les agences de voyages ont une obligation de renseignement. Elles doivent, par exemple, informer leur client, à qui elle vend un billet d’avion, des conditions précises d’utilisation du billet, parmi lesquelles figurent les formalités d’entrée sur le territoire de l’État de destination16. Néanmoins, la responsabilité des agences ne doit pas être retenue trop « aisément ». Le manquement à l’obligation de renseignement doit être réellement caractérisé. Il doit être permis à l’agence de démontrer qu’elle a rempli son obligation.
L’affaire est donc renvoyée. Il va revenir à la cour d’appel, autrement composée, de dire si l’agence a rempli son obligation de renseignement. Si la famille d’un médecin décédé d’un œdème pulmonaire, lors d’un voyage en Équateur, peut reprocher à l’agence de voyages un manquement à son obligation de renseignement sur le mal des montagnes, alors que les informations pratiques données par cette dernière contenaient une rubrique relative au mal des montagnes et donnaient pour conseil de faire un bilan médical… Cela semble peu probable.
Dans cette affaire également, aussi regrettable que cela puisse être pour les victimes, d’un point de vue pratique et financier, les règles de la responsabilité civile ont été strictement appliquées.
Parce que, répétons-le, il arrive que des accidents n’aient pas de responsables auxquels demander réparation… qu’ils ne résultent pas d’une faute… qu’ils correspondent vraiment à la définition du terme « accident ».
Notes de bas de pages
-
1.
Josserand L., note sous CA Lyon, 7 déc. 1928 : DP 1929, 2, p. 17.
-
2.
Cass. 1re civ., 26 févr. 1991, n° 88-15333 : Bull. civ. I, n° 77.
-
3.
CA Paris, 6 nov. 1991 : D. 1991, IR, p. 296, responsabilité de l’agence de voyages qui avait loué une villa dite de luxe alors que la piscine n’était en réalité qu’un trou de deux mètres carrés sur une terrasse sur laquelle avaient vue tous les immeubles voisins, qu’il n’y avait pas de jardin, qu’il n’y avait pas de climatisation mais un ventilateur, et dont le correspondant local ne s’était pas présenté lors de l’arrivée des locataires.
-
4.
CA Paris, 4 oct. 1996, nos 95-5713 et 95-8312 : JCP G 1997, II, 22811 – Cass. 1re civ., 14 janv. 2016, n° 14-28227.
-
5.
Cass. civ., 21 nov. 1911 : DP 1913, 1, p. 249.
-
6.
Cass. 1re civ., 17 janv. 1995, n° 93-13075 : Bull. civ. I, n° 43.
-
7.
Cass. 1re civ., 22 janv. 2009, n° 07-21843.
-
8.
Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° 14-21434.
-
9.
Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, nos 10-23528 et 10-24545 : Bull. civ. I, n° 219.
-
10.
Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 16-11953.
-
11.
Cass. 2e civ., 18 mai 2000, n° 98-12802 : Bull. civ. II, n° 85.
-
12.
Cass. 2e civ., 24 avr. 2003, n° 01-00450 : Bull. civ. II, n° 116.
-
13.
Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, nos 15-17033 et 15-17516.
-
14.
Cass. 1re civ., 10 avr. 2008, n° 07-13520. Dans le même sens : Cass. 2e civ., 23 oct. 2003, n° 01-15391 : Bull. civ. II, n° 330.
-
15.
Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13255 : Bull. ass. plén., n° 9.
-
16.
Cass. 1re civ., 7 févr. 2006, n° 03-17642 : Bull. civ. I, n° 63.