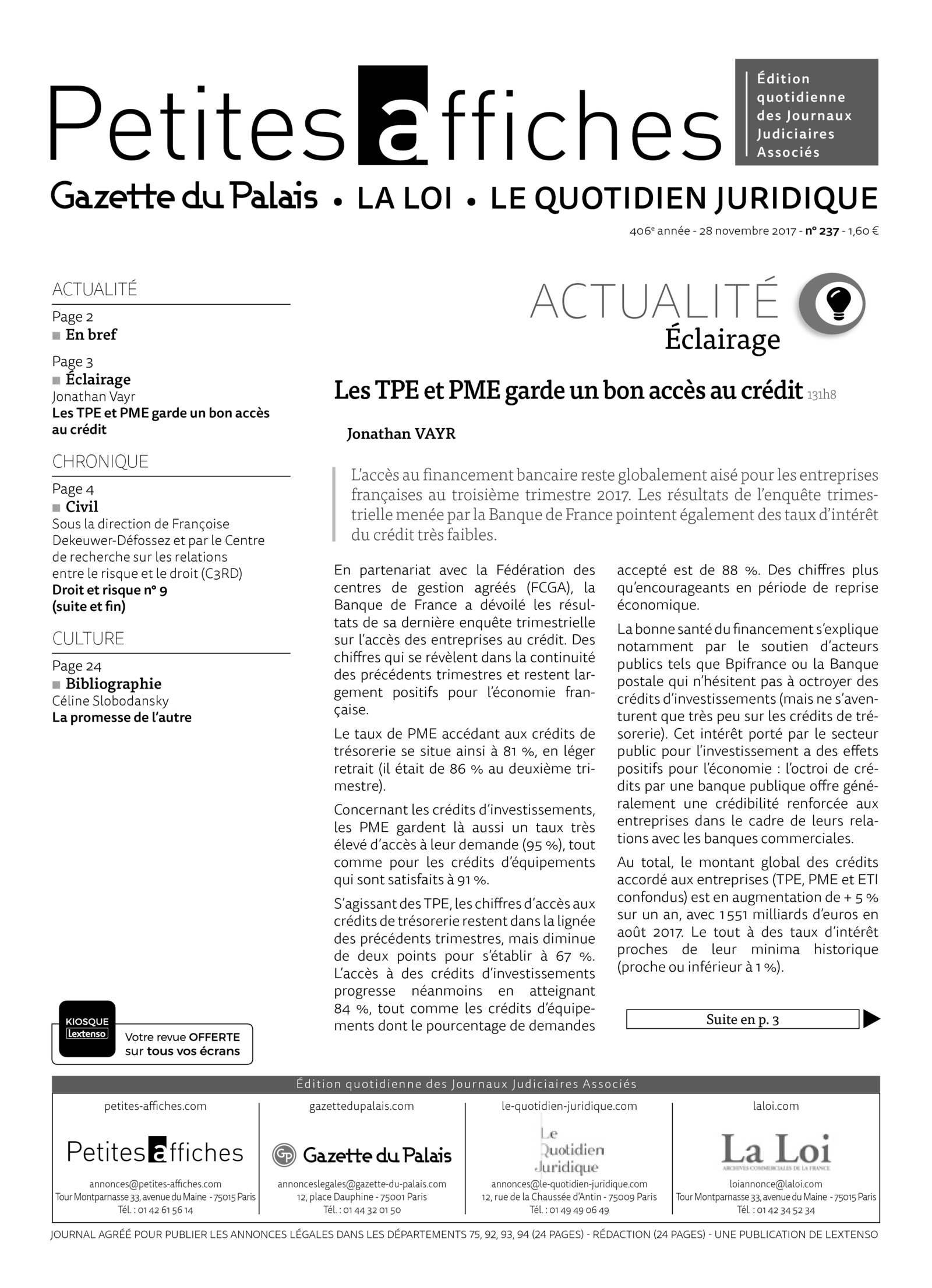Droit et risque n° 9 (suite et fin)
Cette neuvième chronique des tumultueux rapports entre Risque et Droit s’ouvre, comme toujours sur une illustration de ce que le Droit lui-même peut être créateur de risques, mais la question posée est inédite : est-il concevable que le refus d’application du droit européen par une juridiction ouvre le droit à une indemnisation de l’État au titre de la faute lourde ? Que la Cour de cassation dans sa formation la plus haute réponde positivement sur le principe ouvre de nouvelles et inédites perspectives quant à l’indemnisation éventuelle de l’insécurité juridique (Cass. ass. plén., 18 nov. 2016). La même question sera peut-être posée dans un proche avenir à propos de la multiplicité des risques causés par des textes hâtivement rédigés ou animés d’a priori idéologiques biaisés. Ainsi, les risques que font courir tant aux époux qu’aux tiers le nouveau divorce contractuel (art. 50, loi du 18 nov. 2016 de modernisation de la justice), ou même la dégradation des statuts du doctorant comme de son directeur de thèse (arrêté du 25 mai 2016) engendreront probablement des dommages, dont il n’est pas inenvisageable que réparation soit demandée au législateur ?
Quant à la gestion des risques de toute sorte par le droit, elle fait désormais la part belle aux dispositions dites de « prévention » dont on sait qu’elles sont particulièrement délicates, tant la prévision des risques est aléatoire et tant les mesures prises pour y parvenir peuvent s’avérer soit illusoires, soit attentatrices aux libertés. Ces deux cas de figure sont illustrés à merveille par le « droit à la déconnexion », louable tentative de préserver la vie privée du salarié, mais si peu compatible avec un monde désormais connecté en permanence (C. trav., art. L. 2242-8 7°, issu de la loi du 8 août 2016), et par une décision de la cour de Versailles décidant de couper tout lien entre un bébé de deux ans et son père, en raison de la radicalisation islamique de ce dernier (CA Versailles, 20 avr. 2017) dont la conformité au « droit à la vie familiale » du père comme de l’enfant semble problématique.
La réparation des risques réalisés est assurément un domaine mieux balisé, même si la jurisprudence montre la persistance de questions inédites ou de solutions critiquables. Ainsi la reconnaissance, en droit médical, du préjudice « d’impréparation » a nécessité une mise au point précise de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 25 janv. 2015 n° 15-27898), tandis que la survivance d’obligations de sécurité « de moyens » en matière de responsabilité contractuelle (Cass. 1re civ, 25 janv. 2017 n° 16-11953) suscite de légitimes critiques dont il faudra tenir compte lors de la prochaine réforme de la responsabilité civile. Reste enfin la question des conséquences de pratiques managériales pathogènes émanant d’un salarié : le casse-tête de l’employeur qui doit sanctionner et réparer les conséquences d’agissements d’un subordonné est parfaitement illustré par un arrêt de la cour de Toulouse (26 juin 2015, n° 13/02157) !
F.D.D.
I – Les risques du droit
A – L’insécurité juridique
B – Les autres risques du droit
II – La gestion du risque par le droit
A – Anticipation du risque
« Droit à la déconnexion » : article L. 2242-8, 7°, issu de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
La déconnexion, dont on ignore la définition, fait l’objet d’un droit subjectif dont les salariés sont aujourd’hui titulaires. Elle résulte d’un processus de légalisation marqué par plusieurs étapes. Elle trouve ses origines dans l’accord du 19 juin 2013 relatif à la qualité de vie au travail insistant davantage sur la finalité attendue de la déconnexion que sur ses modalités d’exercice. L’accord a, en effet, pour objectif la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle par une gestion intelligente des TIC au service de la compétitivité de l’entreprise1.
Les outils numériques complexifient l’appréhension du temps de travail, de la charge de travail. Ils perturbent nettement la frontière établie entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Les études statistiques réalisées sur cette question l’illustrent. Dans une enquête menée par l’IFOP en mai 2016, cette question était posée : « pendant vos week-ends ou vos vacances, consultez-vous vos communications professionnelles ? ». 31 % des personnes interrogées ont répondu : « oui souvent ». 46 % ont répondu : « oui, de temps en temps ». 23 % ont répondu : « non, jamais ». Finalement, 77 % des cadres interrogés consultent leurs communications professionnelles pendant leur temps de repos. Ils précisent aussi que l’outil connecté leur permet ainsi de s’assurer qu’il n’y a pas de problème pendant leur absence ou de ne pas être débordé à leur retour. Cela ne signifie pas pour autant que les salariés perçoivent de manière positive la possibilité d’avoir un accès permanent et simplifié aux outils de communication professionnelle. Le sujet ici traité est ambivalent. Si 82 % des mêmes personnes interrogées considèrent qu’une telle possibilité est « nocive » car elle est source de stress et d’agacement pour les proches, 60 % d’entre elles jugent que les TIC contribuent à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Les acteurs du monde du travail doivent donc s’emparer de cette singulière question, présentant un intérêt positif tant pour l’entreprise que pour ses salariés, mais en étant à la fois vecteur de risques dans l’organisation du travail et les rapports de travail. Si le « tout connecté » favorise l’autonomie, il accroît, paradoxalement, la dépendance du salarié à son employeur, révélatrice d’une nouvelle forme de subordination2. Une telle pratique produit des « comportements à risque », comme celui de l’hyper connexion. Le vocabulaire est varié : « sur connexion », « surexposition numérique », sources éventuelles de dégradation de l’état de santé des salariés. Le recours à la norme semble alors être un moyen utile pour prévenir les risques liés à l’hyper connexion. C’est la raison pour laquelle, le législateur, suite à l’ANI de 2013, rend obligatoire, depuis le 1er janvier 2017, le droit à la déconnexion formalisé à l’article L. 2242-8, 7°, du Code du travail.
Il faut néanmoins souligner la méthode utilisée par le législateur. Formellement, la loi Travail n’affirme pas un droit à la déconnexion de manière autonome. En effet, aucun article dans le Code du travail n’affirme, en ces termes, que chaque salarié bénéficie du droit de se déconnecter. Il est aujourd’hui énoncé que la négociation annuelle sur la qualité de vie au travail porte sur « les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. À défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ».
La reconnaissance légale de la déconnexion à la faveur du salarié s’effectue par la détermination de ses modalités d’exercice (I). Ces dernières dépendent de la norme relais c’est-à-dire principalement des conventions collectives. Dès lors, il revient aux partenaires sociaux de faire de la reconnaissance de ce droit une réalité. Le législateur laisse, ainsi, le soin aux entreprises de décider de la politique de prévention à mener face aux risques liés à la sur connexion en consacrant un droit pour le salarié et une nouvelle obligation pour l’employeur (II), à savoir la déconnexion.
I. L’affirmation légale d’un droit à la déconnexion
L’institution d’une nouvelle prérogative suppose de déterminer les bénéficiaires (A) exposés à des risques identifiés et liés à la surexposition numérique (B).
A. La qualité des bénéficiaires
Légalement, tous les salariés ne sont pas titulaires de cette prérogative. En effet, du Code du travail, ressortent deux caractéristiques propres aux bénéficiaires du droit à la déconnexion. L’un est qualitatif, l’autre quantitatif. En premier lieu, doit être prise en compte la qualité du salarié dans l’entreprise, c’est-à-dire ses fonctions, son degré de responsabilité. Le droit à la déconnexion concerne essentiellement les salariés dont les fonctions, les missions dans l’entreprise font que le temps de travail ne peut se réduire à la durée hebdomadaire légale du travail. Comme l’explique M. Lanouzière, tous les salariés ne sont pas concernés : « ceux dont les tâches et les responsabilités n’appellent pas une disponibilité particulière ne sont pas censés se connecter à leurs outils professionnels et répondre aux sollicitations de leur employeur en dehors de leurs horaires de travail »3. Sont donc principalement concernés les cadres et les managers, qui eux-mêmes doivent témoigner d’une certaine exemplarité dans l’utilisation des outils numériques. C’est aussi la raison pour laquelle l’article L. 3121-64, 3°, du Code du travail impose à toutes les entreprises ayant recours au forfait jours de respecter le droit à la déconnexion dont les modalités d’exercice doivent être fixées par accord de branche ou accord d’entreprise. La pratique du forfait jours est autorisée pour les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise. Sont également concernés les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées4.
En second lieu, le critère quantitatif se déduit de la condition du seuil de l’obligation de négocier dans les entreprises, soit l’effectif de 50 salariés. Ainsi, en intégrant la déconnexion dans la négociation annuelle en matière de qualité de vie au travail, le législateur circonscrit le périmètre de reconnaissance de ce nouveau droit. Sont concernées en priorité les entreprises de plus de 50 salariés soumises à la négociation annuelle sur la qualité de vie au travail définie à l’article L. 2242-8 du Code du travail. À défaut d’accord collectif – négocier n’étant pas signer -, l’outil choisi par le législateur est la charte. Après avis des représentants du personnel, l’employeur doit rédiger une charte dont on ignore, non pas le contenu puisque l’article L 2242-8 précise qu’elle définit les modalités d’exercice du droit à la déconnexion, mais la valeur juridique. En effet, s’il revient unilatéralement à l’employeur d’élaborer ici les règles applicables en matière de déconnexion, une ambiguïté existe sur la nature et le régime des règles ainsi élaborées. Une incertitude demeure : aura-t-elle la valeur d’un engagement unilatéral ou celle d’une adjonction au règlement intérieur ? Plusieurs auteurs s’accordent pour considérer qu’elle a la valeur d’un engagement unilatéral, source d’obligation pour l’employeur5. Néanmoins, si les règles relatives à la déconnexion génèrent des obligations à l’égard des salariés et assorties de sanctions, elle s’analyse comme un additif au règlement intérieur de l’entreprise soumise au régime de sa modification6.
Concernant les entreprises de moins de 50 salariés et qui n’utilisent pas les conventions de forfait en jours, celles-ci ne semblent pas concernées par le devoir de déconnexion. Toutefois, cela ne signifie pas, à notre sens, que les salariés se situant dans cette dernière hypothèse soient totalement privés d’un tel droit, comme il est difficile d’envisager que leurs employeurs soient écartés de cette obligation émergente. Pour ces derniers, les fondements sont généraux. Même si les salariés ne peuvent invoquer un droit à la déconnexion au sens de l’article L. 2242-8 du Code du travail, l’employeur reste tenu de respecter les temps de repos, de congé. Il demeure débiteur d’une obligation de sécurité, le rendant responsable de la santé de ses collaborateurs. Or il est démontré que l’hyper connexion, ou l’utilisation mal régulée des technologies de l’information et la communication peut avoir un impact sur la santé des salariés. Il est alors préférable que toutes les entreprises anticipent cette question. Elles doivent s’en emparer rapidement, car il est peu probable que les tribunaux épargnent les employeurs assignés par leurs collaborateurs exposés à l’hyper connexion et victimes, par exemple, de burn out.
B. La norme pour prévenir les risques liés à l’hyper connexion
Le droit à la déconnexion, tel qu’il a été prévu par la loi Travail, a pour objectif de sensibiliser, d’alerter les acteurs de l’entreprise à la surexposition numérique impactant les relations de travail, plus précisément le temps de travail, la charge de travail, la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Les risques liés à l’hyper connexion touchent tant les employeurs que les salariés. Leur nature est différente. Les premiers s’exposent à un risque davantage de nature contentieuse susceptible d’impacter l’entreprise. Les seconds s’exposent à un risque ciblé sur leur personne même, à savoir leur propre santé qu’elle soit mentale ou physique.
Le phénomène de la « laisse électronique » est source de risques psychosociaux, ou encore de harcèlement managérial. Comme l’explique des membres de l’ARACT « rester connecter est source de stress ». Le rapport Mettling l’a aussi souligné : « la transformation numérique peut être un facteur de stress au travail : directement, en créant chez le salarié un sentiment de sollicitation permanent, d’accélération soutenue des interactions, mais aussi indirectement car, comme toute évolution, elle peut générer des inquiétudes sur l’évolution des emplois »7.
Les principaux risques sont aujourd’hui identifiés. D’une part, une utilisation déraisonnable ou mal régulée des technologies de l’information, de la communication et de la messagerie peut conduire à une surcharge informationnelle manifestée par le syndrome de débordement cognitif. Les salariés ont le sentiment d’être noyés par des informations qu’ils ne parviennent pas à traiter et qu’ils jugent parfois inutiles, ce qu’on qualifie d’infobésité. D’autre part, l’utilisation de la messagerie et le pouvoir d’attraction qu’elle génère fractionne le travail et provoque l’interruption des taches entraînant un coût intentionnel important pour les salariés8.
Si le salarié est directement touché par ce phénomène, l’employeur l’est aussi indirectement. Il peut être responsable de l’utilisation déraisonnable des outils numériques par ses salariés. Dès lors, il est dans son intérêt de « sécuriser », de « réguler » l’utilisation de ces outils numériques afin de prévenir d’éventuelles atteintes au temps de repos, au temps réservé aux congés. L’hyper connexion met à mal le respect des prescriptions légales et impératives relatives aux durées minimales de repos journalier, aux durées maximales journalières9. Le contentieux relatif aux conventions de forfait jours l’a illustré ces dernières années10. En effet, certaines conventions de branches ne prévoyaient pas de manière suffisante les mesures garantissant aux salariés soumis à cette organisation du temps de travail, un repos effectif et surtout une charge raisonnable de travail. La quantification du temps de travail se calculant en jours et non en heures, le risque d’une amplitude journalière de travail supérieure à 10 heures de travail est réelle. Il est évident que les outils numériques facilitent de tels risques. C’est d’ailleurs, la raison pour laquelle, le législateur, indépendamment de la négociation sur la qualité de vie au travail, oblige les entreprises et les branches professionnelles à intégrer un dispositif de déconnexion dans la pratique des conventions de forfait en jours11.
La transformation numérique est génératrice de risques que le droit tente de limiter en reconnaissant aux salariés la faculté de ne pas se connecter en dehors du temps de travail. Pour ce faire, le législateur fait alors le choix de consacrer le droit de ne pas faire plutôt que la liberté de faire. Est ainsi reconnu le droit de ne pas se connecter plutôt, que la liberté de se connecter. La mise en œuvre de ce droit de ne pas faire dépend néanmoins de la négociation menée au sein de l’entreprise et donc d’un consensus adopté par les partenaires sociaux et l’employeur. Le législateur passe le relai aux acteurs de la négociation.
II. La mise en œuvre négociée du droit à la déconnexion
Il revient à l’entreprise de faire de la déconnexion une réalité. Le recours à la négociation collective est légitime en permettant l’adaptation de ce nouveau droit aux spécificités de chaque entreprise (A). Pour autant, le choix du droit à la déconnexion et non celui de la connexion choisie ou d’une obligation partagée entre l’employeur et le salarié est discutable au regard de la place de la numérisation dans les entreprises de demain (B).
A. La détermination des modalités d’exercice du droit à la déconnexion
La transformation numérique n’échappe pas à la norme négociée. Depuis, le 1er janvier 2017, la reconnaissance d’un droit à la déconnexion génère une nouvelle obligation de négocier. Les organisations syndicales et l’employeur sont tenus de concevoir le droit à la déconnexion. Il leur revient la charge de faire vivre un tel droit. Lors de la négociation, des réponses devront être apportées. Comment doit-il être mis en œuvre ? Quelles sont les modalités réelles permettant d’assurer cette prérogative tout en préservant les intérêts de l’entreprise ? La sanction est-elle possible ? Faut-il privilégier des mesures consensuelles ou des mesures plus pressantes et donc contraignantes tendant à responsabiliser les salariés concernés ?
Intégrée à la négociation sur la qualité de vie au travail, le sujet de la déconnexion doit être discuté par les partenaires sociaux sous le prisme de la prévention des risques liés à la sur connexion. Ceux-ci doivent s’emparer de la mise en œuvre effective de ce droit par une entente portant sur des mesures assurant la sensibilisation, la prise de conscience de l’utilisation parfois excessive des outils numériques aujourd’hui largement intégrés dans le quotidien de nombreux salariés. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le texte impose à l’employeur en cas d’échec de la négociation de décliner, dans une charte, « des actions de formation de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ». Si la première partie de l’article L. 2242-8, 7°, du Code du travail, attaché à l’accord collectif, ne l’indique pas expressément, il semble évident que de telles mesures doivent être discutées collectivement et retranscrites dans les accords signés. Ceci participe, comme l’écrit le texte, à « la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques ». De tels outils produiront efficacement leurs effets, si préalablement les salariés, les managers ont compris le sens de la déconnexion et donc mesurer les risques que l’hyper connexion génère. Mais la prévention des risques nécessite aussi l’action. C’est la raison pour laquelle l’article L. 2242-8 impose aux partenaires sociaux de négocier sur « les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques ». Cela suppose alors de déterminer et de mettre en place des dispositifs qui concrètement limiteront les salariés dans l’utilisation des outils numériques et par conséquent, aussi, légitimeront leur indisponibilité à l’égard de l’employeur. Certaines entreprises n’ont pas attendu août 2016 pour mener une réflexion sur ce sujet. Des accords collectifs de grandes entreprises déjà en vigueur fournissent des enseignements permettant alors aux plus petites de s’en inspirer. Par exemple, il y a 5 ans, l’entreprise AREVA, dans le cadre de son accord sur la qualité de vie au travail, a instauré le droit à la déconnexion, en demandant aux salariés de veiller à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de mails en dehors des heures habituelles de travail. Pour être effectif, l’accord prévoit qu’un suivi spécifique et régulier des flux de mails et de leur répartition temporelle sera mise en œuvre. L’accord portant sur l’accompagnement de la transformation numérique chez Orange prévoit en plus d’un droit à la déconnexion la mise en place de pop-up rappelant les messages clés d’une bonne utilisation des outils numériques : « vous allez envoyer un e-mail à 23 heures, cet e-mail ne pourrait-il pas être envoyé à des heures traditionnelles de travail ? » Est également prévue la réalisation de bilan individualisé et collectif des usages numériques qui pourront conduire à la mise en place de mesures correctives basée sur l’organisation du travail. D’autres dispositifs plus contraignants existent et sont déjà utilisés. Ainsi, Volkswagen bloque ses serveurs le soir et le week-end. Les mesures choisies sont diversifiées. Certaines sont plus contraignantes que d’autres. Il revient aux partenaires sociaux de choisir les mesures adaptées à la situation de l’entreprise. Les principes de finalité et de proportionnalité doivent ainsi les guider dans la détermination des outils assurant l’effectivité du droit à la déconnexion.
La part de la négociation collective est conséquente dans la mise en œuvre du droit à la déconnexion et donc plus généralement dans la prévention des risques liés à la transformation numérique. Le choix opéré par le législateur est justifié. Les problématiques liées à la transformation numérique ne peuvent être écartées du terrain de la norme négociée, assurant une réflexion et une adhésion collective. Elle doit aussi engendrer une réflexion plus globale sur la responsabilisation des acteurs de l’entreprise face aux risques générés par une mauvaise et ou excessive utilisation de ces outils.
B. D’un droit à la déconnexion à la connexion responsable ?
Le parti pris par le législateur a été celui du droit à la déconnexion plutôt que celui du droit à une connexion choisie. Si l’objectif est louable, la question devra être à nouveau posée et traitée de manière plus ambitieuse car la transformation numérique ne se résume pas à l’utilisation des outils numériques. Elle a aujourd’hui pour objet l’économie12. Or en consacrant un droit pour le salarié et un devoir pour l’employeur, la loi Travail n’est pas allée jusqu’au bout des propositions faites par le rapport Mettling. Celui-ci opte pour une obligation partagée. La déconnexion ne se résume pas à un droit offert au salarié. Elle doit aussi prendre la forme d’un devoir. Ses auteurs relèvent, sans ambiguïté, la responsabilité de l’employeur d’assurer le respect de la santé et la sécurité des salariés, notamment en garantissant les temps de repos. Mais ils ajoutent que « savoir se déconnecter au domicile est une compétence qui se construit également à un niveau individuel mais qui a besoin d’être soutenue au niveau de l’entreprise »13. Ainsi, ils insistent sur l’idée d’une coresponsabilité du salarié et de l’employeur qui implique également un devoir de déconnexion14. Si la déconnexion est un enjeu collectif qui doit être soutenu par l’entreprise, ce que rend compte la norme négociée, elle repose aussi au niveau individuel de chaque salarié. Se déconnecter repose sur la capacité individuelle du salarié et de son rapport au temps. L’énonciation d’un droit ne suffit pas à le rendre opérant. Son effectivité dépend de l’implication du salarié pour combattre une nouvelle forme de présentéisme, c’est-à-dire le présentéisme numérique.
En consacrant le droit à la déconnexion, le législateur a écarté l’équilibre entre le droit et le devoir de se déconnecter. Cette solution, celle d’un partage des responsabilités, semble la voie à suivre car la transformation numérique est une réalité qui dans les années à venir ne se cantonnera pas à la question de l’utilisation des outils numériques mais elle s’étendra à celle des compétences, des méthodes de travail et d’organisation. Les formes de travail évoluent. Comme le souligne M. Loiseau, « s’il faut donner la possibilité au salarié de se déconnecter, il faut aussi rendre la déconnexion compatible avec l’évolution plausible de l’organisation du travail dans le sens d’une plus grande fluidité au double point de vue du lieu et du temps de travail »15. À cela, s’ajoute le fait que la nouvelle génération de travailleurs vit connectée depuis l’enfance. Une déconnexion obligée leur paraîtra relever d’un « paternalisme désuet »16.
Le travail est aujourd’hui confronté à un enjeu majeur. Il doit faire face à la révolution numérique qualifiée justement de disruptive. La rupture avec les modèles précédents se consomme progressivement pour laisser la place à d’autres pratiques et comportements qu’il faut rapidement prendre en compte afin de produire les efforts d’adaptation pensés avec ambition et clairvoyance.
E.L.
Risque de radicalisation ou risque de rupture entre l’enfant et son père ?
CA Versailles, 1re ch., 2e sect., 20 avr. 2017, n° 16/05383. La radicalisation islamique est une source de déstabilisation du système juridique dans son ensemble : on le constate en droit pénal, comme au regard de la protection des libertés publiques et des libertés individuelles. Elle aboutit aussi, cela est moins connu, à perturber les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt de la cour de Versailles, un enfant est né le 3 novembre 2014. Il est reconnu par son père un peu plus d’un an après, le 12 janvier 2016, et le père engage immédiatement, dès le 13 janvier, une instance aux fins de voir fixer les mesures concernant l’enfant. On pressent que la reconnaissance et la requête au JAF résultent d’une séparation provoquée par la mère qui a emmené l’enfant avec elle : l’enfant n’ayant pas été reconnu dans l’année de sa naissance, la mère exerce seule l’autorité parentale en application de l’article 372 du Code civil, et elle n’entend pas la partager avec le père.
Le père forme donc une demande judiciaire d’exercice conjoint de l’autorité parentale, à laquelle la mère s’oppose, motif pris de sa radicalisation islamique et des craintes de voir l’enfant emmené en Syrie.
En première instance, par jugement du 17 juin 2016, le JAF de Versailles17 rejette la demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale, mais il accorde au père un droit de visite et d’hébergement d’un jour par mois, assorti de l’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents.
La mère interjette appel de ce jugement, s’opposant à tout droit de visite du père. L’arrêt de la cour de Versailles lui donne raison de manière totale et absolue, puisque non seulement elle supprime tout droit de visite du père, mais elle met les dépens à la charge exclusive de ce dernier et le condamne à verser 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile !
Le texte appliqué par la cour de Versailles est l’article 373-2-1 du Code civil, lequel prévoit qu’en cas d’exercice de l’autorité parentale exclusive par l’un des parents, le droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre que pour « motifs graves ». Pour préserver les liens entre le parent non-titulaire de l’exercice de l’autorité parentale et son enfant, le même article organise ensuite la possibilité d’exercice du droit de visite dans des « points rencontre ». Ces dispositions sont destinées à donner une efficacité concrète aux principes posés dans l’article 373-2, alinéa 2, du Code civil : « Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».
La décision de la cour de Versailles, qui coupe de manière quasi absolue tout lien entre l’enfant et son père, est donc tout à fait atypique et ne peut s’expliquer que par des motifs particulièrement graves, en l’occurrence la radicalisation islamique du père et les dangers qu’elle est supposée faire courir à l’enfant.
De manière plus précise, la mère avance deux arguments qui seront repris par la cour d’appel : le père a annoncé son intention de partir à l’étranger, et il se dérobe à ses obligations paternelles. Ces deux arguments sont, à l’examen, peu étayés et cachent une véritable déchéance des droits paternels pour cause de radicalisation.
I. Des arguments bien fragiles
Pour priver le père de tout contact avec son enfant, la cour d’appel se fonde sur deux arguments, la radicalisation du père qui fait craindre un départ pour la Syrie, et le fait qu’il se serait commodément soustrait à ses obligations, tout en présentant cet abandon comme une épreuve non voulue.
Le risque de voir l’enfant emmené en Syrie serait établi par des propos tenus par le père annonçant son intention de quitter la France, ainsi que par le fait que certains membres de sa famille seraient déjà partis ou auraient tenté de partir en Syrie.
La crainte de voir l’enfant enlevé à l’étranger est fréquemment invoquée devant les tribunaux. Généralement, elle justifie la mise en place de mesures préventives, telles qu’une interdiction judiciaire de sortie du territoire français. Cette mesure, prévue à l’article 373-2-6 du Code civil depuis la loi du 9 juillet 2010 avait été prise par le JAF en première instance dans l’affaire commentée. Certes, son efficacité n’est pas absolue, à telle enseigne que l’État français a pu être condamné en raison de son non-respect18, mais elle peut être complétée par d’autres mesures, comme le dépôt du passeport du parent au commissariat de police pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement, ou encore l’organisation du droit de visite dans un « point rencontre » sous la surveillance de tiers. Sans être totalement efficaces, ces obligations minimisent considérablement les risques de soustraction de l’enfant. Il est vrai que l’exercice du droit de visite dans un « lieu médiatisé » est une solution par essence temporaire19 et ne fait que retarder le règlement du problème. À tout le moins cela aurait permis de ne pas rompre complètement les liens entre le père et l’enfant, en attendant que la situation se décante.
Quant au grief de soustraction à ses obligations paternelles et au reproche tiré du fait que le père présente sa privation de contact avec l’enfant comme une épreuve voulue par Allah afin de se justifier et de se donner le beau rôle, on avouera avoir un certain mal à y adhérer. La séparation d’avec l’enfant étant manifestement le fait de la mère, on ne voit guère comment ensuite reprocher au père de laisser cette dernière supporter seule la charge de son éducation, et ceci d’autant plus que l’arrêt ne mentionne aucunement que le père se soit soustrait à ses obligations pécuniaires. Dans tout autre contexte, ce type d’argument n’aurait pas constitué un « motif grave » de priver le père et son enfant de tout contact.
Derrière des reproches assez mal caractérisés, c’est donc bien la radicalisation du père, et elle seule, qui justifie la privation de droit de visite et d’hébergement.
II. La radicalisation islamique, motif de déchéance de l’autorité parentale ?
Dans l’arrêt commenté, le père n’est pas, à proprement parler, privé de l’autorité parentale. N’en ayant jamais eu l’exercice, à cause de la tardiveté de sa reconnaissance, il en est néanmoins titulaire depuis cette dernière. À ce titre, il conserve un droit d’information et de surveillance, prévu par l’article 372-2-1 du Code civil, au demeurant dépourvu de sanction, ainsi que le devoir de verser une contribution pour son entretien. L’enfant ne peut être ni émancipé ni adopté sans son accord. Mais le père ne peut intervenir en aucune manière dans son éducation et il n’a pas le droit d’entrer en contact avec lui. Tout au plus pourrait-il saisir le juge si d’aventure la situation de l’enfant le justifiait.
Cette situation est une réelle atteinte à son droit à la vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Depuis l’arrêt de la Cour de Strasbourg Palau-Martinez/France20, il est bien établi que l’appartenance à une religion quelle qu’elle soit ne peut justifier aucune atteinte aux droits parentaux en « l’absence de tout élément concret et direct démontrant l’influence de la religion (…) sur l’éducation et la vie quotidienne des (…) enfants ». En l’occurrence, faute de démonstration concrète des dangers ou préjudices subis par les enfants du fait de l’adhésion de leur mère aux témoins de Jéhovah, la France fut condamnée par la Cour de Strasbourg.
S’agissant précisément de l’islam, on peut relever un arrêt de la Cour de cassation, en date du 24 octobre 200021, qui approuve la suppression du droit de visite du père sur ses filles, se fondant « sur les pressions morales et psychologiques que M. X faisait peser sur ses filles encore très jeunes, notamment en exigeant le port du « voile islamique » et le respect de l’interdiction de se baigner dans des piscines publiques, et sur l’absence de « signe d’évolution de sa réflexion pour prendre en compte leur développement psycho-affectif et laisser une place à la mère ». Mais lorsqu’aucun danger ou préjudice concret et précis n’est relevé, le père conserve son droit de contact avec les enfants, même si, par exemple, il appartient à la secte des Adventistes du 7° jour22.
On perçoit dès lors en quoi l’arrêt commenté s’écarte de la jurisprudence habituelle, et des prescriptions de la Cour de Strasbourg. En effet, en dehors de la crainte de voir l’enfant emmené en Syrie, dont nous avons vu qu’elle peut être parée par des mesures de contrôle, aucun autre argument reposant sur des faits avérés ne permet d’établir que la fréquentation du père soit dangereuse pour l’enfant. Notamment, la mère n’évoque pas le risque de circoncision sans son accord, probablement parce que son fils est déjà circoncis.
À moins de considérer que la radicalisation du père est en elle-même un danger et que le « principe de précaution » interdit de mettre en contact un enfant avec son père si celui-ci présente des indices de « radicalisation ». Et d’admettre que le fait pour le père radicalisé de réclamer ce droit de contact est à ce point incongru qu’il justifie la mise totale des dépens à sa charge !
Pour étayer ce raisonnement, il faudrait s’interroger sur cette « radicalisation », sur les limites des comportements et croyances admis dans notre société, sur les preuves de l’adhésion du père à cette idéologie, et sur l’impact que pourrait avoir la fréquentation d’un père « radicalisé », ou tout au moins « mêlé de près à une mouvance islamiste radicale » selon les termes de l’arrêt, pour un enfant de trois ans.
Il est possible que les faits de l’affaire, mieux détaillés, permettent de comprendre et d’approuver la rupture judiciaire totale des liens autres qu’alimentaires entre le père et son fils. À tout le moins peut-on constater qu’en l’état de la motivation de l’arrêt, il semble reposer sur une pétition de principe selon laquelle la radicalisation islamique ne peut qu’être un danger pour l’enfant et justifie en tout état de cause la privation des droits parentaux.
Il est loin d’être acquis que ce raisonnement serait approuvé par la Cour de cassation et par la Cour de Strasbourg si elles étaient saisies de cette affaire.
FDD
B – Les conséquences des risques réalisés
Survenance du risque médical et défaut d’information du médecin : quelques précisions sur le préjudice d’impréparation
Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-27898. En évoquant le droit applicable au devoir d’information du médecin à l’égard de son patient, à cette « relation profondément humaine, où se rencontrent la conscience du médecin et la confiance du malade », Monsieur Léonard de la Gatinais, premier avocat général à la Cour de cassation, indiquait que « L’édifice apparemment abouti, au regard de la jurisprudence de la première chambre, autour du devoir d’information du médecin, est aujourd’hui d’une telle solidité que l’ensemble des matériaux qui le composent devrait permettre d’appréhender toutes les problématiques relevant de l’équilibre indispensable entre le devoir du médecin et le droit du patient »23. Pourtant, et ainsi que l’auteur le remarque, certaines procédures contemporaines ont pour effet de fragiliser l’édifice et permettent d’observer que les choses, les notions juridiques, les droits et devoirs de chacun, ne sont peut-être pas si ancrés dans le « marbre de la relation médecin/malade » que l’on aurait pu le penser ou le souhaiter. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 janvier 2017 livre une illustration éclairante de ce constat.
En l’espèce, après avoir posé un diagnostic de sténose carotidienne droite, un chirurgien a prescrit à son patient la réalisation d’un bilan vasculaire complémentaire. Suite à la pratique d’une artériographie par un radiologue, le patient a présenté une hémiplégie des membres inférieur et supérieur gauches et, par conséquent, a assigné les praticiens en vue d’obtenir la réparation de son préjudice. Dans un arrêt du 30 septembre 2015, la cour d’appel de Rennes a fait droit aux demandes du patient et a retenu la responsabilité solidaire des médecins qui ont été condamnés en réparation, en premier lieu, de la perte de chance d’éviter le dommage, en second lieu, d’un préjudice moral d’impréparation. Considérant que le patient n’avait nullement été averti des risques d’hémiplégie consécutifs à l’artériographie qu’il a subie, les juges du fond en ont conclu qu’il avait non seulement perdu une chance d’éviter la réalisation du dommage, mais aussi qu’il avait été empêché de se préparer à la réalisation d’un tel dommage. La cour d’appel a ainsi identifié deux préjudices distincts, la perte de chance et l’impréparation, tendant chacun à une indemnisation particulière. Les médecins ont alors formé un pourvoi en cassation articulé autour de la violation des articles 1147 et 1382 du Code civil et du principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle. En substance, outre une difficulté tenant au respect du principe de non-cumul des responsabilités, le pourvoi reproche essentiellement aux juges du fond d’avoir réparé deux fois le même préjudice, puisque la perte de chance engloberait le préjudice d’impréparation.
Dépendance ? Autonomie ? Complémentarité ? La question ainsi posée à la première chambre civile de la Cour de cassation est celle du lien juridique entretenu entre d’une part la perte de chance de se soustraire à la réalisation d’un risque médical et, d’autre part, le préjudice d’impréparation subi par la victime. Une fois clarifiée cette problématique des relations nouées entre ces deux notions, la Cour de cassation devait aisément en tirer les conséquences en matière d’indemnisation allouée à la victime. C’est chose faite dans un arrêt du 25 janvier 2017. Dans cette décision, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en retenant qu’« indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé ; qu’il en résulte que la cour d’appel a retenu, à bon droit et sans méconnaître le principe de réparation intégrale, que ces préjudices distincts étaient caractérisés et pouvaient être, l’un et l’autre, indemnisés ».
En retenant une telle position, la Cour de cassation confirme une ligne jurisprudentielle récente qui, renouant avec une certaine orthodoxie juridique, adopte une vision essentiellement subjective du préjudice d’impréparation et redonne en la matière ses lettres de noblesse à la notion de préjudice telle qu’elle est classiquement entendue en droit de la responsabilité civile (I). Ce faisant, la solution jurisprudentielle qui tend à apprécier l’indemnisation du préjudice d’impréparation indépendamment de celle de la perte de chance s’en trouve justifiée et opportune (II).
I. Défaut d’information et préjudice d’impréparation : genèse de l’atteinte à un intérêt individuel
Si l’expression n’est pas d’apparition particulièrement récente24, le préjudice d’impréparation n’a que dernièrement fait une entrée remarquée en jurisprudence, et ce au travers du prisme de ses liens entretenus avec la perte de chance. Depuis un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 7 février 199025, il était en effet tout à fait classique d’affirmer que le défaut d’information sur les risques engendrés par l’acte de soin, devoir d’information incombant au praticien, n’était sanctionné que sur le fondement de la perte de chance qu’aurait eue le patient de refuser l’acte et, par voie de conséquence, d’éviter la réalisation du risque de dommage. L’entier débat judiciaire était alors focalisé sur l’existence éventuelle d’une alternative thérapeutique, celle-là même qui aurait permis au patient de refuser l’acte pratiqué. Qu’elle existe, et l’indemnisation de la victime sur le fondement de la perte de chance demeurait ouverte puisque le patient aurait été en mesure d’opérer un autre choix thérapeutique. Qu’elle n’existe pas, et le caractère nécessaire de l’acte de soin pratiqué par le médecin supprimait le préjudice ou le lien de causalité en même temps que les possibilités d’indemnisation26. Ce faisant, en réduisant l’indemnisation de la victime à l’estimation de la chance par elle perdue, la Cour de cassation a dissocié le montant de l’indemnisation du dommage réel, en ne laissant subsister qu’une indemnisation par définition partielle.
Un temps tentée de supprimer toute sanction civile au défaut d’information en ne retenant aucune perte de chance dans l’hypothèse où les circonstances démontrent que le patient, quand bien même dûment informé des risques générés, aurait accepté l’acte de soin27, un arrêt de la première chambre civile du 3 juin 2010 est revenu sur cette position en énonçant, au visa des articles 16, 16-3 alinéa 2 et 1382 du Code civil, que le défaut d’accomplissement par le médecin de son devoir d’information causait un préjudice à celui auquel l’information était légalement due, préjudice que « le juge ne peut laisser sans réparation »28. Les choses ne pouvaient en rester là puisqu’il subsistait encore la délicate question de la définition et de l’identification de ce préjudice qui nécessitait la nécessaire intervention judiciaire. S’agissait-il d’un préjudice moral inhérent et consubstantiel au droit à l’information du patient, lequel pour l’occasion aurait emprunté les contours d’un droit subjectif d’un genre nouveau ? S’agissait-il à l’opposé d’un préjudice d’impréparation à proprement parler, préjudice tiré de l’absence de préparation de la victime à la survenance du risque médical29 ? Une telle interrogation était loin de ne receler qu’un enjeu strictement théorique. En effet, retenir la première proposition impliquerait de reconnaître l’indemnisation de la victime du défaut d’information quelle que soit l’issue de l’intervention, tandis que la seconde ferait de la survenance du risque une condition sine qua non de la réparation du préjudice d’impréparation.
L’utile précision fut apportée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 23 janvier 201430, décision dont on peut considérer qu’elle constitue l’acte de reconnaissance du préjudice d’impréparation en jurisprudence, quand certaines décisions précédentes n’en avaient été que les prémisses non dénuées d’ambiguïté31. Aux termes de cet arrêt et d’un attendu dont la similarité avec celui de la décision sous examen n’est pas fortuite, la Cour de cassation considère « qu’indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte d’investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation »32.
Ce faisant, et l’arrêt du 25 janvier 2017 en est une confirmation manifeste, la Cour de cassation a incontestablement fait sienne une conception purement subjective du préjudice d’impréparation et, fermant la « boîte de Pandore »33, en est revenue « aux fondamentaux de la responsabilité civile »34. En effet, le visa des articles 16 et 16-3 du Code civil dans l’arrêt de la première chambre civile du 3 juin 2010 sous-tendait l’idée selon laquelle la réparation était fondée sur une lésion à un intérêt collectif, en l’occurrence une atteinte à la dignité, par le biais du défaut d’information. De la sorte, en adoptant une conception large, pour ne pas dire sociale, du préjudice, la Cour de cassation en quelque sorte l’objectivait, et le préjudice s’avérait dès lors déconnecté des souffrances réellement ressenties, subjectivement vécues par la victime. En opérant un resserrement, en redonnant au préjudice sa véritable « coloration subjective »35, en renouant avec la condition du préjudice subi par la victime aux fins d’indemnisation, les arrêts du 23 janvier 2014 et du 25 janvier 2017 ont ainsi opéré un opportun retour aux sources et aux standards de la responsabilité civile, en toute conformité avec le principe de réparation intégrale. En somme, la victime du défaut d’information pourra solliciter du juge non seulement une indemnisation au titre de la perte de chance, mais de surcroît une indemnisation au titre de son préjudice, subjectif donc, d’impréparation, à condition toutefois de rapporter la preuve de la violation de son intérêt individuel, de son préjudice.
Si l’enseignement tiré de l’arrêt du 25 janvier 2017 devait s’arrêter sur ce point, la décision ne serait qu’une confirmation expresse de l’arrêt du 23 janvier 2014. Or, tel n’est pas le cas et, pour la première fois, la Cour de cassation tire les conséquences de sa propre jurisprudence sur l’indemnisation dont la victime peut se prévaloir en cas de défaut d’information.
II. Préjudice d’impréparation et perte de chance : la justification d’une indemnisation cumulative
Un auteur a relevé que le « préjudice d’impréparation a été créé de toutes pièces pour servir de « lot de consolation » dans les cas où la notion de « perte de chance » se révèle impuissante à fournir la moindre compensation à la victime d’un défaut d’information »36. Si tel était à l’évidence le cas à l’origine, où le préjudice d’impréparation semblait n’être qu’un bien maigre sujet de satisfaction au profit de la victime, telle n’est plus la situation désormais, dans la mesure où le possible cumul de l’indemnité versée au titre de la perte de chance et de celle versée au titre du préjudice d’impréparation est affirmée avec force par la décision sous examen.
Certes, et comme il a été remarqué, les sommes en jeu ne sont guère d’égale importance, puisque l’indemnité destinée à compenser la perte de chance est d’un montant bien supérieur et sans commune mesure avec celle visant la réparation du préjudice d’impréparation37. Cependant, sur le plan des principes, cette solution de l’arrêt du 25 janvier 2017 n’en demeure pas moins riche d’enseignement, alors que différentes thèses ont été soutenues afin précisément de justifier l’absence de cumul des deux indemnités. En ce sens, il a d’abord été assuré que chacune des deux indemnités allouées à la victime, et incidemment chacun des deux préjudices dont il est ici question, remplirait une fonction indépendante mais complémentaire l’une de l’autre. Ainsi, la perte de chance serait exclusive d’un quelconque préjudice d’impréparation, dès l’instant où le défaut d’information a effectivement privé le patient de sa possibilité d’échapper à la réalisation du risque, en refusant l’intervention. Dans une telle perspective, l’existence d’une alternative thérapeutique aurait permis au patient, dument informé, d’opérer un choix éclairé entre les diverses options qui s’offraient à lui. Privée de cette faculté par la défaillance du médecin, la victime n’aurait d’alternative que de solliciter en justice l’indemnisation de sa perte de chance. À l’inverse, et puisque le caractère impératif de l’acte de soin pratiqué prive le patient de toute indemnisation au titre de la perte de chance en rendant illusoire son refus de l’intervention, il ne subsisterait pour lui dans cette hypothèse qu’une possibilité d’indemnisation au titre du préjudice d’impréparation. Placée dans l’une ou l’autre de ces situations factuelles, selon le caractère impérieux ou dispensable de l’intervention pratiquée, la victime du défaut d’information ne saurait se prévaloir d’un cumul entre ces deux préjudices distincts et indépendants, bien que complémentaires.
En outre, la thèse de l’impossibilité de cumuler entre ces deux préjudices a été accréditée par l’idée selon laquelle les médecins, condamnés sur ces deux fondements, se verraient en quelque sorte frappés d’une « double peine »38. Il s’agit là de l’argumentation développée par le pourvoi en cassation lequel, rappelons-le, considère que la perte de chance englobe le préjudice d’impréparation et qu’un cumul d’indemnisation reviendrait à réparer deux fois le même dommage. Imaginerait-on en effet un patient qui, non informé du risque généré par l’intervention, a perdu une chance d’échapper à sa réalisation mais, dans le même temps, a eu la possibilité de se préparer à la survenance du risque en question ? Dans ces conditions, le rejet du pourvoi serait d’une incohérence qui confinerait à l’absurde…
Pour séduisante qu’elle soit, cette opinion défendue devant la première chambre civile présente pourtant l’insurmontable écueil de réunir en une synthèse peu convaincante deux préjudices qui, chacun, sont d’une nature fondamentalement différente. Évoquer la perte de chance subie par une victime de se soustraire à la réalisation d’un risque commande de se pencher sur l’atteinte à son intégrité physique, alors le préjudice d’impréparation est un préjudice moral par nature. Cette nuance de taille n’a d’ailleurs pas échappé à la Cour de cassation dans sa décision du 25 janvier 2017 puisqu’elle qualifie expressément le préjudice d’impréparation de « préjudice moral », précision qu’elle n’avait pas apportée dans son arrêt du 23 janvier 2014. De la sorte, la possibilité de retenir cumulativement une indemnisation au titre de ces deux chefs de préjudices bien distincts s’en trouve pleinement justifiée en droit et demeure tout à fait conforme à l’esprit du droit de la responsabilité civile puisque, rappelons-le, la décision du 25 janvier 2017 renoue avec la condition du préjudice subi en faisant de la réalisation du risque une condition essentielle de la réparation. Si d’aucuns reprocheront peut-être à cette décision d’identifier et d’ouvrir le droit à indemnisation d’un nouveau préjudice moral, à l’heure où celui-ci semble pourtant plus que jamais sujet à « désintégration »39, la rigueur juridique dans l’opération de qualification et le principe de réparation intégrale semblent néanmoins bel et bien saufs et respectés dans le cas présent. Si les plaideurs s’engouffreront à n’en point douter dans cette voie, la Cour de cassation devra veiller à ce qu’il en reste ainsi.
R.L.
L’anachronisme de l’obligation de sécurité de moyens en matière de dommage corporel, où le risque d’absence d’indemnisation
Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 16-11953. La classification des obligations contractuelles est l’une des plus célèbres de l’ordre juridique français. Depuis Demogue, il est admis que l’intensité de l’obligation varie, celle-ci pouvant apparaître de moyens comme de résultat40. Dans un contexte de reprise des acquis issus de la jurisprudence depuis la promulgation du Code civil, il apparaît alors discutable de ne pas avoir inséré cette distinction au sein du projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 201741. Cette distinction permet en effet une mise en avant de la diversité des obligations contractuelles, comme une meilleure appréhension de celles-ci par le juge. Selon cette idée de généralité, la distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultat est alors utilisée par le juge lorsqu’il doit déterminer l’intensité des obligations de sécurité, à la suite d’un dommage corporel subi par le créancier contractuel. C’est dans ces hypothèses que l’opposition entre les deux types d’obligations peut s’avérer être un frein à l’indemnisation des dommages corporels, comme le montre la décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 janvier 201742.
En l’espèce, une personne, qui venait de descendre d’un mur d’escalade artificiel a été heurtée par un autre grimpeur, qui venait de « décrocher » du mur. Elle demanda réparation des différents dommages subis à l’établissement exploitant la salle d’escalade, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil43, estimant qu’il avait été défaillant dans l’exécution de son obligation de sécurité. La cour d’appel rejeta ses prétentions, considérant que la victime ne démontrait pas l’existence d’une faute qui aurait été commise par l’établissement. Cette preuve était en effet nécessaire, les juges du fond ayant qualifié l’obligation de sécurité de l’établissement d’obligation de moyens. La victime décida de former un pourvoi en cassation, dans lequel elle estime que la faute de l’établissement peut être établie tant au regard de la dangerosité de l’installation, que de l’absence de surveillance de l’activité. Son pourvoi est rejeté par la Cour de cassation, qui, après avoir posé que l’obligation de sécurité en l’espèce était une obligation de moyens, affirme que « l’accident ne résultait ni de la configuration des lieux ni d’un quelconque manquement de la société M’Roc à son obligation de sécurité, mais était la conséquence de la faute d’imprudence de la victime ».
Cette décision appelle nécessairement à s’interroger sur la détermination de l’intensité des obligations contractuelles, mais aussi, plus largement, sur l’adéquation du droit positif, et notamment de la responsabilité contractuelle, à indemniser efficacement les dommages corporels subis. Il peut en effet être constaté que l’obligation de sécurité, lorsqu’elle est qualifiée de moyens, est inadaptée à la réparation des dommages corporels, en ce qu’elle impose la preuve d’une faute à la victime (I). Si les propositions récentes de réforme de la responsabilité civile proposent une décontractualisation du dommage corporel, cette solution demeure également discutable et pas nécessairement optimale en vue de faciliter la réparation des dommages corporels (II).
I. L’inadaptation de l’obligation de sécurité de moyens
L’obligation de sécurité de moyens est en l’espèce classiquement appliquée par la Cour de cassation, qui prend le soin de noter la présence de ses conditions (A), laissant apparaître une nouvelle fois la situation précaire de la victime dans cette hypothèse (B).
A. L’application traditionnelle de l’obligation de sécurité de moyens
L’opposition entre les obligations de moyens et les obligations de résultat s’applique à l’ensemble des obligations contractuelles. Ces dernières ont vu leur nombre s’accroître, notamment au début du XXe siècle, lorsque la Cour de cassation a décidé de contractualiser un certain nombre de situations, afin d’assurer une meilleure indemnisation à la victime44. C’est ainsi que la Cour de cassation donna naissance en 1911 à l’obligation de sécurité45 qui, aujourd’hui, impose à tout débiteur contractuel prenant en charge le corps d’autrui d’assurer sa sécurité46.
L’obligation de sécurité doit alors être qualifiée d’obligation de moyens ou d’obligation de résultat. Cette détermination est le résultat de l’application des critères classiques permettant de distinguer ces différentes obligations : lorsque l’exécution de l’opération apparaît aléatoire pour le débiteur, l’obligation est de moyens, et le créancier doit démontrer que le débiteur a commis une faute, en ne mettant pas en œuvre tous les moyens dont il disposait afin de parvenir au résultat. Au contraire, en l’absence d’aléa, l’obligation est de résultat : le créancier n’a qu’à démontrer que le résultat n’est pas atteint afin d’engager la responsabilité du débiteur47.
En l’espèce, alors même que la qualification de moyens de l’obligation de sécurité n’était pas discutée au sein du pourvoi, la Cour de cassation pose cependant en guise de prémices à son raisonnement que « l’obligation contractuelle de sécurité de l’exploitant d’une salle d’escalade est une obligation de moyens dans la mesure où la pratique de l’escalade implique un rôle actif de chaque participant ». Cela permet à la Cour de justifier cette qualification : puisque chaque participant a un rôle actif dans la pratique de l’escalade, l’exécution de l’obligation de sécurité est aléatoire pour le créancier. Il ne s’agit là que d’une décision reprenant une solution souvent posée en matière d’activités ludiques ou sportives. Dès que le créancier doit jouer un rôle au sein de l’activité proposée, l’obligation de l’exploitant n’est que de moyens48. À rebours, cela impose à la victime la preuve d’une faute du débiteur, mettant en avant la précarité de sa situation.
B. La vulnérabilité de la victime soumise à la démonstration d’une faute
Par l’application de l’opposition entre les obligations de moyens et les obligations de résultat, la victime d’un dommage corporel subi lors de l’exécution d’un contrat peut voir sa situation évoluer radicalement. Si l’obligation de sécurité venait à être qualifiée d’obligation de résultat, elle n’a qu’à démontrer l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité entre l’activité du débiteur et celui-ci afin d’être indemnisée. Sa situation est alors proche de celle de la victime d’une chose49, ou encore de celle d’un véhicule terrestre à moteur soumis à la loi Badinter50 : toute considération autour de la faute de l’auteur du dommage est exclue.
Au contraire, la victime créancière d’une simple obligation de sécurité de moyens se retrouve confrontée à la démonstration d’une faute commise par le débiteur, outre l’établissement de son préjudice et du lien de causalité. La faute est délicate à établir, puisqu’il s’agit de comparer le comportement du défendeur avec celui de la personne raisonnable. C’est pour cette raison que la responsabilité délictuelle a évolué dans le sens d’une réduction toujours plus importante des faits générateurs de responsabilité fondés sur la faute51, afin de permettre à la victime d’alléger son fardeau probatoire, en vue d’être plus simplement indemnisée.
Dans ces conditions, l’obligation de sécurité de moyens fait l’objet de critiques nourries de la part de la doctrine52, qui lui reproche son retard au regard des autres hypothèses de réparation du dommage corporel, qui ont pour point commun de ne pas exiger de faute de l’auteur du dommage afin d’indemniser la victime. Il faut cependant reconnaître à la Cour de cassation une certaine cohérence : au seul regard des critères de distinction des obligations contractuelles, il est bien évident, pour reprendre l’espèce, que celui qui grimpe un mur d’escalade joue un rôle actif dans la réalisation de l’obligation, justifiant sans l’ombre d’un doute l’obligation de moyens. Toutefois, cette implacable logique a pour paradoxe de qualifier d’obligation de moyens les obligations de sécurité présentes dans les activités où les victimes ont le plus de liberté et qui sont, souvent, les plus dangereuses. Il est donc nécessaire de sortir de cette impasse constituée par l’obligation de sécurité de moyens.
II. Le nécessaire abandon de l’obligation de sécurité de moyens
En ces temps de discussions relatives à une réforme de la responsabilité civile, il est proposé de réparer l’ensemble des dommages corporels selon les seules règles de la responsabilité délictuelle, ce qui ne semble pas à même d’améliorer totalement la situation des victimes (A), laissant alors patent une faille dans l’indemnisation du dommage corporel (B).
A. La décontractualisation de l’obligation de sécurité
Le rattachement au domaine contractuel de la sécurité du corps d’autrui, par le truchement de l’obligation de sécurité, est relativement artificiel : il a été réalisé en considération de l’intérêt des victimes, à une époque où la responsabilité contractuelle était plus à même de les indemniser que la responsabilité délictuelle. Mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit là d’un devoir de portée générale, qui a été greffé au contrat pour les besoins de la cause53.
Ce rattachement pourrait bientôt être remis en cause. Par le projet de réforme de la responsabilité civile en date du 13 mars 2017, le législateur propose que l’ensemble des dommages corporels soient réparés selon les règles de la responsabilité extracontractuelle, qu’ils aient été subis lors de l’exécution d’un contrat ou non54. Si le principe de non-option des responsabilités contractuelle et délictuelle vacillerait55, la mise en œuvre de cette règle signifierait ipso facto la régression spectaculaire des obligations de sécurité, indemnisant très souvent des dommages de nature corporelle. L’indemnisation se réalisant en dehors de la sphère contractuelle, la victime n’aurait plus à démontrer la faute contractuelle du débiteur afin d’être indemnisée.
Cependant, cette solution, si elle a le mérite de tenter une meilleure indemnisation du dommage corporel, à l’image de nombre de dispositions de ce projet de loi56, pourrait également apparaître comme de la simple poudre aux yeux. En effet, dans le domaine extracontractuel, la victime n’est pas totalement à l’abri de la démonstration d’une faute afin d’être indemnisée. Plus précisément, à partir du moment où le dommage n’est pas causé par une chose – et encore, une chose en mouvement – il est exigé que la victime prouve une faute commise par le défendeur, par exemple si le fait générateur de responsabilité est celui porté par l’article 1240 du Code civil57. De plus, le projet de loi propose de faire dépendre la mise en œuvre de l’ensemble des responsabilités du fait d’autrui à la démonstration préalable de la faute de l’auteur du dommage58 : on assisterait alors à un accroissement des hypothèses dans lesquelles une faute doit être démontrée par la victime, alors même que, dans le même temps, ce projet tente de faciliter la réparation du dommage corporel, en le faisant gouverner par les seules règles de la responsabilité extracontractuelle.
Les limites de cette proposition sont simples à établir, il suffit de reprendre les faits objet de la décision commentée pour s’en convaincre. Puisque le dommage a été causé par la chute d’un autre grimpeur, la victime aurait eu deux possibilités, selon les règles envisagées par le projet de réforme. Soit engager la responsabilité du fait personnel de l’autre grimpeur, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, et ainsi démontrer une faute de celui-ci soit, en suivant la nouveauté proposée, utiliser les règles de la responsabilité extracontractuelle à l’égard de l’exploitant de la salle. Toutefois, le dommage n’ayant pas été causé par une chose, c’est également sur le fondement de l’article 1240 du Code civil que la victime devra articuler son action, lui laissant alors entier le fardeau de la démonstration d’une faute, contractuelle aujourd’hui ou extracontractuelle demain. Sans doute la nécessité de faciliter l’indemnisation du dommage corporel mériterait des avancées plus profondes.
B. Une faille patente dans l’indemnisation du dommage corporel
Si l’on devait réaliser un retour aux sources de l’évolution spectaculaire de la responsabilité civile effectuée à partir de la fin du XIXe siècle, l’on trouverait évidemment sur notre route la théorie du risque, défendue par Saleilles et Josserand59. Postulant que celui qui créé un risque et réalise un bénéfice suite à cette création doit en indemniser les conséquences, elle permit notamment d’indemniser l’ouvrier mortellement blessé par une chaudière sans qu’une preuve doive être établie par ses héritiers, par le célèbre arrêt Teffaine60. Il est frappant de constater que la théorie du risque pourrait s’appliquer comme un gant aux activités sportives, de loisir ou, plus largement, ludiques. À chaque fois, nous avons face à la victime un exploitant qui créé un risque de dommage en proposant ce type d’activités, pourquoi ne pas le condamner à indemniser la victime sitôt ce dommage subi, puisqu’il réalise par ailleurs un bénéfice suite à cette exploitation ? Qu’est ce qui justifie, de ce point de vue, que la victime face à la réalisation d’un risque doive démontrer une faute de l’exploitant ? La théorie du risque postule en effet que la seule réalisation du risque établit le fait générateur de responsabilité. N’est-ce alors pas paradoxal que la situation de la victime d’un risque créé soit moins favorable actuellement qu’en 1896, lorsque l’arrêt Teffaine fut rendu ?
Là se situe sans doute l’une des failles du projet de loi du 13 mars 2017. S’il a su reprendre les acquis jurisprudentiels, l’on peut regretter qu’il n’en ait pas profité, par ailleurs, pour poursuivre l’œuvre continue d’adaptation de l’institution à l’évolution de la société qu’a réalisée avec une certaine réussite la jurisprudence61. En effet, pour ce qui est des victimes de dommage corporel soumises à la démonstration d’une faute, à défaut de mise en œuvre d’une garantie d’indemnisation de ce type de dommage62, d’une mise en avant d’un « droit à la sûreté »63, ou encore d’une généralisation de l’obligation de sécurité de résultat64, il semble que la faute demeure encore longtemps un obstacle en vue de leur indemnisation.
A.D.
Pratiques managériales pathogènes : tous concernés !
« Presque tous les témoins font état du climat de peur, voire de terreur, que faisait régner M. Z. Les principales méthodes maltraitantes employées par le directeur peuvent être résumées ainsi : accès de colère, obligation de se justifier sur tout, y compris des éléments personnels, humiliations publiques, remarques intimes, intrusions dans la vie privée, enfermement sur des secrets « entre nous », demandes de nuire aux autres (ne plus leur parler, les surveiller, obtenir des informations personnelles…), brusques volte-face, changement de comportement, déstabilisation, isolements (mise au placard, non-information de réunions), déclaration d’amour puis dénigrement… » : le rapide descriptif de ce mode de management éminemment agressif en serait presque caricatural s’il n’était extrait d’une décision de la cour d’appel de Toulouse révélant ce qu’a pu être le quotidien de ces salariés d’un magasin d’une célèbre enseigne de grande distribution confrontés à leur directeur65. On imagine sans mal les répercussions que peut avoir ce type de comportement sur la santé aussi bien mentale que physique des collaborateurs.
L’affaire n’est malheureusement pas isolée. Elle ne constitue qu’une illustration de pratiques managériales susceptibles de se développer au sein des entités et de peser sur la santé des salariés. L’examen du contentieux est à ce titre instructif : manque de respect, insultes, humiliations, menaces, fausses allégations d’un prochain licenciement, autoritarisme ou agressivité à l’égard des collègues, déconsidération, manipulation, suspicion, paranoïa, empiétement sur la vie privée, absence totale de soutien, manque de cohérence et instructions contradictoires, désintérêt pour les tâches à accomplir et pour son équipe, absence totale de communication… : l’éventail des comportements managériaux pathogènes pris en compte par le juge est suffisamment large pour ne pas pouvoir tous les évoquer. Ces pratiques n’échappent en effet bien évidemment pas au droit. L’actualité jurisprudentielle de ces dernières semaines est à cet égard riche d’enseignements. À sa lumière, se dessine une responsabilisation accrue des salariés à l’égard de ces comportements. Le risque de licenciement encouru par les salariés de l’encadrement qui développeraient des pratiques managériales condamnables en est la facette la plus visible (I), mais elle résulte également de la mobilisation par le juge des obligations de sécurité tant de l’employeur que du salarié (II).
I. Le licenciement à raison de pratiques managériales pathogènes
Il a été à juste titre souligné que « dans bon nombre d’entreprises, l’évolution de carrière, la réussite professionnelle est directement associée à des fonctions de manager » mais que « l’action de diriger ne s’improvise pas et repose sur un bon nombre de qualités »66. Chaque salarié ayant une mission d’encadrement, à quelque niveau que ce soit, qu’il relève d’ailleurs ou non de la catégorie des cadres, devrait prendre le temps de régulièrement s’interroger sur ses pratiques managériales ne serait-ce, à défaut de préoccupations plus altruistes, que pour se préserver d’un risque de licenciement du fait de son comportement managérial.
C’est naturellement d’abord sur le terrain disciplinaire que peuvent être tirées toutes les conséquences d’un mode de management pathogène.
Dans les cas les plus extrêmes, celui-ci sera révélateur d’un harcèlement moral tourné vers une personne déterminée avec l’intention de lui nuire. L’auteur s’exposera alors à un licenciement pour faute grave et à une action du ou des collaborateurs victimes en responsabilité civile, celle-ci étant personnellement engagée67.
L’intention de nuire n’est cependant pas indispensable à la reconnaissance d’un harcèlement moral : des méthodes de gestion du personnel peuvent parfaitement le caractériser et ainsi servir de fondement à un licenciement pour faute grave68. La condamnation d’un tel « harcèlement managérial » exigera toutefois qu’il se manifeste sur le plan individuel, pour un salarié donné, par des agissements répétés ayant pour objet effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel69. Encore récemment, la Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir écarté la qualification de harcèlement moral et dénié l’existence d’une faute grave à la charge d’un directeur de création qui, au cours de réunions, avait tenu des propos brutaux et agressifs visant un service tout entier et non pas une personne à titre personnel70. Pour autant, elle n’en a pas moins admis que le licenciement pour faute était justifié, « les pratiques managériales de l’intéressé, peu respectueuses des personnes placées sous son autorité » constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. C’est dire que la sanction du manager indélicat n’est absolument pas subordonnée à la reconnaissance d’un harcèlement moral : le « management fautif » d’une gérante salariée d’un magasin71, le « comportement plus qu’autoritaire envers de nombreux salariés » d’un chef de centre doublé d’un comportement inacceptable à l’égard d’une salariée dont il venait d’apprendre qu’elle était atteinte du virus du Sida72, « les injures à l’égard d’un subordonné fragile »73 d’un responsable de plate-forme ou encore la « gestion autoritaire et inappropriée » d’une animatrice développement des ventes74 ont été analysés comme une faute, parfois même grave, justifiant la rupture du contrat de travail par l’employeur.
La voie disciplinaire n’est de surcroît pas la seule qui s’offre à l’employeur. L’insuffisance professionnelle est également à même d’embrasser une partie des comportements managériaux défaillants sources de risques pour la santé des collaborateurs. Les « carences » ou « insuffisances » managériales, d’abord semble-t-il invoqués à l’appui du licenciement à côté d’autres difficultés de gestion rencontrées par le salarié, ont même gagné en autonomie75 : la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juin 2017 a ainsi parfaitement admis la légitimité du licenciement pour insuffisance professionnelle d’une directrice régionale fondé sur des griefs d’insuffisance managériale à l’origine de « manifestations de troubles liés aux risques psycho-sociaux pour un nombre important de collaborateurs de l’équipe »76. Semblerait donc pouvoir être opérée une distinction entre d’une part les comportements hostiles, agressifs (injures, humiliations, accès de colère, manipulations…) à l’encontre d’un ou plusieurs collaborateurs, qui trouveraient leur sanction dans un licenciement disciplinaire éventuellement pour faute grave, et d’autre part l’incompétence managériale (incapacité à organiser son équipe, à donner des directives claires ou non contradictoires, attitude démotivante, équipe livrée à elle-même…)77, caractérisant une insuffisance professionnelle et que l’employeur serait fondé à faire valoir à l’appui d’un licenciement non disciplinaire.
Mais si la distinction entre l’incompétence du salarié et son comportement fautif est en théorie simple, la première reposant sur l’absence de mauvaise volonté délibérée dans l’exécution défectueuse des missions, elle est en pratique beaucoup moins aisée à réaliser. Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 2 juin dernier, la lettre de licenciement visait ainsi un style de management directif avec un leadership autoritaire, un manque de cohérence et d’honnêteté, une volonté de démotiver l’équipe, un manque de respect de la personne avec utilisation d’un langage insultant et dégradant ainsi qu’une mauvaise communication avec son équipe, dévalorisante et dénigrante. Et de fait, il était établi que la salariée avait adressé des mails et courriels traitant des membres de son équipe de « pauvres connes » et qu’elle avait réalisé un horoscope satirique considéré comme dévalorisant par les juges du fond. Ils n’en avaient pas moins admis, approuvés en cela par la Cour de cassation, que le licenciement trouvait sa cause réelle et sérieuse dans les insuffisances de son management. La décision laisse tout de même le lecteur quelque peu perplexe et la vigilance s’impose : la faculté légitime de licencier le salarié en raison de son incompétence managériale génératrice de risques pour la santé ne doit pas devenir un moyen commode pour l’employeur d’échapper à une prescription des faits fautifs ou à une mauvaise motivation de la lettre de licenciement78. D’autant que la jurisprudence admet parfaitement que puissent être invoquées dans la lettre de licenciement à la fois des fautes et une insuffisance professionnelle dès lors qu’elles procèdent de faits distincts et que les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement sont respectées79. Sous réserve de respecter la procédure disciplinaire, l’employeur peut donc tout à fait invoquer à l’appui du licenciement des fautes managériales et l’insuffisance professionnelle. Le juge sera alors appelé à prendre en considération l’ensemble des faits invoqués, pour se prononcer sur la légitimité du licenciement80.
L’opportunité que peut présenter pour l’employeur la voie d’un licenciement pour insuffisance professionnelle ne devra cependant pas lui faire oublier qu’il ne pourra s’en prévaloir à la suite d’une évolution du salarié vers des fonctions managériales nouvelles qu’autant qu’il lui aura donné les moyens de s’adapter à l’évolution de son emploi au moyen d’une formation81. Il y a effectivement là « une obligation qui constitue un outil indispensable pour contrer certaines stratégies agressives de management qui, au premier faux pas, conduisent à la rupture du contrat de travail »82. La responsabilisation du « manager » ne peut être envisagée indépendamment des obligations de l’employeur et des moyens dont celui-ci dispose pour assurer de la part de ses salariés l’utilisation de méthodes de management adaptées. S’agissant de comportements susceptibles d’affecter la santé des autres salariés, leur complète appréhension ne peut en réalité s’opérer sans tenir compte de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur d’une part et sur tout salarié d’autre part. Cela explique que le juge n’hésite pas à les mobiliser.
II. La mobilisation des obligations de sécurité
L’obligation de sécurité de l’employeur83 et l’obligation de sécurité du salarié84 ne sont évidemment pas de même nature. Elles n’en entretiennent pas moins des liens étroits, ce qui n’est guère surprenant puisque ce n’est que dans leur complémentarité qu’une protection efficace de la santé des travailleurs peut être trouvée. Aussi l’appréciation du respect par un salarié de son obligation de sécurité dépend-elle notamment des efforts réalisés par l’employeur en exécution de sa propre obligation de sécurité spécialement en ce qui concerne l’information et la formation qu’il aura (ou pas) délivrées au salarié. Bien que les décisions de la Cour de cassation fondées sur l’obligation de sécurité du salarié ne soient pas des plus nombreuses, elle se révèle un terrain propice à la responsabilisation des salariés dans la lutte contre les pratiques managériales pathogènes. Sa discrétion dans la jurisprudence peut peut-être s’expliquer par le fait que dans nombre de situations où elle n’en est pas moins applicable, le comportement du salarié caractérise une inexécution si flagrante de son contrat de travail qu’il n’ait nul besoin de mobiliser l’article L. 4122-1 du Code du travail pour caractériser la faute du salarié. Aussi bien, les hypothèses « classiques » de management agressif constituent-elles certainement un manquement du manager à son obligation de sécurité, celle-ci lui imposant, comme à tout salarié, de ne pas mettre en péril par ses actes ou omissions la santé des tiers concernés85. Une référence expresse à l’obligation de sécurité du salarié au soutien de ces solutions n’apporterait sans doute pas grand-chose tant il est évident que le fait de harceler autrui, de l’humilier, de le menacer… constitue une inexécution fautive du contrat de travail pour tout à chacun. Le cas échéant, elle pourrait toutefois présenter une utilité pour appuyer la reconnaissance d’une faute grave du salarié. C’est d’ailleurs en invoquant un manquement du salarié à son obligation de sécurité que l’employeur avait justifié du licenciement pour faute grave de ce directeur d’un magasin d’une enseigne de la grande distribution en raison du comportement managérial hostile précédemment décrit86. Il avait en cela été approuvé par la cour d’appel de Toulouse87.
Cette affaire est toutefois originale, et à ce titre ne passera certainement pas inaperçue au sein des directions de ressources humaines, en ce que l’employeur ne s’était pas contenté de licencier le directeur du magasin auteur des pratiques managériales hostiles. Il avait également procédé au licenciement disciplinaire, sans toutefois invoquer une faute grave, de la responsable des ressources humaines et du contrôleur de gestion de l’établissement qui, par leur attitude, avaient cautionné le comportement inacceptable de leur supérieur hiérarchique. Dans les deux cas, l’employeur s’était fondé sur un manquement des salariés à leur obligation de sécurité. La cour d’appel lui a donné raison, considérant que chacun avait connaissance des pratiques managériales très contestables du directeur avec lequel ils travaillaient en étroite collaboration, que non seulement malgré leurs fonctions ils n’avaient rien fait pour y mettre fin mais que de surcroît, ils les avaient cautionnées ou couvertes mettant ainsi en danger tant la santé physique que mentale des salariés. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par la responsable des ressources humaines tendant directement à contester la légitimité de son licenciement a pleinement approuvé la décision des juges du fond en en reprenant les termes88. Le fait qu’en l’espèce les salariés aient cautionné le comportement de leur supérieur rend incontestable la reconnaissance de leur faute. À en croire les témoignages, non remis en cause par les juges du fond, ils avaient excusé le comportement du directeur, dénié sa gravité, fait parfois pression sur certains salariés pour qu’ils se taisent ou encore pour recueillir des informations de leur part sur les potentiels opposants, et bien qu’ayant été témoins de propos agressifs à l’encontre de salariés, n’avaient absolument pas réagi. En somme, bien qu’ils ne soient pas à l’origine des pratiques managériales hostiles, ils avaient participé à ce que la situation pathogène perdure en soutenant leur auteur. Il est dès lors compréhensible qu’il ait été reconnu que leur comportement en lui-même mettait en danger la santé des salariés. Peut-être même la faute grave aurait-elle ici été reconnue.
En aurait-il été de même s’ils s’étaient uniquement abstenus de réagir ? Au regard de l’espèce, la réponse nous semble positive : l’obligation de sécurité impose au salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de la santé et de la sécurité des autres personnes concernées non seulement par ses actes mais également par ses omissions. Leurs fonctions, la première en sa qualité de responsable des ressources humaines chargée de veiller au climat social, le second en tant que directeur adjoint du magasin, impliquaient qu’ils se préoccupent de la situation des salariés, et elles leur offraient les moyens d’agir : s’ils n’avaient certes pas les moyens de remédier à la situation, ne disposant pas des pouvoirs nécessaires pour prendre des mesures à l’encontre de leur supérieur hiérarchique, à tout le moins avaient-ils le pouvoir de donner l’alerte à un plus haut niveau89. L’inertie semble bien sanctionnable. L’obligation de sécurité du salarié, telle que définie par le législateur, permet ainsi de saisir des situations ne relevant pas d’une inexécution fautive patente du contrat de travail en donnant la mesure de ce qui est attendu de la part du salarié. Il y a certainement dans les fonctions du salarié et les pouvoirs qu’il détient à ce titre un facteur déterminant de délimitation de l’étendue de son obligation de sécurité.
Faudrait-il aller encore plus loin dans la responsabilisation du salarié et reconnaître comme l’avait fait l’employeur dans les lettres de licenciements, « qu’il incombe à chaque membre de l’encadrement, de contribuer au respect de l’obligation de sécurité de résultat qui lie contractuellement l’entreprise à chacun de ses salariés et dont l’effectivité doit être assurée en permanence » ? Une telle proposition conduirait certainement à faire assumer au salarié, le cas échéant sur le terrain disciplinaire, des risques à la charge de l’employeur. Elle relève à notre sens d’un dangereux amalgame entre obligation de sécurité de l’employeur et obligation de sécurité du salarié. Il faut dire que la jurisprudence est elle-même source de confusions.
En effet, dans une décision du 30 septembre 200590, la chambre sociale de la Cour de cassation a approuvé la reconnaissance d’une faute grave d’un salarié non seulement en ce qu’il avait persisté à ne pas respecter les consignes de sécurité mais également parce que « la lourde obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur ne lui permettait pas de tolérer plus longtemps les insuffisances de son directeur technique ». La reconnaissance de la faute grave du salarié semblait ainsi tout au moins en partie se déduire du fait que le salarié faisait courir d’important risques juridiques à son employeur tenu d’une obligation de sécurité de résultat. En somme, les risques juridiques auxquels il exposait son employeur participaient de la justification de son éviction immédiate de l’entreprise. Cette introduction dans le champ de l’appréciation de la faute du salarié et de la légitimité de son licenciement du risque de condamnation de l’employeur pour manquement à sa propre obligation de sécurité a dès cet arrêt suscité les interrogations d’une partie de la doctrine91. La brèche ouverte, les juges du fond ne semblent cependant pas avoir hésité à s’y engager. À s’en tenir aux seules décisions récentes dans lesquelles était en cause un comportement managérial, il n’est pas rare de découvrir dans la motivation des cours d’appel la référence à l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur, y compris pour directement en conclure que ce dernier était fondé à licencier pour faute grave le salarié92. La cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 14 février 2013 a même adopté un raisonnement similaire alors qu’était en cause l’insuffisance professionnelle du salarié93. On voit alors poindre les dérives auxquelles peut amener cette prise en compte de l’obligation de sécurité de l’employeur dans l’appréciation de la faute du salarié. Admettra-t-on demain que l’obligation de sécurité de l’employeur légitime à elle seule le licenciement du salarié dont le comportement managérial est générateur d’un risque juridique pour lui ?
Certes, il semblera naturel à n’importe quel employeur de pouvoir légitimement licencier pour faute grave un salarié dont les pratiques managériales compromettent le respect de son obligation de sécurité et génère à ce titre pour lui un risque juridique et financier de condamnation. Et il sera certainement convaincu qu’il n’a pas d’autre choix que de procéder au plus vite au licenciement avec éviction immédiate du salarié sous peine de violation de son obligation de sécurité qui lui impose de remédier à la situation. Il est par ailleurs vrai que cette référence faite par la Cour de cassation à l’obligation de sécurité de l’employeur ne contrevient pas à la lettre de l’article L. 4122-1 du Code du travail94 en ce que la responsabilité de l’employeur est toujours susceptible d’être engagée malgré le manquement du salarié à son obligation de sécurité. Et à ce jour, et c’est heureux, la Cour de cassation ne se passe pas de la démonstration d’un comportement managérial constitutif en soi d’une faute grave, la référence à l’obligation de sécurité de l’employeur semblant davantage venir en renfort de la solution.
Néanmoins, cette référence à l’obligation de sécurité de l’employeur est inopportune. Admettre qu’elle participe de la légitimation du licenciement pour faute grave en raison du risque de condamnation que fait courir le salarié à son employeur, conduit à faire assumer ce risque au salarié, tout au moins en partie, et donc la charge d’une obligation dont il n’est juridiquement pas le débiteur et qui est intimement liée à la qualité d’employeur. L’objet de l’obligation de sécurité de l’article L. 4122-1 du Code du travail, qui seule légalement pèse sur le salarié, est clairement dépassé. Si peuvent le cas échéant influer sur la qualification de la faute, la présence ou l’absence de précédents disciplinaires95, le fait que le salarié ait été lui-même victime d’un harcèlement96 ou n’ait pas été correctement formé97, le risque juridique qu’emporterait pour l’employeur un maintien provisoire du salarié le temps du préavis n’a pas à être pris en considération. Le véritable risque déterminant dans la qualification de la faute est celui que le maintien du salarié dans l’entreprise, le temps du préavis, ferait peser sur la santé des collaborateurs. Au demeurant, même en présence d’un comportement constitutif d’une faute grave, il n’est pas exclu que l’employeur, puisse en toute conformité avec son obligation de sécurité, opter pour une autre solution que le licenciement à condition qu’elle permette effectivement de mettre un terme aux agissements du salarié98. C’est dire que la caractérisation de la faute grave doit être appréhendée indépendamment de la décision de l’employeur de licencier le salarié en raison de cette faute grave. La solution ne devrait pas être différente en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle : les faits établissant l’incompétence du salarié devraient à eux seuls être à même de justifier la rupture du contrat de travail. Le risque juridique que fait peser l’insuffisance professionnelle du salarié sur l’employeur n’a pas à rentrer en ligne de compte dans sa caractérisation. Ce n’est qu’une une fois établie cette insuffisance, que se posera la question du respect par l’employeur de son obligation de sécurité dans le choix qu’il aura fait de licencier le salarié pour mettre un terme à ces agissements.
La référence à l’obligation de sécurité dans l’appréciation des manquements du salarié est donc source de confusions et porteuse de risque de dérives dans l’appréciation du manquement du salarié. On regrettera à ce titre que la Cour de cassation ne l’ait pas abandonnée : encore récemment dans un arrêt du 19 janvier 201799, elle a approuvé la décision des juges du fond qui avaient admis la légitimité du licenciement pour faute grave d’un directeur adjoint d’un complexe cinématographique, en ce qu’ils avaient relevé que le salarié avait proféré des insultes et fait preuve d’agressivité à plusieurs reprises à l’égard de ses collègues de travail, et retenu « que l’employeur tenu d’une obligation de protection de la santé physique et mentale de ses salariés, ne pouvait prendre le risque de voir se renouveler même pendant la durée limitée du préavis un tel comportement »100. Risque juridique pour l’employeur d’un maintien provisoire du salarié pendant l’exécution de son préavis ou risque pour la santé des collaborateurs si le salarié restait plus longtemps dans l’entreprise ? En se plaçant sous l’angle de l’obligation de sécurité de l’employeur, la Cour de cassation laisse malheureusement penser que le premier est déterminant.
V. LB.-D.
Notes de bas de pages
-
1.
Article 17 de l’ANI du 19 juin 2013 relatif à la qualité de vie au travail.
-
2.
Ray J.-E., « De la sub/ordination à la sub/organisation », Dr. soc. 2002, p. 5.
-
3.
Entretien avec Lanouzière H., Directeur général de l’ANACT, SSL, n° 1755, p. 7.
-
4.
C. trav., art. L. 3121-58.
-
5.
Loiseau G., « La déconnexion : observations sur la régulation du travail dans le nouvel espace-temps des entreprises connectées », Dr. soc. 2017, p. 463.
-
6.
Ibid. ; Guyot H., « L’adaptation du droit du travail à l’ère du numérique », JCP S 2016, 1310.
-
7.
Rapp. Mettling B., « Transformation numérique et vie au travail », sept. 2015, p. 35.
-
8.
Mathieu C., Pérétié M.-M. et Picault A., « Le droit à la déconnexion : une chimère ? », RDT 2016, p. 592.
-
9.
C. trav., art. L. 3121-18 ; C. trav., art. L. 3121-20 ; C. trav., art. L. 3131-1 ; C. trav., art. L. 3132-2.
-
10.
Cottin J.-B., « Forfait jours, état des lieux du contrôle jurisprudentiel des accords collectifs », JCP S 2015, 1065 ; Niel S., « Sécurisation des forfaits jours », CDRH, n° 236 ; Flores P., « Le forfait en jours après la loi du 8 août 2016 », Dr. soc. 2016, p. 898.
-
11.
C. trav., art. L. 3121-64, 3.
-
12.
Rapp. Mettling B., op. cit., p. 5 : « la “numérisation” de l’économie dépasse aujourd’hui le simple emploi d’outils numériques. Ainsi, le fonctionnement en réseau, l’usage de datas, la dématérialisation, (…), sont autant de changements qui bouleversent l’économie, l’entreprise, et le travail des individus, tant dans les tâches et objectifs que dans la façon de travailler, les méthodes et contextes de leur activité ».
-
13.
Ibid., p. 20.
-
14.
Ibid., p. 21.
-
15.
Loiseau G., op. cit.
-
16.
Ray J.-E., « Grande accélération et droit à la déconnexion », Dr. soc. 2016, p. 912.
-
17.
Arrêt de la 6e chambre JAF, n° 16/00331.
-
18.
CE, 26 avr. 2017, n° 394651, M. et Mme K.
-
19.
V. Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-27983.
-
20.
CEDH, 16 déc. 2003, n° 64927/01.
-
21.
Cass. 1re civ., 24 oct. 2000, n° 98-14386 : RTD civ., 2001 p. 126, obs Hauser J.
-
22.
V. CA Versailles, 19 nov. 2015, n° 14/03881 : JurisData n° 2015-02638 ; Dr. famille 2016, comm. 51.
-
23.
Bernard de la Gatinais L., « Obligation d’information du médecin : la clarification », D. 2014, p. 584.
-
24.
V.° Penneau M., « Le défaut d’information en médecine », D. 1999, p. 46.
-
25.
Cass. 1re civ., 7 févr. 1990, n° 88-14797 : D. 1991, p. 183, obs. Penneau J. ; RTD civ. 1992, p. 109, obs. Jourdain P.
-
26.
V° not. sur ce point : Cass. 1re civ., 7 oct. 1998, n° 97-10267 : D. 1999, p. 145, note Porchy S. ; RTD civ. 1999, p. 83, obs. Mestre J. ; RDSS 1999, p. 506, obs. Dubouis L. – Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n° 98-23.046 : D. 2000, p. 471, obs. Jourdain P. ; Defrénois 15 oct 2000, n° 37237, p. 1121, obs. Mazeaud D. ; RDSS 2000, p. 729, obs. Dubouis L.
-
27.
Cass. 1re civ., 6 déc. 2007, n° 06-19301 : D. 2008, p. 192, note Sargos P. ; ibid., p. 2894, obs. Brun P. et Jourdain P. ; RTD civ. 2008, p. 272, obs. Hauser J. ; ibid. p. 303, obs. Jourdain P.
-
28.
Cass. 1re civ., 3 juin 2010, n° 09-13591 : D. 2010, p. 1484, obs. Gallmeister I. ; ibid., p. 1522, note Sargos P. ; JCP G 2010, 788, note Porchy-Simon S. ; AJDA 2010, 2169, note Lantero C. ; RDSS 2010, p. 898, note Arhab-Girardin F. ; RTD civ. 2010, p. 571, obs. Jourdain P. ; RDC 2011, p. 335, note Bacache M.
-
29.
Jourdain P., « Préjudice réparable en cas de défaut d’information médical : la Cour de cassation réoriente sa jurisprudence », RTD civ. 2014, p. 379.
-
30.
Cass. 1re civ., 23 janv. 2014, n° 12-22123 : D. 2014, p. 590, note Bacache M. ; JCP G 2014, 446, note Bascoulergue A. ; ibid., p. 124, obs. Quezel-Ambrunaz C. ; RTD civ. 2014, p. 379, obs. Jourdain P. ; RDSS 2014, 295, note Arhab-Girardin F. ; RCA 2014, comm. 116, obs. Hocquet-Berg S.
-
31.
Cass. 1re civ., 12 janv. 2012, n° 11-17510 : D. 2012, p. 2277, note Bacache M. ; JCP G 2012, 1036, note Sargos P. ; RTD civ. 2012, p. 737, obs. Jourdain P. ; D. 2013, p. 40, obs. Gout O.
-
32.
La Cour de cassation adopte ainsi une jurisprudence tout à fait similaire avec celle retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 10 octobre 2012, n° 350426 : D. 2012, p. 2518, obs. Poupeau D. ; D. 2013, p. 40, obs. Gout O., AJDA 2012, p. 2231, note Lantero C., RDSS 2013, p. 92, note Cristol D., RCA 2012, comm. 351, obs. Bloch L. Dans cette décision, le Conseil d’État a considéré « qu’indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a pu subir du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles ».
-
33.
Bascoulergue A., note préc.
-
34.
Leveneur L., « D’importantes précisions sur le préjudice causé par le manquement du médecin à son devoir d’information », Contats, conc. consom. 2014, comm. 86.
-
35.
Bascoulergue A., note préc.
-
36.
Viney G., « L’indemnisation due en cas de manquement par le médecin à son devoir d’information », JCP G 2014, 553.
-
37.
Hocquet-Berg S., « Obligation d’information : préjudices réparables en cas de non-respect », RCA 2017, comm. 115. L’auteur relève qu’en l’espèce, la cour d’appel de Rennes a alloué à la victime la somme de 5 000 € au titre du préjudice d’impréparation alors que la somme allouée au titre d’une perte de chance de 50 % est de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
-
38.
V° Alt-Maes F., « La réparation du défaut d’information médicale. Métamorphoses et effets pervers », JCP G 2013, 547.
-
39.
Knetsch J., « La désintégration du préjudice moral », D. 2015, p. 413.
-
40.
Traité des obligations en général, t. V, 1925, Rousseau, § 1237. Adde Bellissent J., Contribution à l’analyse de la distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, Thèse Montpellier I 1999, préf. Cabrillac R., t. 354, 2001, LGDJ, coll. BDP.
-
41.
V. Jourdain P., « Quel avenir pour la distinction des obligations de résultat et de moyens ? », JCP G 2016, 909. Si la distinction est absente du projet de loi du 13 mars 2017, elle l’était tout autant de l’avant-projet de réforme du 29 avril 2016. Selon l’auteur, « la distinction occupe aujourd’hui une place essentielle dans notre droit de la responsabilité. Elle correspond à une réalité psychologique évidente car on ne peut contester que les obligations ont des contenus variables et impliquent pour les débiteurs des efforts d’intensité différente ».
-
42.
Contrats, conc. consom. 2017, comm. 70, obs. Leveneur L.
-
43.
Devenu 1231-1 depuis la réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
-
44.
Sur cette évolution, V. Becqué J., La protection de la victime d’un dommage corporel et de ses proches dans le cadre contractuel, Thèse, 1943, Montpellier, Quillet A.
-
45.
Cass. civ., 21 nov. 1911 : DP 1913, 1, 249, note Sarrut L. ; S. 1912, 1, 73, note Lyon-Caen C.
-
46.
Comme par exemple le transporteur en autocar (V. Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n° 14-13423), l’exploitant d’un télésiège (V. Cass. 1re civ., 11 juin 2002, n° 00-10415 : JCP G 2003, I, 152, n° 13, obs. Viney G. ; Contrats, conc. consom. 2002, comm. 154, obs. Leveneur L.) ou encore l’exploitant d’un manège d’auto-tamponneuses (V. Cass. 1re civ., 12 févr. 1975 : D. 1975, p. 512, note Le Tourneau P.).
-
47.
V. Bénabent A., Droit des obligations, 15e éd., 2016, LGDJ, nos 408 et s.
-
48.
Dans une foule d’exemples jurisprudentiels, et pour en rester sur des décisions récentes, l’exploitant d’une salle de « laser game » est également tenu d’une obligation de moyens, au regard du rôle actif du créancier. V. Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-17813 : Contrats, conc. consom. 2016, comm. 2. Au contraire, dès que ce rôle actif disparaît, l’obligation est classiquement qualifiée de résultat. V. pour l’exploitant d’une activité de saut à l’élastique, Cass. 1re civ., 30 nov. 2016, n° 15-25249 : Contrats, conc. consom. 2017, comm. 31.
-
49.
Selon les rouages généraux de la responsabilité du fait des choses, la victime d’une chose doit prouver la présence d’une chose, le fait de la chose et la détermination de son gardien. Hors l’hypothèse d’une chose inerte, qui impose la démonstration de l’anormalité de la chose, tout élément subjectif est donc éliminé du débat.
-
50.
La faute du conducteur n’est pas une condition de mise en œuvre de la loi Badinter du 5 juillet 1985.
-
51.
V. Brun P., Responsabilité civile extracontractuelle, 4e éd., 2016, LexisNexis, nos 9 et s.
-
52.
V. Jourdain P., « L’obligation de sécurité (à propos de quelques arrêts récents) », Gaz. Pal. Rec. 1993, 2, p. 1171.
-
53.
V. Viney G., Introduction à la responsabilité, 3e éd., 2008, LGDJ, n° 166-13.
-
54.
Art. 1233-1, al. 1er, du projet de loi. À la différence de l’avant-projet de réforme du 29 avril 2016, qui proposait déjà une telle exclusion du dommage corporel de la sphère contractuelle, le projet de loi du 13 mars 2017 précise qu’exceptionnellement, la victime d’un dommage corporel en matière contractuelle pourrait continuer à opter pour la voie contractuelle afin d’être indemnisée, si les stipulations du contrat lui sont plus favorables (art. 1233-1, al. 2, du projet de loi). Sur ce point, v. Knetsch J., « Le traitement préférentiel du dommage corporel », JCP G 2016, suppl. aux nos 30-35, p. 9.
-
55.
Sur lequel, V. Borghetti J.-S., « L’articulation des responsabilités contractuelle et extracontractuelle », JCP G 2016, suppl. au n° 30-35, p. 15.
-
56.
Outre cette décontractualisation, le dommage corporel permettrait une élévation du seuil de la faute de la victime, cette faute devant apparaître lourde pour entraîner une exonération partielle (art. 1254, al. 2). Il resterait en outre étanche à l’apparition proposée de l’obligation de minimiser le dommage (art. 1263).
-
57.
L’article 1240 du Code civil ne fait que reprendre le texte de l’ancien article 1382 du même code, suite à la réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016.
-
58.
Art. 1245, al. 2.
-
59.
V. Viney G., Introduction à la responsabilité, op. cit., nos 49 et s.
-
60.
Cass. civ., 16 juin 1896 : DP 1897, I, p. 433, note Sasleilles R. ; S. 1897, I, p. 17, note Esmein P.
-
61.
Sans doute aurait-il été pertinent de prévoir, dans la même veine, des règles particulières applicables aux transformations contemporaines de l’organisation des entreprises. V. Viney G., « Après la réforme du contrat, la nécessaire réforme des textes du Code civil relatifs à la responsabilité », JCP G 2016, 99, nos 40 et s.
-
62.
V. Starck B., Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée, Thèse, 1947, Paris, spéc. p. 79 et s.
-
63.
V. Radé C., « Plaidoyer en faveur d’une réforme de la responsabilité civile », D. 2003, p. 2247.
-
64.
À raisonner uniquement sur le consentement des parties au contrat, l’on peut en effet considérer, pour reprendre les faits, que le client de la salle d’escalade a donné son consentement à y accéder dans la mesure où il estimait que le débiteur était en mesure de répondre aux risques inhérents à cette activité ; ce qui pourrait alors justifier la généralisation de l’obligation de résultat sitôt venue la question de la qualification d’une obligation de sécurité. Dans le même sens, V. Jourdain P., « L’obligation de sécurité (à propos de quelques arrêts récents) », préc., spéc. p. 1176.
-
65.
CA Toulouse, 26 juin 2015, n° 13/02157.
-
66.
Dejean de La Bâtie A., « “Avoir autorité” ou de l’art d’être un bon manager », CLCE, n° 80, p. 14.
-
67.
Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43914 : RJS 8-9/06, n° 916.
-
68.
Pour un ex. récent : Cass. soc., 8 juin 2017, n° 16-10463, D.
-
69.
Cass. soc., 10 nov. 2009, n° 07-45321 : RJS 2010, n° 8.
-
70.
Cass. soc., 10 mai 2016, n° 14-27716, D.
-
71.
Cass. soc., 13 juill. 2016, n° 15-16458, D.
-
72.
Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-17491, D.
-
73.
Cass. soc., 19 janv. 2010, n° 08-42260, D.
-
74.
Cass. soc., 22 oct. 2014, n° 13-18862 : JCP S. 2015, 1015, note Leborgne-Ingelaere C.
-
75.
Le Conseil d’État a quant à lui admis le licenciement d’un directeur de la culture en raison de son insuffisante compétence managériale susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service public, malgré ses compétences techniques qui n’étaient pas contestées : CE, 20 mai 2016, n° 387105, Communauté de Strasbourg.
-
76.
Cass. soc., 2 juin 2017, n° 16-13134, D.
-
77.
V. pour ex. : Cass. soc., 17 mai 2017, n° 15-20094, PB ; Cass. soc., 16 nov. 2016, n° 15-23713, D ; Cass. soc., 4 mars 2015, n° 13-26945, D.
-
78.
Serait sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute alors que les actes prétendument fautifs ne révèleraient que l’incompétence du salarié, ou à l’inverse, le licenciement pour insuffisance professionnelle que l’employeur ne pourrait étayer que par des actes fautifs.
-
79.
Cass. soc., 22 juin 2011, n° 10-10945, D ; Cass. soc., 31 mai 2017, n° 15-19425, D.
-
80.
Pour un ex., v. : Cass. soc., 31 mai 2017, préc.
-
81.
En revanche, à la suite d’un arrêt du Conseil d’État du 18 janvier 2017 (n° 390396), devrait être abandonnée l’obligation de reclassement du salarié protégé licencié pour insuffisance professionnelle, cette décision énonçant « qu’aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n’impose de chercher à reclasser sur d’autres fonctions un fonctionnaire qui ne parvient pas à exercer celles qui correspondent à son grade ou pour lesquelles il a été engagé ».
-
82.
Lokiec P., « Le licenciement pour insuffisance professionnelle », Dr. soc. 2014, p. 38.
-
83.
C. trav., art. L. 4121-1.
-
84.
C. trav., art. L. 4122-1.
-
85.
Not. Cass. soc., 4 oct. 2011, n° 10-18862, PB, qui vise le « manquement du salarié à son obligation de ne pas mettre en danger, dans l’enceinte de l’entreprise, d’autres membres du personnel ».
-
86.
V. propos introductif.
-
87.
CA Toulouse 26 juin 2015, préc.
-
88.
Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-24406, D.
-
89.
De même appartient-il à un directeur technique chargé de la mise en place et de la gestion de l’ensemble des sites de la société de contrôler le respect des règles d’hygiène et de sécurité élémentaires et de signaler au directeur général les anomalies et dysfonctionnements qu’il lui revenait de constater dans le cadre de ses attributions contractuelles ; à défaut, il manque à son obligation de sécurité qui le contraignait donc à une obligation d’alerte : Cass. soc., 17 mars 2010, n° 08-43233, D.
-
90.
Cass. soc., 30 sept. 2005, n° 04-40625 : JCP E 2006, 1632, note Brissy S.
-
91.
Brissy S., note ss Cass. soc., 30 sept. 2005, n° 04-40625, préc. ; Savatier J., obs. ss Cass. soc., 30 sept. 2005, n° 04-40625 ; Dr. soc., 2006, p. 102.
-
92.
V. les moyens annexés : Cass. soc., 8 juin 2017, n° 16-10463, préc. ; Cass. soc., 31 mai 2017, n° 15-27790, préc. ; Cass. soc., 31 mai 2017, n° 15-27790, D. La cour d’appel de Toulouse dans l’affaire déjà évoquée du directeur de magasin Auchan a quant à elle visé pour reconnaître la faute grave du salarié justifiant son licenciement, notamment « les risques auxquels il a exposé son employeur » (CA Toulouse, 26 juin 2015, n° 13/02157, préc.).
-
93.
CA Toulouse, 14 févr. 2013, n° 11/01525 : « L’employeur apporte donc la preuve d’un comportement managérial inadapté de la part de M. L. ayant conduit à un stress excessif et à un découragement de ses collaborateurs, ce qui caractérise une insuffisance professionnelle, même si par ailleurs il avait de bons résultats en termes de chiffres d’affaires. Les premiers juges ont à juste titre relevé que, l’employeur étant tenu d’une obligation de sécurité de résultat quant à la sécurité et à la santé de ses salariés sur le plan physique et moral, il est fondé à licencier un manager qui exerce son pouvoir avec un autoritarisme excessif au point de déstabiliser les membres de son équipe ».
-
94.
Y est précisé que l’obligation de sécurité mise à la charge du salarié est « sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur ».
-
95.
Cass. soc., 13 juill. 2016, n° 15-16458, D.
-
96.
Il est vrai que le juge, dans les hypothèses de pratiques managériales les plus agressives, semble peu enclin à « trouver des excuses » au comportement du salarié. La grande ancienneté du salarié, particulièrement, n’a que peu d’impact (Cass. soc., 13 juill. 2016, n° 15-16458, préc. ; Cass. soc., 19 janv. 2010, n° 08-42260, D). Mais La Cour de cassation a déjà admis qu’un management constitutif de harcèlement moral, pouvait justifier un licenciement sans constituer une faute grave, le comportement du salarié résultant du harcèlement dont il avait lui-même été victime alors que l’employeur alerté de la situation n’avait rien fait : Cass. soc., 29 janv. 2013, n° 11-23944, D.
-
97.
Cass. soc., 29 févr. 2012, n° 10-20459, D, s’agissant d’une employée administrative licenciée pour faute grave en raison du « mauvais coaching de ses collègues et non-respect de leurs personnes » qui, malgré ses propos pourtant inacceptables à l’égard de ses collègues et la répartition inéquitable du travail à l’origine d’une ambiance tendue et malsaine ne pouvait se voir reprocher une faute grave dès lors qu’elle n’avait bénéficié d’aucune formation particulière ce qui l’avait placée face à des difficultés connues de l’employeur.
-
98.
Rappelons que le fait de remédier à la situation ne prémunira pas l’employeur de toute condamnation : à défaut d’avoir mis en œuvre les mesures de prévention nécessaires conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, et spécialement en l’absence de formation du manager, sa responsabilité pourra être engagée par les collaborateurs victimes du comportement managérial pathogène. Ceux-ci devront cependant établir leur préjudice pour prétendre à des dommages et intérêts, la Cour de cassation ayant récemment abandonné la théorie du préjudice nécessaire y compris en cas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc., 23 mai 2017, n° 15-26941, PB).
-
99.
Cass. soc., 19 janv. 2017, n° 15-24603, D.
-
100.
La référence par la Cour de cassation à l’obligation de sécurité de l’employeur est d’autant plus remarquable que les juges du fond avaient pris la précaution dans leur arrêt de préciser que l’agressivité et les menaces du salarié constituaient à elles seules la faute grave. Les faits reprochés au salarié étant en soi, sans trop de contestation, de nature à caractériser une faute grave, la Cour de cassation aurait tout aussi bien pu se passer de toute référence à l’obligation de sécurité de l’employeur.