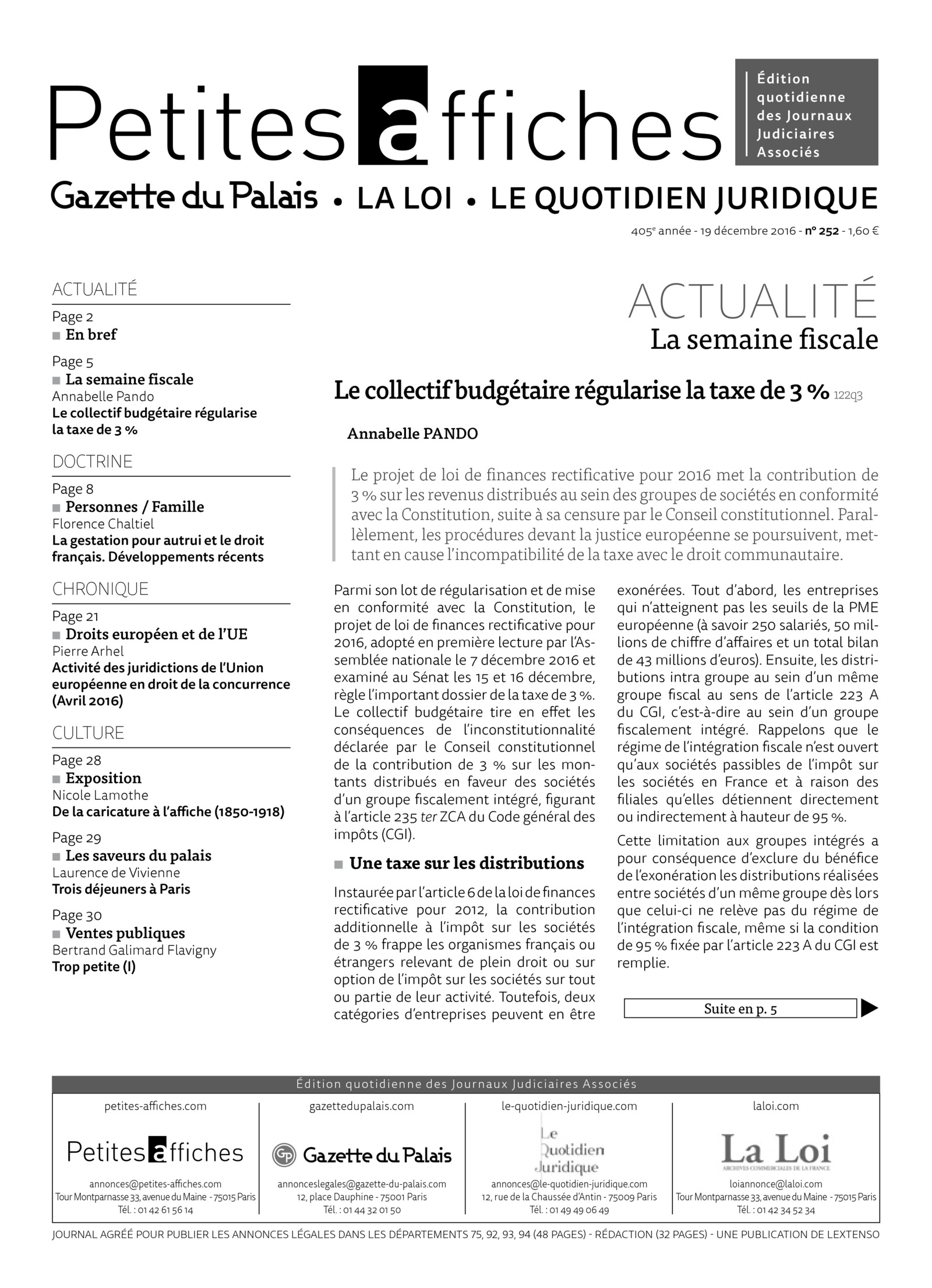La gestation pour autrui et le droit français. Développements récents
Alors que les débats sur la gestation pour autrui, suite aux évolutions jurisprudentielles de la Cour de cassation, se poursuivent, deux décisions récentes, l’une de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’autre du Conseil d’État, apportent de nouvelles pierres au débat, et invitent à poursuivre la réflexion, afin d’apporter la meilleure sécurité juridique aux enfants issus de ce processus qui demeure interdit légalement en France.
Nous avions terminé un précédent propos sur la GPA par ces mots de Hannah Arendt, selon laquelle, l’homme ayant ainsi accédé à la maturité « a fini par en vouloir à tout ce qui est donné, même sa propre existence – à vouloir au fait même qu’il n’est pas son propre créateur ni celui de l’Univers. Animé par ce ressentiment fondamental, il refuse de percevoir rime ou raison dans le monde donné. Toutes les lois simplement données à lui suscitant son ressentiment, il proclame ouvertement que tout est permis et croit secrètement que tout est possible »1. C’est que les débats, jurisprudences et perspectives d’évolutions consécutives sont si denses qu’il importe de donner des éléments précis sur les tenants et aboutissants d’une question juridiquement complexe, éthiquement complète.
Ce qui reste, pour le moment et par-delà les évolutions jurisprudentielles, qu’elles soient supranationales ou nationales, est le principe. La loi française interdit la gestation pour autrui (GPA). Si les bases juridiques prohibitionnistes et la jurisprudence maintiennent le principe (I), les récentes condamnations par la Cour européenne des droits de l’Homme (II), obligent à une réflexion encore approfondie et à une prudence jurisprudentielle (III).
I – Le principe national d’interdiction de la GPA confirmé par la jurisprudence
Le principe général de l’interdiction (A) est confirmé par la jurisprudence sur la longue période (B), même si la Cour de cassation a dû apporter des précisions suite aux jurisprudences européennes (C).
A – Un principe général d’interdiction de la GPA
La Cour de cassation, avant même que ne s’animent davantage les débats sur le sujet, a jugé nulle, en raison de l’illicéité de son objet, la constitution d’une association dont l’objet était de favoriser la conclusion et l’exécution de conventions de mères porteuses2. En 1991, l’Assemblée plénière a jugé, à l’occasion d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi, impossible de prononcer une adoption plénière par la mère d’intention dans le cas où l’enfant est né après un contrat de GPA, au motif que le processus d’ensemble dont cette adoption était l’aboutissement contrevient au principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain et de l’indisponibilité de l’état des personnes3.
La loi bioéthique du 29 juillet 19944 pose une interdiction de la GPA, qui a été inscrite dans le Code civil. L’article 16-7 de ce code dispose que : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». L’article 16-9 précise que cette disposition est d’ordre public. Le législateur a assorti cette interdiction de sanctions pénales. Ainsi, l’article 227-12 du Code pénal dispose qu’est puni d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende « le fait de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. », étant précisé que, toujours selon le Code pénal, d’une part « lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double », et que « la simple tentative de commettre cette infraction est punie des mêmes peines ». Ces dispositions ne concernent que les hypothèses dans lesquelles l’un au moins des faits constitutifs de l’infraction a été commis sur le territoire français, ce qui explique que des Français désireux de recourir à la GPA se soient rendus à l’étranger, dans des pays où le recours à ce procédé est soit autorisé, soit toléré, avec un encadrement juridique et éthique pour le moins variable.
B – Un principe retenu par la jurisprudence sur la longue période
La Cour de cassation a développé une jurisprudence stricte, tirant toutes les conséquences du caractère d’ordre public de l’interdiction législative, et n’admettant aucune manœuvre de contournement de cette interdiction, pour la mère d’intention d’établir un lien de filiation avec l’enfant né d’une GPA5. Elle a ensuite jugé que le ministère public pouvait agir pour défendre l’ordre public et contester la transcription à l’état civil de Nantes d’enfants nés à l’étranger à la suite d’une convention de GPA, en dépit des actes d’état civil dressés à l’étranger6.
La Cour de cassation a ensuite, par trois arrêts du 6 avril 2011, largement commentés7, jugé justifié le refus de transcription d’un acte de naissance établi en exécution d’une décision étrangère contraire à l’ordre public international français, lorsqu’elle comporte des dispositions qui heurtent les principes essentiels du droit français, comme c’est le cas pour les conventions de gestation pour autrui dès lors que, « en l’état du droit positif, il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du Code civil »8.
Elle a, à cette occasion, également précisé que cette contrariété à l’ordre public international français fait, de même, obstacle aux effets en France d’une possession d’état invoquée pour l’établissement de la filiation en conséquence d’une convention de gestation pour autrui9 en 2013, dans une hypothèse différente où, cette fois, l’acte civil, indien, dont la transcription était demandée correspondait à la réalité biologique, la Cour de cassation a jugé qu’est justifié le refus de transcription au motif que la naissance est l’aboutissement d’une gestation pour autrui, en fraude à la loi française, quand bien même la convention de gestation pour autrui serait licite dans le pays considéré10. Dans ces deux arrêts, fondés sur un terrain différent de ceux de 2011, la Cour de cassation précise qu’en présence de cette fraude, ni l’article 3, § 1 de la convention de New York, ni l’article 8 de la Convention EDH ne sauraient être utilement invoqués. Par un arrêt du 19 mars 2014 (n° 13-50005), la Cour de cassation a réitéré sa jurisprudence, bien que son avocat général l’ait appelée à ne pas écarter, pour ce faire, comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention EDH. La jurisprudence de la Cour de cassation peut ainsi être regardée comme ayant absolument refusé, au nom de l’ordre public et du caractère essentiel des principes en cause pour le droit français, de donner, fût-ce au nom de l’intérêt de l’enfant, un quelconque début de prise à une logique du fait accompli11.
Le Conseil d’État, quant à lui, n’a jamais écarté comme inopérant un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention EDH ou de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant au motif qu’une fraude avait été commise, ce qui ne signifie pas que le Conseil d’État n’en tient pas compte dans la balance qu’il opère au titre de l’examen de conventionalité sur cet article. La Cour de cassation n’a jamais été conduite à se prononcer sur la question spécifique de la délivrance d’un certificat de nationalité, qui a fait l’objet d’une saisine du Conseil d’État12.
La question de la légalité de la circulaire relative aux conditions de délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger de Français13 a ainsi fait l’objet d’une décision du Conseil d’État en 2014.
Adressée aux procureurs généraux, aux procureurs de la République et aux greffiers en chef des tribunaux d’instance, cette circulaire est relative aux conditions de délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger de Français « lorsqu’il apparaît, avec suffisamment de vraisemblance, qu’il a été fait recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui ». Elle demande à ses destinataires de veiller « à ce qu’il soit fait droit » aux demandes de certificat, sous réserve que les autres conditions rappelées par la circulaire du 5 mai 1995 relative à la délivrance des certificats de nationalité française soient remplies, « dès lors que le lien de filiation avec un Français résulte d’un acte d’état-civil étranger probant au regard de l’article 47 du Code civil ». Elle précise que « le seul soupçon du recours à une telle convention conclue à l’étranger ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de certificats de nationalité française dès lors que les actes d’état civil local attestant du lien de filiation avec un Français, légalisés ou apostillés sauf dispositions conventionnelles contraires, sont probants au sens de l’article 47 ».
La question de la légalité de la circulaire ne semblait pas aller de soi14. Le certificat de nationalité est régi par les articles 31 à 31-3 du Code civil. Il est délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance à toute personne qui justifie avoir la nationalité française (art. 31). Il constitue un mode de preuve de la nationalité, celui qui détient un certificat étant présumé Français jusqu’à preuve contraire (2e phrase du 1er alinéa de l’article 31-2). L’autorité qui délivre le certificat de nationalité française agit comme autorité administrative, avec un recours administratif possible devant le ministre de la Justice (v. C. civ., art. 31-3). Or depuis un arrêt de Section du 17 mars 199515, qui est revenue sur une jurisprudence du 25 juillet 1975, Dame Cottereau, (p. 442), le contentieux des refus de certificat de nationalité est entièrement judiciaire, même pour son versant indemnitaire.
La circulaire contestée admet donc que le recours à la GPA à l’étranger pourrait conduire à des actes d’état civils probants au sens de l’article 47 du Code civil. L’article 47 traite de la force juridique des actes d’état civil établis à l’étranger. Entre 1962 et 2003, il se bornait à dire que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s’il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays ». La formulation a été renforcée par la loi du 26 novembre 2003 de maîtrise de l’immigration, pour dire désormais : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Ce sont des motifs de lutte contre la fraude documentaire et de maîtrise de l’immigration qui ont conduit à ces modifications.
Toute l’ambiguïté est que, selon les démarches individuelles, les cadres juridiques locaux et les pratiques institutionnelles réelles, l’article 47 a pour conséquence qu’au moins certains actes de naissance d’enfants nés de GPA à l’étranger pourraient ne pas être probants au sens de l’article 47, notamment au regard de l’exigence que les fait déclarés correspondent à la réalité. La CEDH, lorsque la question a été abordée devant elle, n’a pas manqué de relever la difficulté. Le Gouvernement, en défense, faisait valoir que les enfants nés de GPA pouvaient obtenir un certificat de nationalité, en mettant en avant la circulaire. Elle apporte alors les éléments suivants : « La Cour note cependant que des interrogations subsistent quant à cette possibilité. En premier lieu, elle observe qu’aux termes mêmes du texte ainsi invoqué, la nationalité française est attribuée à raison de celle de l’un ou l’autre parent. Or elle constate que la détermination juridique des parents est précisément au cœur de la requête qui lui est soumise. Ainsi, à la lecture des observations des requérants et des réponses du Gouvernement, il apparaît que les règles de droit international privé rendent en l’espèce particulièrement complexe, voire aléatoire, le recours à l’article 18 du Code civil pour établir la nationalité française des troisième et quatrième requérantes. En second lieu, la Cour note que le Gouvernement tire argument de l’article 47 du Code civil. (…). Se pose donc la question de savoir si un tel cas d’exclusion est constitué lorsque, comme en l’espèce, il a été constaté que les enfants concernés sont issus d’une gestation pour autrui obtenue à l’étranger, ce que la Cour de cassation analyse en une fraude à la loi. Or, bien qu’invité par le président à répondre à cette question et à préciser s’il existait un risque qu’un certificat de nationalité ainsi établi soit ensuite contesté et annulé ou retiré, le Gouvernement n’a fourni aucune indication »16.
Or selon la jurisprudence Duvignères17, une circulaire est illégale si, dans le silence des textes, elle fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence ou d’une autre illégalité (invoquée) ou si elle prescrit d’adopter une interprétation qui méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu’elle entendait expliciter, ou qui réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure. Dans le cas de la circulaire en question, la question du cadre juridique dessiné par la Cour européenne des droits de l’Homme est décisif. Elle a en effet jugé que le droit de l’enfant au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8, était méconnu par le refus de la reconnaissance et de l’établissement de sa filiation en droit interne à l’égard de son père biologique. Elle a dans cette mesure remis en cause la portée absolue que la jurisprudence de la Cour de cassation avait conférée aux articles 16-7 et 16-9 du Code civil. Et dès lors qu’un lien de filiation avec un parent français ne peut être refusé, l’article 18 du Code civil selon lequel « Est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est Français » a pour effet que la nationalité française de cet enfant ne peut lui être déniée. La circulaire apparaissait alors conforme à cette ligne18. Ainsi, la Cour européenne des droits de l’Homme juge contraire à la Convention de refuser la transcription du lien de filiation lui-même, il serait également contraire à cette même Convention de refuser d’en tirer les conséquences qui s’imposent en termes de nationalité, étant souligné encore une fois que la nationalité ne concerne que les enfants, et non les parents, et qu’elle n’a aucun effet recognitif quant à la filiation.
C’est au regard de cette série de raisons que le Conseil d’État estime alors que si la circulaire attaquée prescrit à ses destinataires, notamment les greffiers en chef des tribunaux d’instance qui ont, en vertu de l’article 31 du Code civil, qualité pour délivrer des certificats de nationalité française, de veiller à ce qu’il soit fait droit aux demandes de certificat de nationalité française présentées pour des enfants nés à l’étranger de Français, elle subordonne expressément la délivrance de tels certificats au respect des conditions mises par la loi à cette délivrance, en particulier celle tenant à ce que, pour l’application de l’article 18 du Code civil, un lien de filiation de l’enfant avec un Français soit établi ; qu’en indiquant, en ce qui concerne la seule délivrance d’un certificat de nationalité, que doit être tenu pour établi un lien de filiation attesté par un acte d’état civil étranger dans les cas où, conformément à l’article 47 du Code civil, un tel acte fait foi, la circulaire attaquée s’est bornée à rappeler les dispositions de cet article. Il juge aussi que la circulaire attaquée ne méconnaît ni le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation, ni les stipulations du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, non plus que celles de la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ; qu’elle ne porte pas atteinte à l’exercice par l’autorité judiciaire de ses compétences. Enfin, il juge la circulaire attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’application du second alinéa de l’article 40 du Code de procédure pénale, selon lequel : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». La circulaire est donc jugée légale par le Conseil d’État.
Depuis cette jurisprudence qui laisse des portes ouvertes sans résoudre, loin s’en faut, puisqu’elles n’étaient, en l’espèce pas posées, toutes les questions relatives aux conséquences à tirer de gestation pour autrui, réalisées hors de France, une fois les familles de nouveau établies sur le sol français, de nouvelles précisions jurisprudentielles ont pu être apportées.
C – Les nouvelles précisions apportées récemment par la Cour de cassation
Saisie par les questions des cours d’appel de Poitiers et d’Avignon, la Cour de cassation a tranché la question de droit en utilisant, comme élément majeur de son raisonnement, l’adoption. Pour rechercher s’il y a fraude à la loi, le juge doit distinguer ce qui relève de la forme d’une part et du fond d’autre part. Or se fondant notamment tant sur la conception de l’intérêt de l’enfant qu’a développé la Cour européenne des droits de l’Homme que sur les débats parlementaires d’élaboration de la loi ouvrant le mariage aux couples homosexuels, l’avocat général a reformulé la question de telle manière qu’elle permette « de clarifier les conditions de l’accès à la seule filiation adoptive des couples de même sexe » et non de trancher un débat de bioéthique. Est ainsi en question l’adoption et non la procréation médicalement assistée, ce qui dirige nécessairement la réponse du juge en faveur de l’adoption.
En effet, et comme le relève l’avocat général dans ses conclusions, l’enjeu de l’adoption est le lien entre l’enfant et ses parents. L’adoption plénière en particulier est un sujet sensible puisqu’elle entraîne la rupture du lien avec les parents biologiques. Le législateur ayant autorisé les couples homosexuels à adopter, peu importe alors le mode de conception de l’enfant. Dans les faits, seuls les couples de femmes pourront adopter dans ces conditions, c’est-à-dire qu’une femme adoptera l’enfant biologique de son épouse, comme cela est déjà possible hors procréation médicalement assistée. En effet, le cas où l’adoption par le conjoint du père d’un enfant conçu par PMA s’analyse comme une gestation pour autrui, opération juridique qui est elle interdite par un principe d’ordre public en droit international.
La portée de cet avis est toutefois plus limitée qu’elle n’y paraît19.
Sur le plan processuel tout d’abord, car un avis n’a pas à être suivi par les juridictions du fond. Non revêtue de l’autorité de la chose jugée, la position exprimée le 23 septembre peut être contestée à l’occasion d’un pourvoi en cassation. La composition de la formation statuant sur un avis laisse toutefois peu de chance à une telle tentative. Ce sont en effet le premier président de la Cour, avec pour assesseurs les présidents des chambres et deux conseillers désignés par chambre, qui y siègent. Sur le fond, si la fraude à la loi concernant l’adoption semble être écartée, cela n’est le cas qu’en matière internationale. Le droit de la santé français interdit toujours aux couples homosexuels féminins de recourir à la PMA non seulement en raison de leur sexe mais également car seule une infertilité pathologique y ouvre droit. L’avis de la Cour de cassation est une preuve d’un certain courage, comme l’y invitait d’ailleurs son avocat général, pour unifier la jurisprudence et trancher une question juridique sensible. Pour trancher la question sur le plan sociétal, et donner les mêmes droits aux couples de femmes homosexuelles en France comme à l’étranger, l’intervention du législateur est inévitable.
Les arrêts du 3 juillet 2015 laissent en suspens la question de la filiation des parents d’intention, comme le précise d’ailleurs le communiqué de presse selon lequel « les espèces soumises à la Cour de cassation ne soulevaient pas la question de la transcription de la filiation établie à l’étranger à l’égard de parents d’intention : la Cour ne s’est donc pas prononcée sur ce cas de figure ». Il convient cependant de s’interroger sur les solutions pouvant être apportées à cette hypothèse après les arrêts de 2015, sachant que lorsque la GPA est commanditée par un couple, dont les membres sont donc les parents d’intention de l’enfant, la situation diffère du tout au tout selon qu’il s’agit de la filiation paternelle ou de la filiation maternelle20. S’agissant du père d’intention, sa qualité de père d’intention dans le processus de GPA n’est pas antinomique avec la qualité de père génétique, mais lorsque le père présente ces deux qualités, le fait d’être père biologique va primer et permettre la reconnaissance de la filiation paternelle comme ce fut le cas dans les affaires jugées par la Cour de cassation en 2015. Contrairement à ce qu’avait proposé le procureur général Jean-Claude Marin dans ses avis relatifs à ces arrêts, la Cour de cassation n’a pas choisi de faire dépendre la transcription de la preuve de la paternité biologique du père indiqué sur l’acte de naissance. La Cour de Strasbourg, dans l’arrêt Mennesson, a seulement exigé, au nom du droit à l’identité, la reconnaissance de la filiation de l’enfant à l’égard de son père biologique. A contrario, si le père indiqué dans l’acte de naissance n’est pas le géniteur de l’enfant, la transcription de la filiation sur les registres d’état civil ne constitue pas une nécessité au regard du droit européen.
La question de la filiation de la mère d’intention dans le cadre d’un processus de GPA constitue évidemment un problème majeur puisque même si on fait abstraction de la prohibition de la GPA, elle ne peut se voir appliquer les règles de droit français la concernant. La mère est, en effet, en droit français, celle qui accouche (C. civ., art. 325, al. 2), ce que la mère d’intention, par définition, ne fait pas. La réponse que ferait la Cour de cassation si l’acte de naissance avait indiqué une mère d’intention comme mère juridique de l’enfant ne peut être déduite des arrêts de 201521.
La prudence de la Cour de cassation et la référence marquée à la réalité des faits doivent être interprétées comme la volonté de ne pas aller plus loin dans la reconnaissance des effets de la GPA conclue à l’étranger. Cette voie étroite est également celle empruntée par la CEDH, qui dans l’arrêt Mennesson comme dans l’arrêt Paradiso et Campanelli22, a refusé de qualifier de violation du droit au respect de la vie familiale le défaut de reconnaissance de l’enfant à l’égard de ses parents d’intention. L’absence de reconnaissance de la filiation de l’enfant à l’égard de la mère d’intention, telle qu’établie par le droit étranger, s’inscrit dans la logique de la jurisprudence de la Cour européenne qui n’accepte d’imposer aux États la reconnaissance d’un lien de filiation que lorsqu’il est fondé sur un lien de sang.
II – Une nouvelle condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme : portée et enjeux
Le 21 juillet 2016, la Cour européenne des droits de l’Homme a en effet encore condamné la France au motif qu’elle n’a pas reconnu la filiation biologique vis-à-vis de leur père d’enfants nés d’une mère porteuse en Inde.
Reprenant l’argumentation de ces décisions Mennesson n° 65192/11 et Labassée n° 65941/11 du 26 juin 2014, la CEDH conclut qu’il n’y a « pas eu violation de l’article 8 de la Convention s’agissant du droit des requérants au respect de leur vie familiale, mais qu’il y a eu violation de cette disposition s’agissant du droit des deuxième, quatrième et cinquième requérants au respect de leur vie privée ».
La Cour européenne des droits de l’Homme était saisie des refus de transcrire des actes de naissance sur les registres de l’état civil français. La Cour de cassation avait estimé « qu’en l’état du droit positif, est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public ».
Le Cour rappelle en premier lieu que « par deux arrêts du 3 juillet 2015, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a, d’une part, cassé partiellement un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 15 avril 2014, qui refusait de faire droit à la transcription sur un registre consulaire de l’acte de naissance établi en Russie d’un enfant né dans ce pays d’une gestation pour autrui et, d’autre part, rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de cette même juridiction du 16 décembre 2014, qui faisait droit à une telle transcription ». La Cour de cassation a en particulier retenu dans le second de ces arrêts « qu’ayant constaté que l’acte de naissance n’était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, la cour d’appel en a[vait] déduit à bon droit que la convention de gestation pour autrui (…) ne faisait pas obstacle à la transcription de l’acte de naissance ».
Elle souligne également que le Conseil d’État, dans une décision du 12 décembre 2014, a rappelé que « les contrats de gestation ou de procréation pour autrui sont interdits par le Code civil et que cette interdiction est d’ordre public. Il juge cependant que la seule circonstance qu’un enfant soit né à l’étranger dans le cadre d’un tel contrat, même s’il est nul et non avenu au regard du droit français, ne peut conduire à priver cet enfant de la nationalité française ».
Pourtant, reprenant l’argumentation de ces décisions Mennesson n° 65192/11 et Labassée n° 65941/11 du 26 juin 2014, la CEDH conclut qu’il n’y a « pas eu violation de l’article 8 de la Convention s’agissant du droit des requérants au respect de leur vie familiale, mais qu’il y a eu violation de cette disposition s’agissant du droit des deuxième, quatrième et cinquième requérants au respect de leur vie privée »23.
Les affaires jugées par la CEDH sont celles de Philippe Bouvet, père de jumeaux nés en 2010 à Bombay d’une mère porteuse et de Didier Foulon, père d’une petite fille qui a vu le jour en 2009, dans une clinique de la même ville. Dans leur arrêt, les magistrats européens ont conclu à l’unanimité qu’il y avait eu violation du droit à la vie privée des enfants mais n’ont pas retenu de violation du droit des requérants au respect de leur vie familiale. La Cour européenne, comme en 2014, reconnaît par ailleurs le droit à la France de prohiber la GPA, comme c’est le cas actuellement avec des peines pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. Les réactions à ces jurisprudences sont souvent très hostiles. « On est train de retirer à la France le principal moyen de lutter contre la pratique des mères porteuses, avertit pour sa part Ludovine de La Rochère, présidente de La Manif pour tous. Après la reconnaissance du lien biologique avec le père, les tenants de la GPA vont tenter de faire reconnaître la filiation avec le parent d’intention. Le Gouvernement doit faire appel de cette décision afin de marquer son opposition à l’exploitation des femmes et au trafic d’enfants. Il ne faut pas oublier que la GPA, tout particulièrement en Inde où les femmes sont enfermées et maltraitées, est un trafic sordide ».
À la suite de la première condamnation de la France, comme nous l’avons rappelé plus haut, la Cour de cassation avait bouleversé sa jurisprudence, en juin 2015, en validant l’inscription à l’état civil de deux enfants nés d’une GPA en Russie. Mais, pour certaines affaires jugées avant ce revirement, l’incertitude demeure. Ainsi, dans l’affaire Mennesson, un livret de famille n’a toujours pas été délivré aux enfants. « Alors que les arrêts Mennesson et Labassée ont été très critiqués en France, ces deux nouveaux arrêts de la CEDH confirment que la France doit reconnaître légalement la filiation avec le parent biologique des enfants nés par GPA à l’étranger, selon certains commentateurs24. En creux, la Cour dit que les choses n’ont pas assez évolué en France, plus particulièrement pour les parents qui ont vu leur affaire jugée avant 2015. Le droit n’est pas clair en France sur la reconnaissance de la filiation dans les cas de GPA. Ce qui n’est pas très surprenant en l’absence de prise de position politique claire ».
Précisément, selon la Cour européenne des droits de l’Homme, dans ses décisions les plus récentes de l’été 2016, dans la version publique et définitive datant d’octobre 201625, la France méconnaît une nouvelle fois les obligations nées de son appartenance à la CEDH. À l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 9063/14 et 10410/14) dirigées contre la République française, dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La requête n° 9063/14 a été introduite le 24 janvier 2014 par un ressortissant français, Didier Foulon (« le premier requérant »), ainsi que par Émilie Sanja Lauriane Foulon (« la deuxième requérante »). La requête n° 10410/14 a été introduite le 29 janvier 2014 par un ressortissant français, Philippe Bouvet (« le troisième requérant »), ainsi que par Adrien Bouvet (« le quatrième requérant ») et Romain Bouvet (« le cinquième requérant »). La nationalité des deuxième, quatrième et cinquième requérants n’est pas précisée dans la requête. Les parties en présence s’opposaient selon les termes suivants. Selon les requérants, l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale qu’ils dénoncent ne poursuivait aucun des buts légitimes énumérés au second paragraphe de l’article 8, et qu’elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique. S’agissant de l’atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale, ils mettent l’accent sur le fait que les enfants soupçonnés d’être nés à l’étranger d’une gestation pour autrui sont confrontés à des obstacles concrets majeurs en raison de l’absence de reconnaissance en droit français de leur lien de filiation et se trouvent dans une situation juridique incertaine. Premièrement, les arrêts de la Cour de cassation du 3 juillet 2015 n’auraient pas levé les obstacles à la transcription de leurs actes de naissances étrangers, en raison notamment de l’attitude du parquet compétent. Deuxièmement, ils auraient les plus grandes difficultés à obtenir une carte d’identité ou un passeport français. Troisièmement, nombre d’entre eux ne parviendraient toujours pas à obtenir un certificat de nationalité, malgré la circulaire du 25 janvier 201326 et l’arrêt du Conseil d’État du 12 décembre 2014. Quatrièmement, les enfants ainsi que les parents d’intention seraient confrontés à des difficultés récurrentes devant toutes les administrations, qui réclameraient systématiquement un acte de naissance transcrit ou des documents non prévus par la loi, que ce soit pour les inscriptions à l’école, la perception de prestations sociales, l’inscription à la sécurité sociale ou pour l’obtention d’un congé parental. Cinquièmement, les parents d’intention rencontreraient de nombreuses difficultés quant à l’exercice de l’autorité parentale, et les droits successoraux des enfants à leur égard seraient amoindris. Les requérants observent que la cour d’appel et la Cour de cassation n’ont pris en compte ni leur situation concrète, ni les obstacles pratiques auxquels ils se trouvent confrontés, ni l’intérêt supérieur de l’enfant. S’agissant de l’atteinte à leur droit au respect de leur vie privée, les requérants renvoient aux conclusions de la Cour dans les affaires Mennesson et Labassée précitées. Ils font valoir que l’ingérence qu’ils dénoncent a pour effets : de nier la filiation des deuxième, quatrième et cinquième requérants valablement établie en Inde et de les priver de la possibilité de se voir reconnaître la nationalité française, d’hériter de leur père en l’absence de legs ou de testament ou d’hériter de lui dans les mêmes conditions qu’un enfant disposant d’un acte de naissance français, et d’établir la substance de leur identité ; de priver le premier requérant de la titularité de l’autorité parentale.
Les requérants rappellent ensuite que le Gouvernement a l’obligation de mettre fin à la violation de l’article 8 de la Convention, qui ne cessera selon eux que lorsque les actes de naissance des deuxième, quatrième et cinquième d’entre eux seront transcrits et que l’annulation de la reconnaissance de paternité du premier d’entre eux sera privée d’effet. Ils soulignent que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, l’autorité de la chose jugée n’y fait pas obstacle. Enfin, les troisième, quatrième et cinquième requérants contestent la thèse du Gouvernement selon laquelle, si l’autorité de la chose jugée fait obstacle à la transcription des actes de naissance des quatrième et cinquième d’entre eux, elle n’empêche pas de faire établir leur lien de filiation par la reconnaissance de paternité ou la possession d’état. Sur le premier point, ils rappellent que le troisième requérant a déjà fait une reconnaissance de paternité (le 31 mars 2010), et soulignent que c’est l’acte de naissance qui établit la filiation, la reconnaissance de paternité ne faisant que renforcer cette filiation. Sur le second point, ils rappellent que la Cour de cassation a jugé le 6 avril 2011 que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes fait obstacle aux effets en France d’une possession d’état lorsque la filiation est la conséquence d’une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, fût-elle licitement conclue à l’étranger, en raison de la contrariété à l’ordre public international français d’une telle convention. Ils ajoutent qu’aux termes de l’article 311-2 du Code civil, la possession d’état doit être continue, paisible et non équivoque, et que la circulaire de présentation de l’ordonnance n° 759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, du 30 juin 2006, indique que le caractère équivoque peut notamment résulter d’une fraude ou d’une violation de la loi, ajoutant qu’il peut en aller ainsi lorsque la possession d’état est invoquée pour contourner les règles régissant la gestation pour le compte d’autrui. Les requérants précisent de plus que la possession d’état et la reconnaissance de paternité ne permettent pas à l’enfant de disposer d’un acte de naissance français.
Le Gouvernement déclare ne contester ni que les relations en cause relèvent de la vie privée et familiale, ni que le refus de procéder à la transcription des actes de naissance sur le registres de l’état civil et l’annulation de la reconnaissance de paternité puissent être regardés comme une ingérence dans la vie familiale. Notant par ailleurs que les requérants ne contestent pas que cette ingérence est prévue par la loi, il observe que la question qui se pose à la Cour est celle de la légitimité de l’ingérence et de sa proportionnalité par rapport aux buts poursuivis. Le Gouvernement souligne ensuite que, si la Cour de cassation a en l’espèce refusé la transcription des actes de naissance au motif que la convention de gestation pour autrui était entachée d’une nullité d’ordre public, elle a, le 3 juillet 2015, opéré un revirement de jurisprudence : en présence d’un acte étranger établi régulièrement selon le droit local et permettant d’établir le lien de filiation avec le père biologique, plus aucun obstacle ne peut être opposé à la transcription de la filiation biologique. Il indique que, le 7 juillet 2015, la garde des Sceaux a adressée aux parquets concernés une dépêche indiquant qu’il convenait de procéder à la transcription des actes de naissance étrangers des enfants nés à l’étranger d’une gestation pour autrui, sous réserve de leur conformité à l’article 47 du Code civil.
Le Gouvernement ajoute cependant que cette évolution jurisprudentielle ne peut s’appliquer aux demandes de transcription ayant déjà fait l’objet d’une décision juridictionnelles de refus ou d’annulation de transcription revêtues de l’autorité de la chose jugées, comme c’est le cas en l’espèce. Du fait de l’identité de cause et de parties, au sens de l’article 1351 du Code civil, une nouvelle demande de transcription se heurterait à l’autorité de la chose jugée, règle fondamentale de la procédure civile française, garante de sécurité juridique et d’une bonne administration de la justice en ce qu’elle réduit le risque de manœuvres dilatoires et favorise un jugement dans un délai raisonnable. Le Gouvernement précise toutefois que, à la suite du revirement de jurisprudence opéré le 3 juillet 2015 par la Cour de cassation, les troisième, quatrième et cinquième requérants ont la possibilité d’établir leur lien de filiation par la voie de la reconnaissance de paternité (C. civ., art. 316) ou de la possession d’état (C. civ., art. 317) ; selon lui, « ces voies juridiques paraissent aujourd’hui envisageables compte tenu des évolutions jurisprudentielles actuelles ». Cela ne serait en revanche pas possible pour les premier et deuxième requérants, l’autorité de la chose jugée de la décision relative à l’annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par le premier d’entre eux faisant obstacle à la mise en œuvre d’autres modalités d’établissement de la filiation biologique. En conclusion, le Gouvernement déclare réfléchir à la possibilité d’une procédure de révision en matière civile afin d’apporter une solution à ce type de situation27.
La Cour, dans un premier temps, rappelle les évolutions jurisprudentielles nationales suivantes. Elle note que la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué postérieurement à ces arrêts. Par deux arrêts du 3 juillet 2015, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a, d’une part, cassé partiellement un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 15 avril 2014, qui refusait de faire droit à la transcription sur un registre consulaire de l’acte de naissance établi en Russie d’un enfant né dans ce pays d’une gestation pour autrui et, d’autre part, rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de cette même juridiction du 16 décembre 2014, qui faisait droit à une telle transcription. La Cour de cassation a en particulier retenu dans le second de ces arrêts « qu’ayant constaté que l’acte de naissance n’était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, la cour d’appel en a[vait] déduit à bon droit que la convention de gestation pour autrui (…) ne faisait pas obstacle à la transcription de l’acte de naissance ».
La Cour rappelle la situation juridique française et ses évolutions. Ainsi, elle souligne que le 7 juillet 2015, le ministère de la Justice a diffusé une dépêche invitant le parquet général de Rennes à tirer les conséquences de ces arrêts en faisant procéder à la transcription des actes de naissance des enfants concernés, dès lors que leurs actes d’état civil étrangers sont conformes aux dispositions de l’article 47 du Code civil. Par ailleurs, elle souligne que par un arrêt du 12 décembre 2014, que nous avons étudié plus haut, le Conseil d’État avait rejeté les recours en annulation dirigés contre la circulaire adressée le 25 janvier 2013 par la garde des Sceaux aux procureurs généraux près les cours d’appel, au procureur près le tribunal supérieur d’appel, aux procureurs de la République et aux greffiers des tribunaux d’instance. Cette circulaire concerne la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger de parents français « lorsqu’il apparaît, avec suffisamment de vraisemblance qu’il a été fait recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui ». Elle indique que dans un tel cas, cette circonstance « ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de certificats de nationalité française », et invite ses destinataires à veiller à ce qu’il soit fait droit aux demandes de délivrance lorsque les conditions légales sont remplies28. Dans son arrêt, le Conseil d’État rappelle que les contrats de gestation ou de procréation pour autrui sont interdits par le Code civil et que cette interdiction est d’ordre public. Il juge cependant que la seule circonstance qu’un enfant soit né à l’étranger dans le cadre d’un tel contrat, même s’il est nul et non avenu au regard du droit français, ne peut conduire à priver cet enfant de la nationalité française. Il précise que cet enfant y a droit, dès lors que sa filiation avec un Français est légalement établie à l’étranger, en vertu de l’article 18 du Code civil et sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Il ajoute que le refus de reconnaître la nationalité française porterait dans de telles circonstances une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée de l’enfant, garantie par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales29.
La Cour constate que la situation des requérants en l’espèce est similaire à celle des requérants dans les affaires Mennesson et Labassée précitées, dans lesquelles elle a jugé qu’il n’y avait pas eu violation du droit au respect de la vie familiale des requérants (les parents d’intention et les enfants concernés), mais qu’il y avait eu violation du droit au respect de la vie privée des enfants concernés. La Cour prend bonne note des indications du Gouvernement selon lesquelles, postérieurement à l’introduction des présentes requêtes et au prononcé des arrêts Mennesson et Labassée précités, la Cour de cassation a, par deux arrêts du 3 juillet 2015, procédé à un revirement de jurisprudence. Selon le Gouvernement, il résulte de cette jurisprudence nouvelle qu’en présence d’un acte étranger établi régulièrement selon le droit du pays dans lequel la gestation pour autrui a été réalisée et permettant d’établir le lien de filiation avec le père biologique, plus aucun obstacle ne peut être opposé à la transcription de la filiation biologique. Il ajoute que, le 7 juillet 2015, la garde des Sceaux a adressée aux parquets concernés une dépêche indiquant qu’il convenait de procéder à la transcription des actes de naissance étrangers des enfants nés à l’étranger d’une gestation pour autrui, sous réserve de leur conformité à l’article 47 du Code civil. La Cour relève ensuite que le Gouvernement entend déduire de ce nouvel état du droit positif français que le troisième requérant et les quatrième et cinquième requérants ont désormais la possibilité d’établir leur lien de filiation par la voie de la reconnaissance de paternité ou par celle de la possession d’état ; il indique à cet égard que « ces voies juridiques paraissent aujourd’hui envisageables ». Elle relève toutefois le caractère hypothétique de la formule dont use le Gouvernement. Elle constate en outre que les intéressés contestent cette thèse et que le Gouvernement n’en tire lui-même aucune conclusion quant à la recevabilité ou au bien-fondé de leur requête. Ceci étant souligné, et considérant les circonstances de l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de conclure autrement que dans les affaires Mennesson et Labassée. La Cour conclut en conséquence qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention s’agissant du droit des requérants au respect de leur vie familiale, mais qu’il y a eu violation de cette disposition s’agissant du droit des deuxième, quatrième et cinquième requérants au respect de leur vie privée30.
III – Les perspectives et réflexions à poursuivre
L’intérêt supérieur de l’enfant et la position du juge des référés du Conseil d’État : appréciation au cas par cas.
Le Conseil d’État a déjà eu à se prononcer sur des questions liées à la gestation pour autrui. Une circulaire du ministre de la Justice a en effet été attaquée devant lui en 2014. La question posée était alors la suivante : dans le cadre de l’interdiction législative de la GPA, la ministre de la Justice pouvait-elle prescrire de traiter comme elle l’a fait les demandes de délivrance de certificat de nationalité pour des enfants dont il est vraisemblable de penser qu’ils sont nés à l’étranger par GPA ? Le soupçon d’un recours à la GPA par les parents doit-il entraîner le refus de reconnaître les enfants comme Français31 ?
Une ordonnance de référé rendue en août 2016, témoigne de nouveau de la complexité des enjeux. Mme A., ressortissante française, a demandé à l’ambassade de France en Arménie un laissez-passer consulaire pour lui permettre de regagner le territoire français en compagnie d’un enfant, né en Arménie le 24 juin 2016, et dont l’acte de naissance, établi par le service d’état civil arménien, indiquait qu’elle était sa mère. L’ambassade a refusé de délivrer le laissez-passer consulaire après avoir estimé que cette naissance résultait d’une convention de gestation pour autrui et que, dès lors, Mme A. ne pouvait être regardée comme mère de l’enfant.
Mme A. a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, par la procédure d’urgence dite du référé-liberté, pour qu’il ordonne la délivrance d’un document de voyage permettant l’entrée de l’enfant sur le territoire français. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la délivrance d’un laissez-passer consulaire par une ordonnance du 26 juillet 2016. Le ministre a fait appel de cette ordonnance devant le Conseil d’État.
La procédure du référé-liberté, prévue par l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.
Le juge des référés du Conseil d’État a d’abord constaté l’existence d’une telle situation d’urgence, dès lors que la requérante doit pouvoir revenir en France dans les plus brefs délais pour y exercer sa profession libérale et que son départ d’Arménie y laisserait l’enfant, âgé de six semaines, sans personne pour en assumer la charge.
Les parties s’opposent sur la nationalité française de l’enfant. Or, en principe, un laissez-passer consulaire est délivré à une personne démunie de titre de voyage après vérification de sa nationalité française. Dans ces conditions, le juge des référés du Conseil d’État a estimé que le litige soulevait une question sérieuse de nationalité qu’il n’appartient pas au juge administratif de trancher. Il a donc infirmé, sur ce point, l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris et a statué sans se prononcer sur la nationalité de l’enfant.
Pour ce faire, il a rappelé que l’Administration a toujours l’obligation, en vertu de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, d’accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. La circonstance que la conception de cet enfant aurait pour origine un contrat de gestation pour autrui entaché de nullité au regard de l’ordre public français est, à la supposer établie, sans incidence sur cette obligation.
En l’espèce, le juge des référés du Conseil d’État a relevé qu’il résulte de l’acte de naissance arménien, dont l’Administration ne conteste pas l’authenticité, que la requérante exerce l’autorité parentale sur l’enfant né le 24 juin dernier dont elle assume seule la charge. Il a réglé le litige au vu de cet élément de fait, sans se prononcer sur la question de la nationalité de l’enfant, qui relève de la seule autorité judiciaire.
Estimant que l’intérêt supérieur de l’enfant impliquait, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ne pas séparer l’enfant de la requérante, le juge des référés du Conseil d’État a enjoint au ministre des Affaires étrangères et du Développement international de délivrer, à titre provisoire, à l’enfant un document de voyage lui permettant d’entrer sur le territoire national en compagnie de Mme A. La solution retenue réserve donc entièrement la question de la filiation juridique entre la requérante et l’enfant ainsi que celle de la nationalité de ce dernier.
De ces développements, il ressort une évidence, celle de la complexité, qui n’est pas bonne conseillère de la loi. Car la loi, si elle prohibe, doit être respectueuse des règles supranationales, qui, elles-aussi, ne portent pas, de manière franche, condamnation de la prohibition, mais, impliquent, a minima, des aménagements à l’interdiction. Car l’internationalisation des échanges, des circulations et du droit, font que face à un enfant né d’une GPA, le procédé fût-il illégal en vertu de la loi française, le droit national doit considérer l’enfant dans sa plénitude de sujet de droit et garantir ces droits. Trouver l’équilibre entre le plein respect de ces droits et la nécessité de ne pas engendrer de mouvement incitatif au tourisme procréatif est un défi malaisé.
On le voit, le dialogue des juges se poursuit et la société se divise, avec des « pro » et des « anti ».
Les derniers développements en date montrent aussi des hésitations à l’échelle européenne. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe s’est ainsi prononcée le 11 octobre 2016 contre l’adoption d’une recommandation portant sur les « Droits de l’enfant liés à la maternité de substitution ». À l’issue d’un débat, le projet de texte, a été rejeté par 83 voix contre, 77 pour et 7 abstentions, sur un total de 167 suffrages exprimés.
La GPA avait déjà fait l’objet en septembre 2016 d’une résolution rejetée par la commission des questions sociales du Conseil de l’Europe, très divisée sur cette pratique. Avant ce nouveau vote, des partisans du maintien de la prohibition avaient appelé à rejeter ce texte ou à l’amender pour interdire la GPA sous toutes ses formes. Dans un communiqué le collectif souligne que « la maternité de substitution qu’elle soit qualifiée d’“altruiste”, de “commerciale”, légale ou non, est une atteinte aux droits de l’enfant qui est l’objet d’un contrat de vente ou de cession ».
L’auteure du rapport, la Belge Petra de Sutter, sénatrice socialiste et chef du service de médecine reproductive à l’hôpital universitaire de Gand, avait ainsi pourtant revu sa copie depuis un premier vote défavorable par la même commission, en mars dernier. Comme le permettent les règles du Conseil de l’Europe, les débats se sont tenus à huis clos et les textes n’ont pas été publiés avant le vote. Intitulée « L’intérêt de l’enfant dans la GPA commerciale », la résolution rejetée le 21 septembre 2016 souligne les problèmes inhérents au statut des enfants quand ces derniers naissent dans le cadre d’une GPA, « surtout lorsqu’elle est transfrontalière », précise Petra de Sutter32. Dans son premier rapport, celle-ci avait présenté un état des lieux de la GPA dans les pays du Conseil de l’Europe, qui pour certains l’autorisent (l’Ukraine), pour d’autres la tolèrent (la Belgique) et pour d’autres encore l’interdisent (la France). Elle y avait établi explicitement une distinction entre la GPA « commerciale » en la condamnant, et la GPA « altruiste », c’est-à-dire sans contrepartie financière pour la mère porteuse, en proposant de l’autoriser tout en la réservant aux seuls ressortissants du pays où elle se déroule. L’objectif est d’éviter le « tourisme procréatif ».
Ce premier rapport avait été rejeté en mars 2016, la notion de GPA « altruiste » étant loin de faire l’unanimité. Toute GPA est commerciale du point de vue de « No maternity traffic », coalition d’ONG considérant la GPA comme un trafic humain et réclamant son abolition sans condition par le Conseil de l’Europe. « Comme nous étions divisés sur la question de la GPA altruiste, j’ai enlevé cette notion de mon rapport pour ne mentionner que la GPA commerciale », explique Petra de Sutter. Pour autant, l’usage de l’adjectif « commerciale » a, du point de vue des opposants à la GPA, laissé planer le doute sur la possibilité d’une autre forme de GPA pouvant être acceptée.
Malgré le rejet de la résolution, le rapport de Petra de Sutter a donné lieu à une recommandation qui, elle, a été acceptée, par 17 voix contre 14. « Cette recommandation dit aux ministres des Affaires étrangères de mettre en place des lignes directrices sur la GPA », indique Petra de Sutter. Objectif : « sauvegarder les droits de l’enfant », précise un communiqué de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe publié après le vote.
Devant être discutée lors de la séance plénière, en octobre, la recommandation devait recevoir la majorité renforcée des deux tiers pour être adoptée.
Or si les textes adoptés par le Conseil de l’Europe ne sont pas contraignants, ceux-ci peuvent jouer un rôle de référence. « La valeur d’une résolution sur la GPA serait considérable car elle exprimerait une position théoriquement commune aux 47 États membres du Conseil de l’Europe, explique Gregor Puppinck, juriste et directeur du Centre européen pour le droit et la justice, opposé à toute forme de GPA. Aussi, elle donnerait une légitimité aux actions entreprises par d’autres organisations. En droit international, les institutions se citent mutuellement. Quand la Cour européenne des droits de l’Homme traite une affaire, elle s’appuie sur les résolutions de l’assemblée ».
La sinuosité du cheminement des textes au sein Conseil de l’Europe n’empêche pas que s’y jouent de sérieux enjeux33. Avec 16 voix contre 14, le Conseil de l’Europe a rejeté le 15 mars 2016 un rapport recommandant l’autorisation de la gestation pour autrui « altruiste », c’est-à-dire sans contrepartie financière pour la mère porteuse.
Un échec pour les partisans de la GPA. Un rapport recommandant d’autoriser la gestation pour autrui « altruiste », c’est-à-dire sans contrepartie financière pour la mère porteuse, a été rejeté le mardi 15 mars 2016 au Conseil de l’Europe, révèle sa rapporteure. Le texte, discuté devant la commission des questions sociales et de santé du Conseil, a été refusé à 16 voix contre 14, signe que cette institution « n’est pas encore prête », a commenté son auteure, Petra de Sutter.
Deux rassemblements d’opposants à la GPA, l’un féministe, l’autre conservateur, s’étaient tenus ce mardi matin devant les locaux parisiens du Conseil de l’Europe, alors que siégeait cette commission. « C’est une victoire de peu. Le combat n’est pas terminé », a réagi la députée PS et militante féministe Anne-Yvonne Le Dain. « Le rapport n’ira pas dans l’hémicycle. Il n’y aura pas de débat. C’est bien », s’est-elle félicitée. « Le rejet de ce rapport est une victoire pour les droits des femmes et des enfants », s’est réjouit la présidente de La Manif pour tous, une association en pointe depuis 2013 contre le mariage homosexuel, dans un communiqué34.
Les camps féministe et conservateur demandent tous deux désormais une initiative française pour « interdire la GPA dans le monde ». « Les gens qui veulent interdire toute forme de GPA ont des raisons idéologiques. Pourtant, la GPA, ce n’est pas blanc ou noir », a réagi Petra de Sutter. Les législations sur la gestation pour autrui diffèrent parmi les 47 États membres du Conseil de l’Europe, qui l’interdisent à une grande majorité. Le recours aux mères porteuses est ainsi autorisé, tant qu’elles ne sont pas rémunérées, en Belgique, aux Pays-Bas ou encore au Royaume-Uni. Mais le nombre de GPA « altruistes » reste minime dans ces pays. En Belgique, seules soixante naissances du genre ont eu lieu en 20 ans, selon Petra de Sutter. Le comité éthique par lequel les demandeurs doivent passer est en outre très strict, rejetant 80 % des dossiers, a-t-elle ajouté.
D’après l’Autorité de la fertilisation humaine et de l’embryologie, qui régente la GPA au Royaume-Uni, 192 inséminations de mères porteuses ont eu lieu en 2013, contre 46 en 2000. En 2014, la Grèce a à l’inverse autorisé la gestation pour autrui sans obligation de résidence permanente sur son territoire, et avec un dédommagement pour les mères porteuses. L’Ukraine est l’une des principales destinations du tourisme procréatif, avec l’Inde, les États-Unis, ou encore le Canada. Des centaines de couples européens s’y rendent chaque année. Mais la question de la filiation des enfants ainsi nés divise largement à leur retour. Mi-février, une mission sénatoriale française a proposé d’engager des négociations internationales afin d’obtenir des pays pratiquant la GPA qu’ils interdisent aux ressortissants français d’y recourir. Elle a également préconisé de reconnaître la filiation de l’enfant avec son parent biologique35.
Ces derniers développements ne sont évidemment que provisoires. Mais il nous semble, au regard tant du nombre de jurisprudences que de leurs évolutions, en forme de dialogue permanent que des règles standards devraient être adoptées à l’échelle supranationale. Car comme nous l’avons dit un peu plus haut, le sujet central de la réflexion doit être l’enfant. Or les droits de l’enfant, dans leur combinaison avec la prohibition persistante, mais connaissant des évolutions induites, n’apparaissent pas suffisamment garantis. Seule une législation internationale précisément sur ce sujet, fixant un socle, minimal mais essentiel, de règles nous semble désormais impératif.
Notes de bas de pages
-
1.
Arendt H., Les origines du totalitarisme, 2002, Gallimard, Quarto, p. 872.
-
2.
Cass. 1re civ., 13 déc. 1989, n° 88-15655 : Bull. civ. I, n° 387 ; D. 1990, p. 273, rapp. Massip J. ; JCP G 1990, II, 21526, note Sériaux A.
-
3.
Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20105 : Bull. civ. ass. plén., n° 4, rapp Chartier Y. ; D. 1991, p. 417.
-
4.
L. n° 94-654, 29 juill. 1994, relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale, à la procréation et au diagnostic prénatal. Les lois de bioéthique de 1994 recouvraient à la fois l’affirmation des principes généraux de protection de la personne humaine qui ont été introduits notamment dans le Code civil, les règles d’organisation de secteurs d’activités médicales en plein développement tels que ceux de l’assistance médicale à la procréation ou de greffes ainsi que des dispositions relevant du domaine de la santé publique ou de la protection des personnes se prêtant à des recherches médicales.
-
5.
Cass. 1re civ., 9 déc. 2003, n° 01-03927.
-
6.
Cass. 1re civ., 17 déc. 2008, n° 07-20468 : Bull civ I, n° 289.
-
7.
Avis de l’avocat général général Domingo M., « Filiation par mère porteuse : entre l’ordre public international et le droit à une vie de famille », Gaz. Pal. 12 mai 2011, n° I5764, p. 13 à 22 ; Vialla F. et Reynier M., « Pour le droit positif français, Ismaël n’est pas Isaac ! », JCP G 2011, II 441, p. 734 à 736 ; Rome F., « Stérile randonnée… », D. 2011, p. 1001 ; entretien avec Labbée X., « La gestation pour autrui devant la Cour de cassation – à propos des arrêts du 6 avril 2011 », D. 2011, p. 1064 ; Berthiau D. et Brunet L., « L’ordre public au préjudice de l’enfant », études et commentaires, p. 1522 à 1529 ; Le Boursicot M.-C., « Vrais enfants au-delà de l’Atlantique, faux enfants en deçà… », RJPF, 2011/6, p. 14 à 17 ; Weiss-Gout B., « Trois décisions, une même déception », Gaz. Pal. 26 mai 2011, n° I5894, p. 7 à 10 ; Neirinck C., « La gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et l’état civil de l’enfant qui en est né », Dr. famille 2011, étude 14 ; Chénedé F., « Conventions de mère-porteuse : la Cour de cassation met un frein au tourisme procréatif », AJ fam. 2011, n° 5, p. 262 à 265 ; Haftel B., « Gestation pour autrui : éclairage de droit international », AJ fam. 2011, n° 5, p. 265-266 ; Gallois J., « État civil d’enfants nés d’une convention de mère porteuse : la Cour de cassation n’a pas su faire preuve d’audace », RLDC 2011/82, n° 4244, cités par Domino X. dans ses concl. sur CE, 12 déc. 2014, nos 365779, 366710, 366989, 367317, 367324, 368861.
-
8.
Cass. 1re civ., 6 avr. 2011, n° 10-19053, Mennesson II : Bull civ I, n° 72 ; Cass. 1re civ., 6 avr. 2011, n° 09-66486 : Bull civ I, n° 71.
-
9.
Cass. 1re civ., 6 avr. 2011, n° 09-17130 : Bull civ I, n° 70.
-
10.
Cass. 1re civ., 13 sept. 2013, n° 12-18315, PB ; v. aussi Cass. 1re civ., 13 sept. 2013, n° 12-30138, PB.
-
11.
Domino X., concl. sous CE, 12 déc. 2014, nos 365779, 366710, 366989, 367317, 367324 et 368861.
-
12.
V .Domino X., concl. sous CE, 12 déc. 2014, nos 365779, 366710, 366989, 367317, 367324 et 368861.
-
13.
Binet J.-F., « Circulaire Taubira – Ne pas se plaindre des conséquences dont on chérit les causes », JCP G 2013, n° 7 ; Mathey N., « Circulaire Taubira – Entre illusions et contradictions », JCP G 2013, n° 7.
-
14.
Concl. préc.
-
15.
CE, sect., 17 mars 1995, n° 130791.
-
16.
Concl. préc..
-
17.
Statuant sur une requête lui demandant d’annuler le refus du garde des Sceaux d’abroger une circulaire, le Conseil d’État a revu sa jurisprudence relative au régime contentieux des circulaires administratives.
-
18.
Depuis la décision Institution Notre-Dame du Kreisker (CE, ass., 29 janv. 1954, p. 64), le Conseil d’État rejetait comme irrecevables les recours en annulation de circulaires ne posant aucune règle nouvelle. Purement interprétatives, de telles circulaires étaient considérées comme des actes ne faisant pas grief et ne pouvaient, par ailleurs, être invoquées à l’appui d’un recours. Ces circulaires devaient être distinguées de celles à caractère réglementaire, contre lesquelles le recours était possible et qui étaient susceptibles, symétriquement, d’être invoquées à l’appui d’un recours.
-
19.
Revenant sur cette distinction entre circulaires interprétatives et circulaires réglementaires, la section du contentieux du Conseil d’État, par sa décision du 18 décembre 2002, fixe un nouveau critère de recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre une circulaire. Ce critère réside dans le caractère impératif ou non de la circulaire. Désormais, lorsque l’interprétation que l’autorité administrative donne, par voie de circulaires ou d’instructions, des lois et règlements qu’elle a pour mission de mettre en œuvre présente un caractère impératif, elle est considérée comme faisant grief, tout comme le refus de l’abroger, et se trouve, par suite, susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. En revanche, les dispositions dénuées de caractère impératif d’une circulaire ou d’une instruction ne font pas grief et les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables.
-
20.
Cette décision se situe dans la lignée d’une solution retenue peu de temps auparavant par l’assemblée du contentieux du Conseil d’État (CE, 28 juin 2002, n° 220361 : Lebon, p. 229), qui reprenait la jurisprudence issue d’une décision Institut français d’opinion publique (IFOP) du 18 juin 1993 (p. 178), selon laquelle « l’interprétation par l’autorité administrative des lois et règlements qu’elle a pour mission de mettre en œuvre, au moyen de dispositions impératives à caractère général, n’est susceptible d’être directement déférée au juge de l’excès de pouvoir que si et dans la mesure où ladite interprétation méconnaît le sens et la portée des prescriptions législatives et réglementaires qu’elle se propose d’expliciter ou contrevient aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes juridiques ». Cette jurisprudence a été appliquée à de nombreuses reprises (par ex., CE, sect., 2 juin 1999, n° 207752 : Lebon, p. 161, pour une circulaire du président de la commission des sondages). V. le site internet du Conseil d’État.
-
21.
Domino X., concl. préc.
-
22.
http://www.etat-civil.legibase.fr/breves/06102014_Les_couples_homosexuels_peuvent_adopter_des_enfants_issus_d_une_PMA_a_l_etranger
-
23.
Gouttenoire A., « La Cour de cassation et les enfants issus de GPA à l’étranger », JCP G 2015, p. 965.
-
24.
Nous reprenons ces développements de notre précédent article « La gestation pour autrui en droit français : développements récents » paru in LPA 21 mars 2016, p. 6.
-
25.
Dans son arrêt de chambre, rendu le 27 janvier 2015, dans l’affaire Paradiso et Campanelli c/ Italie (req. n° 25358/12), la CEDH dit à la majorité qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’Homme. L’affaire concernait la prise en charge par les services sociaux italiens d’un enfant de neuf mois né en Russie à la suite d’un contrat de gestation pour autrui (GPA), conclu par un couple dont il fut ultérieurement établi qu’il n’avait aucun lien biologique avec l’enfant.
-
26.
La Cour a estimé que les considérations d’ordre public ayant orienté les décisions des autorités italiennes – qui ont estimé que les requérants avaient tenté de contourner l’interdiction de la GPA en Italie ainsi que les règles régissant l’adoption internationale – ne pouvaient l’emporter sur l’intérêt supérieur de l’enfant, malgré l’absence de tout lien biologique et la brièveté de la période pendant laquelle les requérants se sont occupés de lui. Rappelant que l’éloignement d’un enfant du contexte familial est une mesure extrême ne pouvant se justifier qu’en cas de danger immédiat pour lui, la Cour a estimé qu’en l’espèce, les conditions pouvant justifier un éloignement n’étaient pas remplies.
-
27.
Les conclusions de la Cour ne sauraient toutefois être comprises comme obligeant l’État italien à remettre l’enfant aux requérants, ce dernier ayant certainement développé des liens affectifs avec la famille d’accueil chez laquelle il vit depuis 2013.
-
28.
http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-21-juillet-2016-n-906314-et-1041014-gestation-pour-autrui-acte-de-naissance-transcription/
-
29.
Hervieu N., cité dans les journaux La Croix et Le Figaro, 22 juill. 2016.
-
30.
http://hudoc.echr.coe.int/fre ?i=001-164968#{"itemid" :["001-164968"]}
-
31.
CEDH, 26 juin 2014, Mennesson, n° 65192/11, § 36 ; Labassée, n° 65941/11, § 27.
-
32.
CEDH, 21 juill. 2016, 52 à 54.
-
33.
CEDH, 26 juin 2014, Mennesson, § 36, et Labassée, § 27.
-
34.
Pt 36.
-
35.
Pts 55 à 58.
-
36.
Concl. préc.
-
37.
Concl. préc.
-
38.
http://www.la-croix.com/Monde/Europe/La-GPA-nouveau-debat-devant-Conseil-lEurope-2016-09-21-1200790736
-
39.
http://www.la-croix.com/Monde/Europe/La-GPA-nouveau-debat-devant-Conseil-lEurope-2016-09-21-1200790736.
-
40.
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/le-conseil-de-l-europe-rejette-un-rapport-recommandant-la-gpa-altruiste_1773685.html.