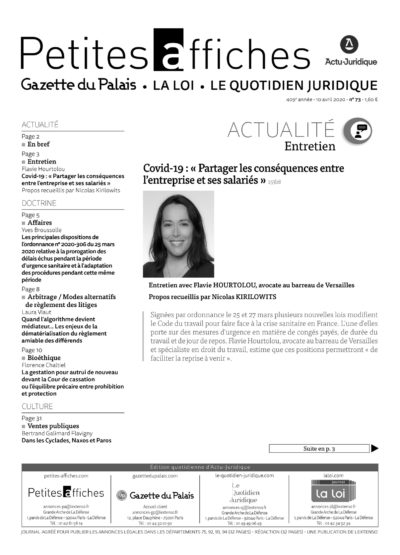La gestation pour autrui de nouveau devant la Cour de cassation ou l’équilibre précaire entre prohibition et protection
La gestation pour autrui est interdite en droit français. Cependant, elle peut être légale dans certains États, et les enfants, nés de ces pratiques à l’étranger de père biologique français notamment, doivent bénéficier d’une protection conformément aux droits de l’enfant reconnus et garantis en droit français. En évitant de reconnaître toute automaticité entre réalisation d’une gestation pour autrui à l’étranger et transcription en France d’actes d’état civil, la Cour de cassation cherche à trouver un équilibre entre prohibition maintenue en droit français et protection des droits de l’enfant. C’est un équilibre qui, compte tenu des principes en présence, ne peut qu’être précaire.
Par un arrêt du 4 octobre 20191, rendu en grande chambre, la Cour de cassation décide de confirmer une décision du ministère public du… 25 novembre 20022. Ce sont ainsi 17 ans de chemin sinueux, chaotique, jalonné de nombreuses décisions de justice, nationales, européennes, de dialogue des juges qui s’achèvent par une confirmation de la décision initiale au nom du principe de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
La question des « mères porteuses » est apparue dans le débat public dans les années 1980. Un avis du comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) du 23 octobre 1984 relatif aux problèmes éthiques nés des techniques de reproduction artificielle considère que « le procédé de maternité de substitution est illicite par son objet et sa cause ». Le 22 janvier 19883, un arrêt de l’assemblée du contentieux du Conseil d’État validait le refus préfectoral d’inscription des statuts de l’association Les Cigognes, qui mettait en relation des couples infertiles et des mères prêtes à porter l’enfant4. La « gestation pour autrui » fait intervenir une mère d’intention, à l’origine du projet, une mère biologique, qui donne ses gamètes, et une mère porteuse, qui permet la grossesse. Techniquement, seule la fécondation in vitro peut permettre la ponction chirurgicale de la donneuse d’ovocytes et le transfert d’embryon(s) sur la mère porteuse. Dans l’hypothèse où le père d’intention rencontrerait des problèmes de fertilité, on peut envisager que les parents aient également recours à un don de gamètes masculins, auquel cas le nombre des acteurs de cette procréation serait porté à cinq (deux parents d’intention, deux donneurs de gamètes, une mère porteuse).
La pratique de la gestation pour autrui (GPA), qui apparaît la plus répandue actuellement, interroge les grands principes éthiques. En effet, alors que faire bénéficier un tiers de ses capacités reproductives issues de ses gamètes fait aujourd’hui l’objet d’un relatif consensus, vendre ou offrir ses capacités gestationnelles est plus controversé. Le don d’ovocytes, certes éprouvant pour le corps de la donneuse, a lieu avant la fécondation des gamètes et constitue un geste ponctuel. La gestation pour autrui consiste, elle, à demander à une femme de porter pendant 9 mois un enfant qu’elle mettra au monde avant de le remettre à ses parents d’intention. En séparant l’enfant de celle qui l’a porté, cette technique introduit une rupture qui interroge le sens même de la maternité, étant rappelé qu’en droit de la filiation, jusque-là, la mère est toujours certaine car c’est elle qui accouche (mater semper certa est)5.
Si ce chemin a été si long, de 2002 à 2019, dans l’affaire jugée le 4 octobre 2019, c’est que la question est d’une haute intensité éthique, aux confins du droit national, du droit international et de l’internationalisation des échanges, aux confins du fait et du droit et, en tout cas, au cœur de l’intime conviction de chacun de ce que représente le fait de « donner la vie ». Deux conceptions de la gestation sont en présence, en faisant abstraction de toute question relative à la procréation médicalement assistée qui n’est pas ici en débat principal6. Soit l’on considère, comme le droit français le fait jusqu’à présent avec force, que toute marchandisation du corps est contraire aux valeurs fondamentales de la société, soit l’on admet que, par accord de volontés, une femme – la mère biologique – peut porter un enfant pour une autre femme – la mère dite d’intention. Dans cette seconde hypothèse, la notion même de « marchandisation » n’est pas retenue, mais plutôt celle d’entraide, ou, dans certains cas même, de gestation qualifiée d’éthique, comme pour éloigner, justement, le spectre de la marchandisation.
Cependant, ces approches philosophiques, traditionnellement développées dans un cadre national où s’exprime la volonté générale qui encadre une société, rencontrent immanquablement une dimension qui dépasse les frontières d’un État et d’une loi, si protectrice puisse-t-elle être. Le développement exponentiel des échanges internationaux et la libre circulation des personnes, mais aussi des idées, conduisent immanquablement, dans ce domaine, comme dans d’autres, à des contournements des règles prohibitives nationales, par le départ, temporaire ou non, à l’étranger. Lorsque ce départ n’est que temporaire, qu’il est fait pour utiliser les techniques recherchées, prohibées dans son État mais autorisées ou tolérées dans d’autres États, pour revenir dans son État d’origine ou de nationalité, les questions juridiques les plus délicates apparaissent.
C’est cette question que la Cour de cassation a eue à juger le 4 octobre 2019. Celle-ci intervient après un véritable feuilleton judiciaire (I) au terme duquel une approche prudente, guidée par l’intérêt supérieur de l’enfant, est retenue (II).
I – Un feuilleton judiciaire s’étirant de 2010 à 2019
L’histoire juridictionnelle qui s’achève le 4 octobre 2019 commence par des actes de naissance américains, dressés dans le comté de San Diego (Californie) conformément à un jugement de la cour supérieure de l’État de Californie du 14 juillet 2000. Par un jugement du 14 juillet 2000, la Cour suprême de Californie, saisie à la fois par le couple français, constitué d’un homme et d’une femme, et la mère porteuse, alors enceinte par fécondation in vitro à partir des gamètes du couple français, décide que tout enfant qui serait mis au monde par la mère porteuse dans les 4 mois aurait le premier requérant pour « père génétique » et la deuxième requérante pour « mère légale ». Le jugement précise les mentions devant figurer sur l’acte de naissance, indiquant notamment que les premiers requérants devaient être enregistrés comme père et mère. Des jumelles naquirent le 25 octobre 2000, et les actes de naissance furent établis comme prévu. Ces actes de naissance concernent donc deux petites filles nées d’une gestation pour autrui, à partir des gamètes de leur père et de leur mère par fécondation in vitro dans le corps de la mère porteuse.
Le 25 novembre 2002, le ministère public a fait transcrire ces actes de naissance par le consulat général de France à Los Angeles en Californie. Par un acte du 16 mai 2003, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a assigné M. et Mme X en annulation de cette transcription. Le ministère public arguait de l’atteinte à l’ordre public pour demander l’annulation de la transcription sur les registres français de l’état civil des actes de naissance des enfants. La validité de ces actes – conformes au jugement de la Cour suprême de Californie – n’était pas contestée. Le 30 septembre 2004, conformément au réquisitoire du procureur de la République de Créteil, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu : il considéra que, commis sur le territoire américain où ils n’étaient pas pénalement répréhensibles, les faits visés ne constituaient pas des délits punissables sur le territoire national.
Dans son arrêt du 25 octobre 2007, la cour d’appel de Paris7 a confirmé le jugement rendu en première instance en déclarant que la demande du ministère public était irrecevable et a indiqué « qu’au demeurant, la non-transcription des actes de naissance aurait des conséquences contraires à l’intérêt supérieur des enfants qui, au regard du droit français, se verraient privés d’acte civil indiquant leur lien de filiation, y compris à l’égard de leur père biologique ». Elle juge ainsi que le ministère public était irrecevable, au regard de l’ordre public international, à solliciter l’annulation des actes transcrits sur les registres du service central de l’état civil de Nantes. Elle procède alors à une substitution de motifs. Elle retient en effet à cet égard que les énonciations de ces actes étaient exactes au regard du jugement de la Cour suprême de Californie du 14 juillet 2000, et que le ministère public ne contestait ni l’opposabilité à la France de ce jugement ni la foi à accorder, au sens de l’article 47 du Code civil, aux actes dressés en Californie dans les formes usitées dans cet État.
Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 20088, au motif que le ministère public disposait d’un intérêt à agir en nullité des transcriptions dès lors qu’il ressortait des constatations de la cour d’appel que les énonciations inscrites sur les actes d’état civil ne pouvaient résulter que d’une convention portant sur la gestation pour autrui. Elle renvoya la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par un arrêt du 18 mars 2010, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a annulé la transcription, sur les registres du service central d’état civil de Nantes, des actes de naissance établis dans le comté de San Diego. Par un arrêt du 6 avril 20119, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme X à l’encontre de cet arrêt.
Les intéressés ont saisi la Cour européenne des droits de l’Homme, qui, par un arrêt du 26 juin 2014, a dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la convention s’agissant du droit de A. et B. X au respect de leur vie privée et que l’État français devait verser une somme aux deux requérants au titre du préjudice moral subi et des frais et dépens.
Sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire institués par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, M. et Mme X, agissant en qualité de représentants légaux de leurs deux filles mineures, ont demandé le réexamen de ce pourvoi.
Par une décision du 16 février 2018, la cour de réexamen des décisions civiles a fait droit à la demande et dit que l’affaire se poursuivrait devant l’assemblée plénière de la Cour de Cassation.
Par un arrêt avant dire droit du 5 octobre 2018, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a transmis à la Cour européenne des droits de l’Homme une demande d’avis consultatif. Cette dernière s’est prononcée le 10 avril 2019.
La durée de l’instance s’explique par un conflit de normes juridiques, les premières décisions étant largement fondées sur le principe national de prohibition de la gestation pour autrui (A). Les orientations de la Cour de cassation ont évolué au terme d’un dialogue avec le juge européen des droits de l’Homme (B).
A – La prohibition de la gestation pour autrui au fondement des premières décisions juridictionnelles
La loi française interdit la gestation pour autrui et, à ce stade de la réflexion politique et sociale, le législateur, dans le cadre de la révision en cours des lois bioéthiques, entend fermement maintenir la prohibition. La loi du 29 juillet 199410 relative au respect du corps humain interdit explicitement la gestation pour autrui.
En introduisant dans le Code civil l’article 16-7, selon lequel « toute convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui est nulle », cette loi a confirmé la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. Elle a par ailleurs ajouté au Code pénal l’article 227-12, qui sanctionne d’une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende « le fait de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre ».
Si le droit français demeure fondé sur la prohibition stricte (2), plusieurs États l’autorisent de manière plus ou moins encadrée par la loi (1).
1 – Des législations nationales entre prohibition et marchandisation
À la suite d’affaires comme celle que nous avons abordée, plusieurs études de droit comparé ont pu être menées. On distingue ainsi les États ayant retenu l’interdiction, tandis que d’autres autorisent la gestation pour autrui selon des modalités diverses en fonction des systèmes juridiques étudiés. La Cour, lors de son arrêt de 201411, a procédé à une recherche de droit comparé couvrant 35 États parties à la convention autres que la France : Andorre, l’Albanie, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la Géorgie, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Moldavie, Monaco, le Monténégro, les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Russie, Saint-Marin, la Serbie, la Slovénie, la Suède, la Suisse, la Turquie et l’Ukraine. De nouveau, lors de sa saisine pour avis consultatif12, la Cour a procédé à une étude de droit comparé couvrant cette fois 43 États parties à la convention autres que la France : l’Albanie, l’Allemagne, Andorre, l’Arménie, l’Autriche, l’Azerbaïdjan, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la Géorgie, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la République de Moldavie, Monaco, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Macédoine du Nord, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Russie, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Turquie et l’Ukraine.
Il en ressort que la gestation pour autrui est autorisée dans 9 de ces 43 États, qu’elle paraît tolérée dans 10 et qu’elle est explicitement ou implicitement interdite dans les 24 autres. Par ailleurs, dans 31 de ces 43 États, dont 12 États dans lesquels la gestation pour autrui est interdite, il est possible pour le père d’intention, père biologique, d’établir sa paternité à l’égard d’un enfant né d’une gestation pour autrui. Dans 19 de ces 43 États (l’Allemagne, l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la Géorgie, la Grèce, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Russie, la Slovénie, la Suède et l’Ukraine), dont 7 États dans lesquels la gestation pour autrui est interdite (l’Allemagne, l’Espagne, la Finlande, le Luxembourg, la Norvège, la Slovénie et la Suède), il est possible pour la mère d’intention d’établir sa maternité à l’égard d’un enfant né d’une gestation pour autrui avec lequel elle n’a pas de lien génétique.
Les modalités d’établissement ou de reconnaissance d’un lien de filiation entre les enfants nés d’une gestation pour autrui et les parents d’intention varient d’un État à un autre, plusieurs pouvant par ailleurs être ouvertes dans un même État. Il peut notamment s’agir de l’enregistrement de l’acte de naissance étranger, de l’adoption ou de procédures judiciaires autres que l’adoption. En particulier, l’enregistrement de l’acte de naissance étranger est possible dans 16 des 19 États membres visés par l’étude dans lesquels la gestation pour autrui est tolérée ou autorisée (l’Albanie, Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Belgique, la Géorgie, la Grèce, la République de Moldavie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Russie, le Royaume-Uni, la République de Macédoine du Nord et l’Ukraine) et dans 7 des 24 États dans lesquels elle est interdite (l’Allemagne, l’Autriche, la Finlande, l’Islande, Malte, la Norvège et la Turquie), du moins en ce qu’elle désigne un parent d’intention ayant un lien génétique avec l’enfant. Il est possible de faire établir ou reconnaître le lien enfant-parent d’intention par une procédure judiciaire autre que l’adoption dans les 19 États dans lesquels la gestation pour autrui est autorisée ou tolérée et dans 9 des 24 États dans lesquels elle est interdite. Quant à l’adoption, elle est possible dans 5 des États autorisant ou tolérant la gestation pour autrui (l’Albanie, la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal et la République tchèque), et dans 12 des 24 États qui l’interdisent (l’Allemagne, la Bulgarie, la Croatie, l’Estonie, l’Espagne, la Finlande, l’Islande, le Luxembourg, la Norvège, la Slovénie, la Suède et la Turquie), en particulier à l’égard des parents qui n’ont pas de lien génétique avec l’enfant.
Ainsi, pour prendre quelques exemples plus précis, outre la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et la Suisse interdisent traditionnellement la gestation pour autrui.
La Belgique et les Pays-Bas lui accordent une tolérance. En Belgique, aucune loi ne l’interdit et elle est donc pratiquée dans le cadre des hôpitaux sous quelques conditions, telles que l’infertilité du couple, la présence d’une mère porteuse relationnelle – une amie ou une connaissance volontaire – ayant moins de 40 ans et étant déjà mère. La gratuité en est le principe. Au Pays-Bas, un texte de 1998 accorde une place à la GPA dans un contexte d’échec de la procréation médicalement assistée en l’encadrant de strictes conditions, telle la gratuité. Plus récemment, la voie de l’adoption d’un enfant né d’une mère porteuse semble se développer.
En Europe, la Grèce et le Royaume-Uni la reconnaissent de manière encadrée. En Amérique du Nord, la gestation pour autrui se pratique. La Grèce dispose d’une loi autorisant la GPA depuis 2002. Elle a été révisée en 2005 et en 2014. Elle est accessible aux couples étrangers. Le droit grec encadre strictement la GPA en la réservant aux couples infertiles et aux femmes célibataires, en prévoyant une limite d’âge à 50 ans et enfin en posant le principe de gratuité. Une convention comprenant tous les éléments requis doit être signée par l’ensemble des intéressés. Au Royaume-Uni, la GPA est autorisée par la loi depuis 1985 (Surrogacy arrangement Act), la législation ayant connu plusieurs modifications depuis lors. L’actualité est celle d’un projet de loi visant à reconnaître que les parents d’intention sont d’emblée juridiquement les parents de l’enfant. Depuis le 6 juin et jusqu’au 27 septembre 2019, les Britanniques devaient donner leur avis sur une modification de la loi sur la gestation pour autrui recommandée par les commissions de la loi en Écosse, en Angleterre et au Pays de Galles. À l’issue de cette consultation, les commissions rédigeront un projet de loi qui sera proposé au gouvernement courant 2021. Le but principal est d’encadrer au mieux ces procédés et de limiter la dimension commerciale de ces contrats, même si officiellement la GPA est gratuite.
En Amérique du Nord, la gestation pour autrui est autorisée au Canada et aux États Unis. Dans ces derniers, certains États fédérés l’autorisent, d’autres pas. Les avocats se sont spécialisés sur ces questions afin d’accompagner les personnes souhaitant y recourir. Ce qui fait que même si elle est officiellement gratuite dans plusieurs États fédérés, deux éléments la rendent onéreuse : les frais d’avocats afin de rédiger les contrats d’une part et d’autre part, les frais de grossesse dont le montant n’est en général pas plafonné. Au Canada, qui est aussi un État fédéral, la compétence revient aux États fédérés.
La Russie et l’Ukraine sont des États dans lesquels la gestation pour autrui est autorisée. Ce qui entraîne des créations de structures d’organisation de GPA à l’étranger pour des personnes cherchant une mère porteuse. Des sites internet ont ainsi pris place sur la toile, proposant, ici des comparatifs de prix, là des tableaux mettant en balance les avantages et les inconvénients de chaque système proposé.
À ce tableau international, il faut ajouter des États comme l’Inde, où la gestation pour autrui est légalisée depuis 2002 et où les dévoiements conduisent à une marchandisation du corps de la femme. Un projet de loi a été déposé en 2016, visant à définir une GPA altruiste, mais les habitudes seront difficiles à supprimer.
Cette situation d’hétérogénéité des législations et des conditions d’accès, la multiplication des échanges, la circulation sans limite de l’information grâce au développement du numérique rendent les législations nationales fondées sur la prohibition souvent platoniques. C’est pourtant l’application stricte de la prohibition qui explique les premières décisions de justice en France.
2 – L’application stricte de la prohibition et les premières décisions de justice en France
C’est l’application stricte de la prohibition qui a justifié une série de décisions de justice rendues sur le territoire français, à la fois dans plusieurs décisions anciennes (a) et dans les premières décisions concernant l’affaire qui donne lieu finalement à l’arrêt du 4 octobre 2019 (b).
a – Une jurisprudence constante fondée sur la prohibition
La Cour de cassation considère que la convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient tant au principe de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes13. Cette position fait obstacle à l’établissement d’un lien juridique de filiation entre l’enfant issu d’une telle convention et la femme qui l’a recueilli à sa naissance et qui l’élève, que ce soit par le biais, comme en l’espèce, de la transcription sur les registres de l’état civil des mentions figurant sur un acte de naissance régulièrement dressé à l’étranger, par le biais de l’adoption14, ou par l’effet de la possession d’état15.
Dans deux arrêts du 13 septembre 2013, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la transcription des actes de naissance d’enfants nés en Inde d’une gestation pour autrui, de mères indiennes et de pères français16. Ces derniers, qui avaient préalablement reconnu les enfants en France, avaient vainement sollicité la transcription des actes de naissance établis en Inde. Dans l’un des cas, la cour d’appel avait ordonné la transcription au motif que la régularité formelle et la conformité à la réalité des énonciations des actes litigieux n’étaient pas contestées. La Cour de cassation a cassé l’arrêt au motif que, en l’état du droit positif, le refus de transcription est justifié « lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public selon les termes des articles 16-7 et 19-9 du Code civil »17. Dans l’autre cas, la cour d’appel avait refusé d’ordonner la transcription, retenant qu’il ne s’agissait pas seulement d’un contrat de gestation pour autrui prohibé par la loi française, mais encore d’un achat d’enfant, contraire à l’ordre public, le père ayant versé à la mère porteuse un salaire de 1 500 €. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi par le même motif que dans son autre arrêt. Elle a ajouté qu’« en présence de cette fraude, ni l’intérêt supérieur de l’enfant que garantit l’article 3, § 1, de la convention internationale des droits de l’enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention (…) ne sauraient être utilement invoqués ». Sur ce même fondement et après avoir souligné que l’action en contestation de paternité exercée par le ministère public pour fraude à la loi, fondée sur l’article 336 du Code civil, n’est pas soumise à la preuve que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père au sens de l’article 332 du même code, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel en ce qu’elle avait annulé la reconnaissance de paternité18. C’est dans ce cadre de précédents jurisprudentiels que s’inscrit la série de décisions rejetant la transcription des actes de naissance litigieux.
b – La série de décisions rejetant la transcription des actes de naissance en cause dans l’affaire finalement jugée le 4 octobre 2019
Ainsi dans la décision du 18 mars 2010, la cour d’appel de Paris juge que les actes de naissance ont été établis sur le fondement de l’arrêt rendu le 14 juillet 2000 par la cour supérieure de l’État de Californie qui a déclaré le premier requérant père génétique et la deuxième requérante mère légale de tout enfant devant naître de la mère porteuse, entre le 15 août 2000 et le 15 décembre 2000 et que les actes d’état civil sont donc indissociables de la décision qui en constitue le soutien et dont l’efficacité demeure subordonnée à sa propre régularité internationale.
Elle précisait alors que la reconnaissance, sur le territoire national, d’une décision rendue par une juridiction d’un État qui n’est lié à la France par aucune convention est soumise à trois conditions, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi. La cour juge en l’espèce, qu’« il est constant que c’est à la suite d’une convention de gestation pour autrui que [la mère porteuse] a donné naissance à deux enfants qui sont issus des gamètes [du premier requérant] et d’une tierce personne et qui ont été remises aux [premiers requérants] ». Elle ajoute que, selon l’article 16-7 du Code civil, dont les dispositions qui sont issues de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 et qui n’ont pas été modifiées par la loi n° 2004-800 du 6 août 2004, sont d’ordre public en vertu de l’article 16-9 du même code, toute convention portant sur la procréation ou sur la gestation pour le compte d’autrui est nulle. Elle en déduit dès lors, que l’arrêt de la cour supérieure de l’État de Californie, en ce qu’il a validé indirectement une convention de gestation pour autrui, est en contrariété avec la conception française de l’ordre public international. Elle décide donc d’annuler la transcription, sur les registres du service central d’état civil français, des actes de naissance américains qui désignent la deuxième requérante comme mère des enfants et d’ordonner la transcription du présent arrêt en marge des actes de naissance annulés.
Elle précise encore que « les [requérants], qui ne peuvent sérieusement prétendre ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, ne sont pas davantage fondés à soutenir qu’une telle mesure contrevient à des dispositions inscrites dans des conventions internationales et des textes de droit interne ; qu’en effet, les notions qu’ils invoquent, en particulier celle de l’intérêt supérieur de l’enfant, ne sauraient permettre, en dépit des difficultés concrètes engendrées par une telle situation, de valider a posteriori un processus dont l’illicéité, consacrée par le législateur français à la suite du juge, ressortit, pour l’heure, au droit positif ; qu’en outre, l’absence de transcription n’a pas pour effet de priver les deux enfants de leur état civil américain et de remettre en cause le lien de filiation qui leur est reconnu à l’égard des [premiers requérants] par le droit californien (…) »19.
Cependant, par un fructueux dialogue des juges, la Cour de cassation a apporté une solution visant à garantir la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
B – Le dialogue des juges et son institutionnalisation
C’est d’abord par la voie de la condamnation – ou non – d’un État que la Cour européenne des droits de l’Homme dialogue avec les ordres juridiques nationaux (1) avant que le protocole n° 16 à la convention européenne des droits de l’Homme n’entre en vigueur en France, permettant au juge suprême national de saisir, avant dire-droit, la Cour européenne (2).
1 – La condamnation de la France en 2014
Dans l’affaire qui est ici traitée, un premier dialogue se noue par décisions de justice interposées. Une première condamnation est prononcée en 201420. La Cour européenne des droits de l’Homme juge alors que la France a manqué au respect de la vie privée et familiale des intéressés. Plus précisément, observant qu’il existe effectivement une législation prohibitive en matière de gestation pour autrui en France, elle rappelle d’abord que l’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les États varie selon les circonstances, les domaines et le contexte et que la présence ou l’absence d’un dénominateur commun aux systèmes juridiques des États contractants peut constituer un facteur pertinent à cet égard21. La Cour observe en l’espèce qu’il n’y a consensus en Europe ni sur la légalité de la gestation pour autrui ni sur la reconnaissance juridique du lien de filiation entre les parents d’intention et les enfants ainsi légalement conçus à l’étranger. Il ressort en effet de la recherche de droit comparé à laquelle elle a procédé que la gestation pour autrui est expressément interdite dans 14 des 35 États membres du Conseil de l’Europe – autres que la France – étudiés ; dans 10 d’entre eux, soit elle est interdite en vertu de dispositions générales ou non tolérée, soit la question de sa légalité est incertaine ; elle est en revanche expressément autorisée dans 7 pays et semble tolérée dans 4 autres. Dans 13 de ces 35 États, il est possible d’obtenir la reconnaissance juridique du lien de filiation entre les parents d’intention et les enfants issus d’une gestation pour autrui légalement pratiquée à l’étranger. Cela semble également possible dans 11 autres de ces États (dont 1 dans lequel cette possibilité ne vaut peut-être que pour le lien de filiation paternel lorsque le père d’intention est le père biologique), mais exclu dans les 11 restants22. Selon la Cour, cette absence de consensus reflète le fait que le recours à la gestation pour autrui suscite de délicates interrogations d’ordre éthique. Elle confirme en outre que les États doivent en principe se voir accorder une ample marge d’appréciation, s’agissant de la décision non seulement d’autoriser ou non ce mode de procréation mais également de reconnaître ou non un lien de filiation entre les enfants légalement conçus par gestation pour autrui à l’étranger et les parents d’intention.
Cependant la condamnation résulte du fait que la Cour estime devoir prendre en compte la circonstance qu’un aspect essentiel de l’identité des individus est en jeu dès lors que l’on touche à la filiation. Il convient donc selon elle d’atténuer la marge d’appréciation dont disposait l’État défendeur en l’espèce. Elle ajoute que les choix opérés par l’État, même dans les limites de cette marge, n’échappent pas au contrôle de la Cour. Il incombe à celle-ci d’examiner attentivement les arguments dont il a été tenu compte pour parvenir à la solution retenue et de rechercher si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts de l’État et ceux des individus directement touchés par cette solution. Or c’est à la lumière de ces données que la Cour supranationale observe ce que la Cour de cassation française a jugé : à savoir que l’ordre public faisait obstacle à la transcription sur les registres français d’un acte de naissance établi en exécution d’une décision étrangère comportant des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français. Elle a ensuite souligné qu’en droit français, les conventions de gestation pour autrui étaient nulles d’une nullité d’ordre public, et qu’elles étaient contraires au « principe essentiel du droit français » de l’indisponibilité de l’état des personnes et refusé de leur faire produire effet au regard de la filiation. Elle en a déduit qu’en ce qu’il donnait effet à une convention de gestation pour autrui, le jugement rendu en la cause des requérants par la Cour suprême de Californie était contraire à la conception française de l’ordre public international, et qu’établis en application de ce jugement, les actes de naissance américains des troisième et quatrième requérantes ne pouvaient être transcrits sur les registres d’état civil français.
La Cour constate que cette approche se traduit par le recours à l’exception d’ordre public international, propre au droit international privé. Elle n’entend pas la mettre en cause en tant que telle. Il lui faut néanmoins vérifier si en appliquant ce mécanisme en l’espèce, le juge interne a dûment pris en compte la nécessité de ménager un juste équilibre entre l’intérêt de la collectivité à faire en sorte que ses membres se plient au choix effectué démocratiquement en son sein et l’intérêt des requérants – dont l’intérêt supérieur des enfants – à jouir pleinement de leurs droits au respect de leur vie privée et familiale23.
Sur cette base, la Cour estime nécessaire de distinguer les droits des parents de ceux des enfants nés de la GPA en question. Pour les premiers, elle observe que la situation concrète ne porte pas atteinte à l’équilibre entre les droits de la convention et la marge d’appréciation des États, dans la mesure où la position du juge français n’empêchait pas nécessairement que les parents et leurs filles nées de GPA vivent ensemble. Cependant, la position de la Cour européenne est différente s’agissant des enfants. Plusieurs éléments doivent alors être pris en considération. Le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d’être humain, ce qui inclut sa filiation. Or en l’état du droit positif, les enfants se trouvent à cet égard dans une situation d’incertitude juridique. S’il est exact qu’un lien de filiation avec les premiers requérants est admis par le juge français pour autant qu’il est établi par le droit californien, le refus d’accorder tout effet au jugement américain et de transcrire l’état civil qui en résulte manifeste en même temps que ce lien n’est pas reconnu par l’ordre juridique français. Autrement dit, la France, sans ignorer qu’elles [il s’agit de jumelles nées de la GPA en question] ont été identifiées ailleurs comme étant les enfants des premiers requérants, leur nie néanmoins cette qualité dans son ordre juridique. La Cour considère que pareille contradiction porte atteinte à leur identité au sein de la société française. La nationalité fait partie de l’identité ; or en l’espèce, une incertitude persiste sur la nationalité des filles. Des questions sur les droits de succession se posent aussi immanquablement. Il y a donc bien atteinte à la vie privée des enfants.
À la suite de cette condamnation, de nouvelles décisions sont prises. La transcription de l’acte de naissance d’un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger est désormais possible pour autant qu’il désigne le père d’intention comme étant le père de l’enfant lorsqu’il en est le père biologique. Elle demeure impossible s’agissant de la maternité d’intention. L’épouse du père, mère d’intention, a toutefois maintenant la possibilité d’adopter l’enfant si les conditions légales sont réunies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant, ce qui crée un lien de filiation à son égard, l’adoption de l’enfant du conjoint étant par ailleurs facilitée par le droit français24. La Cour de cassation a rendu, en assemblée plénière, deux arrêts par lesquels elle a modifié sa jurisprudence25. Par ces arrêts, elle a jugé que l’existence d’une convention de gestation pour autrui ne faisait pas en soi obstacle à la transcription d’un acte de naissance établi à l’étranger. L’article 47 du Code civil étant ainsi interprété à la lumière de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation en a déduit que l’acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l’état civil, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
À la suite de cette jurisprudence, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, par deux arrêts du 5 juillet 2017, que viole l’article 47 précité et l’article 8 de la convention l’arrêt qui refuse la transcription de l’acte de naissance étranger en ce qu’il désigne le père, alors qu’il résulte des données de fait, d’un acte ou jugement étranger, que le patrimoine génétique du père d’intention a été utilisé et qu’en revanche, concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de cet article 47, est la réalité de l’accouchement et qu’ainsi en fait une exacte application, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, la cour d’appel qui refuse la transcription de la filiation maternelle d’intention26.
Par une décision du 16 février 2018, la cour de réexamen des décisions civiles a fait droit à la demande de réexamen du pourvoi en cassation déposée le 15 mai 2017 en application de l’article L. 452-1 du Code de l’organisation judiciaire par les requérants, agissant en qualité de représentants légaux des deux enfants mineurs, contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 mars 2010 qui avait annulé la transcription sur les registres de l’état civil français des actes de naissance américains de ces derniers.
2 – La saisine de la Cour européenne des droits de l’Homme
L’entrée en vigueur du protocole à la convention européenne des droits de l’Homme met en place les conditions d’un dialogue renouvelé. Ce protocole prévoit la possibilité pour les plus hautes juridictions des États parties, d’adresser des demandes d’avis consultatif à la Cour sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la convention ou ses protocoles. Le protocole n° 16 est entré en vigueur le 1er août 2018 à l’égard des États l’ayant signé et ratifié, dont la France.
Ainsi, par un arrêt avant dire-droit du 5 octobre 2018, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a transmis à la Cour européenne des droits de l’Homme une demande d’avis consultatif sur les questions suivantes :
1° En refusant de transcrire sur les registres de l’état civil l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui, en ce qu’il désigne comme étant sa « mère légale » la « mère d’intention », alors que la transcription de l’acte a été admise en tant qu’il désigne le « père d’intention », père biologique de l’enfant, un État partie excède-t-il la marge d’appréciation dont il dispose au regard de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ? À cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l’enfant est conçu ou non avec les gamètes de la « mère d’intention » ?
2° Dans l’hypothèse d’une réponse positive à l’une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d’intention d’adopter l’enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d’établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l’article 8 de la convention ? L’assemblée plénière a sursis à statuer jusqu’à l’avis de la Cour européenne des droits de l’Homme.
La Cour européenne des droits de l’Homme a rendu son avis consultatif le 10 avril 201927. La Cour rappelle, préalablement, que, dans ses arrêts X c/ France28 et H. c/ France29 si elle a admis « qu’il était concevable que la France puisse souhaiter décourager ses ressortissants de recourir à l’étranger à une méthode de procréation qu’elle prohibe sur son territoire », elle a relevé que « les effets de la non-reconnaissance en droit français du lien de filiation entre les enfants ainsi conçus et les parents d’intention ne se limitaient pas à la situation de ces derniers, qui seuls ont fait le choix des modalités de procréation que leur reprochent les autorités françaises et qu’ils portent aussi sur celle des enfants eux-mêmes, dont le droit au respect de la vie privée se trouve significativement affecté ».
Selon la Cour européenne, « l’absence de reconnaissance en droit interne du lien entre l’enfant et la mère d’intention défavorise l’enfant dès lors qu’il le place dans une forme d’incertitude juridique quant à son identité dans la société. Il y a notamment un risque qu’il n’ait pas accès à la nationalité de la mère d’intention dans les conditions que garantit la filiation, cela peut compliquer son maintien sur le territoire du pays de résidence de la mère d’intention (même si ce risque n’existe pas dans le cas soumis à l’examen de la Cour de cassation, le père d’intention, qui est aussi le père biologique, ayant la nationalité française), ses droits successoraux à l’égard de celle-ci peuvent être amoindris, il se trouve fragilisé dans le maintien de sa relation avec la mère d’intention en cas de séparation des parents d’intention ou de décès du père d’intention et il n’est pas protégé contre un refus ou une renonciation de la mère d’intention de le prendre en charge ».
À propos des avis consultatifs que prévoit désormais le protocole n° 16 à la convention européenne des droits de l’Homme, il faut préciser que, comme l’indique le préambule du protocole n° 16, la procédure d’avis consultatif a pour but de renforcer l’interaction entre elle et les autorités nationales et de consolider ainsi la mise en œuvre de la convention, conformément au principe de subsidiarité, en donnant la possibilité aux juridictions nationales désignées de lui demander un avis sur « des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la convention ou ses protocoles » (art. 1, § 1, protocole n° 16) qui se posent « dans le cadre d’une affaire pendante devant elle[s] » (art. 1, § 2, protocole n° 16). L’objectif de la procédure n’est pas de transférer le litige à la Cour, mais de donner à la juridiction qui a procédé à la demande les moyens nécessaires pour garantir le respect des droits de la convention lorsqu’elle jugera le litige en instance (v. pt 11 du rapport explicatif). La Cour n’est compétente ni pour se livrer à une analyse des faits, ni pour apprécier le bien-fondé des points de vue des parties relativement à l’interprétation du droit interne à la lumière du droit de la convention, ni pour se prononcer sur l’issue de la procédure. Son rôle se limite à rendre un avis en rapport avec les questions qui lui ont été soumises. C’est à la juridiction dont émane la demande qu’il revient de résoudre les questions que soulève l’affaire et de tirer, selon le cas, toutes les conséquences qui découlent de l’avis donné par la Cour pour les dispositions du droit interne invoquées dans l’affaire et pour l’issue de l’affaire30. Elle estime que les avis qu’elle est amenée à rendre en application de ce protocole doivent se limiter aux points qui ont un lien direct avec le litige en instance sur le plan interne. Leur intérêt est également de fournir aux juridictions nationales des orientations sur des questions de principe relatives à la convention applicable dans des cas similaires.
En somme dans l’affaire ici commentée, vu les exigences de l’intérêt supérieur de l’enfant et la réduction de la marge d’appréciation, la Cour est d’avis que, dans une situation telle que celle visée par la Cour de cassation dans ses questions, le droit au respect de la vie privée, au sens de l’article 8 de la convention, d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre cet enfant et la mère d’intention, désignée dans l’acte de naissance légalement établi à l’étranger comme étant la « mère légale ». Bien que le litige interne ne concerne pas le cas d’un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et conçu avec les gamètes de la mère d’intention, la Cour juge important de préciser que, lorsque la situation est par ailleurs similaire à celle dont il est question dans ce litige, la nécessité d’offrir une possibilité de reconnaissance du lien entre l’enfant et la mère d’intention vaut a fortiori dans un tel cas31.
Ces éléments doivent être pris en compte dans la question de savoir si le droit au respect de la vie privée de l’enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger, dans la situation où l’enfant a été conçu avec les gamètes d’une tierce donneuse, requiert que cette reconnaissance se fasse par la transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de naissance légalement établi à l’étranger, ou s’il admet qu’elle puisse se faire par d’autres moyens, tels que l’adoption de l’enfant par la mère d’intention. Il est dans l’intérêt de l’enfant qui est dans cette situation que la durée de l’incertitude dans laquelle il se trouve quant à sa filiation à l’égard de la mère d’intention soit aussi brève que possible. La Cour n’en déduit pas pour autant que les États parties soient tenus d’opter pour la transcription des actes de naissance légalement établis à l’étranger, au regard de l’absence de consensus en la matière. La Cour ne déduit pas de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi compris que la reconnaissance du lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention que requiert le droit de l’enfant au respect de la vie privée, au sens l’article 8 de la convention, impose aux États de procéder à la transcription de l’acte de naissance étranger en ce qu’il désigne la mère d’intention comme étant la mère légale. Selon les circonstances de chaque cause, d’autres modalités peuvent également servir convenablement cet intérêt supérieur, dont l’adoption, qui, s’agissant de la reconnaissance de ce lien, produit des effets de même nature que la transcription de l’acte de naissance étranger. Ce qui compte, selon la Cour, c’est qu’au plus tard lorsque, selon l’appréciation des circonstances de chaque cas, le lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé, il y ait un mécanisme effectif permettant la reconnaissance de ce lien. Une procédure d’adoption peut répondre à cette nécessité dès lors que ses conditions sont adaptées et que ses modalités permettent une décision rapide, de manière à éviter que l’enfant soit maintenu longtemps dans l’incertitude juridique quant à ce lien. Il va de soi que ces conditions doivent inclure une appréciation par le juge de l’intérêt supérieur de l’enfant à la lumière des circonstances de la cause32. La Cour conclut sur ce point que, vu la marge d’appréciation dont disposent les États s’agissant du choix des moyens, d’autres voies que la transcription, notamment l’adoption par la mère d’intention, peuvent être acceptables dans la mesure où les modalités prévues par le droit interne garantissent l’effectivité et la célérité de leur mise en œuvre, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant33.
Ainsi la Cour estime que dans la situation où, comme dans l’hypothèse formulée dans les questions de la Cour de cassation, un enfant est né à l’étranger par gestation pour autrui et est issu des gamètes du père d’intention et d’une tierce donneuse, et où le lien de filiation entre l’enfant et le père d’intention a été reconnu en droit interne : 1° le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la convention, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre cet enfant et la mère d’intention, désignée dans l’acte de naissance légalement établi à l’étranger comme étant la « mère légale » ; 2° le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la convention, ne requiert pas que cette reconnaissance se fasse par la transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de naissance légalement établi à l’étranger ; elle peut se faire par une autre voie, telle que l’adoption de l’enfant par la mère d’intention, à la condition que les modalités prévues par le droit interne garantissent l’effectivité et la célérité de sa mise en œuvre, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.
C’est forte de cet avis mais aussi de cette dizaine d’années de réflexions, et sans doute d’hésitations, que la Cour de cassation décide de valider la transcription des actes d’état civil en raison des circonstances de durée de la procédure notamment. C’est donc une approche prudente que retient la Cour de cassation.
II – Une approche prudente retenue par la Cour de cassation
Aucun blanc-seing à ce que l’on pourrait de manière peu heureuse ni satisfaisante qualifier de tourisme de la gestation pour autrui n’est donné par la Cour. C’est le point essentiel de l’arrêt rendu le 4 octobre 2019. C’est un équilibre incertain trouvé entre prohibition et reconnaissance de l’existant (A) au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant dont le contenu devra sans doute être précisé (B).
A – L’équilibre incertain entre prohibition et reconnaissance de l’existant
Le contexte est celui d’une procédure interne visant au réexamen du pourvoi en cassation des requérants après condamnation par la Cour européenne des droits de l’Homme en 2014.
La Cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 mars 2010, au motif de la violation des textes visés de droit international, à savoir, l’article 55 de la constitution française, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et la convention de New-York sur les droits de l’enfant. En application de l’article L. 411-3, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire et de l’article 627 du Code de procédure civile, la Cour de cassation peut, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie. C’est ce qu’elle décide de faire et statue en grande chambre au regard de l’importance du sujet traité. Le juge se situe à la fois dans le cadre de la notion d’ordre public national et international (1) et dans celui d’une situation de fait à prendre en considération (2).
1 – La prohibition et l’ordre public national et international
La Cour ne peut que se situer dans le cadre législatif national de la prohibition. Plusieurs textes sont en présence en ce qui concerne la notion d’ordre public. En premier lieu, selon l’article 423 du Code de procédure civile, le ministère public peut agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion de faits qui portent atteinte à celui-ci.
Or un des arguments des requérants, tout au long de la procédure, tient en ce que la décision étrangère qui reconnaît la filiation d’un enfant à l’égard d’un couple ayant régulièrement conclu une convention avec une mère porteuse n’est pas contraire à l’ordre public international, qui ne se confond pas avec l’ordre public interne. Il convient d’apporter quelques éléments de définitions de l’ordre public international selon la Cour de cassation. Devant les chambres civiles, l’exception d’ordre public international relevée par le juge a pour fonction d’empêcher la perturbation que risque de produire l’application ou la reconnaissance de normes étrangères dont le contenu heurterait les conceptions dominantes de l’ordre juridique du for34. L’ordre public international s’exprime sous une forme positive lorsque le juge français applique directement une loi étrangère ou une loi de police française. Dans ce cas, celle-ci s’impose en-dehors de tout raisonnement de droit international privé, et donc sans référence à la conception française de l’ordre public. L’aspect négatif de l’ordre public international se rencontre lorsqu’il s’agit de faire produire effet en France à une situation juridique déjà créée à l’étranger, au stade soit de l’exequatur d’une décision étrangère, soit de sa reconnaissance, notamment incidente35. Lorsqu’il s’agit de reconnaître des droits acquis à l’étranger, l’effet de la situation qui y a déjà produit ses effets est moins perturbateur pour l’ordre juridique français. Dans ce cas, seul un degré élevé de contrariété de la loi étrangère aux conceptions françaises justifie une intervention de l’ordre public. Celui-ci produit alors un effet atténué, cette moindre réaction étant, notamment, fonction du temps passé entre la situation juridique cristallisée à l’étranger et la reconnaissance en France de ses effets36.
Lorsqu’elle fait état de l’intérêt supérieur de l’enfant, la Cour de cassation ne se réfère pas à la conception française de l’ordre public international, bien qu’à l’évidence l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant en fasse partie. Un arrêt du 30 janvier 197937 a invoqué « l’intérêt effectif » de l’enfant, en le reliant « aux exigences de l’ordre public français ».
Cependant, le juge doit aussi tenir compte de ce que nous pouvons appeler ici l’existant, ou, dit encore autrement, il doit prendre en compte une situation de fait que le droit français en principe n’autorise pas.
2 – La prise en considération d’une situation de fait
L’existant est la réalité sociale face à laquelle le juge suprême de l’ordre judiciaire se trouve. Sur le territoire français, un couple de nationalité française vit avec des enfants nés de gestation pour autrui, avec les gamètes du père implantées dans le corps de la mère dite porteuse. Les enfants nés de ce processus et résidant sur le territoire français avec leurs parents doivent être dans une situation juridique sécurisée.
La Cour européenne des droits de l’Homme considère que l’article 8 de la convention n’impose pas une obligation générale pour les États de reconnaître ab initio un lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention. Ce que requiert l’intérêt supérieur de l’enfant – qui s’apprécie avant tout in concreto plutôt qu’in abstracto – c’est que ce lien, légalement établi à l’étranger, puisse être reconnu au plus tard lorsqu’il s’est concrétisé. Il appartient en principe non pas à la Cour mais en premier lieu aux autorités nationales d’évaluer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, si et quand ce lien s’est concrétisé38. C’est dans ce cadre juridique que la Cour de cassation estime qu’il se déduit de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qu’au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, la circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du Code civil, ne peut, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’enfant, faire obstacle à la transcription de l’acte de naissance établi par les autorités de l’État étranger, en ce qui concerne le père biologique de l’enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l’égard de la mère d’intention mentionnée dans l’acte étranger, laquelle doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé39.
Pour annuler la transcription sur les registres du service d’état civil de Nantes des actes de naissance établis dans le comté de San Diego (Californie) et désignant M. et Mme X en qualité de père et mère des enfants A. et B. X, l’arrêt retient que ces actes ont été établis sur le fondement de l’arrêt rendu le 14 juillet 2000 par la cour supérieure de l’État de Californie qui a déclaré M. C. X, père génétique et Mme D. Z, « mère légale de tout enfant qui naîtrait de Mme E. entre le 15 août 2000 et le 15 décembre 2000 ». Il ajoute que c’est à la suite d’une convention de gestation pour autrui que Mme E. a donné naissance à deux enfants qui sont issus des gamètes de M. X et d’une tierce personne, enfants qui ont été remis à M. et Mme X. Dès lors que toute convention portant sur la procréation ou sur la gestation pour le compte d’autrui est nulle en vertu de l’article 16-7 du Code civil, il conclut que l’arrêt de la cour supérieure de l’État de Californie, en ce qu’il a validé indirectement une gestation pour autrui, est en contrariété avec la conception française de l’ordre public international. La Cour juge qu’en statuant ainsi, par des motifs fondés sur l’existence d’une convention de gestation pour autrui à l’origine de la naissance des enfants, la cour d’appel a violé les textes applicables, à savoir, l’article 55 de la constitution, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 3, § 1, de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant, selon lequel « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En droit français, en application de l’article 310-1 du Code civil, la filiation est légalement établie par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire, ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. Elle peut l’être aussi par un jugement. Par ailleurs, la filiation peut être également établie, dans les conditions du titre VIII du Code civil, par l’adoption, qu’elle soit plénière ou simple.
Au regard de l’existence de ces modes d’établissement de la filiation, la première chambre civile de la Cour de cassation, par quatre arrêts du 5 juillet 201740, a jugé que l’adoption permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, de créer un lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention, épouse du père biologique. Selon l’avis consultatif, l’adoption répond notamment aux exigences de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors que ses modalités permettent une décision rapide, de manière à éviter que l’enfant soit maintenu longtemps dans l’incertitude juridique quant à ce lien, le juge devant tenir compte de la situation fragilisée des enfants tant que la procédure est pendante41.
Sachant que les conventions portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui sont nulles, la Cour de cassation retient, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’il convient de privilégier tout mode d’établissement de la filiation permettant au juge de contrôler notamment la validité de l’acte ou du jugement d’état civil étranger au regard de la loi du lieu de son établissement, et d’examiner les circonstances particulières dans lesquelles se trouve l’enfant.
Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que le prononcé d’une adoption suppose l’introduction d’une nouvelle instance à l’initiative de Mme D. X. En effet, en application des dispositions du titre VIII du Code civil, l’adoption ne peut être demandée que par l’adoptant, l’adopté devant seulement y consentir personnellement s’il a plus de 13 ans. Le renvoi des consorts X à recourir à la procédure d’adoption, alors que l’acte de naissance des deux filles a été établi en Californie, dans un cadre légal, conformément au droit de cet État, après l’intervention d’un juge, la cour supérieure de l’État de Californie, qui a déclaré M. C. X, père génétique et Mme D. X, « mère légale » des enfants, aurait, au regard du temps écoulé depuis la concrétisation du lien entre les enfants et la mère d’intention, des conséquences manifestement excessives en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée de Mmes A. et B. X.
La Cour conclut, s’agissant d’un contentieux qui perdure depuis plus de 15 ans, en l’absence d’autre voie permettant de reconnaître la filiation dans des conditions qui ne porteraient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mmes A. et B. X consacré par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et alors qu’il y a lieu de mettre fin à cette atteinte, la transcription sur les registres de l’état civil de Nantes des actes de naissance établis à l’étranger de A. et B. X ne saurait être annulée.
L’espèce ici jugée est éloquente à plus d’un titre, sans pour autant épuiser le sujet. Elle est éloquente par la durée et la période concernée. Elle commence à un moment où les questions de procréation ne sont pas encore au cœur de débats éthiques et sociaux. Depuis le début de cette affaire, les sociétés en général et la société française en particulier ont profondément évolué. Les questions de mariage, de famille ont suscité des débats et ont connu des évolutions législatives majeures : la loi relative au mariage pour tous a été adoptée, le projet de loi étendant la procréation médicalement assistée à toutes les femmes est en voie d’adoption. Cet ensemble d’éléments donne un éclairage renouvelé à l’affaire jugée le 4 octobre 2019 et invite à définir encore davantage le contenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.
B – L’intérêt supérieur de l’enfant entre faisceau d’indices et contenu à préciser
L’arrêt de la Cour tend à donner une série de critères permettant d’identifier les contours de ce qui constitue l’intérêt supérieur de l’enfant (1), qui devront sans doute être encore précisés (2).
1 – La détermination d’un faisceau d’indices constitutifs de l’intérêt supérieur de l’enfant
La Cour européenne des droits de l’Homme, dans son avis consultatif déjà cité d’avril 2019, apporte une série de précisions. Comme le rapporteur le souligne dans l’affaire ici commentée, jugée par la Cour de cassation le 4 octobre 2019, la Cour européenne précise pour la première fois, que « l’intérêt supérieur de l’enfant comprend aussi l’identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l’élever, de satisfaire à ses besoins et d’assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d’évoluer dans un milieu stable »42.
La Cour précise, de jurisprudence constante, que l’article 8 de la convention demande que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance du lien entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et le père d’intention lorsqu’il est le père biologique43. Or l’absence d’une telle possibilité emportait violation du droit de l’enfant au respect de sa vie privée, tel qu’il se trouve garanti par cette disposition44.
La jurisprudence européenne met un certain accent sur l’existence d’un lien biologique entre l’enfant et au moins l’un des parents d’intention. Ainsi dans un arrêt de 2017, la Cour apporte des précisions sur ce point. L’affaire concerne la prise en charge par les services sociaux italiens d’un enfant de 9 mois né en Russie d’un contrat de gestation pour autrui, conclu avec une femme russe par un couple italien n’ayant aucun lien biologique avec l’enfant.
Compte tenu de l’absence de tout lien biologique entre l’enfant et les requérants, la courte durée de la relation avec l’enfant et la précarité juridique des liens entre eux, et malgré l’existence d’un projet parental et la qualité des liens affectifs, la Cour conclut à l’absence de vie familiale entre les requérants et l’enfant. Elle considère cependant que les mesures litigieuses relèvent de la vie privée des requérants. La Cour considère que les mesures litigieuses avaient pour but légitime la défense de l’ordre et la protection des droits et libertés d’autrui. Sur ce dernier point, elle juge légitime la volonté des autorités italiennes de réaffirmer la compétence exclusive de l’État pour reconnaître un lien de filiation – uniquement en cas de lien biologique ou d’adoption régulière – dans le but de protéger les enfants.
La Cour admet ensuite que les juridictions italiennes, ayant notamment conclu que l’enfant ne subirait pas un préjudice grave ou irréparable en conséquence de la séparation, ont ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu, tout en demeurant dans les limites de la marge d’appréciation dont elles disposaient45.
La Cour admet d’ailleurs, dans le contexte de la gestation pour autrui, que l’intérêt supérieur de l’enfant ne se résume pas au respect de ces aspects de son droit à la vie privée. Il inclut d’autres éléments fondamentaux, qui ne plaident pas nécessairement en faveur de la reconnaissance d’un lien de filiation avec la mère d’intention, tels que la protection contre les risques d’abus que comporte la gestation pour autrui et la possibilité de connaître ses origines. Ainsi, elle admet qu’en interdisant l’adoption privée fondée sur une relation contractuelle entre les individus et en restreignant le droit des parents adoptifs de faire entrer des mineurs étrangers en Italie aux cas dans lesquels les règles sur l’adoption internationale sont respectées, le législateur italien s’efforce de protéger les enfants contre des pratiques illicites, dont certaines peuvent être qualifiées de trafic d’êtres humains46.
La Cour estime, dans son avis consultatif du 10 avril 2019 que l’intérêt supérieur de l’enfant comprend aussi l’identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l’élever, de satisfaire à ses besoins et d’assurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et d’évoluer dans un milieu stable, la Cour considère toutefois que l’impossibilité générale et absolue d’obtenir la reconnaissance du lien entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention n’est pas conciliable avec l’intérêt supérieur de l’enfant, qui exige pour le moins un examen de chaque situation au regard des circonstances particulières qui la caractérise47.
Ce faisceau d’indices connaît sans doute des précisions et des pondérations en fonction des contextes.
2 – Les contours de l’intérêt supérieur de l’enfant encore à préciser
Cette question est au cœur de la dialectique du fait et du droit. Car le droit, en France, c’est la prohibition de la gestation pour autrui. Sur ce sujet, comme sur d’autres, la loi est l’expression de la volonté générale sans que le droit supranational européen, que ce soit celui de l’Union européenne ou celui de la convention européenne des droits de l’Homme, n’ait à ce jour de compétence. La Cour européenne des droits de l’Homme l’a d’ailleurs souligné dès 2014 à propos de cette même affaire : « L’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les États varie selon les circonstances, les domaines et le contexte et que la présence ou l’absence d’un dénominateur commun aux systèmes juridiques des États contractants peut constituer un facteur pertinent à cet égard. Ainsi, d’un côté, lorsqu’il n’y a pas de consensus au sein des États membres du Conseil de l’Europe, que ce soit sur l’importance relative de l’intérêt en jeu ou sur les meilleurs moyens de le protéger, en particulier lorsque l’affaire soulève des questions morales ou éthiques délicates, la marge d’appréciation est large. De l’autre côté, lorsqu’un aspect particulièrement important de l’existence ou de l’identité d’un individu se trouve en jeu, la marge laissée à l’État est d’ordinaire restreinte (voir en particulier, S.H. et autres c/ Autriche)48. » La Cour précise cependant, quelques lignes plus loin, qu’il faut « prendre en compte la circonstance qu’un aspect essentiel de l’identité des individus est en jeu dès lors que l’on touche à la filiation. Il convient donc d’atténuer la marge d’appréciation dont disposait l’État défendeur en l’espèce ».
Il apparaît donc que, si la législation sur la GPA relève d’une compétence nationale, les questions de vie privée, de vie familiale et surtout d’intérêt supérieur de l’enfant ne relèvent pas de la seule appréciation des instances nationales, qu’elles soient législatives, réglementaires ou juridictionnelles. La Cour précise encore que dans le contexte de la reconnaissance d’un lien de filiation entre des enfants nés à l’issue d’une gestation pour autrui et les parents d’intention dépasse en réalité la question de l’identité de ces enfants. D’autres aspects essentiels de leur vie privée sont concernés dès lors que sont en question l’environnement dans lequel ils vivent et se développent et les personnes qui ont la responsabilité de satisfaire à leurs besoins et d’assurer leur bien-être49.
L’avenir reste incertain en l’absence d’automaticité de la transcription des actes d’état civil, ce qui se comprend aisément au regard du principe de la prohibition. Cependant, dans son arrêt de 2014, déjà cité et condamnant initialement la France sur cette affaire, la Cour européenne des droits de l’Homme soulignait que ce qui importe c’est la réalité concrète de la relation entre les intéressés. Or il est certain en l’espèce que les premiers requérants s’occupent comme des parents des troisième et quatrième requérantes depuis leur naissance, et que tous les quatre vivent ensemble d’une manière qui ne se distingue en rien de la « vie familiale » dans son acception habituelle. Cela suffit pour établir que l’article 8 trouve à s’appliquer dans son volet « vie familiale »50.
On notera aussi que l’affaire ici commentée ne concernera pas le cas où il y a eu procréation pour autrui, c’est-à-dire où l’enfant est issu des gamètes de la mère porteuse. Les questions de la Cour de cassation ne visaient d’ailleurs pas cette situation. Ce qui laisse encore ouverte une série d’interrogations.
Les bases juridiques françaises sont essentiellement jurisprudentielles. On rappellera que le Conseil d’État, quant à lui, n’a jamais écarté comme inopérant un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme ou de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant au motif qu’une fraude avait été commise, ce qui ne signifie pas que le Conseil d’État n’en tient pas compte dans la balance qu’il opère au titre de l’examen de conventionalité sur cet article.
Dans son étude de 2018, le Conseil d’État précise que la gestation pour autrui implique pour la mère porteuse des risques inhérents à toute grossesse et accouchement et de fortes sujétions. Elle suppose également de renoncer à sa qualité de mère et de prévoir contractuellement la remise de l’enfant auquel elle donne naissance. Or de telles implications sont frontalement contraires aux principes d’indisponibilité du corps et de l’état des personnes, ainsi qu’au principe de non‐patrimonialisation du corps dans le cas où cette pratique est rémunérée. Si ces principes n’ont pas bénéficié de la même consécration constitutionnelle que le principe de dignité de la personne humaine, ils en expriment une certaine vision : aussi, les remettre en cause bouleverserait le modèle bioéthique français. À cet égard, l’argument tiré de ce que la gestation pour autrui pourrait être « éthique », c’est-à-dire pratiquée hors de toute finalité marchande, ne lève pas sa contrariété aux principes d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes eu égard, notamment, à la difficulté de s’assurer du caractère désintéressé du geste de la mère porteuse51.
Enfin il existe un texte de droit souple en la matière, une circulaire du garde des Sceaux. Le 25 janvier 2013, la garde des Sceaux, ministre de la Justice, a adressé aux procureurs généraux près les cours d’appel, au procureur près le tribunal supérieur d’appel, aux procureurs de la République et aux greffiers des tribunaux d’instance, la circulaire suivante :
« L’attention de la chancellerie a été appelée sur les conditions de délivrance des certificats de nationalité française (CNF) aux enfants nés à l’étranger de Français, lorsqu’il apparaît, avec suffisamment de vraisemblance, qu’il a été fait recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui.
Vous veillerez, dans l’hypothèse où de telles demandes seraient formées, et sous réserve que les autres conditions soient remplies, à ce qu’il soit fait droit à celles-ci dès lors que le lien de filiation avec un Français résulte d’un acte d’état civil étranger probant au regard de l’article 47 du Code civil selon lequel “tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité”.
À l’inverse, face à un acte d’état civil étranger non probant, le greffier en chef du tribunal d’instance sera fondé, après consultation du bureau de la nationalité, à refuser la délivrance d’un CNF.
J’appelle votre attention sur le fait que le seul soupçon du recours à une telle convention conclue à l’étranger ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de CNF dès lors que les actes de l’état civil local attestant du lien de filiation avec un Français, légalisés ou apostillés sauf dispositions conventionnelles contraires, sont probants au sens de l’article 47 précité.
Dans tous les cas, le bureau de la nationalité sera destinataire d’une copie du dossier et du certificat de nationalité française délivré ou du refus de délivrance opposé.
Vous veillerez, par ailleurs, à informer le bureau de la nationalité de toutes difficultés liées à l’application de la présente circulaire ».
Dès 2014, la Cour avait relevé l’existence d’une question grave de compatibilité de la situation de non-reconnaissance de l’adoption établie à l’étranger par des ressortissants français avec l’intérêt supérieur des enfants, dont le respect doit guider toute décision les concernant52. Ce qui signifie, in fine, que la seule base jurisprudentielle ne semble pas suffire à garantir la sécurité juridique des enfants nés de la GPA. L’idée de mettre en place un socle commun de principes essentiels commence à se développer. Ainsi, la conférence de La Haye de droit international privé a entrepris des travaux destinés à proposer une convention internationale permettant d’y répondre sur la base de principes acceptés par les États qui adhéreront à cet instrument53. La conciliation entre prohibition – de la GPA – et protection – de l’enfant – n’est pas encore parfaite. La diversité des situations – identité des parents biologiques, dons de gamète, gratuité ou non, transcription d’actes étrangers ou procédures d’adoption – ne semble pas pouvoir être traitée exclusivement par voie de circulaires et de jurisprudences.
C’est la raison pour laquelle, le procureur s’est ainsi exprimé oralement sur cette affaire : « Le dossier qui vous est soumis aujourd’hui pose sur les plans éthique et juridique des questions complexes et inédites. À cette complexité s’ajoute l’impossibilité de concilier des opinions diamétralement opposées sur ce sujet, en France comme au sein de l’UE. Certains attendent de la Cour de cassation qu’elle rende “une grande décision” de principe fixant le cadre légal, général et absolu de l’établissement de la filiation entre un enfant issu d’une gestation pour autrui et ses parents d’intention. Ce n’est pas l’office du juge de cassation qui doit s’exercer dans le cadre légal existant, sans se substituer au législateur. À chacun son rôle et ses responsabilités »54.
Notes de bas de pages
-
1.
Cass. ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19053, avis oral du procureur général, arrêt n° 648.
-
2.
Le 25 novembre 2002, le ministère public a fait transcrire les actes de naissance litigieux par le consulat général de France à Los Angeles (Californie).
-
3.
« Considérant que l’association requérante a ainsi pour objet de favoriser le développement et de permettre la réalisation de pratiques selon lesquelles une femme accepte de concevoir un enfant par insémination artificielle en vue de céder, dès sa naissance, l’enfant qu’elle aura ainsi conçu, porté et mis au monde à une autre femme ou à un couple ; que de telles pratiques comportent nécessairement un acte, quelle qu’en soit la forme, aux termes duquel l’un des parents s’engage à abandonner un enfant à naître ; que dès lors, en se fondant sur les dispositions de l’article 353‐1‐2° du Code pénal, pour s’opposer par décision du 1er mars 1985 à l’inscription de l’association Les Cigognes, le préfet, commissaire de la République du Bas‐Rhin n’a pas excédé les pouvoirs qu’il tient des dispositions législatives précitées » (CE, ass., 22 janv. 1988, n° 80936, Assoc. Les Cigognes).
-
4.
Étude du Conseil d’État relative à la révision des lois bioéthique, La Documentation française, juill. 2018, p. 74.
-
5.
C. civ., art. 311‐25 : « La filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant ». Cette désignation est faite par l’officier d’état civil sur production du certificat d’accouchement établi par l’équipe médicale, in Étude du Conseil d’État relative à la révision des lois bioéthique, La Documentation française, juill. 2018, p. 76.
-
6.
Ce n’est pas le débat ici mais les questions sont liées, puisque l’accès à la PMA pour toutes les femmes pose immanquablement la question des limites de l’interdiction de la gestation pour autrui.
-
7.
CA Paris, 25 oct. 2007, n° 06/00507.
-
8.
Cass. 1re civ., 17 déc. 2008, n° 07-20468.
-
9.
Cass. 1re civ., 6 avr. 2011, n° 10-19053.
-
10.
L. n° 94-653, 29 juill. 1994.
-
11.
Arrêt du 26 avril 2014 condamnant la France dans cette même affaire.
-
12.
Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention, demande n° P16-2018-001.
-
13.
Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20105 : Bull. civ. ass. plén., n° 4, p. 5. Dans cette affaire, la mère porteuse était la mère biologique de l’enfant.
-
14.
Cass. 1re civ., 29 juin 1994, n° 92-13563 : Bull. civ. I, n° 226, p. 164. Dans cette affaire également, la mère porteuse était la mère biologique de l’enfant.
-
15.
Cass. 1re civ., 6 avr. 2011, n° 09-17130.
-
16.
Cass. 1re civ., 13 sept. 2013, n° 12-18315 et Cass. 1re civ., 13 sept. 2013, n° 12-30138.
-
17.
La Cour de cassation a statué à l’identique le 19 mars 2014 dans une affaire similaire, Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-50005.
-
18.
Affaires rappelées par la Cour européenne des droits de l’Homme, https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2014/06/cedh_26_juin_2014_mennesson_c._france.pdf.
-
19.
Affaires rappelées par la Cour européenne des droits de l’Homme, https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2014/06/cedh_26_juin_2014_mennesson_c._france.pdf.
-
20.
Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme n° 65192/11 du 26 juin 2014, devenu définitif en vertu de l’article 44, § 2, de la convention.
-
21.
Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme n° 65192/11 du 26 juin 2014, devenu définitif en vertu de l’article 44, § 2, de la convention.
-
22.
Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme n° 65192/11 du 26 juin 2014, devenu définitif en vertu de l’article 44, § 2, pt 74, de la convention.
-
23.
Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme n° 65192/11 du 26 juin 2014, devenu définitif en vertu de l’article 44, § 2, pt 84, de la convention.
-
24.
C’est ce que souligne la Cour de cassation dans sa demande d’avis à la Cour européenne des droits de l’Homme.
-
25.
Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, n° 14-21323 et Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, n° 15-50002 : Bull. civ. ass. plén., n° 4.
-
26.
Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 15-28597 ; Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, nos 16-16901 et 16-50025.
-
27.
Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention, demande n° P16-2018-001.
-
28.
CEDH, 5e sect., 26 juin 2014, n° 65192/11.
-
29.
CEDH, 5e sect., 26 juin 2014, n° 65941/11.
-
30.
CEDH, avis, 10 avr. 2019, n° P 16-2018-001 pt 25.
-
31.
CEDH, avis, 10 avr. 2019, n° P 16-2018-001, pts 46 et 47.
-
32.
CEDH, avis, 10 avr. 2019, n° P 16-2018-001, pt 54.
-
33.
CEDH, avis, 10 avr. 2019, n° P 16-2018-001, pt 55.
-
34.
Rapport annuel de la Cour de cassation, 2013, https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2013_6615/etude_ordre_6618/sources_ordre_6624/titre_1_sources_internationales_6625/conception_fran_29035.html.
-
35.
Rapport annuel de la Cour de cassation, 2013, https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2013_6615/etude_ordre_6618/sources_ordre_6624/titre_1_sources_internationales_6625/conception_fran_29035.html.
-
36.
Rapport annuel de la Cour de cassation, 2013, https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2013_6615/etude_ordre_6618/sources_ordre_6624/titre_1_sources_internationales_6625/conception_fran_29035.html.
-
37.
Cass. 1re civ., 30 janv. 1979, n° 78-11568 : Bull. civ. I, n° 37.
-
38.
CEDH, avis, 10 avr. 2019, n° P 16-2018-001.
-
39.
Cass. ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19053, pt 6.
-
40.
Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 15-28597 : Bull. civ. I, n° 163 – Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, nos 16-16901 et n° 16-50025 : Bull. civ. I, n° 164 – Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-16455 : Bull. civ. I, n° 165.
-
41.
Cass. ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19053, pt 15.
-
42.
Rapport de la conseillère Agnès Martinel, 20 sept. 2019, p. 10, https://www.courdecassation.fr/IMG///20190920_Ap_rapport_10-19.053.pdf.
-
43.
CEDH, avis, 10 avr. 2019, n° P 16-2018-001, pt 35.
-
44.
CEDH, 5e sect., 26 juin 2014, n° 65192/11 ; CEDH, 21 juill. 2016, nos 9063/14 et 10410/14, Foulon et Bouvet c/ France ; CEDH, 19 janv. 2017, n° 44024/13, Laborie c/ France.
-
45.
CEDH, 27 janv. 2015, n° 25358/12, Paradiso et Campanelli c/ Italie.
-
46.
CEDH, 27 janv. 2015, n° 25358/12, pt 202.
-
47.
CEDH, avis, 10 avr. 2019, n° P 16-2018-001, pt 40.
-
48.
CEDH, 26 juin 2014, n° 65192/11, pt 77.
-
49.
CEDH, avis, 10 avr. 2019, n° 65192/11, pt 45.
-
50.
CEDH, 26 juin 2014, n° 65192/11, pt 45.
-
51.
Étude publiée en 2018 à la Documentation française, v. p. 17.
-
52.
CEDH, 5e sect., 26 juin 2014, n° 65192/11, pt 99.
-
53.
https://www.hcch.net/fr/projects/legislative-projects/parentage-surrogacy.
-
54.
https://www.courdecassation.fr/IMG/20190920_avis_10-19.053.pdf.