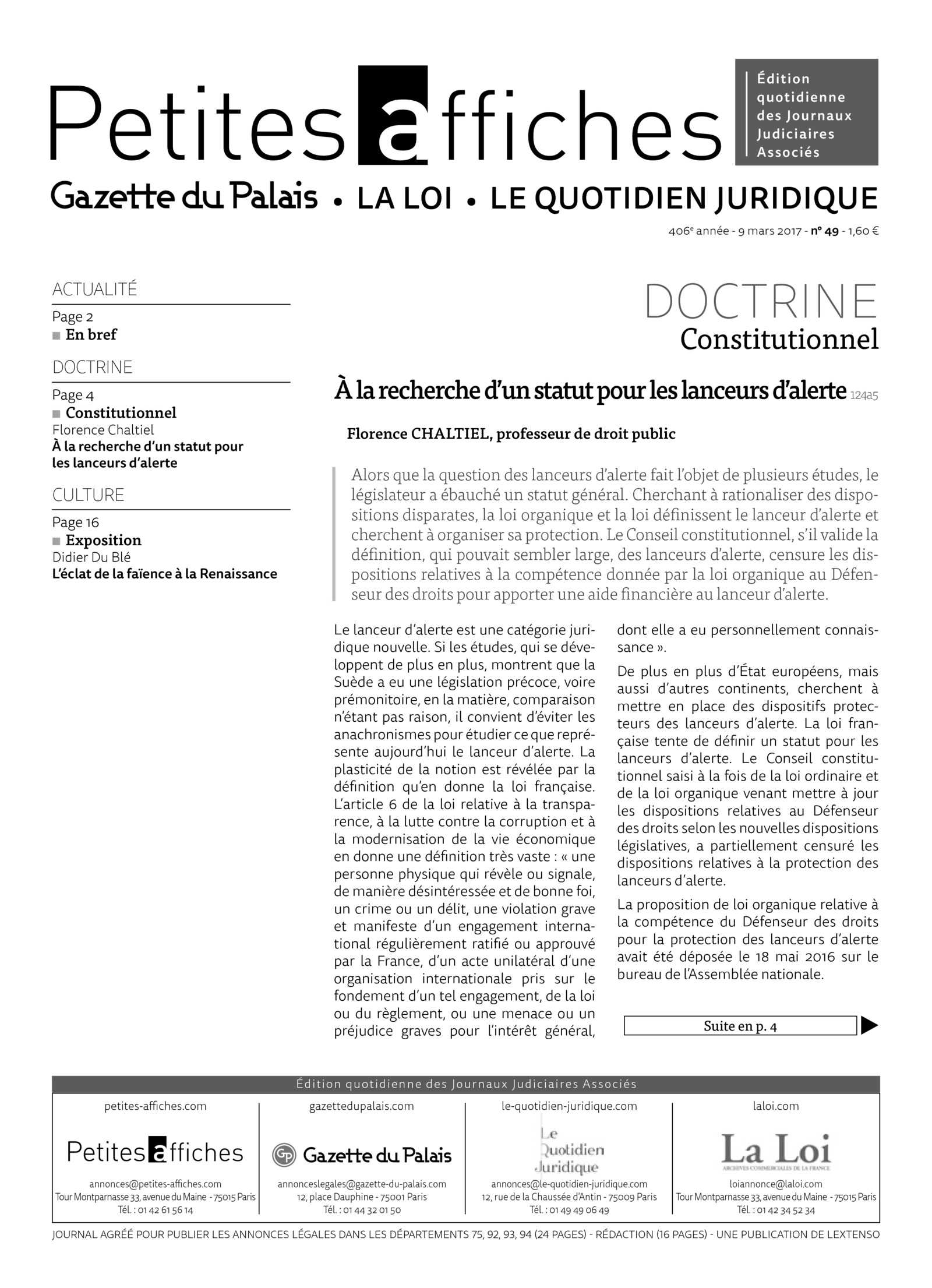À la recherche d’un statut pour les lanceurs d’alerte
Alors que la question des lanceurs d’alerte fait l’objet de plusieurs études, le législateur a ébauché un statut général. Cherchant à rationaliser des dispositions disparates, la loi organique et la loi définissent le lanceur d’alerte et cherchent à organiser sa protection. Le Conseil constitutionnel, s’il valide la définition, qui pouvait sembler large, des lanceurs d’alerte, censure les dispositions relatives à la compétence donnée par la loi organique au Défenseur des droits pour apporter une aide financière au lanceur d’alerte.
Le lanceur d’alerte est une catégorie juridique nouvelle. Si les études, qui se développent de plus en plus1, montrent que la Suède2 a eu une législation précoce, voire prémonitoire, en la matière, comparaison n’étant pas raison, il convient d’éviter les anachronismes pour étudier ce que représente aujourd’hui le lanceur d’alerte. La plasticité de la notion est révélée par la définition qu’en donne la loi française. L’article 6 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique en donne une définition très vaste : « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ».
De plus en plus d’État européens, mais aussi d’autres continents, cherchent à mettre en place des dispositifs protecteurs des lanceurs d’alerte. La loi française tente de définir un statut pour les lanceurs d’alerte. Le Conseil constitutionnel saisi à la fois de la loi ordinaire et de la loi organique venant mettre à jour les dispositions relatives au Défenseur des droits selon les nouvelles dispositions législatives, a partiellement censuré les dispositions relatives à la protection des lanceurs d’alerte3.
La proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d’alerte avait été déposée le 18 mai 2016 sur le bureau de l’Assemblée nationale. Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée le 20 mai 2016. Le texte a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 14 juin 2016 puis, après modification, par le Sénat le 8 juillet 2016. Après la réunion d’une commission mixte paritaire (CMP) qui n’est pas parvenue à trouver un accord sur un texte le 14 septembre 2016, la proposition de loi organique a été adoptée en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016 puis, après modification, par le Sénat le 3 novembre 2016. La loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte a été adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016 en application du quatrième alinéa de l’article 45 de la Constitution. La loi organique était déférée au Conseil constitutionnel par le Premier ministre, en application du cinquième alinéa de l’article 46 et du premier alinéa de l’article 614.
Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a été délibéré en conseil des ministres le 30 mars 2016. Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée le même jour. Le texte a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale puis, après modification, par le Sénat, respectivement les 14 juin et 8 juillet 2016. Après l’échec de la commission mixte paritaire le 14 septembre 2016, le projet a été adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 29 septembre suivant puis, après modification, par le Sénat le 3 novembre. La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a été adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 8 novembre 2016 en application du quatrième alinéa de l’article 45 de la Constitution. La loi était déférée au Conseil constitutionnel par le président du Sénat, plus de soixante sénateurs, plus de soixante députés et, enfin, le Premier ministre.
Par deux décisions rendues le même jour5, le Conseil constitutionnel valide le principe d’un statut donné aux lanceurs d’alerte, ainsi que le rôle d’orientation qui sera désormais dévolu au Défenseur des droits, mais censure notamment la fonction d’aide financière aux lanceurs d’alerte que conféraient les deux textes soumis à examen constitutionnel au Défenseur des droits.
Les institutions européennes, que ce soit du Conseil de l’Europe ou de l’Union européenne, apportent aussi leurs pierres aux réflexions en cours sur un sujet dont les contours restent encore mal définis (I). Le flou des définitions se double d’imprécisions ou d’hésitations sur la nature de la protection à apporter aux lanceurs d’alerte (II).
I – Le lanceur d’alerte : une catégorie nouvelle aux contours mal définis
Si l’on trouve souvent l’information selon laquelle la Suède fut précurseur en la matière, avec des dispositions législatives remontant au XVIIIe siècle6, une telle approche semble davantage relever de l’anachronisme, même si l’existence de ces protections est intéressante à relever.
Plusieurs États européens (A) se sont dotés de législations relatives aux lanceurs d’alerte7. Le point commun est celui de la recherche d’une protection contre les représailles possibles dans les cas de lancement d’alerte. Les dimensions de la question expliquent sans doute, conformément au principe de subsidiarité qui irrigue la pensée européenne, que les instances européennes se soient saisies de la question (B). Il importe de souligner la dimension internationale voire mondiale du phénomène des lanceurs d’alerte, puisque l’on trouve des législations dans de nombreux États du monde dont en Amérique du Nord (C).
A – Les bases législatives existantes dans plusieurs États européens
Si certaines lois sont déjà bien établies même si mises à jour régulièrement (1), d’autres États semblent tâtonner sur les dispositifs à mettre en place (2). La France s’inscrit dans cette logique (3).
1 – L’existence de lois relatives aux lanceurs d’alerte
Le Royaume-Uni a adopté en 1998 une loi globale protégeant les lanceurs d’alerte des secteurs publics et privés, le Public Interest Disclosure Act, dont les commentaires laissent penser que cette législation offre un dispositif équilibré8. Outre un signalement gradué par paliers, elle offre à la fois une protection en amont – avec un référé conservatoire d’emploi jusqu’au procès –, et en aval – avec un dédommagement intégral de la perte de revenus (incluant les années de retraite) et de la souffrance morale.
Il s’agit donc d’un double mécanisme de prévention et réparation, qui ne comporte cependant ni rétrocession ni récompense. En 2013, cette loi a été amendée, en recentrant la définition du signalement sur le concept d’intérêt général, et ajoutant une protection, avec sanctions pénales, contre les représailles de tierces parties, comme par exemple, les collègues de travail.
Plus précisément, l’origine remonte aux années 1990, s’agissant de ce pays. Dans les années 1980 et 1990, la Grande-Bretagne a connu une série de catastrophes sanitaires et de scandales financiers qui l’ont poussée à agir : il est ainsi notamment du naufrage d’un ferry au large de Zeebrugge en 1987 causant 193 morts, de l’explosion de la plate-forme pétrolière Piper Alpha en Mer du Nord en 1988 faisant 160 décès, de la faillite du groupe Maxwell en 1991 révélant la fraude de £ 440 millions sur des pensions de retraite.
Les rapports publics d’enquête sont parvenus à la conclusion que ces catastrophes auraient pu être évitées si les salariés des entreprises concernées avaient révélé les dysfonctionnements internes à leur entreprise. C’est dans ces circonstances que dans la quasi-unanimité et en raison de l’intérêt public (public interest), le Parlement britannique a adopté le 29 juin 1998 le Public Interest Disclosure Act (PIDA)9. L’objectif de cette législation est double : d’une part, accorder une large protection aux salariés lanceurs d’alerte, d’autre part encourager les entreprises britanniques à adopter des procédures internes afin de favoriser les lancements d’alertes. Le PIDA introduit plusieurs amendements dans l’Employment Rights Act de 1996 (ERA) qui est la grande loi prescrivant les droits fondamentaux des salariés.
La section 43B de l’ERA 1996 énonce alors une série de situations qui doivent susciter l’alerte : un crime ou un délit a été commis ou est en voie de l’être ; une personne ne respecte pas ou risque de ne pas respecter une obligation légale à laquelle elle est soumise ; un dysfonctionnement de la justice est survenue ou va survenir ; la santé ou la sécurité d’une personne est en danger ou risque de l’être ; un danger est causé ou sera causé à l’environnement ; la dissimulation d’une information d’un des éléments précités.
Le lanceur d’alerte anglais n’est donc protégé que si l’alerte tombe dans l’une de ces six catégories ci-dessus. La jurisprudence britannique est abondante et offre de nombreuses illustrations. Pour être protégé, le salarié anglais doit révéler des faits et non de simples sentiments ou des amertumes10. Le salarié n’est pas obligé de suivre une procédure ou forme spéciale pour lancer son alerte (communication orale, communication écrite, emails, lettre d’avocats, enregistrement vidéo).
Le lanceur d’alerte britannique doit avoir une « reasonable belief », c’est-à-dire une croyance raisonnable dans la légitimité de son alerte11. Comme dans les textes français, le lanceur d’alerte anglais devait également agir de bonne foi12. Toutefois, l’Entreprise and Regulatory Reform Act de 2013 a supprimé cette condition qui attirait de nombreuses critiques selon lesquelles il convient de se concentrer sur le contenu de l’alerte que sur les motivations du lanceur d’alerte (mais les tribunaux peuvent toujours tenir compte de la mauvaise foi du salarié pour diminuer les dommages intérêts accordés de 25 %).
Depuis le 25 juin 2013, l’exigence de bonne foi a été remplacée par celle de l’alerte faite dans l’intérêt du public13.
Le lanceur d’alerte anglais est protégé contre toute mesure de rétorsion, disciplinaire, de harcèlement, ou de licenciement motivée par l’alerte. La protection est large et comprend les salariés du secteur privé et publique (y compris la police voire l’armée dans certains cas) ainsi qu’une catégorie particulière de travailleurs (independant workers)14.
La jurisprudence britannique donne aussi plusieurs exemples de protection des lanceurs d’alerte contre les mauvais traitements (detriments) infligés par leur employeur en raison de l’alerte : mise à pied15, mutation professionnelle16, mutation géographique17, désignation publique du lanceur d’alerte dans l’entreprise18, mise au placard19, harcèlement moral et exclusion20.
Concernant la protection contre le licenciement, il reviendra au salarié de prouver que la véritable raison de son licenciement est fondée sur l’alerte. En pratique, quand le salarié apporte des indices sérieux laissant soupçonner un licenciement abusif, il reviendra à l’employeur d’apporter la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement21.
Les tribunaux anglais punissent très sévèrement les employeurs lorsqu’ils ont été convaincus de whistleblowing. Le salarié doit être réparé dans l’intégralité de son préjudice moral et financier : ainsi du préjudice moral : les dommages intérêts varient entre £ 500 et £ 25 00022 ; des dommages-intérêts punitifs et complémentaires peuvent être accordés (aggravated damages) et peuvent monter jusqu’à £ 20 00023. S’agissant du préjudice financier, il n’est pas soumis au plafond habituel de dommages intérêts des tribunaux anglais24. Le préjudice financier tient compte de l’âge du lanceur d’alerte et de ses chances de retrouver un autre emploi en cas de licenciement. Dans cette récente affaire tranchée le 17 août 201125, un lanceur d’alerte de 53 ans s’est vu alloué £ 1 201 453 de dommages-intérêts26.
L’Irlande a repris en 2014 son architecture et sa philosophie, avec des amendements tel l’élargissement du champ matériel, ou l’immunité en termes de procédure civile. Plusieurs États d’Europe centrale et orientale se sont dotés de dispositions de définition et de protection des lanceurs d’alerte. Les bases législatives restent, dans l’ensemble, assez récentes, dans ces États, tandis que d’autres États sont encore à la recherche de la législation qui devra permettre de répondre au mieux aux défis que pose la réflexion sur les lanceurs d’alerte.
2 – Des lois en préparation dans plusieurs États
D’autres États européens, s’ils ont des législations visant à lutter contre la corruption et les scandales financiers, commencent à mettre en place des législations plus englobantes. L’Allemagne et l’Italie entrent dans ce processus.
S’agissant de l’Italie, les réflexions sont directement axées sur les scandales financiers et la lutte contre la corruption. L’Allemagne connaît déjà quelques bases juridiques de définition et de protection des lanceurs d’alerte sans que la législation ne soit encore assez englobante. Les ministres de la Justice des länder avaient eu l’occasion de se réunir au printemps 2016, mais la législation rente encore en préparation.
Le législateur français a tenté de mettre en place un régime englobant des lanceurs d’alerte, quant aux définitions et aux protections.
3 – La loi française vise à une définition globale
Les lois françaises organisent, chacune dans son domaine lorsqu’il y a lieu, des éléments de définition des lanceurs d’alerte. Le chapitre II de la loi ordinaire faisant l’objet de la décision commentée crée un régime juridique général de protection des lanceurs d’alerte.
Le droit français connaît déjà de tels régimes spécifiques en matière de travail27, de renseignement, de sécurité sanitaire, de santé publique ou d’environnement.
L’article 6 définit les lanceurs d’alerte et exclut du régime de l’alerte institué par la loi les éléments « couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client ».
L’article 7 instaure, au bénéfice des lanceurs d’alerte, une irresponsabilité pénale pour la divulgation des secrets protégés par la loi, lorsque « cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte prévus à l’article 6 [précité] ».
L’article 8 organise une telle procédure de signalement, selon une « gradation des canaux de signalement » en trois niveaux : l’alerte doit être adressée au supérieur hiérarchique, à l’employeur ou à un référent désigné par celui-ci (1er niveau) ; à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels (2e niveau) ; à défaut de traitement dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public (3e niveau). En cas d’urgence (« danger grave et imminent » ou « risque de dommages irréversibles »), le lanceur d’alerte peut directement s’adresser aux autorités du deuxième niveau voire rendre public son alerte. L’article prévoit également la mise en place de procédures de recueil des signalements.
Les autres articles sont relatifs à la confidentialité des procédures de recueil de signalement (art. 9), à la protection des lanceurs d’alerte contre les mesures de représailles dans le cadre professionnel (art. 10), aux possibilités de saisir la justice en cas de licenciement en représailles à une alerte (art. 11 et 12), et à la création d’un délit d’entrave au signalement d’une alerte (art. 13). L’article 14 précise les modalités de l’aide financière susceptible d’être accordée par le Défenseur des droits à un lanceur d’alerte, conformément à ce que prévoyait la loi organique examinée par le Conseil constitutionnel le même jour que la loi ordinaire. L’article 15 est propre aux lanceurs d’alerte dans le cadre militaire et l’article 16 prévoit un dispositif spécifique de protection des lanceurs d’alerte, signalant un manquement dans le domaine financier auprès de l’autorité des marchés financiers ou de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution28.
La loi apporte ainsi désormais une définition unique, se substituant ou complétant les dispositifs préexistants. Même large, elle est jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. L’article 6 de la loi donne en effet une définition du lanceur d’alerte. L’article 7 confère à ce dernier une irresponsabilité pénale pour la divulgation de certains secrets protégés par la loi, sous trois conditions cumulatives : la divulgation du secret doit être nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause ; le lanceur d’alerte doit correspondre à la définition qu’en donne l’article 6 ; il doit avoir respecté les procédures de signalement prévues par la loi. L’article 8 organise une procédure de signalement.
Cette procédure exige que l’intéressé porte d’abord l’alerte à la connaissance de son supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de son employeur ou du référent désigné par celui-ci. En l’absence de diligence de cette personne, le signalement peut alors être adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels. À défaut de traitement par ces derniers dans un délai de trois mois, il peut être rendu public. En cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être adressé directement à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative et aux ordres professionnels et être rendu public. Le paragraphe III de l’article 8 impose à certains organismes publics ou privés de mettre en place, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, des procédures appropriées de recueil des signalements pour leur personnel et leurs collaborateurs extérieurs ou occasionnels. Le paragraphe IV prévoit que toute personne peut interroger le Défenseur des droits afin d’être orientée vers l’organisme approprié de recueil de l’alerte.
La confection de ces dispositions29 a donné lieu à de nombreux échanges entre les deux chambres et à des modifications nombreuses, comme en témoignent les travaux parlementaires.
Les sénateurs requérants reprochaient à l’article 6 de définir de manière imprécise le lanceur d’alerte. Il en résulterait une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, de l’article 34 de la Constitution, du principe d’égalité et du principe de proportionnalité des peines, dans la mesure où cette définition détermine l’application de l’irresponsabilité pénale prévue à l’article 7 de la loi déférée. Les sénateurs requérants ajoutaient qu’en raison de l’imprécision de l’expression « une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général », cette disposition est contraire à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
Les sénateurs requérants reprochaient, en outre, à l’article 8 de méconnaître ce même objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi dans la mesure où, alors que la définition du lanceur d’alerte prévue à l’article 6 vise « une personne physique », sans plus de précision, la procédure de signalement définie à cet article 8 ne semble concerner que les employés de l’organisme faisant l’objet de l’alerte.
Le Conseil constitutionnel rappelle que l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. Il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi30.
En premier lieu, le juge constitutionnel indique que l’article 6 définit le lanceur d’alerte comme « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ». Il exclut toutefois du régime juridique de la protection des lanceurs d’alerte, défini au chapitre II de la loi déférée, les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client. Les critères de définition du lanceur d’alerte ainsi retenus ne sont pas imprécis31.
En second lieu, le Conseil constitutionnel souligne que la procédure de signalement prévue à l’article 8 est organisée en trois phases successives dont la loi fixe l’ordre. Or, le juge relève que la première de ces phases, qui prévoit que le signalement est adressé au supérieur hiérarchique, à l’employeur ou au référent que celui-ci a désigné ne peut concerner qu’une personne employée par l’organisme mis en cause ou, en application du paragraphe III de l’article 8, un collaborateur extérieur ou occasionnel de cet organisme. De la même manière, les protections apportées par les articles 10 à 12, aux lanceurs d’alerte répondant aux conditions des articles 6 à 8, se limitent aux discriminations que ces derniers sont susceptibles de subir dans le cadre de leur vie professionnelle.
Le champ couvert par l’article 6 est donc plus large que celui couvert par l’article 8, puisqu’il ne se limite pas, lui, au cadre professionnel. Toutefois, pour le Conseil constitutionnel, il n’en résulte aucune inintelligibilité : la définition de l’article 6 « a vocation à s’appliquer non seulement aux cas prévus par l’article 8, mais aussi, le cas échéant, à d’autres procédures d’alerte instaurées par le législateur, en dehors du cadre professionnel » (même paragr.). On peut d’ailleurs observer que le législateur a pris soin de préciser à l’article 7, qui instaure une irresponsabilité pénale, que le lanceur d’alerte doit non seulement répondre aux critères de l’article 6, mais aussi avoir respecté les « procédures de signalement définies par la loi ». La procédure prévue à l’article 8 n’est, à ce titre, qu’une procédure parmi d’autres32.
Il résulte ainsi des termes et de l’objet des articles 8 et 10 à 12, selon l’interprétation qu’en donne le Conseil constitutionnel, que le législateur a entendu limiter le champ d’application de l’article 8 aux seuls lanceurs d’alerte procédant à un signalement visant l’organisme qui les emploie ou celui auquel ils apportent leur collaboration dans un cadre professionnel. Le fait que le législateur ait retenu, à l’article 6, une définition plus générale du lanceur d’alerte, ne se limitant pas aux seules personnes employées par l’organisme faisant l’objet du signalement non plus qu’à ses collaborateurs, n’a pas pour effet de rendre les dispositions contestées inintelligibles. En effet, cette définition a vocation à s’appliquer non seulement aux cas prévus par l’article 8, mais aussi, le cas échéant, à d’autres procédures d’alerte instaurées par le législateur, en dehors du cadre professionnel.
Il résulte de ce qui précède que les articles 6 et 8 ne méconnaissent pas l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Le juge estime enfin que l’article 6 de la loi déférée, qui ne méconnaît par ailleurs ni le principe de légalité des délits et des peines, ni l’article 34 de la Constitution, ni le principe d’égalité, ni la proportionnalité des peines, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. Il en va de même de l’article 8 de la loi déférée33. Nous verrons plus bas que le dispositif de protection financière a, quant à lui, été censuré.
Comme on le voit à travers ce panorama des législations en place ou en cours de réalisation, la recherche de la bonne définition, la recherche de la bonne protection, demandent de nombreuses réflexions. La philosophie du principe de subsidiarité explique sans doute aussi que les instances européennes se soient saisies du sujet. En effet, en vertu de ce principe, dès lors que les effets d’une législation dépassent les frontières d’un seul État membre, les instances supranationales sont légitimées à agir. Pour autant les questions que les États se posent, et qui peuvent, dans certains cas, conduire à des blocages ou à des reports de réalisation de la législation recherchée, se retrouvent aussi à l’échelle européenne.
B – La participation des instances européennes aux réflexions sur les lanceurs d’alerte
Parallèlement à cette expérimentation législative mondiale et européenne, et en tirant les enseignements (avec l’expertise des ONG dont TI), le Conseil de l’Europe élaborait de 2009 à 2014 un corpus théorique pionnier, notamment avec la recommandation du Comité des ministres du 30 avril 2014, retenant pour définition le signalement « d’une menace ou d’un préjudice pour l’intérêt général », avec en amont le référé conservatoire d’emploi, et en aval l’aménagement de la charge de la preuve, et la protection contre toutes représailles, actives ou passives. Ni incitation ni récompense financière, mais la question d’une aide ou compensation financière pour régler les frais de justice était utilement abordée lors des débats.
Ainsi, le Conseil de l’Europe recommande aux États membres de disposer d’un cadre normatif, institutionnel et judiciaire pour protéger les personnes qui, dans le cadre de leurs relations de travail, font des signalements ou révèlent des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l’intérêt général. À cette fin, l’annexe à la recommandation énonce une série de principes destinés à guider les États membres lorsqu’ils passent en revue leurs législations nationales ou lorsqu’ils adoptent ou modifient les mesures législatives et réglementaires qui peuvent être nécessaires et appropriées dans le cadre de leur système juridique. Le cadre national normatif, institutionnel et judiciaire, y compris, le cas échéant, les conventions collectives de travail, devrait être conçu et développé dans le but de faciliter les signalements et les révélations d’informations d’intérêt général en établissant des règles destinées à protéger les droits et les intérêts des lanceurs d’alerte34.
C – Les systèmes existant hors cadre européen
L’Amérique du Nord s’illustre par plusieurs mécanismes qui ne semblent pas transposables aux systèmes européens que l’on vient d’aborder.
Au Canada, la loi, qui est entrée en vigueur le 15 avril 2007, s’applique à presque l’ensemble du secteur public fédéral, soit environ 400 000 fonctionnaires. Sont inclus les ministères et les organismes, les sociétés d’État mères, la Gendarmerie royale du Canada et d’autres organismes du secteur public fédéral.
Les Forces canadiennes, le Service canadien du renseignement de sécurité et le Centre de sécurité des télécommunications ne sont pas couverts par la loi. Ces organismes doivent établir leurs propres mécanismes similaires à ceux établis au titre de la loi pour traiter des actes répréhensibles. La loi ne s’applique pas aux représentants élus ni à leur personnel. De même, les employés de la chambre des communes et du Sénat en sont exclus. La loi fournit un mécanisme qui permet aux employés du secteur public fédéral de divulguer des renseignements qui, selon eux, peuvent démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être, ou qu’il leur a été demandé de commettre un tel acte. La loi protège les fonctionnaires qui ont divulgué contre d’éventuelles représailles. Enfin, elle respecte le droit à la justice naturelle et à l’équité procédurale de toutes les personnes impliquées dans un processus de divulgation ou de représailles. La loi s’inscrit dans un continuum, qui commence par la création d’un environnement de travail où le dialogue sur les valeurs et l’éthique est encouragé, où les employés se sentent à l’aise de soulever leurs préoccupations sans crainte de représailles, et où on encourage la bonne conduite.
Le préambule de la loi précise que la fonction publique est une institution nationale essentielle au fonctionnement de la démocratie parlementaire canadienne ; il est dans l’intérêt public de maintenir et d’accroître la confiance du public dans l’intégrité des fonctionnaires ; la confiance dans les institutions publiques ne peut que profiter d’un régime de divulgation interne et de protection des divulgateurs ; la loi vise à atteindre l’équilibre entre le devoir de loyauté des fonctionnaires envers leur employeur et la liberté d’expression garantie par la Charte canadienne des droits et libertés ; le gouvernement du Canada s’engage à adopter une charte des valeurs pour le service public.
En vertu de la loi, le ministre responsable du secrétariat du Conseil du Trésor doit encourager dans le secteur public un environnement favorable à la divulgation des actes répréhensibles. De plus, le Conseil du Trésor doit établir un code de conduite applicable à l’ensemble du secteur public qui est entré en vigueur le 1er avril 2012. Les administrateurs généraux doivent également établir un code de conduite applicable à l’organisme dont ils sont responsables. Ce code doit être compatible avec celui du Conseil du Trésor.
Compte tenu de la nature fédérale du Canada, il importe de citer une législation en préparation au Québec, en ce qu’elle met en évidence des difficultés qui sont communes à la réflexion sur les lanceurs d’alerte. Ainsi, en novembre 2016, on pouvait lire dans la presse québécoise que « Le Parti québécois exige une protection des sources journalistiques qui dévoilent des scandales gouvernementaux, ce qui n’est pas prévu dans le projet de loi déposé par les libéraux ». « Permettre la divulgation publique, c’est ouvrir une porte supplémentaire pour que la vérité éclate, même si parfois cette vérité dérange. Pourquoi le ministre ne se donne pas tous les moyens pour favoriser la divulgation et protéger les lanceurs d’alerte ? », a lancé la députée Nicole Léger lors de la période de questions.
L’article 6 du projet de loi 87 « facilitant la divulgation d’actes répréhensibles dans les organismes publics » est controversé. Il a été critiqué par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, car il est un obstacle supplémentaire pour le lanceur d’alerte qui souhaite parler aux médias. « Ce projet de loi, loin de simplifier les choses pour les sonneurs d’alarme, place le fardeau de la preuve sur leurs épaules », disait l’organisme lors de son passage en commission parlementaire.
En effet, l’article stipule que pour divulguer au public des actes répréhensibles, une personne devra prouver que cet acte représente un « risque grave pour la santé ou la sécurité d’une personne ou pour l’environnement ». Et ce n’est pas tout, avant de contacter un journaliste, un fonctionnaire doit obligatoirement « communiquer ces renseignements à la police ou au commissaire » de l’UPAC. Certes le projet de loi permet aux fonctionnaires de faire leur plainte au Protecteur du citoyen, mais ces conditions semblent difficiles à mettre en place. Le projet de loi 87 prévoit de protéger les lanceurs d’alertes du gouvernement provincial, des municipalités et des entreprises privées qui ont des contrats gouvernementaux35. Le texte est en débat.
S’agissant des États-Unis d’Amérique, le système se caractérise par des récompenses, que les systèmes européens semblent chercher à éviter. La loi revue en 2007, permet aux employés de livrer des preuves « de violation de la loi, du règlement ou de la réglementation », « de mauvaise gestion, de gros gaspillage de fonds, un abus d’autorité, ou un danger spécifique pour la santé ou la sécurité publique ».
Ces révélations sont autorisées par ce texte sauf si elles sont interdites par loi ou s’il est exigé qu’elles restent secrètes. Bradley Manning (devenu Chelsea Manning) et Edward Snowden rentrent exactement dans ces exceptions. Il faut mentionner une autre importante restriction de cette loi : elle ne s’applique pas aux employés de la poste américaine (UPS), de la NSA (pour laquelle travaillait Snowden) ou encore du FBI. Aucune protection n’existe donc pour les deux lanceurs d’alerte américains d’autant plus que Bradley Manning, étant militaire, dépend de la justice martiale.
Cependant, les salariés d’une entreprise peuvent être, normalement, davantage protégés. Les Américains ont ainsi mis en place un site internet gouvernemental sur lequel il est possible de remplir une déclaration sur des conditions de travail dangereuses, des problèmes environnementaux, des risques pour la sécurité publique, etc. Ces dénonciations peuvent être faites sans qu’aucune représailles de la part de leur employeur ne soient craintes grâce à l’Occupational Safety and Health Act (OSH Act).
Si l’on parle beaucoup dans les médias des whistleblowers dans le cadre de partage de données sur internet, d’autres lanceurs d’alerte agissent aussi au sein des entreprises36.
On constate que les lanceurs d’alerte sont devenus une catégorie juridique à part entière, qui se distingue de la notion classique d’obligation de dénonciation contenue en France à l’article 40 du Code de procédure pénale : toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Cette définition aura à être précisée par la jurisprudence. La protection du lanceur d’alerte est un sujet d’importance majeure dont les contours demandent encore à être précisés, d’autant plus après la censure partielle de la loi par le juge constitutionnel.
II – La protection du lanceur d’alerte : un accompagnement encore à préciser
Les lanceurs d’alerte prennent incontestablement des risques. Les risques sont liés aux possibles représailles, aux discriminations dont ils pourraient faire l’objet suite à un lancement d’alerte. L’utilité des lanceurs d’alerte en termes d’intérêt général oblige les États à mettre en place des mécanismes de protection.
Comme on l’a vu plus haut, la notion de récompense semble, pour le moment, devoir être exclu des législations européennes. Pour autant, il importe de trouver les mécanismes les plus pertinents de protection.
La loi française avait envisagé une aide financière accordée par le Défenseur des droits dans deux hypothèses. Mais le dispositif a été censuré par le Conseil constitutionnel faute de base juridique de compétence du Défenseur des droits en la matière (A). Les autres dispositions relatives à la protection des lanceurs d’alerte ont, elles, été validées par le Conseil constitutionnel, laissant dès lors en suspens la question d’une éventuelle aide financière (B).
A – La censure des dispositions relative au pouvoir d’aide financière du lanceur d’alerte par le Défenseur des droits
Le Conseil constitutionnel avait déjà eu à se prononcer sur la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles relatives au défenseur des droits par la loi organique. Dans sa décision de 2011, il avait en effet jugé « qu’aux termes de l’article 2 de la loi organique : “Le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, ne reçoit, dans l’exercice de ses attributions, aucune instruction. Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l’occasion des opinions qu’ils émettent ou des actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions” ». Le Conseil constitutionnel a alors estimé « qu’en érigeant le Défenseur des droits en “autorité constitutionnelle indépendante”, le premier alinéa de l’article 2 rappelle qu’il constitue une autorité administrative dont l’indépendance trouve son fondement dans la Constitution ; que cette disposition n’a pas pour effet de faire figurer le Défenseur des droits au nombre des pouvoirs publics constitutionnels ». Il avait souligné d’autre part, « que nul ne saurait, par une disposition générale de la loi, être exonéré de toute responsabilité personnelle quelle que soit la nature ou la gravité de l’acte qui lui est imputé ; que, si le législateur organique pouvait, pour garantir l’indépendance du Défenseur des droits et de ses adjoints, prévoir qu’ils bénéficient d’une immunité pénale, il devait, dans la définition de l’étendue de cette immunité, concilier le but ainsi poursuivi avec le respect des autres règles et principes de valeur constitutionnelle et, en particulier, le principe d’égalité ». Il avait ensuite jugé « que, dès lors, l’immunité pénale reconnue au Défenseur des droits et à ses adjoints ne saurait s’appliquer qu’aux opinions qu’ils émettent et aux actes qu’ils accomplissent pour l’exercice de leurs fonctions ; qu’elle ne saurait exonérer le Défenseur des droits et ses adjoints des sanctions encourues en cas de méconnaissance des règles prévues par les articles 20 et 29 de la loi organique, sur les secrets protégés par la loi, et par son article 22, sur la protection des lieux privés ; que, sous ces réserves, les dispositions de l’article 2 sont conformes à la Constitution »37.
De nouveau, à propos des lanceurs d’alerte cette fois le Conseil constitutionnel juge que le législateur organique a conféré des prérogatives qui outrepassent ce qu’autorise la Constitution.
S’inspirant d’une recommandation formulée par le Conseil d’État, dans son étude relative aux lanceurs d’alerte38, le rapporteur du texte pour la commission des lois de l’Assemblée nationale, Sébastien Denaja, a défendu en première lecture à l’Assemblée nationale l’adoption concomitante, avec l’examen du projet de loi ordinaire, d’une proposition de loi organique confiant au Défenseur des droits une mission de protection des lanceurs d’alerte.
La loi organique qui en résulte ne comporte qu’un article attribuant au Défenseur des droits, par ajout d’un 5° à l’article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, la compétence nouvelle « d’orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de cette personne et, en tant que de besoin, de lui assurer une aide financière ou un secours financier ». L’article 10 de la même loi organique est modifié pour prévoir que le Défenseur des droits « ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° du même article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi ». L’article 11 est modifié pour étendre aux nouvelles missions du Défenseur des droits les compétences du collège qui l’assiste en matière de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité. L’article 20 est complété pour prévoir que « Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles ».
Or l’article 71-1 de la Constitution, consacré au Défenseur des droits, précise que « Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences ». Son troisième alinéa renvoie à la loi organique pour la définition des attributions et les modalités d’intervention du Défenseur des droits. Trois attributions nouvelles étaient ainsi confiées au Défenseur des droits : d’une part, l’« orientation » des lanceurs d’alerte, d’autre part la mission de veiller à leurs droits et libertés et, enfin, la charge de leur conférer « en tant que de besoin » une aide financière ou un secours financier39. Rappelant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 71-1 de la Constitution : « Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences », le Conseil constitutionnel admet que ces dispositions de l’article 71-1 de la Constitution permettent au Défenseur des droits d’aider toute personne s’estimant victime d’une discrimination à identifier les procédures adaptées à son cas. Par coordination, l’article 14 de la loi ordinaire précisait les conditions et les modalités d’attribution de cette aide ou de ce secours financier.
Si l’on observe les travaux parlementaires, il en ressort qu’en créant le Défenseur du droit par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Constituant a entendu permettre que soient notamment rassemblées au sein de cette institution les missions exercées jusqu’alors par un certain nombre d’autorités administratives indépendantes. Alors que sa compétence était initialement limitée aux dysfonctionnements des services publics, elle a été étendue, lors de l’examen parlementaire, jusqu’à recouvrir la mission générale de veiller au respect des droits et libertés par les personnes publiques ou tout organisme à l’égard duquel la loi organique confère compétence au Défenseur des droits.
Le législateur organique a pu, sur ce fondement, attribuer au Défenseur des droits les missions et les pouvoirs du Médiateur de la République, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations (HALDE), du Défenseur des enfants et de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS).
Dans sa décision du 29 mars 201140, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de la loi organique précisant les missions du Défenseur des droits, et fixant la liste des personnes physiques ou morales qui peuvent le saisir ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être saisi ou se saisir d’office, étaient conformes à la Constitution. Il se déduit notamment de cette décision que le législateur organique peut étendre le périmètre de compétence du Défenseur des droits aux organismes privés.
Dans la décision du 8 décembre 2016 relative à la loi organique, le Conseil constitutionnel a logiquement validé la compétence conférée au Défenseur des droits pour l’orientation des lanceurs d’alerte41. Il a en effet relevé que les dispositions précitées du premier alinéa de l’article 71-1 de la Constitution « permettent au Défenseur des droits d’aider toute personne s’estimant victime d’une discrimination à identifier les procédures adaptées à son cas ». Il était donc loisible au législateur organique, « qui a estimé que les lanceurs d’alerte courent le risque d’être discriminés par l’organisme faisant l’objet de leur signalement, de charger le Défenseur des droits d’orienter ces personnes vers les autorités compétentes, en vertu de la loi, pour recueillir leur signalement »42.
La nouvelle compétence confiée au Défenseur des droits présente en effet de larges similitudes avec celle que la loi organique lui a d’ores et déjà conféré en matière de lutte contre les discriminations. Les représailles ou les mesures de rétorsions auxquelles s’exposent les lanceurs d’alerte sont constitutives de telles discriminations. Or, conformément à l’article 27 de la loi organique du 29 mars 2011, le Défenseur des droits peut d’ores et déjà « assister » les personnes victimes de discrimination et les aider « à identifier les procédures adaptées à [leur] cas », ce qui s’analyse comme une compétence d’orientation.
En revanche, le Conseil constitutionnel a considéré que « la mission confiée par les dispositions constitutionnelles précitées au Défenseur des droits de veiller au respect des droits et libertés ne comporte pas celle d’apporter lui-même une aide financière, qui pourrait s’avérer nécessaire, aux personnes qui peuvent le saisir » (paragr. 5). Ce faisant, le Conseil a fixé une limite aux prérogatives potentielles du Défenseur des droits. Cette autorité dispose de nombreux pouvoirs : elle peut ainsi, dans l’exercice de ses fonctions et conformément à la loi organique du 29 mars 2011, réaliser des auditions ou recueillir des informations (art. 18 et 20 de ce texte), le cas échéant avec la possibilité de mettre en demeure des personnes sollicitées (art. 21), procéder à des vérifications sur place (art. 22), faire des recommandations (art. 25, 30 et 31), proposer une résolution amiable du conflit (art. 26) ou une transaction (art. 28), saisir les autorités investies du pouvoir d’engager des poursuites (art. 29), saisir, pour les mineurs, le service d’aide social à l’enfance (art. 35), présenter des observations aux juridictions (art. 33) ou conduire des actions de communication et d’information sur les sujets entrant dans son champ de compétence (art. 34). Le Conseil constitutionnel a jugé que le soutien financier des personnes qui le saisissent n’entre cependant pas dans ses attributions telles que définies par la Constitution.
Le Conseil constitutionnel en déduit donc qu’il était donc loisible au législateur organique, qui a estimé que les lanceurs d’alerte courent le risque d’être discriminés par l’organisme faisant l’objet de leur signalement, de charger le Défenseur des droits d’orienter ces personnes vers les autorités compétentes, en vertu de la loi, pour recueillir leur signalement.
En revanche, la mission confiée par les dispositions constitutionnelles précitées au Défenseur des droits de veiller au respect des droits et libertés ne comporte pas celle d’apporter lui-même une aide financière, qui pourrait s’avérer nécessaire, aux personnes qui peuvent le saisir. Dès lors, le Conseil constitutionnel juge que législateur organique ne pouvait, sans méconnaître les limites de la compétence conférée au Défenseur des droits par la Constitution, prévoir que cette autorité pourrait attribuer aux intéressés une aide financière ou un secours financier.
Il en résulte que les mots « et, en tant que de besoin, de lui assurer une aide financière ou un secours financier » figurant au 1° de l’article unique de la loi organique déférée, sont contraires à la Constitution.
Cette censure apparaît quasiment insurmontable en ce que seule une révision constitutionnelle augmentant le champ de compétence du défenseur des droits pourrait permettre de mettre en application les dispositions censurées. Cette voie est probablement à exclure à moyen terme en tout cas.
En l’absence de compétence d’une autorité administrative indépendante comme le Défenseur des droits pour apporter un soutien financier aux lanceurs d’alerte, ceux-ci devront sans doute emprunter les voies existantes, les mécanismes d’aide juridictionnelle, s’agissant des actions en justice et les voies non contentieuses et juridictionnelles en cas de risques de représailles consécutifs au lancement de l’alerte.
B – La question des aides financières et du dédommagement
Les exemples étrangers montrent que deux grands choix sont opérés, sans qu’ils ne soient exclusifs l’un de l’autre. Il s’agit soit d’une aide financière, en cas de licenciement ou de mise en difficulté suite au lancement d’alerte ou encore de dédommagement en cas de frais engagés soit de récompenses au regard des faits révélés et de l’utilité sociale de la dénonciation. On observe en effet de nombreux cas d’indemnisation substantielle de lanceurs d’alerte. Les États-Unis font figure d’illustration en la matière ainsi, en juin 2016, le régulateur américain, la Securities and Exchange Commission, a annoncé le versement de plus de 17 millions de dollars à un lanceur d’alerte, pour avoir fourni « des indices détaillés et fait substantiellement avancer l’enquête et l’action de la SEC ». Cette récompense est la deuxième plus grosse accordée à un lanceur d’alerte par le régulateur. Le record a été atteint en 2014 avec une récompense de 30 millions de dollars. Depuis la mise en place en 2011 de son programme dédié aux lanceurs d’alerte, la SEC a versé plus de 85 millions de dollars de récompense à 32 lanceurs d’alerte. Les récompenses qui sont financées par les amendes versées à la SEC, sont accordées quand les indices fournis ont permis à la SEC de terminer avec succès ses enquêtes. Elles peuvent représenter entre 10 % et 30 % des sanctions financières infligées lorsque celles-ci dépassent 1 million de dollars43.
Telle n’est pas la voie retenue par la France. D’ailleurs un exemple récent d’un lanceur d’alerte ayant refusé une récompense d’un fort montant témoigne d’une certaine volonté de moralisation de la réflexion sur les lanceurs d’alerte. Ainsi, à l’été 2016, un ancien salarié de la Deutsche Bank, qui avait révélé les manipulations comptables de son employeur, reproche aux autorités boursières américaines de ne pas avoir sanctionné les dirigeants de la banque.
À l’avenir, il conviendra à la fois de préciser la définition du lanceur, celle donnée par le législateur étant très large, de vérifier si les pouvoirs conférés au Défenseur des droits suffiront à assurer sa nouvelle mission, qui est, elle-aussi, très large, quand bien même la dimension d’aide financière a été censurée, et les degrés de protection du lanceur, au regard des enjeux des affaires, au cas par cas.
La Cour européenne des droits de l’Homme a eu à se prononcer, dans un arrêt de référence44 sur les contours de définition et de protection des lanceurs d’alerte. On peut en retenir les éléments suivants. Il s’agissait d’une affaire à propos d’un « dénonciateur », qui avait fait parvenir deux lettres à la presse, puis avait été révoqué. La Cour a retenu que la divulgation à la presse de documents internes était, en l’espèce, protégée par l’article 10 de la Convention, qui garantit le droit à la liberté d’expression, lequel inclut le droit de recevoir et de transmettre des informations et des idées. M. Guja, directeur du service de presse du parquet général de Moldova avant d’être révoqué, s’est constitué partie civile : il avait transmis deux lettres confidentielles à un journal, mais avant de s’y résoudre, il avait tenté, en vain, de consulter les responsables des autres services du bureau du procureur général. Il s’était ainsi mis en infraction par rapport au règlement interne du service de presse. De l’avis de M. Guja, ces lettres n’étaient pas confidentielles et, dans la mesure où elles révélaient que le vice-président du Parlement, Vadim Mişin, avait fait pression, illégalement, sur le parquet général, il avait ainsi contribué à la lutte contre la corruption menée par le président et ce, dans l’intention de donner une image positive du parquet. M. Guja a engagé une procédure contre le parquet afin d’obtenir sa réintégration, mais il a été débouté de sa demande. Invoquant l’article 10 de la Convention, il a sollicité la Cour européenne des droits de l’Homme pour faire annuler sa révocation.
La Cour a retenu que, en l’espèce, les divulgations, même à des journaux, pouvaient être justifiées dans la mesure où l’affaire portait sur des pressions exercées par une personnalité politique de haut rang sur des procédures pénales pendantes. Dans le même temps, le parquet avait donné l’impression d’avoir succombé aux pressions politiques. Elle a également invoqué les rapports des organisations non gouvernementales internationales (la Commission internationale des juristes, Freedom House et Open Society Justice Initiative), qui font état de l’échec de la séparation des pouvoirs et du défaut d’indépendance de la justice en Moldova. À n’en pas douter, ce sont des questions très importantes dans une société démocratique, intéressant le public à juste titre et entrant dans le cadre du débat politique. La Cour a considéré que la divulgation d’informations portant sur des pressions indues et sur des dysfonctionnements au sein du parquet général revêtent, dans une société démocratique une importance, face à l’intérêt général, qui l’emporte sur l’intérêt qu’il y a à maintenir la confiance du public envers le parquet. La libre discussion sur des problèmes d’intérêt général est essentielle en démocratie et il faut se garder de décourager les citoyens de s’exprimer sur de tels problèmes. La Cour a été d’avis que M. Guja avait agi de bonne foi et a finalement relevé que la sanction qui lui avait été infligée (la révocation) était la plus lourde des peines prévues. Celle-ci avait non seulement des répercussions négatives sur la carrière du requérant, mais risquait également d’avoir un effet dissuasif sur les autres agents du parquet général et les décourager de signaler les agissements irréguliers. De plus, compte tenu de la couverture médiatique dont l’affaire avait fait l’objet, la sanction pouvait aussi avoir un effet dissuasif sur d’autres fonctionnaires et salariés.
Au regard de l’importance du droit à la liberté d’expression sur des questions d’intérêt général, du droit des fonctionnaires et des autres salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, des devoirs et responsabilités des salariés envers leurs employeurs et du droit de ceux-ci de gérer leur personnel, la Cour, après avoir pesé les divers autres intérêts ici en jeu, a conclu que l’atteinte portée au droit à la liberté d’expression du requérant, en particulier à son droit de communiquer des informations, n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ». Dès lors, la Cour a conclu à la violation de l’article 10 de la Convention45.
Au terme de cette étude nécessairement non exhaustive, il apparaît que le sujet du lanceur d’alerte est vaste. Les discussions parlementaires ayant finalement permis l’adoption d’un statut, dont les dispositions se substituent aux régimes parcellaires, de même que la censure partielle montrent que le terrain reste glissant. Le décret doit encore être rédigé, pour la mise en œuvre des définitions et protection accordées aux lanceurs d’alerte. Le sujet est loin d’être clos.
Notes de bas de pages
-
1.
Outre la récente étude du Conseil d’État (2016, La documentation française), v. not., colloque sur « Les lanceurs d’alerte et les droits de l’Homme », qui s’est tenu en avril 2015, co-organisé par le Credof (Paris Ouest – Nanterre La Défense) et l’UMR de droit comparé (Paris I – Panthéon-Sorbonne) ; Lewis D., Vandekerckhove W. (ed.), Whistleblowing and Democratic Values, 2011, The International Whistleblowing Research Network ; Noiville C. et Hermitte M.-A., « Quelques pistes pour un statut juridique du chercheur lanceur d’alerte », EDP Science/Natures Sciences Sociétés, 2006/3 ; Chateauraynaud F., « Lanceur d’alerte », in Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation, consultable en ligne : www.dicopart.fr/fr/dico/lanceur-dalerte. ; Résolution 1729 (2010), 29 avr. 2010, Protection des « donneurs d’alerte » de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ; Lochak D., « L’alerte éthique entre dénonciation et désobéissance », AJDA 2014, p. 2236 ; Foegle J.-P., « Lanceur d’alerte ou “leaker” ? Réflexions critiques sur une distinction », Revue des droits de l’Homme n° 10 ; Klausser N., « Les associations de défense des étrangers, des lanceurs d’alerte ? » Revue des droits de l’Homme n° 10 ; Meyer M., « Le droit d’alerte en perspective : 50 années de débats dans le monde », AJDA 2014, p. 224 ; Benaiche L., « La protection du lanceur d’alerte », RLCT 2014/02/01, n° 98.
-
2.
On cite toujours la Suède comme ayant été pionnière en la matière puisque les lanceurs d’alerte y sont protégés par une loi de 1766 sur la liberté de la presse qui garantit le droit d’accès à l’information, y compris aux documents officiels, et la liberté de parole. Cité par Lochak D., art. cité en note 1.
-
3.
Cons. const., 8 déc. 2016, n° 2016-740 DC : loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte et Cons. const., 8 déc. 2016, n° 2016-741 DC : loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
-
4.
V. le dossier documentaire sur le site du Conseil constitutionnel.
-
5.
Déc. préc. du 8 déc. 2016.
-
6.
Ex. de la Suède préc.
-
7.
Lochak D., « Les lanceurs d’alerte et les droits de l’Homme : réflexions conclusives », Revue des Droits de l’Homme, oct. 2016.
-
8.
Foegle J.-P., https://revdh.revues.org/1073.
-
9.
Ibid.
-
10.
Cavendish v. Geduld 2010 ICR 325, EAT.
-
11.
Darnton v. University of Surrey [2003] IRLR 133.
-
12.
Street v. Derbyshire Centre [2004] EWCA Civ 964.
-
13.
Chestertons v. Nurmohamed UKEAT/0335/14/DM, 8 April 2015 à propos de l’alerte sur le calcul d’une commission concernant 100 employés – l’intérêt public est retenu.
-
14.
Ibid.
-
15.
Bhebbie v. Birmingham Trust ET Case n° 1304678/11.
-
16.
Merrigan v. University of Gloucester ET Case n° 1401412/10.
-
17.
Mitchell v. Barclays Bank plc ET Case n° 2502431/12.
-
18.
Okoh v Metronet Rail Ltd ET Case n° 2201930/06.
-
19.
Vinciunaite v Taylor Gordon Ltd ET Case n° 3104508/10.
-
20.
Carroll v Greater Manchester Fire Service ET Case N° 2407819/00.
-
21.
Maund v Penwith District Council 1984 ICR 143, CA.
-
22.
Vento v Chief Constable of West Yorkshire Police 2003 ICR 318, CA.
-
23.
Commissioner of Police of the Metropolis v Shaw 2012 ICR 464 EAT.
-
24.
£ 78 335 en 2015.
-
25.
Watkinson v. Royal Cornwall Hospitals NHS Trust ET Case n° 1702168/08.
-
26.
Ibid.
-
27.
C. trav., art. L. 1161-1 et C. trav., art. L. 1132-3-3.
-
28.
In Commentaires aux Cahiers du Conseil constitutionnel.
-
29.
Commentaires aux Cahiers.
-
30.
Ibid.
-
31.
Ibid.
-
32.
Commentaires aux Cahiers préc.
-
33.
Déc. préc.
-
34.
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ %20Recommendations/CMRec(2014)7F.pdf.
-
35.
Journal du Québec, 1er nov. 2016.
-
36.
Foegle J.-P., étude comparée France États-Unis, https://revdh.revues.org/1009.
-
37.
Déc. préc. du 8 déc. 2016.
-
38.
Ibid.
-
39.
Commentaires aux Cahiers préc.
-
40.
Communiqué de presse – Cons. const., 29 mars 2011, n° 2011-626 DC.
-
41.
Déc. préc. point. 5.
-
42.
Commentaires aux Cahiers.
-
43.
http://www.agefi.fr/asset-management/actualites/quotidien/20160610/sec-recompense-17-millions-dollars-lanceur-d-184338.
-
44.
CEDH, 12 févr. 2008, n° 14277/04, Guja c/ Moldova [GC].
-
45.
http://merlin.obs.coe.int/iris/2008/6/article1.fr.html.