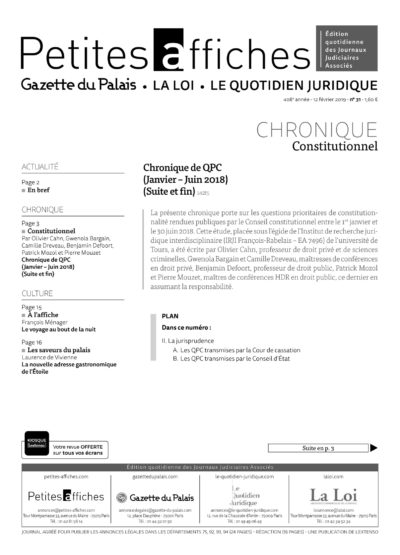Chronique de QPC (Janvier – Juin 2018) (Suite et fin)
La présente chronique porte sur les questions prioritaires de constitutionnalité rendues publiques par le Conseil constitutionnel entre le 1er janvier et le 30 juin 2018. Cette étude, placée sous l’égide de l’Institut de recherche juridique interdisciplinaire (IRJI François-Rabelais – EA 7496) de l’université de Tours, a été écrite par Olivier Cahn, professeur de droit privé et de sciences criminelles, Gwenola Bargain et Camille Dreveau, maîtresses de conférences en droit privé, Benjamin Defoort, professeur de droit public, Patrick Mozol et Pierre Mouzet, maîtres de conférences HDR en droit public, ce dernier en assumant la responsabilité.
I – Le procès constitutionnel
A – Sur la recevabilité
B – Sur le fond
II – La jurisprudence
Écartons d’emblée notre (quasi inexistante, ce semestre) jurisprudence électorale : la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 1er juin 20181 est la seconde (après la décision n° 2017-4977 AN/QPC du 7 août 2017) à faire application de l’article 16-1, al. 2, du règlement propre au contentieux parlementaire, qui lui permet de rejeter sans instruction contradictoire préalable les QPC ne réunissant pas les conditions de l’article 23-5, al. 3, de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ; ici, le Conseil constitutionnel applique également l’article 38 de l’ordonnance, son pendant en matière électorale (« requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection ») : le requérant, en effet, se contentait de mettre en doute la constitutionnalité de l’article L. 7111-1 CGCT, qui fit en 2011 de la Guyane un DROM et en définit donc le statut, c’est-à-dire des dispositions « dénuées de lien avec l’organisation des élections législatives sur ce territoire », « régie par le Code électoral », de sorte qu’elles n’étaient même pas « applicables au litige ». La décision n° 2018-5626 AN/QPC fait certainement partie de celles dont les membres du Conseil doivent penser qu’elles leur font perdre leur temps. Peut-être verrons-nous un jour naître une sanction de la « QPC abusive »…
Il n’en reste pas moins, justement, qu’elle suscite une réflexion sur la portée de la QPC : la « QPC prétexte » — l’exact inverse de la QPC dilatoire, puisque cette dernière ne vise qu’à gagner du temps (dans un procès généralement pénal ou fiscal) — sert-elle seulement l’ego de son auteur, ou n’est-elle pas d’abord une offrande faite au juge ? Libre à l’oracle d’enrichir la cause ! Après tout, le contentieux électoral est bien le seul offrant au citoyen le moyen de saisir directement le Conseil constitutionnel, en particulier via la jurisprudence Hauchemaille.
Il est vrai que la QPC sert également… aux avocats ! C’est la QPC n° 2018-704, sur la commission d’office, c’est la QPC n° 2018-716, sur les droits de plaidoirie ; deux transmissions de la Cour de cassation, non du Conseil d’État.
Pierre Mouzet
A – Les QPC transmises par la Cour de cassation
Les décisions QPC transmises par la Cour de cassation pour ce semestre, on l’a dit, n’auront guère été nombreuses. Elles n’en méritent pas moins l’attention. Ont été ici sélectionnées deux transmissions de la chambre criminelle, une question à la croisée du droit immobilier et du droit du service public hospitalier transmise par la troisième chambre civile et, via la chambre sociale, une question de droit du travail.
Décision n° 2018-696 QPC du 30 mars 2018 : le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination n’est-il que le droit de ne pas s’accuser ?
Par un arrêt en date du 10 janvier 2018 (Cass. crim., 10 janv. 2018, n° 17-90019), la chambre criminelle de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 434-15-2 du Code pénal qui punit « de trois ans d’emprisonnement et de 270 000 € d’amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités » dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaires. La haute juridiction pénale a estimé que présentait un caractère sérieux la question de savoir si cette disposition « qui contraint, sous menace de sanctions pénales, une personne suspectée dans le cadre d’une procédure pénale » à collaborer avec les enquêteurs pouvait « porter atteinte au droit de ne pas faire de déclaration et à celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination ». Le Conseil constitutionnel a admis l’intervention d’autres parties qui invoquaient, en outre, une violation du droit au respect de la vie privée, du secret des correspondances, des droits de la défense, du principe de proportionnalité des peines et de la liberté d’expression.
Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés. Le prévenu avait été interpellé et placé en garde à vue pour détention d’un produit stupéfiant. Il avait refusé de révéler les codes de déverrouillage de ses téléphones et se trouvait poursuivi tant pour usage de stupéfiants que pour refus de déférer à la réquisition judiciaire. La contestation de la constitutionnalité de cette procédure aurait ainsi pu être fondée, en outre, sur une éventuelle atteinte au principe de légalité criminelle. En effet, outre qu’il est discutable de qualifier le code de déverrouillage d’un téléphone portable de « convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie », il est difficile de considérer que ledit code pouvait avoir permis de « préparer, faciliter ou commettre » l’infraction de possession de stupéfiants. L’inconstitutionnalité de l’interprétation de la norme d’incrimination n’était pas soulevée par le requérant ; elle constituait, néanmoins, un élément de contexte qui aurait pu alerter les Sages.
Tel n’a pas été le cas. Le Conseil constitutionnel, au visa des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789, relève que, selon une « jurisprudence constante de la Cour de cassation », l’obligation posée par la disposition contestée « pèse sur toute personne, y compris celle suspectée ». Non sans audace, au regard des faits de l’espèce, il affirme ensuite qu’en imposant cette obligation « uniquement si ce moyen de cryptologie est susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit et uniquement si la demande émane d’une autorité judiciaire, le législateur a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des infractions et de recherche des auteurs d’infractions ». Enfin, après avoir rappelé la définition légale du « moyen de cryptologie », issue de la loi du 21 juin 2004 (qui confirme les doutes sur le respect des corollaires de la légalité), il estime que « les dispositions critiquées » n’ont pas « pour objet d’obtenir des aveux » et « n’emportent ni reconnaissance ni présomption de culpabilité », d’autant que « l’enquête ou l’instruction doivent avoir permis d’identifier l’existence des données traitées par le moyen de cryptologie » susceptibles d’avoir contribué à l’infraction et que « ces données, déjà fixées sur un support, existent indépendamment de la volonté de la personne suspectée ». Il en conclut que « les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit de ne pas s’accuser ni au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances » pas plus qu’elles ne méconnaissent « les droits de la défense, le principe de proportionnalité des peines et la liberté d’expression, ni aucun autre droit ou liberté que la constitution garantit ».
Cette solution s’inscrit en cohérence avec sa jurisprudence2. Est-ce à dire qu’elle est satisfaisante ?
Une auteure relève le caractère « sommaire » de la motivation3. La lecture du commentaire confirme sa fragilité.
Ainsi, le raisonnement du Conseil est, d’abord, fondé sur l’existence d’« autres délits réprimant un comportement similaire » à celui réprimé par la disposition querellée, soit les articles 60-1, 77-1-2, 57-1, 99-3 et 99-4 du Code de procédure pénale. Or toutes ces dispositions ne sont pas pertinentes au regard de l’espèce, puisque certaines ne visent que des personnes qui ne sont pas placées dans une situation dans laquelle elles risquent de s’auto-incriminer en répondant à la réquisition. Reste que les dispositions qui s’appliquent à « toute personne » sanctionnent le refus de déférer à la réquisition d’une amende de 3 750 €. La « jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme relative au droit de ne pas s’accuser » est ensuite exposée ; c’est précisément là que le bât blesse. Certes, le Conseil constitutionnel emprunte à la Cour de Strasbourg la limite au droit de ne pas s’auto-incriminer lorsque les données « existent indépendamment de la volonté » du suspect ; mais l’étude de la jurisprudence européenne conduit à constater que, ce faisant, le Conseil ne retient que ce qui sert la conclusion à laquelle il souhaite parvenir. Ainsi, la lecture de la décision du Conseil constitutionnel montre que, si l’arrêt CEDH du 17 décembre 1996 Saunders c/ Royaume-Uni est cité, il n’a guère été tenu compte de la « raison d’être » de la jurisprudence européenne qui lie la protection du droit au silence « à la protection de l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités » ce qui « présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’accusé ». De même, les critères d’appréciation de l’admissibilité de la coercition étatique, énumérés dans l’arrêt CEDH du 11 juillet 2006, Jalloh c/ Allemagne (n° 54810/00), également cité, sont eux aussi négligés puisque, compte tenu de la gravité relative des faits reprochés au prévenu, l’éventuelle disproportion de l’exposition à une peine d’emprisonnement aurait du être discutée ; ce d’autant que, dans l’arrêt CEDH du 29 juin 2007, O’Halloran et Francis c/ Royaume-Uni (n° 15809/02 et 25624/02), dernière décision visée, l’absence de violation n’est admise qu’en considération du fait que la sanction pénale accompagnant le refus de déférer à une obligation de (se) dénoncer n’était qu’une amende modérée. En d’autres termes, contrairement à ce qui est insinué par l’emprunt des termes de la Cour européenne et la référence à la jurisprudence de cette dernière dans le commentaire, la solution adoptée par le Conseil constitutionnel ne satisfait pas évidemment aux exigences européennes. Faute d’avoir vérifié la proportionnalité de la sanction pénale encourue à l’ingérence dans les droits fondamentaux − question évacuée par un argument d’autorité − le Conseil a peut-être ouvert la voie à une condamnation de la France4. Le risque est d’autant plus grand que la décision du Conseil constitutionnel ramène le droit de ne pas s’auto-incriminer à un droit largement théorique, l’usage du simple droit de se taire pouvant en lui-même conduire à une lourde sanction pénale.
Olivier Cahn
Décision n° 2018-697 QPC du 6 avril 2018 : résiliation anticipée des baux consentis par certains établissements hospitaliers
Les établissements hospitaliers sont propriétaires de locaux à usage d’habitation qu’ils louent à leurs agents ou à des personnes qui n’ont pas ou plus de liens professionnels avec eux. Pour une grande part, ces baux relèvent de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Les locataires bénéficient d’un contrat d’une durée de 6 ans − le bailleur étant une personne morale − et d’un droit au renouvellement. Jusqu’à une réforme récente, le bailleur ne pouvait mettre un terme prématurément au contrat, sauf en cas de manquement grave du locataire. S’il souhaitait réaffecter un local loué en logement de fonction, l’établissement devait attendre le terme du bail et délivrer un congé pour motif réel et sérieux en application de l’article 15-I, en respectant un préavis de 6 mois. La Cour de cassation a estimé que constituait un tel motif la nécessité de fournir des logements à loyer non dissuasif au personnel hospitalier devant exercer en région parisienne, l’insuffisance de tels logements étant l’un des causes du manque d’effectifs dans les hôpitaux5.
Pour remédier à cette difficulté, la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a inséré sous l’article 14-2 de la loi du 6 juillet 1989 une disposition permettant à trois établissements hospitaliers − l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille − de reprendre un logement loué afin de l’attribuer à l’un de leurs agents6.
Désormais, les bailleurs concernés peuvent mettre fin au contrat à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois, lequel est porté à 8 mois pour les contrats en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi. La notification doit indiquer le motif de la résiliation et la nature des fonctions occupées par la ou les personnes auxquelles le bailleur envisage d’attribuer ou de louer le logement. Si le local n’est finalement pas affecté à celle(s)-ci, le preneur peut, s’il en fait la demande, se voir accorder un nouveau bail. Sont exclus les baux en cours lorsque leurs titulaires ne disposent que de faibles ressources. Cette possibilité de résiliation anticipée du bail est inédite dans la loi de 1989.
Cette disposition a fait d’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité7. Selon les requérants, elle violerait le principe d’égalité devant la loi en instituant une différence de traitement injustifiée au détriment des locataires de ces bailleurs et selon que le bailleur est un établissement public de santé visé par la loi ou non. Par ailleurs, elle porterait une atteinte injustifiée au droit au maintien des conventions légalement conclues. Le Conseil constitutionnel a rejeté ces griefs en émettant toutefois une réserve d’interprétation8.
De jurisprudence constante, le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il y soit dérogé pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit9. Faisant cet examen, le Conseil constitutionnel estime que la prérogative accordée aux bailleurs vise à permettre d’attribuer un logement aux agents de ces établissements à proximité du lieu d’exercice de leurs fonctions, dans des zones où le marché du logement est particulièrement tendu, assurant la continuité du service public. Ainsi, le marché de l’immobilier propre aux villes de Paris, Lyon et Marseille constitue des situations spécifiques objectives qui motivent une différence de traitement.
Pour répondre au grief de l’application de la loi critiquée aux contrats en vigueur, le Conseil constitutionnel a, en application de sa jurisprudence constante, vérifié que l’atteinte portée au principe du droit au maintien des conventions est justifiée par un motif d’intérêt général suffisant10. Il estime que constitue un tel motif la nécessité d’augmenter significativement le nombre de logements susceptibles d’être concernés par le dispositif.
La décision commentée émet cependant une réserve dans la mesure où la loi n’exclut pas que le pouvoir de résiliation puisse être exercé par les établissements hospitaliers à l’égard de leurs propres agents, ni ne définit les critères suivant lesquels il pourrait dans ce cas s’appliquer. La réserve, qui avait motivé l’arrêt de renvoi de la Cour de cassation, est logique : le but de la loi étant de loger les agents en exercice, elle ne pourrait permettre, sans condition stricte, d’évincer ces derniers.
Camille Dreveau
Décision n° 2018-703 QPC du 4 mai 2018 : le senior à la peine
Quiconque cherchera dans le Code du travail et le Code de la sécurité sociale quelque trace d’une politique de l’emploi en faveur des seniors n’y décèlera plus que des dispositions éparses relatives à la « gestion des âges » ; c’est que le terme même a quasiment disparu des codes. Des « salariés âgés » peuvent encore y être repérés çà et là mais l’emploi du « senior » n’est manifestement plus à la mode (s’il l’a jamais été) ou ne se fait visible qu’à l’horizon de la retraite. Il fut pourtant un temps, pas si lointain, où le législateur, trahissant son essoufflement, avait conçu des contributions financières contraignant les entreprises à mener des politiques en faveur de l’emploi des seniors par le biais de dispositifs négociés ou unilatéraux. Après l’échec de la contribution sociale prévue en matière de licenciement d’un salarié âgé de plus de 50 ans (la fameuse « contribution Delalande » créée en 1987 et plusieurs fois modifiée), la loi de financement de la sécurité sociale du 17 décembre 2008 avait instauré une pénalité financière pour les entreprises d’au moins 50 salariés n’ayant pas satisfait à leurs obligations de conclure un accord collectif ou de mettre en œuvre un plan d’action en matière d’emploi des salariés âgés ; le produit de cette pénalité était affecté à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés. Cinq ans plus tard, le dispositif, codifié initialement dans le Code de la sécurité sociale à l’article L. 138-24, fut réservé, dans le Code du travail, aux entreprises d’au moins 300 salariés par la loi portant création du contrat de génération (L. n° 2013-185, 1er mars 2013). Finalement, l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1387 mit définitivement un terme à ces politiques en abrogeant ces dispositions, pénalité et contrat de génération inclus. La QPC transmise au Conseil constitutionnel par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, relative à l’article L. 138-24 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi de 2008, pourrait donc apparaître comme un contentieux d’un autre temps. Elle n’est en réalité pas dénuée d’enseignements dès lors que le mécanisme en cause, la pénalité financière, se révèle être, dans sa nature mais avec des modalités variables, régulièrement emprunté par le législateur au soutien de ses politiques sociales.
Ironie du sort, la QPC soulevée relativement à cette pénalité est issue d’un contentieux opposant l’URSSAF à une société, dénommée « People and Baby », spécialisée dans le marché des crèches. La société, s’étant vue infliger la sanction pécuniaire en matière d’emploi des seniors, contestait la conformité au principe de proportionnalité et de nécessité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration de 1789. Le Conseil suivra la requérante puisqu’il jugera contraire à la constitution l’alinéa 2 de la disposition en cause, relatif aux modalités de calcul de la pénalité, en ce qu’il méconnaît le principe de proportionnalité des peines. L’application de l’article 8 à cette mesure était prévisible dès lors que le Conseil l’interprète de façon constante comme ayant vocation à s’appliquer à toute sanction ayant le caractère d’une punition. La finalité punitive du dispositif était peu discutable en l’espèce et le Conseil retient, sans surprise, que le législateur a « entendu réprimer le manquement à l’obligation » instituée (§ 10). Par le passé, la contribution au profit du régime de l’assurance-chômage infligée aux employeurs licenciant des salariés de plus de 50 ans avait au contraire été qualifiée de cotisation sociale visant à « dissuader l’employeur de procéder à des licenciements entraînant des dépenses accrues pour le régime d’assurance-chômage » (Cons. const., 29 juill. 1992, n° 92-311 DC, § 6). La pénalité serait purement punitive, quand la majoration de contribution se voulait seulement dissuasive. Il faut pourtant souligner toute l’ambiguïté du mécanisme de la pénalité financière qui ne saurait être résumé par cette seule finalité répressive. La pénalité se veut bien évidemment dissuasive et ce faisant invite, paradoxalement, à agir : c’est l’absence d’effort, de négociation ou de plan d’action en faveur de l’emploi des salariés âgés qui est sanctionné, non l’absence de résultats en matière d’emploi qui est pénalisé. Il ne s’agit pas uniquement par ce biais de punir le manquement aux obligations fixées mais bien également d’inciter à leur mise en œuvre pour parvenir à un objectif plus important de promotion de l’emploi des salariés âgés. La pénalité financière ainsi instituée s’inscrivait dans une version revisitée du « droit promotionnel » qui ne se contente pas de récompenser les bonnes pratiques, récompense coûteuse pour l’État, mais pénalise les mauvaises tout en y trouvant un moyen de financer partiellement ses politiques publiques et d’en faire reposer les conditions de leur réalisation sur les acteurs privés en leur laissant le soin d’en détailler les modalités.
C’est ensuite à la lumière de l’objectif poursuivi et au regard des moyens censés permettre de l’atteindre que le Conseil conclura à l’absence de proportionnalité de la punition sans s’attarder à en expliciter les motifs. Ce n’est pas en son principe que la pénalité est remise en cause mais dans son mode de calcul. Le montant de la pénalité était fixé par la loi à 1 % des rémunérations ou gains versés aux salariés de l’entreprise sur la période non couverte par l’accord ou le plan d’action. Pénalité forfaitaire, son montant était indifférent au degré de réalisation des mesures en faveur de l’emploi des seniors, l’entreprise étant susceptible de se voir infliger une telle pénalité dès lors qu’elle n’avait pas conclu d’accord ou de plan d’action à ce sujet. La Cour de cassation, dans son arrêt de transmission de la question prioritaire, soulignait que « l’absence de modulation en fonction de la gravité du manquement constaté » présentait un caractère sérieux. C’est également sur ce terrain que le Conseil retiendra la non-conformité des dispositions. La sanction instituée, fixée « quelle que soit la situation de l’emploi de ces salariés au sein de l’entreprise », est « susceptible d’être sans rapport avec la gravité du manquement réprimé » (§ 11). Paradoxale effectivement que cette pénalité, visant à promouvoir l’emploi des salariés âgés, aveugle au taux d’emploi des seniors dans l’entreprise mais sanctionnant l’absence de dispositif en faveur de ceux-ci. Le Conseil ne s’étend pas d’ailleurs à détailler les prescriptions légales et se contente de mettre en rapport, dans une formule bien succincte, de « telles obligations » (§ 11) avec l’objectif poursuivi pour juger que les moyens mis en œuvre sont sans lien avec la gravité du manquement.
Le recours à des pénalités financières en matière de négociation collective, instrument désormais privilégié des politiques sociales contemporaines, s’est étendu à d’autres domaines, notamment celui de la pénibilité du travail et surtout celui de l’égalité professionnelle. Faut-il alors craindre que le même régime soit infligé à ces pénalités financières ? L’article L. 4163-2 du Code du travail, issu de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, prévoit un mécanisme de pénalité dès lors que les entreprises n’ont pas satisfait à leurs obligations en matière de négociation ou de plan d’action pour la prise en compte de la pénibilité du travail. De même, la récente loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 a renforcé les obligations des entreprises en matière d’égalité professionnelle tout en maintenant la pénalité infligée en cas de non-respect de celles-ci. Cependant, dans ces deux cas, le législateur a pris soin de ne fixer qu’un montant maximum, un plafond, et non une pénalité forfaitaire (« 1 % au maximum des rémunérations ou gains »). Ce montant doit en outre être déterminé par l’Administration « en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière de prévention de la pénibilité » (C. trav., art. L. 4163-2) ; de même, en matière d’égalité professionnelle, précision est faite qu’il doit être tenu compte « des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations » (C. trav., art. L. 2242-8). Il faut alors considérer que, dans leur rédaction, ces dispositions ne s’exposent pas à une décision d’inconstitutionnalité puisque le mode de calcul de ces pénalités est fonction des moyens mis en œuvre. Elles conservent la même ambiguïté dans leur configuration, réprimant pour inciter à agir, mais leurs modalités de calcul se font plus fines. Quant au senior, il se fond désormais dans les dispositifs de « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ». De peine, il n’en a plus.
Gwenola Bargain
Décision n° 2018-706 QPC du 18 mai 2018 : précisions sur la nature et les éléments constitutifs du délit d’apologie du terrorisme
Les faits de l’espèce peuvent être brièvement rappelés. Le requérant avait donné une longue interview à un magazine dans laquelle, contestant le fait que les actes perpétrés par des terroristes soient systématiquement qualifiés de « lâches », il avait affirmé que les auteurs de l’attentat perpétré au Bataclan le 13 novembre 2015 avaient, en choisissant d’être tués lors de leur action, fait preuve d’un certain « courage ». Poursuivi pour apologie d’un acte de terrorisme, il a été condamné, à hauteur d’appel, à une peine d’emprisonnement partiellement assortie d’un sursis et mise à l’épreuve. S’étant pourvu en cassation, il a formé une QPC portant sur la conformité du délit d’apologie du terrorisme, prévu à l’article 421-2-5 du Code pénal et réprimé par cette disposition et celles des articles 422-3 et 422-6 du même code, aux principes de légalité criminelle et de liberté de communication garantis par les articles 8 et 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.
Par arrêt du 27 février 2018 (Cass. crim., 27 févr. 2018, n° 17-83602), la chambre criminelle de la Cour de cassation a renvoyé cette affaire au Conseil constitutionnel. Elle a jugé la question suffisamment sérieuse pour décider de passer outre sa réticence habituelle à saisir les Sages d’une QPC relative au principe de légalité11 et de revenir sur le refus qu’elle avait précédemment opposé au renvoi d’une question similaire12. Il est vrai qu’en février puis en décembre 2017, le Conseil constitutionnel avait, par deux fois, censuré le délit de consultation habituelle de sites terroristes, en justifiant l’inconstitutionnalité par les lacunes de l’élément moral, qui ne prévoyait pas l’adhésion de l’auteur des faits à un quelconque projet terroriste13 − exigence qui ne résulte pas non plus de la jurisprudence afférente à l’article 421-2-5 du Code pénal.
Le Conseil constitutionnel estime que le principe de légalité n’est pas méconnu dès lors que la répression de l’apologie du terrorisme n’intervient que lorsqu’il est démontré une incitation « à porter un jugement favorable sur une infraction expressément qualifiée par la loi d’“acte de terrorisme” ou sur son auteur », qui se matérialise par des « circonstances traduisant la volonté de leur auteur de les rendre publics » ; il en conclut que « les dispositions contestées de l’article 421-2-5 du Code pénal ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précises pour garantir contre le risque d’arbitraire ». La méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines est, elle aussi, écartée. Le Conseil affirme d’abord, que ne sont pas affectées d’une « disproportion manifeste » les peines prévues aux articles 421-2-5 et 422-3 du Code pénal, justifiant son appréciation par le fait que lesdites peines sont prononcées en prenant en considération « la nature des comportements réprimés », les « circonstances de l’infraction » et la « personnalité de [l’]auteur » et, au regard de la circonstance aggravante prévue par la première disposition, par le fait que « le législateur a pris en compte l’ampleur particulière de la diffusion des messages prohibés » rendue possible par internet et l’influence de cet outil « dans le processus d’endoctrinement d’individus susceptibles de commettre des actes de terrorisme ». Concernant, ensuite, la peine de confiscation prévue par l’article 422-6 du même code, il relève que cette peine ne peut être prononcée qu’« à l’encontre des personnes “coupables d’actes de terrorisme” » et n’est pas à cet égard « manifestement disproportionnée », mais que « si le délit d’apologie publique d’actes de terrorisme est prévu par l’article 421-2-5 du Code pénal, qui figure dans le chapitre Ier, intitulé “Des actes de terrorisme”, du titre II du livre IV du même code, le législateur n’a pas expressément qualifié cette infraction d’acte de terrorisme » et qu’en conséquence, cette peine n’est « pas applicable aux personnes coupables d’apologie publique d’actes de terrorisme ». Enfin, l’atteinte à la liberté d’expression et de communication n’est pas non plus constatée. En effet, le Conseil, après avoir rappelé sa jurisprudence, selon laquelle « les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi », estime que « en instituant le délit d’apologie publique d’actes de terrorisme, le législateur a entendu prévenir la commission de tels actes et éviter la diffusion de propos [en] faisant l’éloge », satisfaisant ainsi à « l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions, dont participe l’objectif de lutte contre le terrorisme ». Il rappelle ensuite que la norme d’incrimination satisfait aux exigences de la légalité criminelle et de la proportionnalité des peines et justifie que l’« insertion dans le Code pénal [du] délit contesté » soustrait sa répression aux « garanties procédurales spécifiques aux délits de presse » par le fait que « les actes de terrorisme dont l’apologie est réprimée sont des infractions d’une particulière gravité susceptibles de porter atteinte à la vie ou aux biens ». Il en déduit que « l’atteinte portée à la liberté d’expression et de communication par les dispositions contestées est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi » sans exiger une adhésion de l’auteur de l’apologie d’un acte de terrorisme au projet criminel dont ce dernier résulte.
Cette décision appelle trois remarques14. S’agissant de la conformité du délit aux exigences de la légalité criminelle, le Conseil constitutionnel, en exposant les éléments constitutifs de l’infraction efface, par une synthèse de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’imprécision de la norme d’incrimination. Cette démarche n’est, en soi, ni critiquable, ni originale15. Elle suscite, cependant, deux réserves. D’abord, ce faisant, les Sages valident implicitement l’interprétation extensive de la haute juridiction pénale, qui assimile toute approche qui n’est pas critique des auteurs d’un acte de terrorisme à une présentation favorable16. Une telle jurisprudence est susceptible de poser des difficultés au regard de la liberté académique des chercheurs (par exemple, les écrits de sociologues consécutifs aux attentats de janvier 2015, qui mettaient en cause la responsabilité de la société dans ces actes). Ce point aurait avantageusement pu faire l’objet d’une réserve d’interprétation. Par ailleurs, l’analyse opérée par le Conseil constitutionnel ne serait vraiment convaincante que si la définition de l’acte de terrorisme était elle-même conforme aux exigences de la légalité criminelle17. S’agissant du respect de la liberté d’expression, le Conseil constitutionnel n’exige pas, comme il l’avait fait lorsqu’il a censuré le délit de consultation habituelle de sites terroristes, que l’auteur de l’apologie ait, d’une quelconque manière, adhéré au projet criminel. Yves Mayaud l’approuve en estimant que l’apologie « relève d’un comportement d’adhésion au terrorisme »18. Toutefois, l’application extensive que fait la Cour de cassation de cette infraction oblige à nuancer19. Il faut alors peut-être plus simplement considérer que les Sages ont estimé que, dès lors que l’apologie « crée en elle-même un trouble à l’ordre public » et que sa répression satisfait à « un objectif de valeur constitutionnelle de prévention » d’infractions « d’une particulière gravité », l’atteinte à la liberté d’expression est « nécessaire, adaptée et proportionnée » sans que soit exigée la sympathie de l’auteur pour le terrorisme. Enfin, pour passer outre le grief de disproportion de la peine de confiscation prévue par l’article 422-6 du Code pénal, le Conseil constitutionnel procède à la subtile distinction précitée. D’apparence habile, cette distinction heurte doublement la volonté du législateur : d’abord la volonté explicite, en ce que l’article 421-2-5 est contenu dans le chapitre Ier « Des actes de terrorisme » du titre II « Du terrorisme » du Livre IV du Code pénal ; ensuite, la volonté implicite qui découle de la cohérence des peines, en ce que le Conseil n’a manifestement pas mesuré les implications de son interprétation, d’où il résulte que la confiscation est applicable à l’association de malfaiteurs terroristes délictuelle (C. pén., art. 421-2-1) mais pas à l’incitation parentale d’un mineur à commettre des actes de terrorisme, criminelle aux termes de l’article 421-2-4-1 du même code.
Olivier Cahn
B – Les QPC transmises par le Conseil d’État
La vingtaine de transmissions par la juridiction administrative brille par sa diversité. En témoignent les trois décisions sélectionnées ici, qui concernent les finances locales (en l’occurrence, les concours étatiques à l’intercommunalité), encore ; une affaire d’expropriation (ou, plutôt, de refus d’expropriation) dont la presse a beaucoup fait état ; et, d’abord, un ultime avatar de l’état d’urgence, qu’on présentera sous l’angle du principe constitutionnel de la laïcité.
Décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 : la boucle de la laïcité
Confessons le risque d’incompréhension lié au fait de centrer sur le principe de laïcité une décision, au surplus extraordinairement longue et riche (il en a déjà été beaucoup question plus haut), que le Conseil constitutionnel lui-même présente, dans l’intitulé du commentaire publié sur son site internet, comme concernant diverses « mesures administratives de lutte contre le terrorisme ». Certes, chacun sait que la laïcité est l’ennemi de l’obscurantisme religieux et que la haine a pris les armes ; le combat commence d’ailleurs avec l’instruction, dans l’éducation, et l’on pourrait la rapprocher de la décision n° 2018-710 QPC du 1er juin 2018 sur la fermeture de classes hors contrat. Mais la préservation d’un ordre laïc indispensable au vivre-ensemble va bien au-delà de la légitime défense et, inversement, la foi n’est pas en soi synonyme de terrorisme.
Ce prélude politique entendu, le discours scientifique n’en doit pas moins être situé. La thèse ici défendue est que l’on ne saurait prendre pour une incidente secondaire une position du juge en réalité aussi centrale que fondamentale. Tandis que la partie la plus visible de la décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 (l’inconstitutionnalité du contrôle juridictionnel de l’interdiction de fréquenter ou de la saisie de « documents » et d’« objets » au cours d’une « visite » administrative, voire le contrôle des « périmètres de protection ») n’est au fond que redite de raisonnements acquis ou déclinaison d’une jurisprudence bien établie, notamment par la décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018. Sa portée principale semble en effet se trouver à l’endroit de la fermeture des lieux de culte, dans les § 37 à 43 validant l’article L. 227-1 CSI, toutes ces dispositions provenant de la « normalisation » par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 de mesures de la loi du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence.
C’est que l’aile Montpensier a ici voulu nous parler de laïcité. Alors que ni l’arrêt de transmission du Conseil d’État ni les requérants ou les intervenants ne la visaient, n’évoquant notamment que la liberté de conscience et d’opinion, la liberté religieuse ou encore le respect de la vie privée, le Conseil constitutionnel fait d’autorité référence, en soutien, à l’idée qui figure aujourd’hui à l’article 1er de la constitution. Dans notre décision du 29 mars 2018, il exposait ce principe pour la cinquième fois20, seulement, en près de quinze ans : le principe de laïcité − dont on sait depuis 2013 qu’il est bien invocable en QPC21, ce qui n’était pas évident − n’est en effet apparu dans la motivation propre du Conseil constitutionnel qu’au moment de l’examen du traité établissant une constitution pour l’Europe, fin 2004, et spécialement de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne22. Non seulement son invocation, ici, n’était pas présentée comme un grief, mais il faut insister sur son acception et se demander quelle était sa fonction dans notre affaire.
À comparer la QPC n° 2017-695 avec les précédentes décisions du Conseil constitutionnel, on peut certes constater que la portée du principe de laïcité « a évolué », comme l’affirme son commentaire officiel. Mais il ne s’agit nullement d’un revirement ! Si le Conseil constitutionnel paraît s’être retourné, c’est qu’il a opéré une boucle, un travelling circulaire ; ou, osons une métaphore proche, si le panorama s’étend, c’est que l’image, tout simplement, est encore ici complétée. La laïcité a toujours été associée à une autre exigence constitutionnelle, ce qui lui donne chaque fois une coloration différente. Ensuite, l’éclairage change car les problèmes de droit sont distincts et les solutions aussi, formant un spectre de lumière allant du froid, qui bride, au chaud, qui aide. Car la laïcité a deux jambes : la protection de la nation et la protection des convictions. Ainsi, la première décision du Conseil marqua, avec le refus du communautarisme, bâti sur les articles 1er à 3 de la constitution23, une prohibition − le principe de laïcité interdit « à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers »24 − et la deuxième une validation : croisée cette fois avec le treizième alinéa du préambule de 1946 (qui la répète) et le PFRLR de la liberté de l’enseignement, la laïcité « ne fait pas obstacle à la possibilité pour le législateur de prévoir », dit la décision n° 2009-591 DC du 22 octobre 2009, « la participation des collectivités publiques au financement du fonctionnement des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association ». Du célèbre triptyque de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 (« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ») n’ont donc été constitutionnalisés que les deux premiers éléments − c’est toute une politique fiscale qu’on eut sinon condamnée aussi ! − lesquels furent expressément visés dans la QPC n° 2012-297 du 21 février 2013. Mais, alors, le juge dut recourir à un autre principe constitutionnel, la putative intention du constituant, pour couvrir la rémunération de ministres du culte, en Alsace-Moselle, voire des ministres d’un culte, en Guyane25. Dans ces deux précédentes QPC, le Conseil constitutionnel avait déjà associé, comme dans la QPC n° 2017-795, le principe de laïcité à l’article 10 de la Déclaration de 1789, lequel protège la liberté de religion et plus largement la liberté de conscience, mais en disant de la seule laïcité qu’elle impose, outre « la neutralité de l’État », sa première jambe, « notamment le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes ».
À lire la QPC n° 2017-695 du 29 mars 2018, il est frappant de constater que les mots « liberté de religion » ne figurent pas (pas plus que la neutralité de l’État, ici hors-sujet) dans la motivation du Conseil constitutionnel : lui-même n’y utilise que leur déclinaison individuelle, la « liberté de conscience » (à laquelle la fermeture d’un lieu de culte « porte donc atteinte », tranche le § 38), et leur mise en œuvre collective, le « libre exercice des cultes ». À cet égard, il y a là, surtout, une curieuse construction, dans la formulation du § 37, car écrire qu’il « résulte » de l’article 1er de la constitution « et » de l’article 10 de la Déclaration « que le principe de laïcité impose notamment que la République garantisse le libre exercice des cultes », c’est soit voir la laïcité dans le texte de 1789, ce qui serait un contresens, soit soumettre la laïcité à la liberté de religion, ce qui en serait un autre : il eut fallu dire que la liberté de culte est garantie et par la laïcité et par l’article 10… Mais peu importe la manière dont la boucle est reliée à ses deux précédentes décisions : l’aile Montpensier s’est focalisée sur la constitutionnalité de la fermeture des lieux de culte hors état d’urgence. Que de conseils au juge administratif ! Si la décision n° 2017-795 se contente de citer l’article L. 227-1 CSI pour le déclarer conforme, on peut y lire autant de semi-réserves d’interprétations : et de rajouter à l’alinéa 1 qu’il autorise le préfet à fermer « provisoirement » et « sous certaines conditions » (§ 38) des lieux de culte ; et de rappeler (avec une inusuelle insistance soulignée par deux points) le caractère cumulatif des deux conditions, la prévention du terrorisme et la provocation qui se tient en ces lieux, dont le préfet doit « établir » le lien (§ 39) ; et de relever que l’alinéa 2 n’a « pas prévu » le renouvellement de la fermeture, limitée à six mois, lequel ne peut donc reposer que « sur des faits intervenus après la réouverture » (§ 40) ; et − sans parler du rappel d’un « recours en référé » aux conséquences précisées par l’alinéa 3 et des suspensions induites (§ 42) − de marteler (§ 41) les critères hérités de la jurisprudence strasbourgeoise d’une mesure « adaptée, nécessaire et proportionnée », la disproportion pouvant provenir du seul fait, dont l’article L. 227-1 ne dit mot, que le représentant de l’État n’aura pas suffisamment tenu « compte des conséquences d’une telle mesure pour les personnes fréquentant habituellement le lieu de culte et de la possibilité qui leur est offerte ou non de pratiquer leur culte en un autre lieu »… Un mot, à ce sujet, en guise de conclusion temporaire : demandons-nous si nous sommes loin de voir l’expression « liberté de religion » directement déduite du principe de laïcité, sous forme d’affirmation de principe et non plus de simples concrétisations convergentes ponctuelles avec ce « libre exercice des cultes » ici répété une demi-douzaine de fois.
Alors, la boucle serait-elle déjà bouclée ? Ne manque-t-il pas encore quelques précisions quant à cette idée que la laïcité oblige la République, non seulement à s’abstenir mais peut-être à agir, envers les croyants − en tout cas ceux qui croient aussi en la laïcité − par exemple en matière de droit funéraire ? Et verra-t-on un jour le juge jouer de ce « même religieuses » de l’article 10 de la Déclaration du 26 août 1789, qui contient toute l’essence voltairienne de la laïcité ?
Pierre Mouzet
Décision n° 2018-698 QPC du 6 avril 2018 : l’érosion dunaire n’est pas un risque naturel majeur…
L’érosion dunaire ne devrait-elle pas être regardée comme un risque naturel majeur ? Telle est la question que les propriétaires du bâtiment Le Signal, à Soulac-sur-Mer, ont posée au Conseil constitutionnel, et telle est la question que l’on demeure en droit de se poser à la lecture de sa décision.
Nul besoin de revenir longuement sur les circonstances de faits qui symbolisent, à bien des égards, les conséquences du changement climatique et du phénomène d’érosion côtière qu’il a d’ores et déjà commencé à causer. Initialement bâti en 1965, à près de 200 mètres du rivage, l’immeuble de 78 logements a vu les flots se rapprocher à moins de 20 mètres et semble vouer à un écroulement certain dans un avenir proche. Dès 2014, le préfet de la Gironde a pris un arrêté de péril imminent conduisant à l’évacuation en urgence de l’immeuble et proposé une indemnisation, refusée par les propriétaires car jugée dérisoire. Ces derniers ont, par la suite, sollicité le préfet afin qu’il mette en œuvre la procédure d’expropriation pour risques naturels majeurs prévue par les articles L. 561-1 et L. 561-3 du Code de l’environnement, ce qu’il a refusé, conforté en cela par les juridictions du fond. Le Conseil constitutionnel conclut ici, sur la question transmise par le Conseil d’État saisi en cassation, à la conformité aux droits et libertés garantis par la constitution, et notamment au principe d’égalité et au droit de propriété, de ce dispositif. Si cette solution n’étonne guère et était en ce sens attendue, il reste que les propriétaires concernés, et plus largement les habitants de zones soumises à des phénomènes aggravés d’érosion côtière, demeurent en attente d’une solution pérenne.
Une solution attendue − L’article L. 561-1 du Code de l’environnement dispose, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, que « (…) lorsqu’un risque prévisible de mouvement de terrain, ou d’affaissement de terrain dû à une cavité souterraine et à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à une montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l’État peut déclarer d’utilité publique l’expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation ». L’indemnisation versée émane d’un « fonds de prévention de risques majeurs » (fonds Barnier) créé également par la loi du 2 février 1995 (C. envir., art. L. 561-3). C’est, au demeurant, la seule connexité entre ces deux dispositions qui permet de considérer que les risques énumérés de manière limitative à l’article L. 561-1, et ouvrant droit au déclenchement de la procédure exceptionnelle d’expropriation, peuvent être dits « majeurs », l’adjectif ne figurant que dans la dénomination du fonds…
Bien que l’érosion côtière semble se rapprocher du cas de « submersion marine » (ajouté à la suite de la tempête Xynthia de 2010 par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement), ce risque ne figure pas explicitement au nombre des hypothèses concernées par le fonds Barnier. C’est ainsi logiquement que le préfet et les juridictions du fond n’ont pas fait droit à la demande présentée par les propriétaires. La solution adoptée par le Conseil constitutionnel ne saurait non plus étonner. En ce qui concerne le manquement allégué au principe d’égalité, il n’y a rien de choquant à admettre que les finalités poursuivies par le législateur − visant la protection de la vie de personnes habitants dans des zones précises, exposées à un risque majeur imminent, et non l’indemnisation de tous les propriétaires susceptibles d’être exposés à un risque naturel qu’ils auraient pu choisir d’ignorer26 − pouvaient raisonnablement lui permettre de réserver un traitement différent aux personnes exposées au risque d’érosion côtière. Il résulte en ce sens des travaux préparatoires que l’intention du législateur était très clairement d’exclure du nouveau mécanisme ce type de risque, comme tous phénomènes qui sont « soit d’évolution lente (séisme, érosion des côtes), soit d’importance telle qu’il devient manifestement impossible d’exproprier les biens des populations concernées »27. L’approche « sélective » opérée par le législateur repose ainsi sur des considérations objectives en rapport avec l’objet de la loi. S’agissant de l’atteinte au droit de propriété, il n’y a pas plus de surprise à considérer que le refus de recourir à une procédure d’expropriation − par elle-même attentatoire au droit de propriété − puisse caractériser une telle atteinte. Les juges de la rue Montpensier confirment ici la réticence des juridictions administratives envers toute forme de reconnaissance d’un « droit » à l’expropriation28. Encore que, sur ce point, la QPC aurait pu être l’occasion de souligner l’originalité de l’article L. 561-1 du Code de l’environnement, qui vise, d’abord, l’indemnisation des propriétaires pour un motif de sécurité publique, avant la recherche d’une « utilité publique », au sens où elle est habituellement entendue dans les mécanismes classiques d’expropriation.
L’attente d’une solution – Si l’érosion dunaire ne figure donc pas au nombre des « risques naturels majeurs » au sens de l’article L. 561-1 du Code de l’environnement, sans que cela ne contrevienne à aucun droit ou liberté garantis par la constitution, elle n’en demeure pas moins – objectivement − un risque naturel grave et croissant qui, s’agissant tout spécifiquement des habitants du Signal, mais aussi plus largement de tous les résidents des zones côtières, demeure en attente d’une solution préventive durable… À cet égard, les projets et propositions de loi se succèdent, comme les vagues sur la grève, sans parvenir, pour l’heure et dans le matériau juridique, à « endiguer » le recul du trait de côte accentué chaque jour un peu plus par celles-ci… « À changements climatiques, changements juridiques », voudrait-on espérer avec Philippe Yolka29… Nous n’y sommes pas encore, et faute de voir aboutir une stratégie globale (après l’abandon, à la suite du changement de majorité parlementaire, de la proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique, déposée le 13 juillet 2016, la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux, adoptée en première lecture au Sénat le 30 janvier 2018 est, depuis ce jour, au point mort), on en reste au stade des « rustines » (avec, pour ce qui concerne le cas de l’espèce, la proposition « sur-mesure » de loi visant à instaurer un régime transitoire d’indemnisation pour les interdictions d’habitations résultant d’un risque de recul du trait de côte adoptée en première lecture au Sénat le 16 mai 2018, moins d’un mois après la décision ici commentée). Si l’enjeu dépasse bien évidemment le cadre législatif et national, celui-ci ne saurait, en sens inverse, se reporter sur les seules initiatives privées ou locales − certains projets de révision de plans locaux d’urbanisme commencent d’ailleurs à envisager des programmes de repli vers l’intérieur des terres… Dit autrement, et de manière paradoxale, l’absence de censure des dispositions contestées révèle − on serait tenté de dire : signale − les carences du dispositif légal de maintien du trait de côte.
Benjamin Defoort
Décision n° 2018-711 QPC du 8 juin 2018 : encore les finances locales
La décision n° 2018-711 QPC du 8 juin 2018, Communauté d’agglomération du Grand Sénonais, a été l’occasion pour le Conseil constitutionnel de valider, à partir du cas des communautés d’agglomération, le système législatif de calcul et de répartition de la dotation d’intercommunalité versée annuellement par l’État aux EPCI à fiscalité propre dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement des communes. En l’occurrence, étaient initialement visées certaines dispositions issues des articles L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30 et L. 5211-33 du Code général des collectivités territoriales à l’encontre desquelles la communauté d’agglomération du Grand Sénonais avait soulevé la question prioritaire de constitutionnalité à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision préfectorale en date du 3 mai 2016 lui ayant attribué la dotation d’intercommunalité au titre de la même année pour un montant estimé trop faible par l’établissement requérant. Conformément aux dispositions susmentionnées, les EPCI à fiscalité propre reçoivent, à compter de l’année où ils perçoivent le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d’intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1 du CGCT30. Le montant de cette dotation est réparti par le comité des finances locales entre quatre catégories de groupements avec les communautés urbaines et les métropoles, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies du Code général des impôts, les communautés de communes appliquant ce dernier article et les communautés d’agglomération créées avant le 1er janvier 2005, la loi de finances pour 201731 ayant supprimé la catégorie des syndicats d’agglomération nouvelle de la liste des bénéficiaires32. Les sommes attribuées à chacune de ces catégories sont ensuite ventilées entre les différents établissements correspondants après prélèvement des sommes nécessaires à l’application de l’article L. 5211-33 du CGCT33. Ce dernier précise en son I, alinéa 1er, que les communautés de communes et d’agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d’attribution de la dotation au sein de la même catégorie, une attribution inférieure par habitant à 95 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente. Il ajoute en son II, 3° qu’un EPCI à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issu d’une fusion ou qui fait suite à un ou à plusieurs EPCI à fiscalité propre, perçoit, dans les deux premières années d’attribution de la dotation au sein de la nouvelle catégorie, une attribution par habitant au moins égale à celle de l’année précédente, augmentée dans les mêmes proportions que la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du CGCT. Dans sa décision du 28 mars 201834, le Conseil d’État procéda au renvoi devant le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée au motif qu’outre son originalité35, celle-ci présentait un caractère sérieux. Selon la haute juridiction administrative en effet, l’application des dispositions législatives ainsi contestées aboutissait à doter les communautés d’agglomération ayant au moins trois ans d’existence de la garantie de percevoir une dotation par habitant au moins égale à 95 % de celle de l’année précédente alors que, pour celles plus récentes, si ladite garantie s’élevait à 100 % de ce montant, augmenté comme la dotation globale de fonctionnement, elle était calculée sur la base d’une dotation par habitant bien inférieure car correspondant à celle des communautés de communes et non d’agglomération36. Se posait par conséquent la question relative au bien-fondé du moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses du CGCT portaient atteinte aux principes d’égalité entre les collectivités territoriales et devant les charges publiques. Estimant que la question prioritaire de constitutionnalité portait sur les termes « et les communautés d’agglomération » de l’article L. 5211-33, I, alinéa 1er du CGCT, le Conseil constitutionnel réaffirme que le principe d’égalité devant la loi issu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 n’interdit pas au législateur de régler de manière différente des situations différentes ou de déroger à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans les deux cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Il rappelle également que le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 du même texte impose au législateur de fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose sans que celle-ci ne conduise à une rupture caractérisée de cette égalité. Ainsi, bien que la dotation d’intercommunalité, dont le montant est déterminé pour chaque catégorie d’EPCI par le produit de la population totale de cette catégorie et de la dotation par habitant, soit ensuite répartie entre les établissements publics de ladite catégorie en fonction de leur population, leur coefficient d’intégration fiscale et leur potentiel fiscal, les dispositions contestées de l’article L. 5211-33 du CGCT garantissent un minimum de dotation d’intercommunalité à certains d’entre eux. Les communautés d’agglomération de trois ans et plus bénéficiant d’une dotation au moins égale à 95 % de celle de l’année précédente, il résulte de cette garantie une double différence de traitement. La première concerne lesdites communautés et celles plus récentes pour lesquelles la dotation est déterminée la première année à partir d’un coefficient d’intégration fiscale moyen, sans application de la garantie, et l’année suivante sous réserve de la garantie de recevoir au moins 95 % de la dotation perçue au titre de l’année précédente. La seconde est établie entre les communautés d’agglomération d’au moins trois ans et celles créées à l’issue d’une fusion d’EPCI ou d’un changement de catégorie de groupements, qui sont assurées de recevoir, durant les deux premières années de leur existence, une dotation au moins égale à celle perçue l’année précédente dans le cadre de leur catégorie d’origine, augmentée dans mêmes proportions que la dotation forfaitaire instituée au sein de la dotation globale de fonctionnement. Pour autant, le Conseil constitutionnel ne conclut pas à la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, rejetant ainsi le moyen invoqué en ce sens en se fondant successivement sur deux motifs distincts. D’une part, il se réfère au caractère non pérenne de la différence de traitement instaurée entre les communautés d’agglomération récentes et celles ayant trois ans d’ancienneté dont la garantie contestée, établie à 95 % de la dotation versée l’année précédente, est ainsi appelée à voir son montant diminuer progressivement. On peut néanmoins se poser la question de la nécessité qu’il y avait pour le juge à s’interroger sur l’ancrage dans le temps d’une telle différence de traitement dans la mesure où, de toutes les manières, ledit juge n’aurait probablement pas conclu à la constitutionnalité ou, inversement, à l’inconstitutionnalité d’une telle différenciation en s’appuyant uniquement sur le caractère provisoire ou durable de celle-ci. D’autre part en effet, en assortissant la dotation d’intercommunalité de garanties proportionnelles aux attributions par habitant perçues les années précédentes, le législateur a entendu assurer aux EPCI la stabilité et la prévisibilité de leurs ressources. À ce propos, le Conseil constitutionnel relève sans autre explication que les communautés d’agglomération de trois ans au moins ne sont pas placées dans la même situation que les EPCI nouvellement créés, qui par définition n’ont jamais perçu une telle dotation, ou que les communautés d’agglomération issues de la fusion ou de la transformation d’établissements publics, dont l’attribution de la dotation d’intercommunalité était jusqu’alors déterminée en fonction des règles et de la composition propre à la catégorie à laquelle elles appartenaient. Les différences de traitement apparaissant dès lors justifiées par une différence de situation et en rapport avec l’objet de la loi, elles ne méconnaissaient en aucune façon les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. Sur ce fondement, le juge déclare conforme à la constitution les termes « et les communautés d’agglomération » figurant à l’article L. 5211-33, I, alinéa 1er, du CGCT.
Patrick Mozol
Notes de bas de pages
-
1.
Notons qu’elle a été publiée au Journal officiel du 2 juin avec la référence tronquée « n° 2018-5626 AN » alors qu’elle figure bien sur le site internet du Conseil sous la référence complète « n° 2018-5626 AN/QPC » ; en revanche, son § 1 y comprend une seconde phrase… tirée d’une toute autre décision, relative à un compte de campagne !
-
2.
V. par ex. Cons. const., 27 janv. 2012, n° 2011-214 QPC et Cons. const., 8 juill. 2016, n° 2016-552 QPC.
-
3.
Chavent-Leclère A.-S., « Le refus du suspect de se soumettre à l’obligation de décryptage n’est pas contraire aux droits de la défense », Procédures, n° 5, 2018, comm. 159.
-
4.
V. mutatis mutandis CEDH, 22 juin 2017, n° 8806/12, Aycaguer c/ France et Cons. const., 16 sept. 2010, n° 2010-25 QPC.
-
5.
Cass. 3e civ., 7 fév. 1996, n° 93-20135 ; Cass. 3e civ., 4 juill. 2001, n° 99-19905.
-
6.
Rouquet Y., « La loi santé au secours des bailleurs établissements publics de santé », Dalloz actualité, 5 févr. 2016 ; Danon A., « Baux d’habitation : création d’un cas de résiliation de bail pour permettre à des centres hospitaliers de loger leur personnel », Loyers et copr. avril 2016, étude 5.
-
7.
Cass. 3e civ., 16 janv. 2018, n° 17-40059 : Dalloz actualité, 22 janv. 2018, obs. Rouquet Y. ; Vial-Pedroletti B., « QPC sur le droit de résiliation du bail par le bailleur établissement public de santé », Loyers et copro 2018, comm. 53.
-
8.
AJDA 2018, p. 772, obs. Maupin E.
-
9.
Comp. à propos du contrat de bail Cons. const., 18 mars 2009, n° 2009-578 DC : D. 2009, p. 799, obs. Rouquet Y. − Cons. const., 23 janv. 2015, nos 2014-441, 2014-442, 2014-443 QPC : AJDI 2015, p. 285, obs. Damas N. ; Loyers et copro. 2015, comm. 67, obs. Vial-Pedroletti B. − Cons. const., 9 janv. 2018, n° 2017-683 QPC : AJDI 2018, p. 441, obs. Damas N.
-
10.
Comp. en matière de bail Cons. const., 18 mars 2009, n° 2009-578 DC ; Cons. const., 23 janv. 2015, nos 2014-441, 442, 443 QPC.
-
11.
Conte P., « La question prioritaire de constitutionnalité et le petit bricoleur (ou l’apport de la clef de 12 à la clarification de la loi pénale) », Dr. pén. 2013, n° 4.
-
12.
Cass. crim., 1er déc. 2015, n° 15-90017 : Dr. pén. 2016, comm. 44, obs. Conte P.
-
13.
Cons. const., 10 févr. 2017, n° 2016-611 QPC : AJ Pénal 2017, p. 237, obs. Alix J − Cons. const., 15 déc. 2017, n° 2017-682 QPC : nos obs. « Délit de consultation de sites terroristes : ni fleurs, ni couronnes… », Lexbase Hebdo 18 janv. 2018, p. 54, éd. pénale.
-
14.
Pour un commentaire détaillé, v. Mayaud Y., « L’apologie du terrorisme, un “acte de terrorisme” qui n’en est pas un… », D. 2018, p. 1233.
-
15.
Par ex. CEDH, 15 nov. 1996, n° 17862/91, Cantoni c/ France.
-
16.
Mayaud Y., « L’apologie du terrorisme, un “acte de terrorisme” qui n’en est pas un… », D. 2018, p. 1233.
-
17.
Alix J., Terrorisme et droit pénal : Étude critique des incriminations terroristes, vol. 91, 2010, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, p.467-490.
-
18.
Mayaud Y., op. cit., p. 1235.
-
19.
Par ex. dans un arrêt Cass. crim. 25 avr. 2017, n°16-83331 : Droit pénal 2017, comm. 103, obs. Conte P., « L’adhésion au projet terroriste est ambiguë ».
-
20.
Depuis lors, dans sa décision n° 2018-767 DC du 5 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a grevé d’une réserve la révision du règlement du Sénat (son l’article 91 bis, al. 2, imposant d’exercer le mandat « dans le respect du principe de laïcité ») parce qu’il « ne saurait avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à la liberté d’opinion et de vote des sénateurs ».
-
21.
Cons. const., 21 févr. 2013, n° 2012-297 QPC.
-
22.
Cons. const., 19 nov. 2004, n° 2004-505 DC.
-
23.
« qui s’opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance » (Cons. const., 19 nov. 2004, n° 2004-505 DC, § 16).
-
24.
Cons. const., 19 nov. 2004, n° 2004-505 DC, § 18.
-
25.
Cons. const., 2 juin 2017, n° 2017-633 QPC.
-
26.
CE, avis, Travaux publics, 8 mars 1994, n° 355785, EDCE 1995, p. 402.
-
27.
Le Grand J.-F, rapp. n° 4 fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, déposé le 5 octobre 1994.
-
28.
CAA Marseille, 29 avr. 2010, n° 08MA01238 : AJDA 2010, p. 1715, concl. Marcovici L.
-
29.
Yolka P., « Sur les falaises de Marne », AJDA 2016, p. 1406.
-
30.
CGCT, art. L. 5211-28, al. 1er.
-
31.
L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, de finances pour 2017 : JO n° 1, 30 déc. 2016.
-
32.
CGCT, art. L. 5211-29, I.
-
33.
CGCT, art. L. 5211-30, al. 1er.
-
34.
CE, 28 mars 2018, n° 417024.
-
35.
Nonobstant la déclaration de conformité, prononcée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004, de l’article 48 de la loi de finances pour 2005 qui avait modifié les articles CGCT, art. L. 5211-29, CGCT, art. L. 5211-30 et CGCT, art. L. 5211-33.
-
36.
Soit 20,05 à 34,06 € pour les premières en fonction de leurs situations respectives et 45,40 € pour les secondes conformément à la législation en vigueur au moment des faits litigieux.