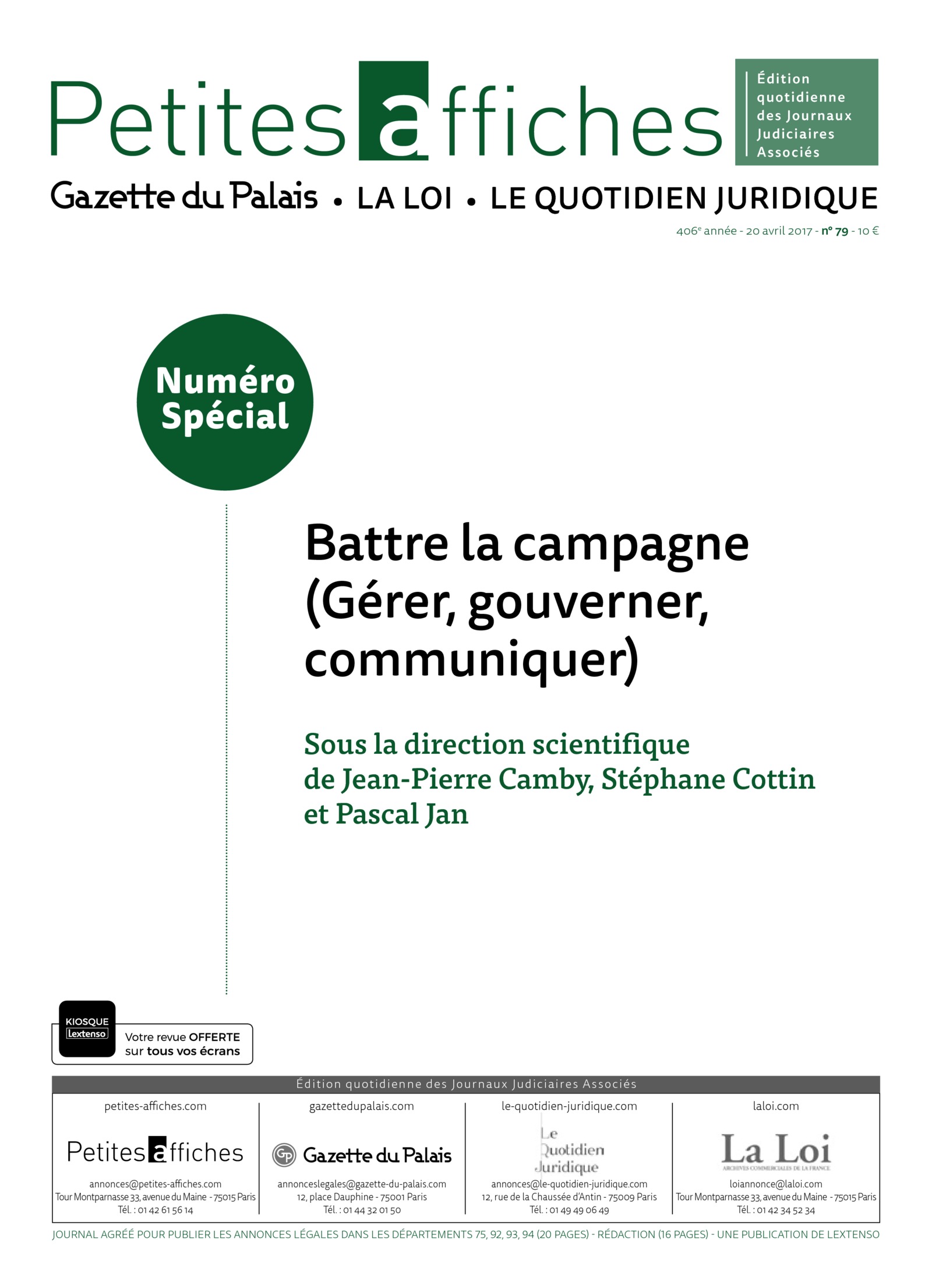La démission du Premier ministre comme problème constitutionnel.Instaurer une pratique constitutionnellement fondée
Il serait logique que le Premier ministre attende le renouvellement de l’Assemblée pour présenter sa démission.
Au-delà des diverses péripéties qui affectent jusqu’ici la campagne pour l’élection présidentielle, la séquence électorale du printemps 2017 apparaît plus ouverte et incertaine que jamais. Cette incertitude permet de soulever un problème qui n’a, jusqu’à présent, jamais été sérieusement envisagé ou discuté : celui de la démission du Premier ministre ou, plus précisément, du moment de cette démission en lien avec une élection présidentielle suivie d’élections à l’Assemblée nationale.
Le texte de la Constitution de 1958 n’est pas détaillé sur ce point. Il est seulement énoncé à l’article 8 (al. 1er) que « le président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement ». L’article 50, de son côté, dispose que « lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du gouvernement, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement ».
Au contraire, certaines constitutions européennes sont tout à fait précises. La Loi fondamentale d’Allemagne de 1949 énonce ainsi dans son article 69 (al. 2) : « Les fonctions du Chancelier fédéral prennent toujours fin avec la réunion d’un nouveau Bundestag ». Le mandat du chef de gouvernement allemand est ainsi juridiquement limité dans le temps.
En pratique, depuis les débuts de la Ve République, tous les Premiers ministres en fonction au moment d’une élection présidentielle ont démissionné rapidement après la tenue du second tour de celle-ci, alors même qu’ils n’avaient pas été désavoués par l’Assemblée nationale (ils n’étaient donc pas dans l’hypothèse évoquée par l’article 50 précité). Ainsi Georges Pompidou le 8 janvier 1966 (Charles de Gaulle ayant été réélu le 19 décembre 1965, proclamé par le Conseil constitutionnel le 28 décembre 1965, le jour de l’entrée officielle en fonction étant le 8 janvier 1966). Maurice Couve de Murville le 20 juin 1969 (Georges Pompidou ayant été élu le 15 juin, proclamé et entré en fonction le 19 juin. La situation était un peu particulière car le général de Gaulle avait déclaré cesser immédiatement ses fonctions – autrement dit : avait démissionné – dès le 28 avril au lendemain du référendum qu’il avait perdu, si bien que l’intérim fut assuré par le président du Sénat, Alain Poher, entre le 28 avril et le 19 juin 1969). Pierre Messmer le 27 mai 1974 (jour d’entrée en fonction de Valéry Giscard d’Estaing, le président Pompidou étant décédé en fonction). Raymond Barre le 13 mai 1981 (l’entrée en fonction de François Mitterrand – élu le 10 mai – étant le 21 mai 1981). Jacques Chirac le 10 mai 1988 (François Mitterrand ayant été réélu le 8 mai, son élection proclamée le 11 mai, il entra officiellement en fonction le 21 mai). Édouard Balladur le 11 mai 1995 (Jacques Chirac ayant été élu le 7 mai 1995). Lionel Jospin le 6 mai 2002 (Jacques Chirac avait été réélu le 5 mai 2002). Dominique de Villepin le 15 mai 2007 (Nicolas Sarkozy avait été élu le 6 mai, entré en fonction le 16 mai). François Fillon le 10 mai 2012 (François Hollande étant élu le 6 mai).
Cette pratique constante, rarement discutée, est parfois qualifiée de « démission de courtoisie » ou de procédé relevant de la « tradition républicaine »1.
De fait, elle remonte à la IIIe République, et débute plus précisément en 1879 : après l’élection de Jules Grévy à la présidence de la République le 30 janvier (il fut installé le 3 février), le président du Conseil en titre (qui avait été nommé en décembre 1877 par le président Mac-Mahon), Jules Dufaure, présenta sa démission le 4 février. Sans doute moins par sentiment d’une obligation constitutionnelle que parce que, âgé de 80 ans et usé par une longue vie politique entamée sous la monarchie de Juillet, il était physiquement et politiquement fatigué. Le républicain à peine moins modéré William Henry Waddington fut nommé à la présidence du Conseil.
Jules Grévy démissionna le 2 décembre 1887 (suite au scandale du trafic des décorations) ; son successeur, Sadi Carnot fut élu le 3 décembre et le président du Conseil, Maurice Rouvier, qui avait tenté de soutenir Jules Grévy, présenta sa démission le 4 décembre. Un autre républicain, Pierre Tirard, lui succéda et fut nommé le 12, sans que ce nouveau cabinet ne représente une inflexion politique quelconque dans la République des « opportunistes » déjà bien assise.
On remarquera que les deux premiers précédents avaient amené une nouvelle personnalité à la tête du nouveau cabinet. Cela devait cesser d’être le cas à partir de 1894 : Sadi Carnot ayant été assassiné le 24 juin 1832, l’Assemblée nationale porta Jean Casimir-Perier à la présidence de la République, le 27 juin. Le président du Conseil, Charles Dupuy, présenta sa démission au nouveau président mais celui-ci le confirma dans ses fonctions et le cabinet fut reformé à l’identique le 1er juillet. La situation était d’autant plus absurde que Charles Dupuy avait lui-même été candidat à l’élection présidentielle contre Jean Casimir-Perier et très nettement défait lors de ce scrutin (il était arrivé en troisième position). Sans doute le contexte de l’émotion suscitée par l’assassinat du chef de l’État pouvait justifier cette continuité mais on sait que Jean Casimir-Perier, très critique envers le fonctionnement du gouvernement parlementaire de la IIIe République, était en faveur d’une action plus énergique de l’exécutif. L’ironie du sort est qu’il n’ait pas profité de l’occasion pour imprimer plus nettement sa marque par la nomination d’une nouvelle personnalité à la présidence du Conseil, et que son président du Conseil reconduit ait contribué à le pousser à démissionner au bout de quelques mois2.
La pratique ne devait plus se démentir par la suite. Présentant leur démission « pour la forme » après l’élection d’un nouveau chef de l’État, les présidents du Conseil furent toujours reconduits, sauf cas particulier3. Elle fut même reprise sous la IVe République, alors que la « fiction » dualiste avait été réduite (le président du Conseil devant être investi par un vote exprès de l’Assemblée nationale). Pourtant, suite à l’élection de René Coty à la présidence de la République le 23 décembre, le président du Conseil Joseph Laniel offrit sa démission le jour de l’entrée en fonction du chef de l’État, le 16 janvier 1954 et fut immédiatement renommé. Là encore, la situation avait ceci d’absurde que Joseph Laniel, précisément, avait été candidat malheureux à la présidence de la République et avait même, par son obstination à se maintenir dix tours de scrutin durant, contribué à la durée interminable de cette élection.
Les Premiers ministres de la Ve République ont donc repris cette pratique ancienne. Elle prenait évidemment un sens nouveau et relativement cohérent avec la logique politique imprimée par la conception gaullienne du système de gouvernement et particulièrement de la présidence de la République. Renonçant aux précautions de langage qu’il avait dû observer en 1958 lors de l’élaboration du texte de la Constitution afin de faciliter son adoption, le général de Gaulle livra sans fard, notamment dans sa célèbre conférence de presse du 31 janvier 1964, sa conception des choses : récusant tout idée de « dyarchie » au sommet de l’État, il affirmait avec force le primat du chef de l’État sur le Premier ministre. La démission « spontanée » du Premier ministre après une élection présidentielle était, de ce point de vue, en cohérence avec cet esprit gaullien de la Constitution. Et l’on sait que, sur ce point (la primauté du président), les successeurs du général se sont inscrits pleinement dans la continuité de celui-ci.
Mais il ne s’agit que d’une lecture particulière du droit de la Constitution (c’est-à-dire des règles strictement juridiques posées par le texte) mise au service d’un certain type de système de gouvernement, en l’occurrence ce que l’on peut appeler faute de mieux le présidentialisme.
Or, il importe de réaliser que, juridiquement, le Premier ministre n’est pas obligé de démissionner immédiatement après l’élection présidentielle. Aucune règle formelle de la Constitution ne lui en fait l’obligation. Ce n’est qu’en vertu de la pratique rappelée plus haut, pratique certes constante mais sans base juridique positive que les Premiers ministres acceptent de présenter la démission du gouvernement au président sortant (ou exceptionnellement au nouveau président).
Il est permis de critiquer cette pratique en ce qu’elle ne rend pas justice de la structure véritable, fournie par le texte de la Constitution, à partir de laquelle se développe le système de gouvernement. Même en admettant le rôle majeur du président de la République dans le jeu dynamique des institutions (ce qui n’est pas évident en droit strict), le régime français reste juridiquement parlementaire : sous la Ve République, un Premier ministre tire constitutionnellement sa légitimité à la fois du président et de l’Assemblée nationale (on dit parfois qu’il est doublement responsable). Sa responsabilité politique devant l’Assemblée nationale est même la seule qui soit juridiquement codifiée par les articles 49 et 50. Celle devant le président relève d’une lecture dualiste, permise par le texte constitutionnel mais non imposée par lui. Quoi qu’il en soit, le Premier ministre a toujours besoin de cette double légitimité.
La situation peut différer selon qu’un nouveau président (ou un président réélu) trouve une Assemblée qui lui est majoritairement acquise et dont le mandat court encore un certain temps (1966, 1969, 1974, 1995), d’une part, ou bien, d’autre part, soit placé en face d’une Assemblée majoritairement hostile (1981 et 1988) ou une Assemblée devant être renouvelée quelques semaines après (cas de 2002, 2007, 2012 et 2017). Le problème de la démission du Premier ministre peut être alors posé de façon différente. On peut sans trop d’inconvénient admettre que la démission d’un Premier ministre d’une sensibilité politique proche de la majorité de l’Assemblée en fonction et acquise au président ne pose pas de difficulté majeure. Par son retrait volontaire, le chef du gouvernement laisse à un ami (objectivement parlant) politique la liberté de mouvement (cas de 1969, 1974, et même 1995 et 2007, malgré les inimitiés personnelles). En revanche, la démission paraît beaucoup moins justifiée lorsque l’Assemblée doit être renouvelée à très brève échéance, soit parce que la législature vient normalement à son terme (les quatre hypothèses de 2002 à 2017), soit parce que le nouveau président fait usage de son droit propre de dissolution comme François Mitterrand (par deux fois) pour obtenir une majorité qui lui soit favorable.
Que se passe-t-il selon la pratique jusqu’ici suivie ? Le Premier ministre s’efface volontairement à la suite de l’élection présidentielle, le nouveau chef de l’État nomme un Premier ministre puis un gouvernement qui n’est de facto qu’un gouvernement de transition puisque son sort est suspendu au résultat des élections à l’Assemblée nationale qui suivent de très près. Jusqu’ici, les élections ayant été favorables au chef de l’État et à son gouvernement, le Premier ministre fut renommé et le gouvernement composé de façon un peu différente. Tel fut le cas en 1981, 1988, 2002, 2007 et 2012. On peut observer qu’elle procure au président un « bonus » important : il aborde les élections parlementaires en position de force (symboliquement et pratiquement, grâce à la maîtrise de l’appareil d’État). De fait, depuis les origines et jusqu’à présent, l’élection du président au suffrage universel direct a comporté un effet d’entraînement politique puissant, si bien que les électeurs, lorsqu’ils furent appelés à élire les députés quelques semaines après ce premier scrutin, ont toujours donné au président une majorité favorable, légitimant après-coup le gouvernement « de transition » formé par anticipation.
Mais il n’empêche que ces mêmes électeurs sont parfaitement libres de désigner une autre majorité ou bien pas de majorité claire du tout. Il y a quelque désinvolture à affirmer que « les Français donneront évidemment une majorité au président ». L’électeur reste libre, y compris de n’être pas (en apparence) cohérent avec son premier vote (pour le président).
C’est pourquoi, il serait beaucoup plus logique que le Premier ministre attende la réunion de la nouvelle Assemblée pour démissionner. Cette façon de procéder aurait une justification sérieuse et raisonnable : empêcher que le président (quel qu’il soit) ne nomme un Premier ministre et un gouvernement de transition, non légitimés par l’Assemblée, et qui l’aident à prendre des initiatives douteuses, par exemple, convoquer un référendum avant l’élection de la nouvelle Assemblée ou bien procéder à un changement massif des principaux postes administratifs, notamment les préfets.
Que l’on ne se méprenne pas : en attendant le résultat des élections à l’Assemblée pour présenter sa démission, il ne s’agirait pas pour le Premier ministre de contrecarrer le choix de la majorité des électeurs à l’élection présidentielle. Mais simplement de donner plein effet à la logique profonde de la Constitution qui exige une double légitimité (et non pas la seule légitimité issue du président) pour tout gouvernement. Et donc d’attendre que le corps électoral ait rendu son verdict complet (présidentiel et parlementaire).
On peut même suggérer que le Premier ministre serait bien avisé de le faire si d’aventure était élue à la présidence de la République une personne inquiétante. Pour le dire clairement : si Mme Le Pen était élue le 7 mai, M. Cazeneuve serait bien inspiré de demeurer à son poste ; il en a parfaitement le droit. Il aurait à attendre l’issue du scrutin des 11 et 18 juin.
Mais au-delà des scénarios concrets, la question du moment de la démission du Premier ministre pose un problème de fond. Alors que la pratique présidentialiste dominante paraît épuisée et sans doute même contre-productive, qu’elle est à juste titre critiquée de divers côtés, il serait temps, plutôt que d’engager un hasardeux chantier de révision tel celui désigné sous le slogan de « VIe République », de mettre fin à la désinvolture vis-à-vis des ressorts parlementaires de la Ve République par des pratiques nouvelles constitutionnellement fondées en droit. En un mot de revenir à un parlementarisme positif.
Notes de bas de pages
-
1.
« La tradition républicaine toujours observée veut que le Premier ministre présente au président nouvellement élu la démission de son gouvernement », affirmait ainsi François Mitterrand dans sa Lettre aux Français en 1988 (cité par Avril P., Les conventions de la Constitution, 1997, PUF, Léviathan, p. 101).
-
2.
V. Lemaire E., « Introduction à : Jean Casimir-Perier », in Notes sur la Constitution de 1875, 2015, Dalloz.
-
3.
Ribot succède à Dupuy après l'élection de Félix Faure en janvier 1895. Leygues succède à Millerand qui venait d'être élu à la présidence de la République (septembre 1920). Herriot est nommé par Doumergue en juin 1924 après la crise présidentielle ; il succède au cabinet technique de François-Marsal nommé par Millerand.