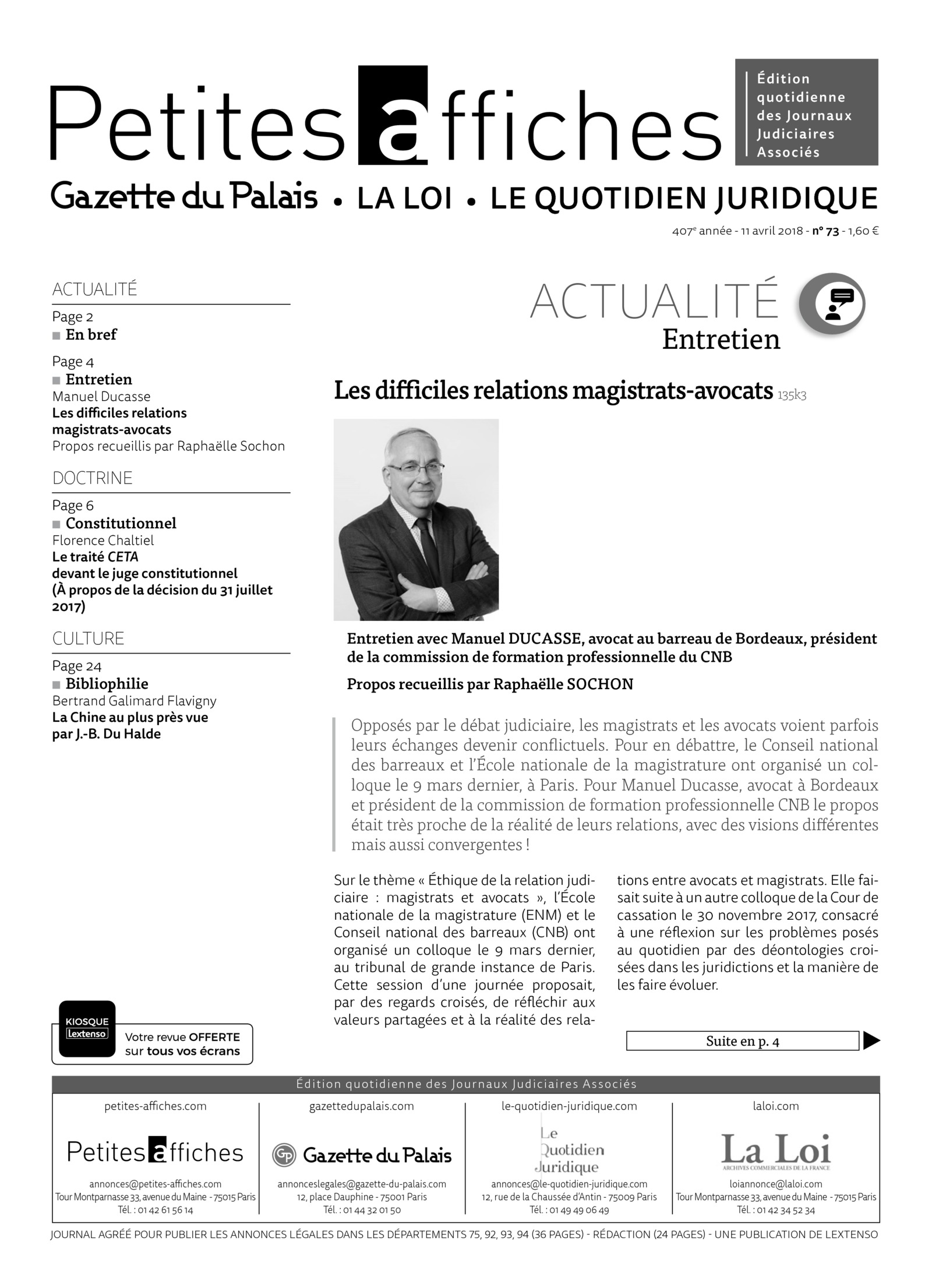Le traité CETA devant le juge constitutionnel (À propos de la décision du 31 juillet 2017)
La décision rendue le 31 décembre 2017 par le Conseil constitutionnel à propos du traité dit CETA (l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part), est originale par cela qu’elle a été différée afin de se livrer à une étude approfondie du traité. Ce dernier a, en effet, suscité de nombreuses controverses. La décision a ainsi été rendue plus de 5 mois après la saisine. Le Conseil constitutionnel, tout en validant sa conformité, rappelle et précise encore sa jurisprudence relative à la souveraineté et s’inscrit dans un partage de rôle entre le juge européen et le juge national eu égard à la nature mixte de l’accord.
Le traité CETA (l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part) a été signé le 30 octobre 2016. Il a été approuvé par le Parlement européen le 15 février 2017. Le Conseil constitutionnel a été saisi de ce traité pour examiner sa conformité à la constitution sur le fondement de l’article 54, par plus de 60 députés, le 22 février 2017. Il a rendu sa décision le 31 juillet 20171, dans le sens de la Constitutionnalité, ouvrant ainsi à la ratification du traité.
L’accord comporte 30 chapitres. Le chapitre 1 énonce l’objet et les finalités de l’accord et comporte un ensemble de définitions générales. Le chapitre 2 concerne le traitement national et l’accès aux marchés pour les marchandises. Le chapitre 3 porte sur les recours commerciaux. Les chapitres 4 et 5 concernent les obstacles non tarifaires aux échanges de marchandises résultant de réglementations techniques et de mesures sanitaires et phytosanitaires. Le chapitre 6 contient des stipulations en matière de douanes. Le chapitre 7 est relatif aux subventions. Le chapitre 8 porte sur les investissements et institue, à sa section F, un mécanisme de règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États. Le chapitre 9 concerne le commerce transfrontière des services. Le chapitre 10 comporte des stipulations relatives à l’admission et au séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles. Le chapitre 11 est relatif à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. Le chapitre 12, intitulé « Réglementation intérieure », s’applique aux octrois de licences. Les chapitres 13 à 16 concernent les services financiers, les services de transport maritime international, les télécommunications et le commerce électronique. Le chapitre 17 est relatif à la politique de la concurrence. Le chapitre 18 porte sur les entreprises d’État, monopoles et entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux. Les chapitres 19 et 20 sont relatifs aux marchés publics et à la propriété intellectuelle. Le chapitre 21 traite de la coopération en matière de réglementation. Les chapitres 22 à 24 comportent des stipulations transversales relatives au commerce et au développement durable, au commerce et au travail et au commerce et à l’environnement. Le chapitre 25 concerne la coopération et les dialogues bilatéraux. Le chapitre 26 est relatif aux dispositions administratives et institutionnelles. Le chapitre 27 est consacré à la transparence. Le chapitre 28 est relatif à certaines exceptions. Le chapitre 29 instaure des procédures de règlement des différends. Enfin, le chapitre 30 contient des stipulations générales et finales.
Ces chapitres sont complétés par un instrument interprétatif commun, par 38 déclarations et par des annexes. Ainsi que l’indique l’article 30.1 de l’accord, les « protocoles, annexes, déclarations, déclarations communes, mémorandums d’accord et notes de bas de page » de l’accord en font partie intégrante.
Ce traité a suscité de si nombreuses controverses et interrogations2 que le Conseil constitutionnel a sollicité plusieurs études avant de pouvoir rendre sa décision. Il a en effet reçu 16 contributions extérieures dont la liste est rendue publique sur le site internet du Conseil constitutionnel3 et procédé à 10 auditions. Ce traité a aussi ceci de particulier qu’il entre dans la catégorie des accords mixtes. La notion d’accords mixtes est née de la construction de la politique commerciale commune et de ses interprétations successives par le juge européen.
En effet, l’union douanière a été réalisée dès 1968 et la Communauté européenne, puis l’Union, ont progressivement succédé aux États au sein des traités de commerce. La Cour de justice de l’Union européenne (UE) a ainsi interprété les traités dans le sens de la nature exclusive de la politique commerciale commune4. Pour comprendre cette assertion, il convient de rappeler que, jusqu’au traité de Lisbonne, il n’existait pas de liste de compétences pour l’Union d’un côté, et pour ses États membres de l’autre. Seuls étaient donnés des titres de compétences à la Communauté, devenue Union, lui permettant d’exercer une série de compétences et de construire des politiques communes.
Au fil des révisions successives des traités et des jurisprudences européennes une classification, nécessairement incertaine en l’absence de liste préétablie, s’est dessinée. Cette incertitude s’explique d’ailleurs largement par la philosophie même de la construction européenne, souvent exposée par les pères fondateurs. La méthode des petits pas et de l’effet d’engrenage ou spill-over ne pouvait certes pas s’accommoder de listes de compétences. Il fallait avancer pas à pas, pour ne pas heurter la souveraineté des États. Ces derniers, à force de travailler ensemble et de mettre en commun des compétences, devaient toujours aller vers davantage de nécessité de travail collectif. Arrivés à une maturité d’exercice, les compétences ont ainsi donné lieu à de véritables politiques communes. La dimension initialement économique de la construction européenne a logiquement conduit la Cour de justice européenne à interpréter la politique commerciale comme étant fondée sur une compétence exclusive. Au fur et à mesure des révisions des traités, de nouvelles compétences ont été attribuées à l’Union européenne, elles-mêmes en appelant parfois de nouvelles. C’est ainsi qu’au début des années 2000, la nécessité s’est faite sentir de clarifier les compétences de chacun, l’Union européenne d’un côté et les États membres de l’autre. Le traité de Lisbonne donne ainsi les précisions suivantes. Il définit trois grands types de compétences. Il énonce, en premier lieu, les compétences exclusives – article 3 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) : l’Union européenne est la seule à pouvoir légiférer et adopter des actes contraignants dans ces domaines. Les pays de l’Union ne sont pas habilités à le faire eux-mêmes, sauf si l’UE les autorise à mettre en place ces actes. L’Union dispose d’une compétence exclusive dans les domaines suivants : l’union douanière ; l’établissement de règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ; la politique monétaire pour les pays de l’UE dont la monnaie est l’euro ; la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ; la politique commerciale commune ; la conclusion d’accords internationaux sous certaines conditions.
En deuxième lieu, le traité énonce les compétences partagées (TFUE, art. 4) : l’Union et les pays de l’UE sont habilités à légiférer et à adopter des actes contraignants. Cependant, les États membres de l’UE ne peuvent exercer leur compétence que dans la mesure où l’Union européenne n’a pas exercé ou a décidé de ne pas exercer la sienne. La compétence partagée entre l’Union et les pays membres s’applique aux domaines suivants : le marché intérieur ; la politique sociale, pour les aspects définis de façon précise dans le traité exclusivement ; la cohésion économique, sociale et territoriale (politique régionale) ; l’agriculture et la pêche (à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer) ; l’environnement ; la protection des consommateurs ; les transports ; les réseaux transeuropéens ; l’énergie ; l’espace de liberté, de sécurité et de justice ; les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le TFUE uniquement ; la recherche, le développement technologique et l’espace ; la coopération au développement et l’aide humanitaire.
En troisième lieu, le traité énonce les compétences d’appui (TFUE, art. 6). Dans ces domaines, l’Union européenne ne peut intervenir que pour soutenir, coordonner ou compléter les actions des États membres. Les actes juridiquement contraignants de l’Union ne doivent pas nécessiter une harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des pays membres. Les compétences d’appui se rapportent aux domaines politiques suivants : la protection et l’amélioration de la santé humaine ; l’industrie ; la culture ; le tourisme ; l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport ; la protection civile ; la coopération administrative.
Le traité définit aussi des compétences particulières. L’Union européenne peut prendre des mesures pour veiller à ce que les pays de l’UE coordonnent leurs politiques économiques, sociales et de l’emploi au niveau européen. La politique étrangère et de sécurité commune (PESC) se distingue par des caractéristiques institutionnelles spécifiques, comme la participation limitée de la Commission européenne et du Parlement européen au processus décisionnel et l’exclusion de toute activité législative. Cette politique est définie et mise en place par le Conseil européen (composé des chefs d’État ou de gouvernement des pays de l’UE) et par le Conseil (composé d’un ministre de chaque pays de l’UE). Le président du Conseil européen et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité représentent l’UE en matière de politique étrangère et de sécurité commune.
L’exercice des compétences de l’UE est soumis à deux principes fondamentaux figurant à l’article 5 du traité sur l’Union européenne que sont le principe de proportionnalité : le contenu et la forme de l’action de l’UE n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités, et le principe de subsidiarité : dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’UE intervient seulement si, et dans la mesure où, l’objectif d’une action envisagée ne peut pas être atteint de manière suffisante par les pays de l’UE, mais peut l’être mieux au niveau de l’UE.
Il faut donc retenir que la politique commerciale est une compétence exclusive de l’Union européenne. Cependant, la clarté de l’exclusivité s’est quelque peu brouillée par la complexité et la densité des traits internationaux. Les États, s’ils ne contestaient pas l’exclusivité de la politique commerciale commune, dans les premiers temps, se sont néanmoins aperçus que certains domaines, comme la propriété intellectuelle ou certains services par exemple, ne pouvaient relever de la compétence exclusive de l’Union européenne. Ainsi les avis dits « GATS et TRIPS5 » de la Cour de justice ont permis de concevoir la notion d’accords mixtes. La Cour avait alors indiqué que le choix de la base juridique appropriée revêt une importance de nature constitutionnelle. En effet, la Communauté ne disposant que de compétences d’attribution, elle doit rattacher l’accord qu’elle entend conclure à une disposition du traité qui l’habilite à approuver un tel acte. Le recours à une base juridique erronée est donc susceptible d’invalider l’acte de conclusion lui-même et, partant, de vicier le consentement de la Communauté à être liée par l’accord auquel cette dernière a souscrit. Tel est le cas notamment lorsque le traité ne confère pas à la Communauté une compétence suffisante pour ratifier l’accord dans son ensemble, ce qui revient à examiner la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres pour conclure l’accord envisagé avec des pays tiers, ou encore lorsque la base juridique appropriée dudit acte de conclusion prévoit une procédure législative différente de celle qui a effectivement été suivie par les institutions communautaires6. S’agissant de l’ordre dans lequel doivent être examinées les questions qui étaient alors posées à la Cour, il y a lieu de reconnaître, ainsi que l’ont relevé la plupart des intervenants et comme l’admet d’ailleurs la Commission elle-même, que le caractère, exclusif ou non, de la compétence communautaire aux fins de la conclusion des accords en cause et la base juridique à laquelle il doit être recouru à ce même effet constituent deux questions intimement liées.
La question de savoir si la Communauté dispose seule de la compétence pour conclure un accord ou si une telle compétence est partagée avec les États membres dépend notamment de la portée des dispositions communautaires susceptibles d’attribuer aux institutions communautaires le pouvoir de participer à un tel accord.
La cour avait alors jugé que la conclusion des accords avec les membres affectés de l’organisation mondiale du commerce au sens de l’article 21 de l’accord général sur le commerce des services (GATS), tels que visés dans la présente demande d’avis, relève de la compétence partagée de la Communauté européenne et des États membres7. Il en résulte un élément d’importance qui est que, dans le cas de compétence exclusive, les institutions européennes seules mènent les étapes de la négociation, tandis que, dans le cas d’accords mixtes, les États conservent une marge de négociation dans leurs domaines de compétences.
Or le traité CETA entre précisément dans ce cadre d’accord mixte. Une partie de ce traité relève donc de la compétence des États et explique aussi leur implication dans les réflexions et négociations. Le Conseil constitutionnel s’est donc prononcé le 31 juillet 2017, en jugeant que le traité soumis est conforme à la Constitution. Pour juger ainsi, il a procédé classiquement par énumération première des normes de références qui, moins classiquement, apparaissent, au regard de la nature du traité, comme étant à la fois nationales et européennes (I), ces normes de référence, confrontées au traité examiné, n’ont pas révélé d’éléments d’inconstitutionnalité (II).
I – Les normes de référence applicables : normes constitutionnelles nationales et européennes
Si, lorsque l’article 54 de la constitution a été pensé et rédigé, il semblait l’être aux fins d’éviter une trop forte avancée de la supranationalité européenne, il a été finalement l’occasion de plusieurs censures. Ce faisant, le Conseil constitutionnel a dégagé des normes de références, par une interprétation nécessaire des dispositions constitutionnelles nationales (A). La nature mixte du traité soumis à son appréciation, donnant lieu à la décision du 31 juillet 2017 le conduit à esquisser des normes de référence européennes (B).
A – Les normes de référence constitutionnelles nationales confirmées par le juge
Le Conseil constitutionnel a forgé, depuis les années 1970, une jurisprudence polie au gré des saisines relatives aux traités internationaux. Dès 1970, à partir des dispositions contenues dans les traités, le Conseil constitutionnel a inventé la formule de « conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ». Après une brève éclipse de cette expression au profit d’une incertaine distinction, finalement abandonnée, entre les limitations – jugées autorisées – et les transferts – jugés interdits – de souveraineté, le Conseil constitutionnel l’utilise systématiquement lorsqu’est en cause le principe de souveraineté (1), l’enrichissant de la notion d’identité constitutionnelle (2).
1 – La notion de conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale
C’est déjà à propos de normes européennes que le Conseil constitutionnel a forgé la notion de « conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ». Saisi du traité sur les ressources propres, en 19708, il juge que la décision du 21 avril 1970, qui recommande le remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux communautés, a le caractère d’une mesure d’application des dispositions des traités instituant les communautés européennes, dès lors qu’elle est prise dans les conditions prévues notamment à l’article 201 du traité instituant la Communauté économique européenne et à l’article 173 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, c’est-à-dire conformément aux règles constitutionnelles respectives des États membres ; que l’application de ces règles exige que l’adoption des dispositions prévues par ladite décision qui, sur certains points, porte sur des matières de nature législative telles qu’elles sont définies à l’article 34 de la constitution, soit subordonnée, conformément à l’article 53, à l’intervention d’une loi ; que la condition de réciprocité susmentionnée se trouve remplie, que dans le cas de l’espèce, elle ne peut porter atteinte, ni par sa nature, ni par son importance, aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale9.
En 197610, alors qu’il est saisi dans un contexte politique difficile, les députés étant à ce moment-là farouchement hostiles au principe de l’élection des membres de l’Assemblée européenne au suffrage universel direct, le Conseil constitutionnel utilise une distinction entre les limitations de souveraineté et les transferts. Se fondant sur le préambule de la constitution de 1946, selon lequel la France respecte les règles du droit public international et consent aux limitations de souveraineté indispensables à la préservation de la paix, le Conseil constitutionnel juge que les limitations de souveraineté sont autorisées par la constitution. En revanche, et c’est ce qui lui permet de valider l’acte relatif à l’élection des membres de l’Assemblée européenne au suffrage universel direct, les transferts de souveraineté sont alors interdits11. Le Parlement européen n’étant alors qu’une assemblée dotée de faibles pouvoirs de décision, le Conseil constitutionnel ne détecte aucun transfert.
Cette jurisprudence est rapidement abandonnée au profit de celle créée en 1970. On la retrouve systématiquement dans toutes les décisions dans lesquelles le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur la conformité d’un traité international ou européen à la constitution. Outre les traités sur l’Union européenne, deux décisions ont porté sur la conformité de dispositions européennes relatives à l’interdiction de la peine de mort. Ainsi, en 198512, le Conseil constitutionnel juge que le protocole n° 6 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, soumis à l’examen du Conseil constitutionnel, stipule que la peine de mort est abolie, qu’elle peut toutefois être prévue pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; que cet accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par l’article 65 de la Convention européenne des droits de l’Homme ; que cet engagement international n’est pas incompatible avec le devoir pour l’État d’assurer le respect des institutions de la République, la continuité de la vie de la nation et la garantie des droits et libertés des citoyens ; dès lors que le protocole n° 6 ne porte pas atteinte aux conditions essentielles de l’exercice de la souveraineté nationale et qu’il ne contient aucune clause contraire à la constitution13.
En 2005, de nouveau saisi de deux traités relatifs à l’interdiction de la peine de mort, l’un international, l’autre européen14, il censure la dimension irrévocable de l’accord. Il indique en effet que le protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales abolit la peine de mort en toutes circonstances. Il relève que le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule qu’« aucune personne (…) ne sera exécutée » et oblige tout État partie à abolir la peine de mort ; qu’il ne permet de déroger à cette règle que pour les crimes de caractère militaire, d’une gravité extrême et commis en temps de guerre ; qu’en outre, cette faculté doit être fondée sur une législation en vigueur à la date de la ratification et avoir fait l’objet d’une réserve formulée lors de celle-ci. Il rappelle qu’au cas où un engagement international contient une clause contraire à la constitution, met en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou porte atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale, l’autorisation de le ratifier appelle une révision constitutionnelle. Sur ces bases, le juge constitutionnel estime que les deux protocoles soumis à l’examen du Conseil constitutionnel ne contiennent aucune clause contraire à la constitution et ne mettent pas en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis. Au regard de ces engagements, il indique que la question est alors celle de savoir s’ils portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale. Le juge constitutionnel juge ainsi que, porte atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale, l’adhésion irrévocable à un engagement international touchant à un domaine inhérent à celle-ci.
Le juge opère alors une distinction entre les deux engagements soumis à son appréciation. Il relève en premier lieu que le protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, s’il exclut toute dérogation ou réserve, peut être dénoncé dans les conditions fixées par l’article 58 de cette convention ; que, dès lors, il ne porte pas atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale. Il indique, en revanche, que ne peut être dénoncé le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que cet engagement lierait irrévocablement la France même dans le cas où un danger exceptionnel menacerait l’existence de la Nation ; qu’il porte, dès lors, atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale15.
La volonté du constituant étant de pouvoir ratifier ces traités, une révision constitutionnelle s’en était alors suivie. La formule suivante est alors insérée à l’article 66 de la constitution : « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ».
Les années 1990 et 2000 donnent l’occasion au juge constitutionnel de peaufiner et donner encore plus de maturité à son approche de la souveraineté, confrontée à la construction du droit supranational européen. La décision majeure est, à n’en pas douter, celle du 9 avril 199216 relative au traité de Maastricht. C’est, en effet, la première fois que le Conseil constitutionnel censure un traité international pour contrariété à la constitution et précisément aux « conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ». Il détecte à ce moment-là trois motifs d’inconstitutionnalité sur des sujets dont chacun s’attendait à ce qu’ils suscitent une censure. Il s’agissait alors des dispositions relatives à l’Union économique et monétaire, en d’autres termes, le passage de la monnaie commune à la monnaie unique. Il s’agissait aussi du droit de vote et d’éligibilité des citoyens de l’Union européenne aux élections européennes, et enfin, du principe du vote à la majorité qualifiée, qui devait être effectif en 1996, concernant la politique des visas. Depuis ce traité, plusieurs autres traités ont été censurés au regard de cette même formule relative à la souveraineté. Il en est ainsi notamment du traité d’Amsterdam17, du traité établissant une constitution pour l’Europe18 ou enfin du traité de Lisbonne19. Chaque fois, la technique de contrôle a été la même. Le juge constitutionnel, au regard des compétences transférées et des méthodes de prises de décision, décide si le traité porte atteinte, ou non, aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale. Dit de manière synthétique, le juge censure lorsqu’il est face à un cumul de matières relevant de la souveraineté et une méthode intégrée ou supranationale.
Le pouvoir constituant a, lui aussi, adopté une méthode de travail constante. Il a en effet procédé par des « révisions-adjonctions » plutôt que par d’incertaines révisions modifications. La méthode choisie est, en effet, la plus sûre. Comment réviser des dispositions constitutionnelles aussi cardinales que celles relatives à la souveraineté nationale ? La révision adjonction a ainsi consisté, chaque fois, à ajouter dans la constitution les dispositions préalablement censurées.
Le résultat de ces processus de « censure-révision » successifs est une européanisation de la constitution. Le titre XV de la constitution est ainsi entièrement consacré à l’appartenance française à l’Union européenne, et, plus récemment, à la participation du parlement national à la construction européenne. Ces dispositions sont, pour l’essentiel, les suivantes : les articles 88-1 à 88-7 précisent les conditions d’appartenance de la France à l’Union européenne. Il faut en retenir, en premier lieu, la valeur constitutionnelle de l’appartenance de la France à l’Union européenne. En deuxième lieu, ces dispositions reprennent des éléments préalablement jugés non conformes par le juge constitutionnel. En troisième lieu, ces articles reprennent des éléments consacrés à la participation du parlement national aux affaires européennes. Enfin, est affirmé le principe selon lequel tout traité prévoyant une nouvelle adhésion d’un État à l’Union européenne est soumis à un référendum.
Au regard de ce titre XV, le Conseil constitutionnel a, lui aussi, européanisé davantage sa jurisprudence. Alors qu’il refusait, et qu’il refuse toujours, de contrôler la conformité de la loi aux traités internationaux régulièrement ratifiés et entrés en vigueur depuis sa jurisprudence de 1975, il accepte de veiller à la conformité des lois aux traités européens et actes de droit dérivés de l’Union européenne. Pour autant, il n’entendait pas supprimer tout verrou constitutionnel vis-à-vis du droit européen, y compris dans son droit dérivé. C’est ainsi qu’il a enrichi sa jurisprudence de la notion d’identité constitutionnelle.
2 – La notion d’identité constitutionnelle
Sur la base de l’article 88-1 de la constitution, le Conseil constitutionnel a jugé que « la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu’en raison d’une disposition expresse contraire à la constitution20 ». Il utilise désormais, depuis sa décision de 200621, la notion d’identité constitutionnelle. Sans être précisément définie, on peut estimer que cette notion recouvre les valeurs fondamentales de la République ou encore ses caractéristiques essentielles.
Le juge constitutionnel a ainsi affirmé, d’une part, qu’aux termes de l’article 55 de la constitution, « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie » ; que, si ces dispositions confèrent aux traités, dans les conditions qu’elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n’impliquent que le respect de ce principe doit être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la constitution ; que le moyen tiré du défaut de compatibilité d’une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d’inconstitutionnalité ; que l’examen d’un tel grief fondé sur les traités ou le droit de l’Union européenne relève de la compétence des juridictions administratives et judiciaires ; d’autre part, qu’aux termes de l’article 88-1 de la constitution : « La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 » ; qu’ainsi, la transposition en droit interne d’une directive de l’Union européenne résulte d’une exigence constitutionnelle. Il souligne alors qu’il appartient au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l’article 61 de la constitution, d’une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive de l’Union européenne, de veiller au respect de cette exigence ; que, toutefois, le contrôle qu’il exerce à cet effet est soumis à une double limite ; qu’en premier lieu, la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti ; qu’en second lieu, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l’article 61 de la constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne sur le fondement de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; qu’en conséquence, il ne saurait déclarer non conforme à l’article 88-1 de la constitution qu’une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu’elle a pour objet de transposer ; qu’en tout état de cause, il appartient aux juridictions administratives et judiciaires d’exercer le contrôle de compatibilité de la loi au regard des engagements européens de la France et, le cas échéant, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel22.
Le Conseil constitutionnel a ainsi apporté une série d’éclairages et d’interprétations des normes constitutionnelles et précisément de la souveraineté nationale. Après une certaine réserve initiale vis-à-vis des traités internationaux, qu’il qualifie de relatifs et contingents par opposition à la constitution stable et non relative, il a progressivement admis la nature spécifique de l’Union européenne, s’inscrivant dans une volonté de dialogue non seulement avec les autres juges nationaux mais aussi avec la Cour de justice de l’Union, acceptant finalement le principe de pouvoir la saisir d’un renvoi préjudiciel.
De même, dans une décision QPC de 2014, il rappelle qu’aux termes de l’article 88-1 de la constitution, « la République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 » ; qu’en l’absence de mise en cause d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, le Conseil constitutionnel n’est pas compétent pour contrôler la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d’une directive de l’Union européenne ; qu’en ce cas, il n’appartient qu’au juge de l’Union européenne, saisi, le cas échéant, à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette directive des droits fondamentaux garantis par l’article 6 du traité sur l’Union européenne23. Encore récemment, le juge constitutionnel rappelle qu’il appartient au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l’article 61 de la constitution d’une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au respect de cette exigence ; que, toutefois, le contrôle qu’il exerce à cet effet est soumis à une double limite ; qu’en premier lieu, la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti ; qu’en second lieu, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l’article 61 de la constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne sur le fondement de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; qu’en conséquence, il ne saurait déclarer non conforme à l’article 88-1 de la constitution qu’une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu’elle a pour objet de transposer ; qu’en tout état de cause, il appartient aux juridictions administratives et judiciaires d’exercer le contrôle de compatibilité de la loi au regard des engagements européens de la France et, le cas échéant, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel24.
Au regard de cette construction jurisprudentielle des normes de référence et de leurs formulations successives, le Conseil constitutionnel, vis-à-vis du traité CETA, les rappelle comme suit. Par le préambule de la constitution de 1958, le peuple français a proclamé solennellement « son attachement aux droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la constitution de 1946 ».
Dans son article 3, la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 énonce que « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ». L’article 3 de la constitution de 1958 dispose, dans son premier alinéa, que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Le préambule de la constitution de 1946 proclame, dans son quatorzième alinéa, que la République française se « conforme aux règles du droit public international » et, dans son quinzième alinéa, que « sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix ».
Dans son article 53, la constitution de 1958 consacre l’existence de « traités ou accords relatifs à l’organisation internationale ». Ces traités ou accords ne peuvent être ratifiés ou approuvés par le président de la République qu’en vertu d’une loi. La République française participe à l’Union européenne dans les conditions prévues par le titre XV de la constitution. Aux termes de l’article 88-1 de la constitution : « La République participe à l’Union européenne, constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ». Le constituant a ainsi consacré l’existence d’un ordre juridique de l’Union européenne intégré à l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique international. Tout en confirmant la place de la constitution au sommet de l’ordre juridique interne, ces dispositions constitutionnelles permettent à la France de participer à la création et au développement d’une organisation européenne permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l’effet de transferts de compétences consentis par les États membres.
Il rappelle toutefois que, lorsque des engagements souscrits à cette fin ou en étroite coordination avec celle-ci contiennent une clause contraire à la constitution, remettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale, l’autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle25.
Cet ensemble de normes constitutionnelles nationales de référence semble désormais, à la lecture de la décision du Conseil constitutionnel sur le traité CETA, de normes de référence que l’on peut interpréter comme étant à la fois nationales et européennes.
B – Les normes de référence constitutionnelles et européennes esquissées par le juge
Dans le cas où le Conseil constitutionnel est saisi, sur le fondement de l’article 54 de la constitution, d’un accord qui devait être signé et conclu tant par l’Union européenne que par chacun des États membres de celle-ci, le juge constitutionnel indique qu’il lui appartient de distinguer entre, d’une part, les stipulations de cet accord qui relèvent d’une compétence exclusive de l’Union européenne en application d’engagements antérieurement souscrits par la France ayant procédé à des transferts de compétences consentis par les États membres et, d’autre part, les stipulations de cet accord qui relèvent d’une compétence partagée entre l’Union européenne et les États membres ou d’une compétence appartenant aux seuls États membres.
S’agissant des stipulations de l’accord qui relèvent d’une compétence partagée entre l’Union européenne et les États membres ou d’une compétence appartenant aux seuls États membres, il revient au Conseil constitutionnel, comme il est rappelé au paragraphe 11, de déterminer si ces stipulations contiennent une clause contraire à la constitution, remettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale. S’agissant, en revanche, des stipulations de l’accord qui relèvent d’une compétence exclusive de l’Union européenne, le juge constitutionnel souligne qu’il lui revient seulement, saisi afin de déterminer si l’autorisation de ratifier cet accord implique une révision constitutionnelle, de veiller à ce qu’elles ne mettent pas en cause une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France. En l’absence d’une telle mise en cause, il n’appartient qu’au juge de l’Union européenne de contrôler la compatibilité de l’accord avec le droit de l’Union européenne. C’est au regard de ces principes qu’il revient au Conseil constitutionnel de procéder à l’examen de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, tel que défini aux paragraphes 3 et 426.
S’agissant de la distinction au sein du texte entre les compétences de chacun, le Conseil constitutionnel souligne que l’accord a comme objectif, selon son préambule, de créer un marché élargi et sûr pour les marchandises et les services des parties et d’établir des règles claires, transparentes, prévisibles et mutuellement avantageuses pour régir leurs échanges commerciaux et leurs investissements.
Le Conseil constitutionnel se fonde sur les principes dégagés par l’avis du 16 mai 201727 de la Cour de justice de l’Union européenne pour déduire que ne relèvent de la compétence exclusive de l’Union européenne ni les stipulations de l’accord figurant au chapitre VIII relatives aux investissements autres que directs, ni celles qui définissent, à sa section F, la procédure de règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États. Il en va de même des stipulations des chapitres 1, 21, 26, 27, 28, 29 et 30, pour autant que celles-ci concernent une compétence partagée entre l’Union européenne et ses États membres.
Sollicité sur le principe de précaution, le Conseil constitutionnel précise que les députés requérants soutiennent que les stipulations de l’article 8 sont contraires au principe de précaution. Ils estiment, en outre, que les stipulations de la section F du chapitre 8 sont contraires à la constitution. Selon eux, le mécanisme de règlement des différends qu’elles instituent serait contraire aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale et à l’article 88-1 de la constitution aux motifs, d’une part, qu’il permettrait aux investisseurs du Canada, à leur seule discrétion, d’échapper à la compétence des juridictions françaises pour mettre en cause la France devant le tribunal institué par l’accord et, d’autre part, qu’il porterait atteinte aux compétences exclusives de la Cour de justice de l’Union européenne. Les règles relatives à la constitution du tribunal seraient, en outre, contraires aux principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions. Enfin, en accordant un privilège de juridiction aux investisseurs canadiens qui ne serait justifié ni par une différence de situation ni par un motif d’intérêt général, l’accord méconnaîtrait le principe d’égalité devant la loi28. Les députés requérants reprochent à l’accord de ne faire aucune référence au principe de précaution et de n’imposer aux parties aucune obligation en la matière, y compris en cas de risques graves et irréversibles. Le principe de précaution serait, en outre, méconnu par plusieurs stipulations de l’accord.
Il rejette les moyens des députés selon l’argumentation suivante. Aux termes de l’article 5 de la charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par l’application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Ces dispositions, comme l’ensemble des droits et devoirs définis dans la charte de l’environnement, ont valeur constitutionnelle. Dès lors, il incombe au Conseil constitutionnel, saisi en application de l’article 54 de la constitution, de déterminer si un engagement international soumis à son examen méconnaît le principe de précaution.
Le juge souligne, en premier lieu, dans le chapitre 22 consacré au commerce et au développement durable, que les parties à l’accord « reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement sont interdépendants et forment des composantes du développement durable qui se renforcent mutuellement, et elles réaffirment leur engagement à promouvoir le développement du commerce international d’une manière qui contribue à la réalisation de l’objectif de développement durable ». Les parties visent, à ce titre, les objectifs suivants : « favoriser le développement durable par une coordination et une intégration accrues de leurs politiques et mesures respectives en matière de travail, d’environnement et de commerce (…) promouvoir le dialogue et la coopération entre elles en vue de resserrer leurs relations commerciales et économiques d’une manière qui appuie leurs mesures et leurs normes respectives en matière de protection du travail et de l’environnement (…) améliorer l’application de leur droit respectif en matière de travail et d’environnement (…) favoriser la consultation et la participation du public dans la discussion des questions de développement durable ».
Le Conseil souligne en deuxième lieu, d’une part, l’absence de mention expresse du principe de précaution dans les stipulations de l’accord qui relèvent d’une compétence partagée entre l’Union européenne et les États membres n’emporte pas de méconnaissance de ce principe. En outre, les décisions du comité mixte prises dans les conditions rappelées aux paragraphes 48 à 50 ci-dessus sont soumises au respect du principe de précaution protégé par le droit de l’Union européenne, notamment par l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il indique que le 2 de l’article 24.8 de l’accord stipule que « les parties reconnaissent que, en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne sert pas de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures économiquement efficaces visant à prévenir la dégradation de l’environnement ». Ces stipulations autorisent les parties à prendre des mesures économiquement efficaces visant à prévenir la dégradation de l’environnement en cas de risque de dommages graves ou irréversibles.
Le juge souligne enfin que, selon le a) du paragraphe 9 de l’instrument interprétatif commun, « l’Union européenne et ses États membres ainsi que le Canada sont tenus d’assurer et d’encourager des niveaux élevés de protection de l’environnement, et de s’efforcer d’améliorer continuellement leur législation et leurs politiques en la matière de même que les niveaux de protection sur lesquels elles reposent ». Selon son b), l’accord « reconnaît expressément au Canada ainsi qu’à l’Union européenne et à ses États membres le droit de définir leurs propres priorités environnementales, d’établir leurs propres niveaux de protection de l’environnement et d’adopter ou de modifier en conséquence leur législation et leurs politiques en la matière, tout en tenant compte de leurs obligations internationales, y compris celles prévues par des accords multilatéraux sur l’environnement ».
Le Conseil constitutionnel estime ainsi que l’ensemble de ces stipulations sont propres à garantir le respect du principe de précaution issu de l’article 5 de la charte de l’environnement. Et juge donc que les stipulations des chapitres 1, 21, 26, 27, 28, 29 et 30 qui concernent une compétence partagée entre l’Union européenne et les États membres ne portent pas atteinte au principe de précaution29.
Au regard de cet ensemble de normes de référence que la nature mixte du traité donne l’occasion au Conseil constitutionnel d’étendre à certaines normes européennes, le juge valide l’ensemble du traité soumis à son examen.
II – La conformité du traité : le partage des rôles entre juge national et juge de l’Union européenne
Si le traité est jugé conforme à la constitution, c’est à la faveur, pour chacun des griefs soulevés, de sa nature mixte qui s’interprète à partir de la distinction entre les compétences propres et les compétences partagées entre l’Union et ses États membres (A). Ces compétences étant, dans chacune de leurs catégories concernées par le traité soumis à examen, il en résulte une certaine confiance mutuelle entre le juge national et le juge européen (B).
A – La nature mixte de l’accord : compétences exclusives et compétences partagées
Le Conseil constitutionnel prend acte de la nature mixte de l’accord. Comme le juge le souligne, l’accord soumis à l’examen du Conseil présente, en effet, un caractère mixte, conformément à la notion d’accords mixtes, déjà reconnus de longue date par la Cour de justice de l’Union européenne.
L’essentiel des matières que couvre l’accord relève d’une compétence exclusive de l’Union européenne qui résulte de transferts de compétences déjà opérés par des traités antérieurement souscrits par la France. Certains des aspects de l’accord relèvent, toutefois, d’une compétence partagée entre l’Union européenne et ses États membres. Le Conseil constitutionnel a pris en compte cette nature particulière de l’accord qui lui était soumis ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en la matière. Ainsi, s’agissant des domaines sur lesquels l’Union jouit d’une compétence exclusive, le Conseil constitutionnel a limité l’étendue de son contrôle à la vérification que l’accord ne met en cause aucune règle ou principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France. En l’espèce, eu égard à l’objet de l’accord, qui a le caractère d’un traité de commerce, le Conseil constitutionnel a jugé qu’aucune règle ou principe de cette nature n’était mis en cause.
En ce qui concerne les matières relevant d’une compétence partagée entre l’Union européenne et ses États membres, le Conseil constitutionnel a vérifié si les stipulations de l’accord ne comportaient pas de clause contraire à la constitution30. Pour ce faire, il analyse les clauses relatives aux investissements et aux modes de règlement des différends liés (1) et apporte des précisions relatives à la souveraineté (2).
1 – Les clauses relatives à l’investissement, les modes de règlement des différends et les compétences européennes
Le chapitre 8 de l’accord est relatif à l’investissement. Sa section A contient des définitions, fixe le champ d’application du chapitre et comporte les stipulations relatives à ses relations avec les autres chapitres. Les stipulations du chapitre 8 s’appliquent ainsi à « tout type d’actif qu’un investisseur détient ou contrôle, directement ou indirectement, et qui présente les caractéristiques d’un investissement, y compris une certaine durée ainsi que d’autres caractéristiques telles que l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, l’attente de gains ou de profits, ou l’acceptation du risque ». La section B porte sur l’« établissement d’investissements » et traite en particulier de l’accès aux marchés. La section C est relative au traitement non discriminatoire. La section D énonce les principes qui régissent la protection des investissements. La section E couvre les réserves et les exceptions. La section F institue un mécanisme de règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États.
Le chapitre 8 de l’accord reconnaît ainsi aux investisseurs entrant dans le champ d’application de l’accord certains droits substantiels, tels que le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée, le traitement juste et équitable et la protection contre les expropriations directes ou indirectes. Ces investisseurs relèvent, en outre, en cas de litige avec l’État d’accueil de l’investissement ou l’Union européenne, d’une procédure spécifique de règlement des différends, qui comporte notamment un « tribunal » et un « tribunal d’appel ». Après une phase de consultation prévue par l’article 8.19, et compte tenu de la possibilité offerte par l’article 8.20 de recourir à la médiation, l’investisseur peut, passé un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande de consultations, présenter une demande de détermination du défendeur à l’Union européenne. Selon l’article 8.21, l’Union détermine s’il s’agit d’un État membre ou de l’Union elle-même. Selon l’article 8.22, une fois la procédure engagée, qui doit respecter plusieurs exigences formelles, aucune procédure n’est plus possible devant un tribunal ou une cour en vertu du droit interne ou international. Suivant l’article 8.25, le défendeur consent au règlement du différend par le tribunal. Le mécanisme de règlement des différends est composé de deux niveaux de juridiction, les articles 8.27 et 8.28 étant respectivement relatifs au tribunal et au tribunal d’appel. Le tribunal compte 15 membres, 5 ressortissants d’États membres de l’Union, 5 ressortissants du Canada et 5 ressortissants de pays tiers. Le « comité mixte », prévu à l’article 26.1 de l’accord peut toutefois procéder à des nominations additionnelles par multiples de trois. Des exigences de qualification sont prévues. La durée du mandat des membres est déterminée. Les demandes sont instruites par un panel de 3 membres. Les membres du tribunal sont rémunérés. La sentence rendue par le tribunal peut être contestée devant le tribunal d’appel pour des causes limitativement énumérées. L’article 8.30 énonce les règles d’éthique qui s’appliquent aux membres du tribunal et du tribunal d’appel. Les articles 8.32 à 8.38 fixent les règles de procédure. L’article 8.39 est relatif au pouvoir de décision du tribunal, qui peut accorder des dommages et intérêts ou la restitution de biens. L’article 8.41 est relatif à l’exécution des sentences du tribunal. Son point 4 prévoit que « l’exécution de la sentence est régie par la législation relative à l’exécution des jugements ou des sentences qui est en vigueur là où l’exécution est demandée ».
Les députés requérants soutenaient que les stipulations de l’article 8 sont contraires au principe de précaution. Ils estiment, en outre, que les stipulations de la section F du chapitre 8 sont contraires à la constitution. Selon eux, le mécanisme de règlement des différends qu’elles instituent serait contraire aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale et à l’article 88-1 de la constitution aux motifs, d’une part, qu’il permettrait aux investisseurs du Canada, à leur seule discrétion, d’échapper à la compétence des juridictions françaises pour mettre en cause la France devant le tribunal institué par l’accord et, d’autre part, qu’il porterait atteinte aux compétences exclusives de la Cour de justice de l’Union européenne. Les règles relatives à la constitution du tribunal seraient, en outre, contraires aux principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions. Enfin, en accordant un privilège de juridiction aux investisseurs canadiens qui ne serait justifié ni par une différence de situation ni par un motif d’intérêt général, l’accord méconnaîtrait le principe d’égalité devant la loi31.
S’agissant du respect des conditions essentielles d’exercice de la souveraineté, le juge relève, en premier lieu, qu’il ressort de l’ensemble des stipulations de l’accord que celui-ci poursuit l’objectif de réduire ou supprimer les obstacles au libre-échange entre les parties. Dans ce cadre, le chapitre 8 a pour objet de contribuer à la protection des investissements réalisés dans les États parties par des investisseurs couverts par l’accord, sans faire obstacle à toute mesure que les États sont susceptibles de prendre en matière de contrôle des investissements étrangers.
Il relève ensuite que les pouvoirs attribués au tribunal et au tribunal d’appel sont définis par l’article 8.39 de l’accord et couvrent exclusivement « le versement de dommages pécuniaires et tout intérêt applicable » et « la restitution de biens ». En outre, s’agissant des mesures provisoires, le tribunal, en application de l’article 8.34, ne peut « ordonner une saisie ou interdire l’application de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation visée à l’article 8.23 ». Le tribunal ne détient, suivant les termes mêmes de l’accord, aucun pouvoir d’interprétation ou d’annulation des décisions prises par des organes de l’Union européenne ou de ses États membres. Selon le 4 de l’article 8.41 relatif à l’exécution des sentences : « L’exécution de la sentence est régie par la législation relative à l’exécution des jugements ou des sentences qui est en vigueur là où l’exécution est demandée ».
Le juge souligne encore que le mécanisme de règlement des différends institué par le chapitre 8 ne s’applique, selon l’article 8.18, qu’en cas de méconnaissance d’une obligation prévue, en matière de traitement non discriminatoire, « à la section C, en ce qui concerne l’expansion, la direction, l’exploitation, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance et la vente ou disposition » de son investissement ou, en matière de protection des investissements, « à la section D, si l’investisseur affirme avoir subi une perte ou un dommage en raison de la violation alléguée ».
Dans un quatrième temps, le juge indique que d’une part, il résulte des stipulations des articles 8.27 et 8.28 de l’accord que le tribunal et le tribunal d’appel comportent autant de membres désignés par l’Union européenne que par le Canada. Ceux-ci sont désignés par le comité mixte, dont les compétences et les modalités de décision sont décrites au paragraphe 50 ci-dessous. La désignation des membres du tribunal et du tribunal d’appel s’effectue par « consentement mutuel » entre les parties en application du 3 de l’article 26.3. La position de l’Union européenne doit alors être fixée d’un commun accord avec les États membres. D’autre part, l’article 8.27 impose que les « membres du tribunal possèdent les qualifications requises dans leurs pays respectifs pour la nomination à des fonctions judiciaires, ou sont des juristes possédant des compétences reconnues. Ils auront fait la preuve de leurs connaissances spécialisées en droit international public. Il est souhaitable qu’ils possèdent des connaissances spécialisées plus particulièrement dans les domaines du droit de l’investissement international, du droit commercial international et du règlement des différends découlant d’accords internationaux en matière d’investissement ou d’accords commerciaux internationaux32.
Enfin, le juge indique qu’en vue d’éviter les conflits ou les divergences entre les tribunaux institués par l’accord et les juridictions de droit interne, l’article 8.22 impose à l’investisseur de renoncer à introduire une procédure devant une juridiction interne ou internationale relativement à une mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation visée par sa plainte et, le cas échéant, de se retirer ou de se désister d’une telle procédure si elle est en cours. En outre, afin de garantir l’interprétation que font les parties des stipulations de l’accord, le 3 de l’article 8.31 prévoit qu’une interprétation adoptée par le comité mixte lie le tribunal. Il ajoute encore que le fait de relever du champ d’application de l’accord n’interdit pas aux investisseurs étrangers de porter par préférence, s’ils le souhaitent, le différend devant le juge national plutôt que devant le tribunal institué par l’accord.
Ainsi, eu égard à l’objet de l’accord, aux pouvoirs confiés au tribunal et au tribunal d’appel, à leur composition et au champ d’application du mécanisme de règlement des différends, les stipulations instituant ce mécanisme ne méconnaissent pas les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale. Pour ces motifs et ceux énoncés aux paragraphes 44 à 52, les stipulations du chapitre 8 qui ne concernent pas une compétence exclusive de l’Union européenne, ne portent aucune atteinte à ces conditions.
Le juge consacre ensuite plusieurs paragraphes aux griefs liés au respect des principes d’indépendance et d’impartialité33. Il raisonne en plusieurs étapes pour parvenir à une validation du dispositif.
Comme de tradition, il fait mention de l’article 16 de la déclaration de 1789 qui prévoit : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ». Les principes d’indépendance et d’impartialité sont indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles.
Il se livre ensuite à une énumération de ce qui lui apparaît comme des garanties34. En premier lieu, selon le 1 de l’article 8.30 de l’accord, consacré aux « règles d’éthique » : « Les membres du tribunal sont indépendants. Ils n’ont d’attache avec aucun gouvernement. Ils ne suivent les instructions d’aucune organisation ou d’aucun gouvernement en ce qui concerne les questions liées au différend. Ils ne participent pas à l’examen d’un différend qui donnerait lieu à un conflit d’intérêts direct ou indirect. Ils se conforment aux lignes directrices de l’Association internationale du barreau (International Bar Association) sur les conflits d’intérêts dans l’arbitrage international, ou à toutes règles complémentaires adoptées en vertu de l’article 8.44.2. En outre, dès leur nomination, ils s’abstiennent d’agir à titre d’avocat-conseil, de témoin ou d’expert désigné par une partie dans tout différend relatif aux investissements en instance ou nouveau relevant du présent accord ou de tout autre accord international ». Le 2 du même article prévoit : « Une partie au différend qui estime qu’un membre du tribunal se trouve en position de conflit d’intérêts peut demander au président de la Cour internationale de justice de rendre une décision sur la contestation de la nomination de ce membre. Tout avis de contestation est envoyé au président de la Cour internationale de justice dans les 15 jours suivant la date à laquelle la composition de la division du tribunal a été communiquée à la partie au différend, ou dans les 15 jours suivant la date à laquelle cette partie a eu connaissance des faits pertinents, si elle n’avait pas pu raisonnablement en avoir connaissance au moment de la constitution de la division. L’avis de contestation énonce les motifs de la contestation ». Selon son 4, « Sur recommandation motivée du président du tribunal ou à leur initiative conjointe, les parties peuvent, par décision du Comité mixte (…) révoquer un membre du tribunal dont la conduite n’est pas conforme aux obligations énoncées au paragraphe 1 et est incompatible avec la qualité de membre du tribunal ». Les stipulations de l’article 8.30 s’appliquent, selon le 4 de l’article 8.28, au tribunal d’appel. En second lieu, le 5 de l’article 8.27 prévoit que les membres du tribunal sont en principe nommés pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois.
De cette énumération, le juge constitutionnel estime que les stipulations de la section F du chapitre 8 qui régissent la procédure de règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États ne méconnaissent pas les principes d’indépendance et d’impartialité35.
Il procède selon la même démarche en ce qui concerne le respect du principe d’égalité devant la loi. Aux termes de l’article 6 de la déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
En premier lieu, les stipulations du chapitre 8 de l’accord comportent, en faveur des investisseurs non ressortissants de l’État d’accueil de l’investissement, des prescriptions touchant à certains droits substantiels. Celles-ci, qui sont relatives en particulier au traitement national, au traitement de la nation la plus favorisée, au traitement juste et équitable et à la protection contre les expropriations directes ou indirectes, ont pour seul objet d’assurer à ces investisseurs des droits dont bénéficient les investisseurs nationaux. Ainsi, le a) du paragraphe 6 de l’instrument interprétatif commun prévoit que l’accord « ne conduira pas à accorder un traitement plus favorable aux investisseurs étrangers qu’aux investisseurs nationaux ». Dès lors, les stipulations du chapitre 8 ne créent sur ce point aucune différence de traitement.
En second lieu, néanmoins, le juge admet bien que la section F du chapitre 8 crée une différence de traitement entre les personnes investissant en France en réservant l’accès aux tribunaux qu’elle institue aux seuls investisseurs canadiens. Cependant, il estime que cette différence de traitement entre les investisseurs canadiens et les autres investisseurs étrangers en France répond toutefois au double motif d’intérêt général tenant, d’un côté, à créer, de manière réciproque, un cadre protecteur pour les investisseurs français au Canada et, de l’autre, à attirer les investissements canadiens en France. Ce motif d’intérêt général étant en rapport direct avec l’objet de l’accord, qui est de favoriser les échanges entre les parties, les stipulations du chapitre 8 pouvaient donc instituer un mécanisme procédural de règlement des différends susceptible de s’appliquer, s’agissant d’investissements réalisés en France, aux seuls investisseurs canadiens. Le juge constitutionnel déduit de ces éléments que les stipulations du chapitre 8 de l’accord ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi36.
De cet ensemble de considérations, le juge constitutionnel estime que les stipulations du chapitre 8 qui relèvent d’une compétence partagée entre l’Union européenne et ses États membres ne contiennent aucune clause contraire à la constitution, ne remettent pas en cause les droits constitutionnellement garantis et ne portent pas atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale. Elles n’impliquent donc aucune révision de la constitution37.
2 – De nouvelles précisions sur la notion de souveraineté et la capacité normative
En ce qui concerne le respect des conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale par les stipulations relatives à l’édiction de normes, le Conseil constitutionnel s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence que nous avons rappelée plus haut tout en apportant des précisions relatives au lien entre la souveraineté nationale et la capacité normative de l’État.
Les députés requérants soutenaient que l’accord comporte des règles contraignantes pour l’élaboration des normes de droit interne dans une mesure qui affecte les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale. Ils font valoir que c’est en particulier le cas de certaines stipulations de l’article 8.4, relatif à l’accès aux marchés dans le cadre de la protection des investissements. L’association du Canada à l’édiction de normes nationales, qui serait prévue notamment aux chapitres 21 et 27 de l’accord, aurait également pour effet d’imposer la révision de la constitution. Les attributions conférées par l’accord au comité mixte constitueraient un autre empiètement sur la compétence normative nationale de nature à faire obstacle à la ratification du traité sans révision constitutionnelle préalable. Il en irait de même du dispositif de règlement des différends portant sur l’interprétation ou l’application des stipulations de l’accord prévu à son chapitre 29. Dès lors que la France aura ratifié l’accord et que celui-ci sera entré en vigueur, les règles qui y figurent s’imposeront à elle. La France sera liée par ces stipulations qu’elle devra appliquer de bonne foi en application des « règles du droit public international ». L’accord aura, en application de l’article 55 de la constitution, une autorité supérieure à celle des lois. Il appartiendra aux divers organes de l’État de veiller à l’application de cet accord dans le cadre de leurs compétences respectives. Ainsi, l’ordre juridique interne défini par la constitution impose au législateur de respecter les stipulations des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés.
À partir de ces griefs, le Conseil constitutionnel estime qu’il lui revient de s’assurer que la capacité à édicter des normes de droit interne n’est pas limitée dans une mesure telle qu’il en résulterait une atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale38.
Pour répondre à cette question, le juge relève que l’accord comporte des stipulations qui rappellent la capacité des parties à légiférer et à réglementer. Ainsi, selon le 2 de l’instrument interprétatif commun, l’accord « préserve la capacité de l’Union européenne et de ses États membres ainsi que du Canada à adopter et à appliquer leurs propres dispositions législatives et réglementaires destinées à réglementer les activités économiques dans l’intérêt public, à réaliser des objectifs légitimes de politique publique tels que la protection et la promotion de la santé publique, des services sociaux, de l’éducation publique, de la sécurité, de l’environnement et de la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs, la protection de la vie privée et la protection des données, ainsi que la promotion et la protection de la diversité culturelle ». S’agissant du chapitre 8 de l’accord, l’article 8.9 prévoit :
« 1. Pour l’application du présent chapitre, les parties réaffirment leur droit de réglementer sur leurs territoires en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de politique, tels que la protection de la santé publique, de la sécurité, de l’environnement ou de la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs, ou la promotion et la protection de la diversité culturelle.
2. Il est entendu que le simple fait qu’une partie exerce son droit de réglementer, notamment par la modification de sa législation, d’une manière qui a des effets défavorables sur un investissement ou qui interfère avec les attentes d’un investisseur, y compris ses attentes de profit, ne constitue pas une violation d’une obligation prévue dans la présente section ».
Le juge constitutionnel relève ensuite que d’une part, si le 1 de l’article 8.4 prohibe différentes mesures de limitation ou de restriction de nature à entraver les accès aux marchés couverts par l’accord, ces mesures ont vocation à s’appliquer aux investissements directs qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union européenne. D’autre part, le 2 de l’article 8.4 exclut du champ d’application du 1 différentes catégories de mesures. Il en va ainsi, en particulier, des mesures « restreignant la concentration de la propriété dans le but d’assurer une concurrence loyale » ou « visant à assurer la conservation et la protection des ressources naturelles et de l’environnement ».
Le Conseil souligne encore que le chapitre 21 stipule, à son article 21.2, que les parties « s’engagent à développer davantage leur coopération en matière de réglementation en tenant compte de leur intérêt mutuel » en vue d’atteindre différents objectifs. Toutefois, d’une part, le 6 de l’article 21.2 prévoit que « les parties peuvent entreprendre des activités de coopération en matière de réglementation sur une base volontaire. Il est entendu qu’une partie n’est pas tenue de participer à une quelconque activité de coopération en matière de réglementation et peut refuser ou cesser de coopérer ». D’autre part, l’instrument interprétatif commun stipule que « cette coopération s’effectuera sur une base volontaire, les autorités de réglementation pouvant choisir librement de coopérer, sans y être contraintes ou sans devoir mettre en œuvre les résultats de leur coopération ».
Le juge poursuit en relevant que le comité mixte institué par l’article 26.1, composé de représentants de l’Union européenne et de représentants du Canada, a pour principales fonctions celles qui sont énumérées par le 4 de cet article, en particulier celles de superviser et faciliter la mise en œuvre et l’application de l’accord, promouvoir ses objectifs généraux, superviser les travaux des comités spécialisés et résoudre les différends pouvant survenir quant à l’interprétation ou l’application de l’accord dans certains domaines. Le 5 du même article 26.1 confère, en outre, différentes prérogatives au comité mixte et, en particulier, celle d’adopter des interprétations des stipulations de l’accord qui lient les tribunaux institués en application de la section F du chapitre 8 et du chapitre 29. L’article 26.3 prévoit, enfin, que le comité mixte dispose, en vue d’atteindre les objectifs de l’accord, « du pouvoir décisionnel pour toute question » dans les cas prévus par l’accord. En vertu du 2 de ce même article, les décisions prises par le comité mixte « lient les parties ».
Cependant, le Conseil constitutionnel souligne, d’une part, que si le 2 de l’article 30.2 de l’accord attribue au comité mixte le pouvoir de décider d’amender les protocoles et annexes, cette compétence ne trouve pas à s’appliquer s’agissant des annexes 8-A et 8-B du chapitre 8, relatives à l’expropriation et à la dette publique. D’autre part, les décisions du comité mixte qui lient les parties ne peuvent être adoptées, selon le 3 de l’article 26.3, que « par consentement mutuel » entre les représentants de l’Union européenne et les représentants du Canada qui composent le comité mixte. Par ailleurs, dans une telle hypothèse, la position de l’Union européenne doit être établie par le Conseil en application de la procédure prévue au paragraphe 9 de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans ce cas, selon la déclaration n° 19 du Conseil et des États membres du 14 janvier 2017, dès lors qu’une décision du comité mixte relève de la compétence des États membres, la position de l’Union et de ses États membres au sein du comité mixte « est adoptée d’un commun accord » au Conseil.
Enfin, le juge constitutionnel souligne que si une interprétation adoptée par le comité mixte lie le tribunal institué en vertu de la section F du chapitre 8, cette stipulation a pour objet de garantir que l’Union européenne, ses États membres et le Canada, parties à l’accord, ne se voient pas imposer par le tribunal une interprétation distincte de celle qui recueille leur assentiment. En dernier lieu, d’une part, le chapitre 29 de l’accord se borne, selon les termes de son article 29.2, à instituer une procédure de règlement des différends « portant sur l’interprétation ou l’application » de ses stipulations. D’autre part, le mécanisme d’arbitrage ainsi prévu et l’exigence qui pèse sur les parties de prendre les mesures nécessaires pour se conformer, selon les termes du chapitre 29, aux « conclusions » du « rapport final » du groupe d’arbitrage ont pour seul objet de veiller à la bonne application de l’accord. En conséquence, ces stipulations n’ont, par elles-mêmes, pas pour effet d’affecter l’élaboration des normes de droit interne.
Il résulte de tout ce qui précède que les stipulations des chapitres 1, 21, 26, 27, 28, 29 et 30, qui comportent des prescriptions se rapportant à l’élaboration de normes de droit interne et qui relèvent d’une compétence partagée entre l’Union européenne et les États membres, ne contiennent aucune clause contraire à la constitution.
Cette approche mérite d’être soulignée dans la double mesure où, d’une part, elle ajoute la notion de capacité normative au faisceau d’indices permettant de statuer sur l’atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale et, d’autre part, elle apparaît comme une manière de donner acte de l’exercice conjoint de la souveraineté par l’État membre et l’Union européenne. Dans les domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union, le Conseil constitutionnel n’a pratiquement pas à se prononcer sur les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté. C’est une approche qui implique une confiance mutuelle entre le juge national et le juge européen.
B – L’application du traité et la confiance mutuelle entre le juge national et le juge européen
On relèvera en premier lieu le point 30 de la décision du 31 juillet 2017, qui marque l’articulation entre les deux ordres juridiques et les rapports qui s’instaurent entre chaque ordre juridique et juridictionnel. En ce qui concerne le respect de l’article 88-1 de la constitution, le juge indique qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l’article 54 de la constitution, d’examiner la compatibilité d’un engagement international avec les autres engagements internationaux et européens de la France. L’article 88-1 de la constitution ne lui attribue pas davantage la compétence de contrôler la compatibilité d’un engagement international avec les stipulations des traités mentionnés à cet article. Par suite, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de confronter les stipulations de la section F du chapitre 8 aux prescriptions du droit de l’Union européenne qui régissent la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 88-1 de la constitution doit, en conséquence, être écarté.
Outre cet élément rapidement écarté, plusieurs griefs étaient soulevés, dont certains relèvent en partie de la compétence de la Cour de justice européenne, lorsque le traité s’appliquera. Le Conseil constitutionnel s’est ainsi prononcé sur le tribunal institué par l’accord pour régler les différends entre les investisseurs et les États.
Le tribunal créé par l’accord soumis à l’examen du Conseil se caractérise par les éléments suivants. Le chapitre de l’accord qui crée le tribunal a pour objet de contribuer à la protection des investissements réalisés dans les États parties. Le champ d’application du mécanisme de règlement des différends est délimité par les stipulations de l’accord. Les pouvoirs attribués au tribunal sont limités au versement de dommages pécuniaires et à la restitution de biens. Le tribunal ne peut ni interpréter ni annuler des décisions prises par les États.
Le tribunal comprend autant de membres désignés par l’Union européenne que par le Canada. Les membres désignés par l’Union européenne le sont par un comité mixte composé paritairement entre l’Union européenne et le Canada qui se prononce par consentement mutuel. En outre, la position de l’Union européenne en la matière doit être fixée d’un commun accord avec les États membres. Les membres du tribunal et du tribunal d’appel doivent répondre à des exigences de qualification. Tout différend peut être porté, le cas échéant, devant le juge national et des mécanismes sont prévus pour éviter les conflits ou les divergences entre le tribunal institué par l’accord et les juridictions de droit interne.
Compte tenu de ces éléments, et dès lors qu’ils ne sont pas de nature à faire obstacle à toute mesure que les États sont susceptibles de prendre en matière de contrôle des investissements étrangers, le Conseil constitutionnel a admis que l’institution du tribunal prévu par l’accord ne méconnaît pas les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale.
L’accord énonce par ailleurs des « règles d’éthique » auxquelles sont soumis les membres du tribunal et dont la correcte application devra permettre que les principes d’indépendance et d’impartialité ne soient pas méconnus. Enfin, le Conseil constitutionnel a jugé que les règles qui régissent le tribunal ne méconnaissent pas le principe d’égalité. En particulier, si l’accès au tribunal institué par l’accord est, en France, réservé aux seuls investisseurs canadiens, cela répond à un double motif d’intérêt général. D’une part, l’accord crée, de manière réciproque, un cadre protecteur pour les investisseurs français au Canada. D’autre part, les règles en cause permettent d’attirer les investissements canadiens en France.
De même, s’agissant du principe de précaution, dont on a vu plus haut qu’il relevait de normes de références à la fois nationales et européennes, le Conseil constitutionnel a validé l’accord, malgré l’absence de mention du principe. Sur ce point, le Conseil a d’abord rappelé les engagements des parties contenus dans le chapitre 22 de l’accord expressément consacré au commerce et au développement durable.
Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé, d’une part, que l’absence de mention expresse du principe de précaution dans les stipulations de l’accord qui relèvent d’une compétence partagée entre l’Union européenne et les États membres n’emporte pas de méconnaissance de ce principe. En outre, les décisions du comité mixte sont soumises au respect du principe de précaution protégé par le droit de l’Union européenne, notamment par l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Le Conseil constitutionnel s’est enfin fondé sur le 2 de l’article 24.8 de l’accord qui stipule : « Les parties reconnaissent que, en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne sert pas de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures économiquement efficaces visant à prévenir la dégradation de l’environnement ». Ces stipulations autorisent les parties à prendre des mesures économiquement efficaces visant à prévenir la dégradation de l’environnement en cas de risque de dommages graves ou irréversibles. En outre, l’instrument interprétatif commun de l’accord précise que les parties sont tenues d’assurer et d’encourager des niveaux élevés de protection de l’environnement.
Les députés requérants reprochaient en effet à l’accord de ne faire aucune référence au principe de précaution et de n’imposer aux parties aucune obligation en la matière, y compris en cas de risques graves et irréversibles. Le principe de précaution serait, en outre, méconnu par plusieurs stipulations de l’accord. Sur ce point, le Conseil constitutionnel rappelle qu’aux termes de l’article 5 de la charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par l’application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Ces dispositions, comme l’ensemble des droits et devoirs définis dans la charte de l’environnement, ont valeur constitutionnelle. Dès lors, il incombe au Conseil constitutionnel, saisi en application de l’article 54 de la Constitution, de déterminer si un engagement international soumis à son examen méconnaît le principe de précaution.
Partant, le Conseil constitutionnel indique en premier lieu, dans le chapitre 22 consacré au commerce et au développement durable, les parties à l’accord « reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement sont interdépendants et forment des composantes du développement durable qui se renforcent mutuellement, et elles réaffirment leur engagement à promouvoir le développement du commerce international d’une manière qui contribue à la réalisation de l’objectif de développement durable ». Les parties visent, à ce titre, les objectifs suivants : « favoriser le développement durable par une coordination et une intégration accrues de leurs politiques et mesures respectives en matière de travail, d’environnement et de commerce (…) promouvoir le dialogue et la coopération entre elles en vue de resserrer leurs relations commerciales et économiques d’une manière qui appuie leurs mesures et leurs normes respectives en matière de protection du travail et de l’environnement (…) améliorer l’application de leur droit respectif en matière de travail et d’environnement (…) favoriser la consultation et la participation du public dans la discussion des questions de développement durable ». Il indique en deuxième lieu, d’une part, que l’absence de mention expresse du principe de précaution dans les stipulations de l’accord qui relèvent d’une compétence partagée entre l’Union européenne et les États membres n’emporte pas de méconnaissance de ce principe. En outre, les décisions du comité mixte sont soumises au respect du principe de précaution protégé par le droit de l’Union européenne, notamment par l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le 2 de l’article 24.8 de l’accord stipule que « les parties reconnaissent que, en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne sert pas de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures économiquement efficaces visant à prévenir la dégradation de l’environnement ». Ces stipulations autorisent les parties à prendre des mesures économiquement efficaces visant à prévenir la dégradation de l’environnement en cas de risque de dommages graves ou irréversibles. Enfin, selon le a) du paragraphe 9 de l’instrument interprétatif commun, « l’Union européenne et ses États membres ainsi que le Canada sont tenus d’assurer et d’encourager des niveaux élevés de protection de l’environnement, et de s’efforcer d’améliorer continuellement leur législation et leurs politiques en la matière de même que les niveaux de protection sur lesquels elles reposent ». Selon son b), l’accord « reconnaît expressément au Canada ainsi qu’à l’Union européenne et à ses États membres le droit de définir leurs propres priorités environnementales, d’établir leurs propres niveaux de protection de l’environnement et d’adopter ou de modifier en conséquence leur législation et leurs politiques en la matière, tout en tenant compte de leurs obligations internationales, y compris celles prévues par des accords multilatéraux sur l’environnement ». Ainsi, le Conseil constitutionnel juge que l’ensemble de ces stipulations sont propres à garantir le respect du principe de précaution issu de l’article 5 de la charte de l’environnement. Il valide donc les stipulations des chapitres 1, 21, 26, 27, 28, 29 et 30 qui concernent une compétence partagée entre l’Union européenne et les États membres au regard du principe de précaution39.
Concernant l’application provisoire, d’une part, celle-ci ne porte que sur des stipulations relevant de la compétence exclusive de l’Union européenne. D’autre part, sur les conditions de dénonciation, l’accord prévoit la possibilité d’interrompre cette application provisoire en cas d’impossibilité pour une partie de le ratifier.
Selon le a) du 3 de l’article 30.7 de l’accord : « Les parties peuvent appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles se sont notifié réciproquement l’accomplissement de leurs obligations et procédures internes respectives nécessaires à l’application provisoire du présent accord, ou à toute autre date convenue entre les parties ». Selon son c), « une partie peut mettre fin à l’application provisoire du présent accord par un avis écrit à l’autre partie. L’application provisoire prend fin le premier jour du deuxième mois suivant cette notification ».
Les députés requérants soutenaient que la faculté des États membres de mettre fin à l’application provisoire de l’accord sur le fondement de ces stipulations est incertaine. Dès lors que cette application provisoire concernerait des stipulations qui relèvent de la compétence des États membres, cette incertitude mettrait en cause les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale. Le juge constitutionnel indique que, d’une part, compte tenu du paragraphe 17 de la présente décision, il ressort de la décision du 28 octobre 2016 du Conseil de l’Union européenne mentionnée ci-dessus qu’aucune stipulation de l’accord relevant d’une compétence partagée entre l’Union européenne et les États membres ou d’une compétence appartenant aux seuls États membres ne fait l’objet de l’application provisoire décidée par les parties à l’accord. Il souligne, d’autre part, ainsi que le prévoit la déclaration n° 20 du Conseil du 14 janvier 2017, si la ratification de l’accord « échoue de façon définitive en raison d’une décision prononcée par une Cour constitutionnelle, ou à la suite de l’aboutissement d’un autre processus constitutionnel et d’une notification officielle par le gouvernement de l’État concerné, l’application provisoire devra être et sera dénoncée. Les dispositions nécessaires seront prises conformément aux procédures de l’Union européenne ».
Ainsi, dès lors que l’application provisoire de l’accord ne porte que sur des stipulations relevant de la compétence exclusive de l’Union européenne et que l’accord prévoit la possibilité d’interrompre cette application provisoire en cas d’impossibilité pour une partie de le ratifier, les stipulations critiquées par les députés requérants ne portent, selon le Conseil constitutionnel, pas atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale.
S’agissant des conditions de dénonciation de l’accord, il faut d’abord noter que selon l’article 30.9 de l’accord :
« 1. Une partie peut dénoncer le présent accord en donnant un avis écrit d’extinction au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada, ou à leurs successeurs respectifs. Le présent accord s’éteint 180 jours après la date de cet avis. La partie qui donne un avis d’extinction fournit aussi une copie de l’avis au Comité mixte (…).
2. Nonobstant le paragraphe 1, dans l’éventualité de l’extinction du présent accord, les dispositions du chapitre 8 (Investissement) restent en vigueur pendant une durée de 20 ans après la date d’extinction du présent accord, en ce qui concerne les investissements effectués avant cette date ».
Les députés requérants estimaient que l’accord lierait irrévocablement la France, ce qui porterait atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale. Or on sait que l’adhésion irrévocable à un engagement international touchant à un domaine inhérent à la souveraineté nationale porte atteinte aux conditions essentielles de son exercice. C’est ce qui avait déjà été jugé en 2005 à propos de l’engagement irrévocable d’interdiction de la peine de mort40.
Cependant, en ce qui concerne l’accord soumis à son appréciation, le juge estime que, d’une part, il ressort des termes mêmes de l’article 30.9 que les parties ne sont pas liées irrévocablement par l’accord soumis à l’examen du Conseil constitutionnel. D’autre part, l’accord ne touche pas, eu égard à son objet, à un domaine inhérent à la souveraineté nationale. Il en conclut que les conditions de dénonciation de l’accord prévues par les stipulations précitées ne portent pas atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale.
En conclusion, cette décision s’inscrit dans une continuité et quelques innovations. La continuité est celle de la méthode de travail gardée par le Conseil constitutionnel pour apprécier la conformité d’un traité international à la constitution, en général, et à la souveraineté, en particulier. L’innovation réside dans la nature mixte du traité dont il était saisi. Ce faisant, il tire de nouveau les conséquences de l’appartenance française à l’Union européenne et semble donner acte de l’exercice conjoint de la souveraineté qui en résulte. Il mène son raisonnement en faisant le départ entre ce qui relève de la compétence exclusive de l’Union européenne, abordant les questions a minima et accordant sa confiance aux institutions européennes pour garantir les principes fondamentaux communs, et ce qui relève des compétences partagées pour lesquelles il approfondit son contrôle et valide le traité. Il précise enfin sa conception de la souveraineté autour de la capacité à légiférer. Il en ressort une nette impression de l’européanisation encore accrue de la jurisprudence constitutionnelle, s’inscrivant dans un partage de souveraineté entre l’Union européenne, pour laquelle une confiance dans le respect des principes fondamentaux communs est accordée et l’État, pour lequel le Conseil constitutionnel veille au respect de la capacité législative et de l’identité constitutionnelle.
Notes de bas de pages
-
1.
Cons. const., 31 juill. 2017, n° 2017-749 DC.
-
2.
V. les propos autorisés de Fekl M., alors membre du gouvernement en charge des questions relatives au commerce extérieur, Le Figaro, 21 janv. 2017, http://www.lefigaro.fr/.
-
3.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/.
-
4.
CJCE, 12 déc. 1972, nos C-21 à 24-72, International Fruit Company.
-
5.
Avis n° 1/94 de la Cour, 15 nov. 1994. « Compétence de la Communauté pour conclure des accords internationaux en matière de services et de protection de la propriété intellectuelle – Procédure de l’article 228, paragraphe 6, du traité CE ».
-
6.
Avis n° 2/00, 6 déc. 2001, pt 5.
-
7.
Avis n° 1/08, 30 nov. 2009.
-
8.
Cons. const., 30 juin 1970, n° 70-39 DC.
-
9.
Idem.
-
10.
Cons. const., 30 déc. 1976, n° 76-71 DC ; déc. du Conseil des communautés européennes relative à l’élection de l’Assemblée des communautés au suffrage universel direct.
-
11.
Pour juger ainsi, le Conseil constitutionnel se fonde sur le faible nombre de compétences d’alors du Parlement européen.
-
12.
Cons. const., 22 mai 1985, n° 85-188 DC, prot. n° 6 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, signé par la France le 28 avril 1983.
-
13.
Idem.
-
14.
Cons. const., 13 oct. 2005, nos 2004-524 et 525 DC. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2005, par le président de la République, en application de l’article 54 de la constitution, de la question de savoir si doivent être précédées d’une révision de la constitution les autorisations de ratifier :
-
15.
- le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté à New York le 15 décembre 1989 ;
-
16.
- le protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, adopté à Vilnius le 3 mai 2002.
-
17.
Idem.
-
18.
Cons. const., 9 avr. 1992, n° 92-308 DC.
-
19.
Cons. const., 31 déc. 1997, n° 97-394 DC ; traité d’Amsterdam modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les communautés européennes et certains actes connexes.
-
20.
Cons. const., 19 nov. 2004, n° 2004-505 DC ; traité établissant une constitution pour l’Europe.
-
21.
Cons. const., 20 déc. 2007, n° 2007-560 DC.
-
22.
Cons. const., 10 juin 2004, n° 2004-496 DC ; Cons. const., 27 juill. 2006, n° 2006-540 DC.
-
23.
Cons. const., 27 juill. 2006, n° 2006-540 DC, cons. n° 28.
-
24.
Cons. const., 28 mai 2014, n° 2014-694 DC, loi relative à l’interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié.
-
25.
Cons. const., 4 avr. 2014, n° 2014-373 QPC.
-
26.
Cons. const., 29 déc. 2015, n° 2015-426 DC.
-
27.
Pts 5 à 11 de la décision ici commentée.
-
28.
Pt 15 de la décision ici commentée.
-
29.
Avis n° 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne.
-
30.
Pt 21 de la décision ici commentée.
-
31.
Pts 54 à 60 de la décision ici commentée.
-
32.
Communiqué de presse du Conseil constitutionnel sur la décision ici commentée.
-
33.
Pts 19 à 21 de la décision ici commentée.
-
34.
Pts 22 à 26 de la décision ici commentée.
-
35.
Sur ces principes, v. not. Cons. const., 20 févr. 2003, n° 2003-466 DC, loi organique relative aux juges de proximité.
-
36.
V. sur ce point, une approche critique de Bismuth R. à propos de cette décision sur le site du cercle des juristes.
-
37.
Pts 29 à 34 de la décision ici commentée.
-
38.
Pts 35 et s. de la décision ici commentée.
-
39.
Pt 42 de la décision ici commentée.
-
40.
Pts 43 et 44 de la décision ici commentée.
-
41.
Pts 55 à 61 de la décision ici commentée.
-
42.
Cons. const., 20 oct. 2005, nos 524 et 525 DC.