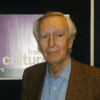L’équilibre des pouvoirs publics au prisme de la loi « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration »

Des débats parlementaires manichéens, des conditions de vote chaotiques et une décision du Conseil constitutionnel censurant pour des motifs de pure forme le tiers d’un texte voté à une large majorité : voilà le bilan de la procédure législative conduisant à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. De manière inédite sous la Ve République, se révèle une fragilité institutionnelle et procédurale à laquelle le gouvernement d’Elisabeth Borne n’a pas résisté, sans que sa responsabilité politique ne soit formellement engagée. En délivrant très peu de solutions de fond, le Conseil constitutionnel laisse ouvertes de nombreuses questions. Ainsi, sa vision très extensive de la notion de cavaliers législatifs esquive des sujets comme le droit du sol à Mayotte ou les conditions d’attribution aux étrangers de prestations sociales non contributives. Plus généralement, la loi du 26 janvier 2024 et la décision du Conseil constitutionnel sont très loin d’épuiser la problématique juridique des moyens de la politique migratoire.
« Le Conseil constitutionnel n’est pas une chambre d’écho des tendances de l’opinion publique, il n’est pas non plus une chambre d’appel des choix du Parlement, il est le juge de la constitutionnalité des lois. Cette définition claire, c’est probablement parce qu’elle n’est pas ou pas encore intégrée par tous que, à l’occasion des débats sur les lois concernant deux questions très sensibles, les retraites et l’immigration, le Conseil constitutionnel s’est retrouvé au milieu de passions contradictoires et momentanément tumultueuses ». Présentant les vœux du Conseil constitutionnel au chef de l’État le 8 janvier 2024, le président Laurent Fabius avait annoncé par avance quel serait l’enjeu de la décision du 25 janvier 2024 et prévenu qu’elle renverrait les « passions contradictoires » dos à dos. Sur pareil sujet, le Conseil constitutionnel ne peut en effet échapper aux procès en instrumentalisation, aux interprétations politiques, aux mises en cause partisanes, voire au soupçon – infondé– d’être sous l’emprise de sa propre technostructure. Mais il n’échappe pas davantage à ses propres faiblesses.
L’immigration fait partie en France des débats les plus clivants. La cohésion sociale est fragilisée par une panne partielle de l’intégration. La tentation de l’exclusion, d’un côté, celle du séparatisme, de l’autre, creusent un fossé entre populations. Le faible nombre d’obligations de quitter le territoire français (OQTF) exécutées donne la mesure de l’impuissance de l’État et le sentiment public de cette impuissance atteint son paroxysme lorsqu’un crime est commis par une personne sous OQTF. Nos dispositifs d’accueil sont submergés. La justice administrative croule sous le contentieux des étrangers. Compte tenu de ses caractéristiques quantitatives et qualitatives, l’immigration apparaît aujourd’hui comme un problème sociétal majeur. Le nier est aussi absurde que d’imputer à l’immigration tous les problèmes de la société française ou d’en faire la cause unique de la délinquance1. Mais est-il encore possible de légiférer dans un domaine aussi controversé ? La « question migratoire », creuset des contradictions françaises, tétanise de bout en bout les débats parlementaires. Le moindre déplacement de curseur est investi par l’idéologie plutôt que d’être rationnellement débattu. La Cour des comptes elle-même n’a pas échappé à la polémique du fait de la date retardée de parution d’un rapport2.
La décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993 (n° 93-325 DC) avait provoqué, fait alors inédit sous la Ve République, une révision constitutionnelle3, donnant lieu à un « lit de justice »4 qui s’est reproduit à plusieurs reprises5. Le débat est aujourd’hui relancé, en termes quasi identiques au regard de la hiérarchie des normes, sur la possibilité pour le constituant d’aller à l’encontre de la décision du Conseil constitutionnel du 25 janvier 2024. Un référendum d’initiative partagée est également envisagé en vue de soumettre à l’approbation populaire une partie des articles alors censurés par le Conseil.
Comment s’en étonner ? En matière d’immigration, les décisions juridictionnelles, nationales ou supranationales, suscitent périodiquement l’incompréhension. C’est par exemple le cas lorsque la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH)6 ordonne le retour en France d’un Ouzbek radicalisé7. Ou lorsqu’elle exige, à propos du rapatriement des familles françaises de personnes parties faire le djihad en Syrie et en Iraq, « un mécanisme de contrôle des décisions ne donnant pas suite aux demandes de retour sur le territoire national qui permette de vérifier que les motifs tirés de considérations impérieuses d’intérêt public ou de difficultés d’ordre juridique, diplomatique et matériel que les autorités exécutives pourraient légitimement invoquer sont bien dépourvus d’arbitraire », remettant ainsi en cause la notion d’acte de gouvernement. La politique (ou l’absence de politique ?) de l’immigration est l’une de celles sur lesquelles les institutions sont le plus contestées par nos concitoyens. Et, parmi les institutions, ce sont les juridictions qui suscitent la plus grande défiance.
La théorie des jeux définit un jeu à somme négative comme celui où il n’y a que des perdants. Il semble que la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 réponde à cette définition. Le vote parlementaire, même très majoritaire, perd son aptitude à exprimer la volonté générale. Une majorité d’idées, soutenue par l’opinion, est finalement mise en échec par le Conseil constitutionnel qui, à son corps défendant sans doute, apparaît comme la chambre d’appel du Parlement. Le gouvernement est porté à la démission. Le fonctionnement régulier des pouvoirs publics – dont l’article 5 de la Constitution fait du président de la République le garant –, la qualité et la portée du débat législatif, l’image et les méthodes du Conseil constitutionnel, la stabilité gouvernementale, tout semble pris en défaut.
On peut en voir d’abord une manifestation dans une défaillance de la stabilité gouvernementale démentant ce qui semblait être un acquis définitif de la Ve République. Le débat parlementaire a ébranlé la responsabilité politique du gouvernement en dehors de l’article 49 de la Constitution (I).
La loi « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » pose également la question de la place du président de la République dans le processus législatif et devant le Conseil constitutionnel. Le chef de l’État est intervenu dans le débat parlementaire et dans le contentieux constitutionnel en dehors des prévisions de l’article 5 de la Constitution (II).
La position très rigoriste du Conseil en matière d’amendements soulève en outre la question du pouvoir d’initiative du législateur. La portée extensive donnée par le Conseil constitutionnel à la notion de « cavalier législatif » méconnaît la lettre et l’esprit de l’article 45 de la Constitution (III).
Paradoxalement, en dépit de la tempête qu’elle a déclenchée, la décision du 25 janvier 2024 juge peu de choses sur le fond (IV).
I – Le débat parlementaire a mis en cause la responsabilité politique du gouvernement en dehors de l’article 49 de la Constitution
Le 8 janvier 2024, Elisabeth Borne remettait sa démission au chef de l’État 8. On peut y voir, en grande partie, la conséquence du débat parlementaire, alors pourtant que l’usage de l’article 49, alinéa 3, a été évité.
La Ve République s’est construite sur des principes clairs, même si bien des éléments de son fonctionnement sont laissés indéterminés par un « compromis dilatoire »9, à commencer par la place effective du chef de l’État dans le processus décisionnel. Au rang de ces principes figure la rationalisation de la mise en jeu de la responsabilité politique des gouvernements. Le constituant de 1958 a voulu rompre avec les mauvaises pratiques des IIIe et IVe Républiques, qui aboutissaient à provoquer la chute des gouvernements sans vote de défiance, voire sans vote du tout. Il fallait en finir avec les démissions ministérielles provoquées par une nuit parlementaire propice aux ententes de couloir. Le constituant de 1958 entendait faire de l’article 49 de la Constitution la source exclusive du renversement de l’exécutif. Et ce pari a été gagné : 44 gouvernements se sont succédé depuis 1958, là où la IIIe République en a connu plus du double pour une longévité identique, et la IVe plus de la moitié en douze ans. Hors cohabitations, les gouvernements de la Ve République dépendaient du chef de l’État, et non de vicissitudes parlementaires.
Cette stabilité reposait sur trois éléments : l’impossibilité pour un ministre de récupérer son siège de parlementaire lorsqu’il quittait le gouvernement, la liberté du gouvernement d’engager sa responsabilité et le caractère exclusif de la procédure expédiente de mise en jeu de la responsabilité gouvernementale que prévoit l’article 49 (troisième alinéa) de la Constitution.
Il a été mis fin par la révision du 23 juillet 2008 aux deux premiers éléments, notamment par la limitation de l’usage de l’article 49, alinéa 3, à un texte10 – autre que les textes financiers – par session. Mais le caractère exclusif de la mise en jeu de la responsabilité politique demeurait fermement ancré, et, avec lui, une règle logique, jusqu’ici inébranlable, de la Ve République : la chute du gouvernement ne peut résulter que d’un vote refusant la confiance. Dans sa décision du 24 juin 195911 relative au règlement de l’Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel censure la possibilité de voter des résolutions – quand bien même cette possibilité, contrairement à une opinion reçue, n’avait pas provoqué de chute du gouvernement sous la IVe République – afin d’exclure toute mise en cause de la responsabilité de l’exécutif en dehors des procédures de l’article 49. Des « résolutions » sans valeur impérative sont réapparues avec la révision du 23 juillet 2008, mais elles n’ont rien changé au caractère exclusif de la mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement : les seules procédures prévues à cette fin résultent de l’article 49, alinéas 1 à 3.
Pour la première fois depuis 1958, la procédure législative suivie avec la loi « pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration » semble déroger à cette règle. L’apparition d’un front du refus, par alliances de contraires, conduit les députés à adopter une motion de rejet préalable, le 11 décembre 2023. C’est inédit pour un projet du gouvernement examiné en première lecture à l’Assemblée12. La motion de rejet fait apparaître que le blocage parlementaire a changé de signification. Il fait se manifester, au sein de l’assemblée devant laquelle le gouvernement engage normalement sa responsabilité, une majorité de blocage, qui n’est évidemment pas une majorité d’alternance. Le gouvernement se voit refuser le débat. Pour autant l’Assemblée ne renverse pas le gouvernement. C’est là une transformation fondamentale qui affecte la logique institutionnelle, puisqu’on peut y voir une cause, au moins indirecte, de la fin du gouvernement d’Elisabeth Borne.
Ainsi, est réinventée la démission du gouvernement provoquée sans vote de motion de censure. De cette pratique parlementaire, qui modifie substantiellement l’équilibre des institutions, la décision du 25 janvier 2024 du Conseil constitutionnel ne saurait porter trace : la procédure d’adoption de la loi n’est pas en cause, puisque le rejet n’a pas interrompu la navette parlementaire et que le succès de la commission mixte paritaire a permis au gouvernement d’obtenir ensuite un vote conforme des deux assemblées. Mais comment passer sous silence cette altération du fonctionnement du régime ?
II – Le chef de l’État est intervenu dans le débat parlementaire et dans le contentieux constitutionnel en dehors des prévisions de l’article 5 de la Constitution
La décision met en évidence plusieurs particularités procédurales. En premier lieu, on observera que le Conseil publie deux observations parlementaires au soutien du texte, ce qui, sans remettre en cause la règle selon laquelle seul le gouvernement défend les textes adoptés – quelle qu’en soit l’origine –, permet aux soutiens du texte d’apparaître dans la procédure, tandis que les observations du président du groupe socialiste du Sénat figurent au titre des contributions extérieures.
Les quatre recours dont le Conseil a été saisi, ceux des députés de la NUPES et des sénateurs socialistes bien sûr, mais aussi ceux émanant du chef de l’État et de la présidente de l’Assemblée nationale, relèvent plus de visées – et de pesées – politiques que de préoccupations strictement constitutionnelles. Les dispositions issues d’amendements sénatoriaux (principalement en cause) scellaient un accord qui avait sauvé la loi du naufrage malgré le vote, au palais Bourbon, de la motion de rejet préalable. Mais l’hémisphère gauche du camp présidentiel, et le chef de l’État lui-même, espéraient pouvoir s’affranchir de cet engagement grâce aux censures que prononcerait le Conseil. Conclure un accord avec une partie de la droite pour éviter le rejet du texte, puis, ce dernier une fois adopté, obtenir du Conseil constitutionnel l’annulation des clauses qui dérangeaient paraît inélégant, mais apaisant pour une partie du parti présidentiel.
Le débat a ainsi révélé, au moins autant que celui sur la réforme des retraites, l’importance de l’ombre portée du Président sur le vote de la loi. La Constitution n’en fait pourtant pas un acteur du jeu législatif. Or il a pesé de tout son poids pour qu’aboutisse la négociation.
À l’article 5 de la Constitution, la notion d’« arbitrage » résulte, elle aussi, du « compromis dilatoire » de 1958. La révision de 2008 s’est gardée de toucher à cette notion.
En l’espèce, après avoir pesé de tout son poids en faveur d’une négociation avec le centre et la droite sénatoriale, puis pour une commission mixte paritaire conclusive, le président de la République a décidé d’adresser au Conseil constitutionnel une saisine « blanche », ne précisant ni les dispositions qui lui apparaissent douteuses, ni aucun grief de constitutionnalité. Usant du langage diplomatique, le président Fabius a qualifié la démarche de « peu banale ».
En effet, d’une part, les saisines présidentielles sur une loi sont rares : elles intéressent les décisions des 23 juillet 2015 (DC, n° 2015-713, loi sur le renseignement13), 13 mars 2019 (n° 2019-780 DC, maintien de l’ordre public lors des manifestations) et 11 mai 2020 (n° 2020-800 DC, état d’urgence sanitaire). D’autre part, ces trois saisines étaient motivées, même si le dépôt de la première a suscité un débat, le président Jean Louis Debré ayant fait savoir qu’il refuserait d’admettre une saisine en blanc14. L’article 2 du règlement de procédure adopté le 11 mars 2022 affirme cette position : « La saisine mentionne les dispositions législatives ou les clauses de l’engagement international sur lesquelles il est invité à se prononcer, ainsi que les exigences constitutionnelles qu’elles sont susceptibles de méconnaître ». Mais le règlement de procédure est-il opposable au chef de l’État ?
Une saisine en blanc pose un problème au regard de la possibilité d’articuler ensuite une QPC sur un texte intégralement déféré 15. En se contentant de déclarer conformes ou contraires à la Constitution les dispositions sur lesquelles il s’est prononcé, le Conseil évite cet inconvénient.
III – La portée extensive donnée par le Conseil à la notion de « cavaliers législatifs » méconnaît la lettre et l’esprit de l’article 45 de la Constitution
« M le président Marrast a refusé de recevoir comme amendement une disposition qui n’avait rien de commun avec le texte soumis au vote de l’Assemblée. De même dans la séance de la chambre des députés du 16 novembre 1880, M. le président Gambetta a refusé de considérer comme contre-projet à une loi sur l’organisation de la magistrature un amendement qui traitait du Conseil d’État et de la Cour de cassation… En matière parlementaire on ne peut mettre en discussion que ce qui se rattache à l’ordre du jour »16. La prohibition des cavaliers17 répond à une considération procédurale de bon sens : éviter l’éparpillement des débats, l’insuffisante réflexion sur une question qui s’invite dans une thématique différente, par des parlementaires mal ou pas informés. Elle contribue à la sincérité du débat, à la clarté et à l’intelligibilité de la loi, ou à sa cohérence. C’est pour ces raisons que, dès la IIIe République, fut inscrit le principe que, en matière budgétaire, les amendements ne sont recevables « que s’ils se rapportent au texte en discussion » (RAN, art. 102). En 1935, cette règle de recevabilité fut généralisée : « Les amendements ou articles additionnels ne sont recevables que s’ils sont proposés dans le cadre du projet ou de la proposition et s’ils s’appliquent effectivement à l’article qu’ils visent » (art. 84).
Avant 2009, l’article 98, alinéa 5, du règlement de l’Assemblée disposait que « les amendements et les sous-amendements ne sont recevables que s’ils s’appliquent effectivement au texte qu’ils visent, ou, s’agissant d’articles additionnels, s’ils sont proposés dans le cadre du projet ou de la proposition ; dans les cas litigieux, la question de leur recevabilité est soumise, avant leur discussion, à la décision de l’Assemblée ». D’abord posée par les règlements des assemblées, dont la méconnaissance n’entache pas la constitutionnalité de la loi, la règle a été reprise par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui affirme le principe selon lequel les amendements doivent se rapporter au texte débattu. Après s’y être référé dans la décision n° 85-191 DC du 10 juillet 1985, il en fait un argument central de son contrôle dans sa décision n° 85-198 DC du 13 décembre 1985. La jurisprudence a ensuite évolué dans un sens restrictif, provoquant l’incompréhension des parlementaires.
« Nous voulons remettre en cause la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, ces dernières années a restreint notre liberté d’amendement en première lecture ». C’est ainsi que, le 9 juillet 2008, le rapporteur de la révision constitutionnelle, Jean-Luc Warsmann, explique ce qui deviendra la seconde phrase du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis »18. L’expression « un lien même indirect », reprise par le règlement de l’Assemblée et par l’article 44 bis du règlement du Sénat, vise donc à assouplir une jurisprudence sur les cavaliers jugée trop sévère par le constituant de 200819.
Quant à la référence à la seule première lecture dans l’article 45, elle rappelle que l’admission de dispositions adventices est moins possible encore lors des phases suivantes du débat : c’est la théorie de l’« entonnoir législatif »20.
L’objectif du constituant est donc, en 2008, de desserrer la contrainte. Mais la modification de l’article 45 de la Constitution semble avoir eu un effet contraire à celui recherché : la censure des cavaliers « législatifs » a acquis une base constitutionnelle, mais les deux mots « même indirect » ont été oubliés. Selon la jurisprudence récente, même ayant un lien avec la thématique d’un projet de loi, un amendement est « cavalier » dès la première lecture s’il n’entretient pas de lien avec un article au moins du projet de loi. Nombre de décisions illustrent cette absence d’inflexion, pour ne pas dire ce durcissement, de la jurisprudence21. C’est ainsi que sont censurés 34 articles de la loi Macron par la décision du 5 août 2015 et 26 articles par la décision du 3 décembre 2020 dans la loi de simplification de l’action publique. C’est ainsi que des dispositions relatives aux pouvoirs de l’agence française de lutte contre le dopage sont jugées sans lien, même indirect, avec un projet de loi sur les Jeux olympiques 22. On pourrait comprendre cette rigueur pour des textes mosaïques (« portant dispositions diverses »), mais comment admettre que des amendements sur le regroupement familial ou sur les titres de séjour soient jugés par le Conseil constitutionnel, comme en l’espèce, sans lien, même indirect, avec une loi sur l’immigration ?
Le Conseil n’a pas exigé un contrôle parlementaire systématique, dès le dépôt d’un amendement, du lien présenté par cet amendement avec le texte en discussion, comme il l’a fait s’agissant des irrecevabilités financières posées par l’article 40 de la Constitution23. La contrepartie d’un tel contrôle est la nécessité d’une contestation de l’irrecevabilité devant le Parlement pour qu’elle puisse être soulevée devant le Conseil. Celui-ci est donc juge d’appel. Or, dans le cas des cavaliers législatifs, le Conseil n’exige pas de préalable parlementaire. Il se saisit même d’office s’il l’estime nécessaire, comme il l’a d’ailleurs fait pour deux dispositions le 25 janvier 2024. Cette différence procédurale présente un avantage lors du débat : des amendements apparemment éloignés du texte débattu peuvent être votés. Elle présente aussi un inconvénient lors du contrôle : le juge constitutionnel est poussé à davantage censurer, ne serait-ce que parce que son contrôle est exhaustif. Mais aussi parce que la censure formelle lui permet d’éviter un examen de fond. Elle est parfois le seul élément de censure24.
Le Conseil a cédé ici à la tentation de la rigueur en retenant l’acception la plus extensive qui soit de la notion de cavalier législatif. Le grief portait sur 33 articles et les censures sont systématiques. Ainsi en est-il des dix articles portant sur les titres de séjour25, alors même que le titre Ier du projet de loi comportait quatre articles sur la délivrance de cartes de séjour. Le Conseil évite ainsi, par exemple, de se prononcer sur la délicate question du regroupement familial, mais aussi des frais d’inscription dans les établissements d’enseignement supérieur des étudiants étrangers.
Il en va de même de :
• l’article 16, sur l’obtention d’un visa de long séjour pour les ressortissants britanniques propriétaires de résidences secondaires en France ;
• l’article 19, soumettant le bénéfice du droit au logement, de l’aide personnelle au logement, de l’allocation personnalisée d’autonomie et des prestations familiales pour l’étranger non ressortissant de l’Union européenne à une condition de résidence en France d’une durée d’au moins cinq ans ou d’affiliation au titre d’une activité professionnelle depuis au moins trente mois, qui échappe ainsi à une décision au fond pourtant attendue (d’aucuns voyaient dans cet article une expression de la très honnie « préférence nationale », alors même que des conditions similaires, jugées conformes à la Constitution26, sont imposées pour bénéficier du RSA) ;
• les articles 24, 25, 26 et 81 réformant certaines règles du Code civil relatives au droit de la nationalité ;
• les paragraphes III et IV de l’article 47 prévoyant que l’aide internationale au développement doit prendre en compte le degré de coopération des États en matière de lutte contre l’immigration irrégulière ;
• l’article 50 sur l’aide au retour ;
• l’article 58, relatif aux refus d’entrée ;
• l’article 67, modifiant les conditions d’hébergement d’urgence de certaines catégories de personnes sans-abri ou en détresse ;
• les articles 68 et 69, relatifs aux hébergements de demandeurs d’asile ;
• l’article 81 qui, à Mayotte, en Guyane et à Saint-Martin, exigeait qu’un au moins des parents réside régulièrement sur le territoire de cette collectivité depuis un an, à la naissance de l’enfant, pour que celui-ci bénéficie du « droit du sol ».
Notons, sur ce dernier point, que le ministre de l’Intérieur a déclaré, aussitôt après la décision du 25 janvier 2024, vouloir reprendre le dispositif de l’article 81 pour Mayotte. Il a ensuite élargi son ambition au vu de la crise migratoire sévissant dans l’île et des revendications de la population locale : il s’agit désormais non plus de limiter, mais de supprimer le jus soli à Mayotte et sans doute de le faire par voie constitutionnelle27.
Notons également que n’est pas censuré l’article prévoyant que, si, à la suite d’un refus d’entrée, l’entreprise de transport aérien ou maritime se trouve dans l’impossibilité de réacheminer l’étranger en raison de son comportement récalcitrant, seules les autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière sont compétentes pour l’y contraindre. Cette disposition est destinée à harmoniser le droit en vigueur avec la décision du 15 octobre 202128, qui voit dans le monopole public de l’exercice de la force légale un « principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ». Elle échapperait en tout état de cause au sort des cavaliers législatifs29, car le dispositif tend à corriger une inconstitutionnalité, ce qui rendrait en toute hypothèse recevable un amendement dès la première lecture, comme au cours des lectures suivantes30.
Le Conseil a donc opté pour une rigueur absolue en censurant une trentaine de cavaliers. Technique, cette censure est inévitablement perçue comme inspirée par des mobiles partisans. Les motifs de la décision ont beau être procéduraux, ses effets sont très politiques, ne serait-ce que par l’étendue quantitative des censures (40 % du texte) et par la nature des dispositions passant à la trappe (les apports de la droite). La décision du 25 janvier est source de malentendus – et nourrit des soupçons de collusion. Nos compatriotes ont du mal à trouver véniel, parce que reposant sur un motif de procédure, un taux de censure aussi élevé. Quant à leur expliquer qu’une « jurisprudence constante » guidait la main du Conseil, ils pourraient répliquer que le juge doit changer de jurisprudence… En tout état de cause, le Parlement paraît le grand perdant de cette décision, tant son pouvoir d’initiative en sort restreint.
Au demeurant, la jurisprudence sur les cavaliers est si peu constante que deux articles (16 et 17) de la loi du 10 septembre 2018 (« loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie »), issus d’amendements parlementaires, n’ont pas été censurés par le Conseil lorsqu’il a examiné ce texte, alors qu’ils portaient sur l’adaptation du droit du sol à Mayotte et que le projet de loi initial ne contenait pas de disposition relative à l’acquisition de la nationalité.
Une précision apportée à l’article 45 de la Constitution (exigence d’un lien, même indirect, avec le domaine traité par le texte en discussion, ou avec son objet) provoquerait un recentrage de la jurisprudence, tout en continuant à subordonner le droit d’amendement à la connexité avec la thématique traitée.
En l’état, le Parlement apparaît au public comme le grand perdant de cette décision. La position arrêtée par le Conseil en matière de cavaliers législatifs est bien peu propice, en effet, au pouvoir d’initiative parlementaire. Il est vrai que désarçonner un cavalier est plus commode – et moins compromettant – que se prononcer sur le fond. Sa décision, précise-t-il s’il en était besoin, « ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles ».
Sur le fond, justement, le Conseil s’est peu prononcé.
IV – Le Conseil constitutionnel s’est peu prononcé sur le fond
Lors de ses vœux du 8 janvier, Laurent Fabius avait déclaré qu’« on peut toujours modifier l’état du droit mais, pour ce faire, il faut toujours veiller à respecter l’État de droit ». Cependant, les contours de l’« État de droit » sont parfois flous. Dans l’interprétation de la Constitution, dans l’application des principes dans lesquels elle s’incarne, dans la mise en œuvre des méthodes de contrôle de constitutionnalité (proportionnalité, plein exercice par le législateur de sa compétence, réserves d’interprétation…), résident des zones inexplorées, des indéterminations, des angles morts : autant de « marges de manœuvre » par lesquelles il est loisible au juge de faire prévaloir ses propres choix.
La censure partielle de l’article premier porte sur l’organisation d’un débat parlementaire annuel relatif à des quotas migratoires indicatifs31. Le législateur ne peut s’imposer à lui-même le calendrier de ses travaux, en créant une obligation de débats32. Si la décision ne censure pas la remise d’un rapport destiné à assurer l’information du Parlement, elle ne laisse pas non plus subsister la compétence parlementaire pour fixer des objectifs chiffrés, qui, en elle-même, ne porte pas atteinte à la fixation de l’ordre du jour. La loi ne comporte donc plus aucune mesure tendant, fût-ce sous forme d’orientations, à une limitation des flux d’entrée. Le plafonnement effectif des flux imposerait une révision constitutionnelle levant toute une série d’obstacles de droit interne et de droit européen, en particulier une modification de l’article 34.
Appelle un commentaire particulier la censure de l’article 38 qui permettait à un officier de police judiciaire de procéder de force à la photographie et à la prise d’empreintes d’un étranger majeur, en cas de refus caractérisé de ce dernier de se soumettre à ces opérations à l’occasion d’un contrôle aux frontières extérieures ou dans le cadre d’un placement en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Tout en considérant que l’identification des étrangers en situation irrégulière poursuit « l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l’ordre public, objectif de valeur constitutionnelle », et sans condamner la contrainte dans son principe, le Conseil juge, comme souvent en matière régalienne, que la disposition est insuffisamment encadrée. L’article prévoyait pourtant l’information préalable du procureur de la République. Mais le Conseil lui reproche de n’avoir subordonné le relevé forcé d’empreintes et la photographie non consentie ni à l’autorisation de ce magistrat (saisi d’une demande motivée en ce sens), ni à la démonstration que l’opération est l’unique moyen d’identifier la personne récalcitrante, ni à la présence d’un avocat. Le relevé forcé d’empreintes digitales et la photo non consentie seraient-ils des traitements inhumains et dégradants ?
Enfin, il faut souligner que les dispositions prévoyant un juge unique à la CNDA ou le recours à la visioconférence ont été déclarées conformes à la Constitution. Il en va de même à l’article 77 sur la prolongation du maintien en zone d’attente.
En définitive, quelles que soient les interprétations (divergentes) qu’on lui a prêtées, il y a peu d’éléments de fond dans la décision du 25 janvier 2024.
La loi, écrit Michelet33, « n’est pas un maître, un tyran, un bourreau. Elle est l’interprète des peuples, l’intelligent et bienveillant organe de tous. Elle leur traduit leur pensée. Son action indirecte, plus importante encore que son commandement direct conduit les hommes […], les oblige d’avouer que sous des mots différents ils voulaient la même chose ». On peut douter que la discussion parlementaire et la décision du Conseil constitutionnel aient eu cette vertu fédératrice en l’espèce.
Avec les censures prononcées, lesquelles ne portent que peu sur le fond, la promulgation de la trentième loi sur l’immigration de la Ve République n’a pas mis fin aux débats. Sur bien des points, les positions sont sorties exacerbées des débats parlementaires. Ceux-ci étaient à peine clos qu’éclatait le problème du chaos migratoire mahorais, avec les questions du jus soli et de l’asile, qui trouvent une illustration immédiate à Mayotte.
La loi aurait-elle été rédigée, comme l’affirment les auteurs de l’appel à manifester du dimanche 21 janvier 2024, « sous la dictée des marchands de haine qui rêvent d’imposer à la France leur projet de préférence nationale » ? La décision aboutirait-elle, comme le soutiennent d’autres, à un « texte mort-né » ? Il faut s’y faire : légiférer sur certains sujets – les retraites, l’immigration – déchaîne les passions françaises. D’un débat manichéen, les institutions ne peuvent sortir gagnantes.
Notes de bas de pages
-
1.
V. CE, 12 juill. 2022, n° 451897 pour la sanction par l’ARCOM de propos tenus « de manière véhémente et sans qu’aucune contradiction sérieuse ne lui soit portée, que les étrangers “mineurs isolés”, c’est-à-dire entrés en France sans leur famille, étaient “pour la plupart”, des “voleurs”, des “violeurs” et des “assassins”, que leur présence en France était assimilable à une “invasion” et que le risque que leur présence faisait courir à la population française était tel que plus aucun d’entre eux ne devait être accueilli en France ».
-
2.
Le 4 janvier 2024 la politique de lutte contre l’immigration irrégulière : « Entre 2017 et 2022, le nombre d’OQTF a augmenté de 60 % alors que les effectifs préfectoraux chargés de l’éloignement et du contentieux n’ont crû que de 9 % » (p. 27). « Le contentieux des étrangers, au sens large, représente 41 % des affaires enregistrées par les tribunaux administratifs en 2021 – contre 30 % en 2016 – et 61 % devant les cours administratives d’appel. En particulier, les principaux recours contre les OQTF ont plus que quadruplé en 10 ans » (p. 63). « En l’état incomplet du comptage du ministère de l’Intérieur, moins de 1,5 % des personnes sous OQTF quittent volontairement le territoire » (p. 79). L’étude d’impact retient 124 111 OQTF prononcées.
-
3.
F. Luchaire, « Le droit d’asile et la révision de la Constitution », RDP 1994, p. 5-43.
-
4.
L’expression est de G. Vedel : « Si les juges ne gouvernent pas, c’est parce que, à tout moment, le souverain, à la condition de paraître en majesté comme constituant peut, dans une sorte de lit de justice, briser leurs arrêts », in « Schengen et Maastricht », RFDA 1992, p. 179 ; « Le juge constitutionnel ne saurait donc résister à une révision de la Constitution qui, selon le vœu implicite du législateur, lèverait l’obstacle que le texte constitutionnel opposait à la loi. Autrement dit, le pouvoir constituant, expression suprême de la valeur souveraineté nationale, peut a posteriori anéantir la censure prononcée par le Conseil constitutionnel. La souveraineté nationale, la volonté générale sont intactes ». Pouvoirs n° 45, p. 150. V. A.-M. le Pourhiet, le Figaro, 6 févr. 2024.
-
5.
Si l’on compte bien, à 14 reprises, hors révisions faisant suite à des décisions sur les traités ou adaptant la Constitution pour les outre-mer.
-
6.
CEDH, 14 sept. 2022, n° 42384/19, même si « la Cour constate qu’aucune obligation de droit international conventionnel ou coutumier ne contraint les États à rapatrier leurs ressortissants. Il en résulte que les citoyens français retenus dans les camps du nord-est de la Syrie ne sont pas fondés à réclamer le bénéfice d’un droit général au rapatriement au titre du droit d’entrer sur le territoire national garanti par l’article 3 § 2 du Protocole n° 4. À cet égard, la Cour prend note des préoccupations du gouvernement défendeur et des gouvernements tiers sur le risque qu’il y aurait, en consacrant un tel droit, d’aboutir à la reconnaissance d’un droit individuel à la protection diplomatique qui irait à l’encontre du droit international et du pouvoir discrétionnaire des États ».
-
7.
7 mars 2022, cité par CE, 7 déc. 2023, n° 489817.
-
8.
Le texte commence par : « Vous m’avez fait part de votre volonté de nommer un nouveau Premier ministre », formule identique à celle employée par Michel Rocard le 15 mai 1991, ou précédemment par Jacques Chaban Delmas ou Georges Pompidou.
-
9.
P. Avril, Les conventions de la Constitution, 1997, PUF.
-
10.
Selon les auteurs, il faut entendre un nouveau texte et non une nouvelle lecture d’un texte.
-
11.
Cons. const., DC, 24 juin 1959, n° 59-2 : « Les propositions de résolution… tendraient à orienter ou à contrôler l’action gouvernementale, leur pratique serait contraire aux dispositions de la Constitution qui, dans son article 20, en confiant au gouvernement la détermination et la conduite de la politique de la Nation, ne prévoit la mise en cause de la responsabilité gouvernementale que dans les conditions et suivant les procédures fixées par ses articles 49 et 50 ».
-
12.
Sous la Ve République, des motions furent adoptées sur la directive permettant un prélèvement européen sur les recettes de TVA (Assemblée, 1978) sur les nationalisations (Sénat, 1981), sur les entreprises de presse (Sénat, 1984), sur les OGM (Assemblée, 2008), sur la proposition de loi sur le PACS (Assemblée, le 9 oct. 1998), mais jamais contre un projet de loi par une majorité hétérogène et à ce stade du débat.
-
13.
Loi sur le renseignement, v. P. Mouzet, AJDA 2015, p. 695.
-
14.
P. Jan, Huffington Post, 4 mai 2015 ; P. Avril et J. Gicquel, Pouvoirs n° 156, Chron., p. 178.
-
15.
Cons. const., DC, 26 mai 2011, n° 2011-630, obs. M. Guillaume, N3C 2015, n° 48, p. 127.
-
16.
Eugène Pierre traité de droit politique électoral et parlementaire, n° 697.
-
17.
Cons. const., « Le contrôle des cavaliers législatifs entre continuité et innovation », par J. Maïa, titre VII, n° 4, avr. 2020.
-
18.
J.-E. Gicquel, LPA 19 déc. 2008, p. 77.
-
19.
AN, rapp. Warsmann, n° 892, p. 328, illustre le nécessaire desserrement de la contrainte par des exemples issus de la jurisprudence qui « s’est montrée particulièrement sévère » : pratique de soins psychiatriques disjointe d’un texte relatif à l’organisation des professions de santé, surtout de psychothérapeutes dans un texte sur le médicament, et sept censures dans un texte sur la protection juridique des majeurs (Cons. const., DC, 1er mars 2007, n° 2007-552).
-
20.
AN, rapp. Warsmann, n° 892, p. 348.
-
21.
Cons. const., DC, 16 juill. 2009, n° 2009-584, sur la dénomination de l’École nationale supérieure de sécurité sociale dans la loi portant réforme de l’hôpital – Cons. const., DC, 14 oct. 2009, n° 2009-589, pour des dispositions sur les experts-comptables et la fiducie dans un texte sur les marchés financiers.
-
22.
Cons. const., DC, 17 mai 2023, n° 2023-850 : « L’article 7 est relatif au droit de communication entre l’Agence française de lutte contre le dopage et les agents de la cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l’article L. 561-23 du Code monétaire et financier. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles des articles du chapitre II du projet de loi initial, et en particulier avec celles de son article 4 permettant, à titre temporaire, au laboratoire antidopage français de procéder à des analyses génétiques sur les échantillons prélevés sur les sportifs au cours des Jeux olympiques et paralympiques de Paris ».
-
23.
Cons. const., DC, 20 juill. 1977, n° 77-41 : « Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions des articles 81, 86, 92 et 98 du règlement de l’Assemblée nationale, ainsi que celles des articles 24 et 45 du règlement du Sénat, dispositions par lesquelles un contrôle de la recevabilité des propositions et amendements au regard de l’article 40 de la Constitution a été organisé dans le cadre des prérogatives appartenant au Parlement. Considérant en conséquence que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi de la question de savoir si une proposition ou un amendement formulé par un membre du Parlement a été adopté en méconnaissance de l’article 40 de la Constitution que si la question de la recevabilité de cette proposition ou de cet amendement a été soulevée devant le Parlement ». Il en va de même pour le droit d’amendement en lecture définitive – Cons. const., DC, 15 janv. 2015, n° 2014-709 : JF Kerléo, Politeia, n° 27 2015.
-
24.
V. supra, note 22.
-
25.
Les articles 6 et 8 modifiant certaines conditions relatives au lien que l’étranger doit avoir avec un ressortissant français ou un étranger titulaire de la carte de résident pour se voir délivrer un titre de séjour pour motif familial ; les articles 9 et 10, modifiant certaines conditions de délivrance d’un titre de séjour pour un motif tenant à l’état de santé de l’étranger ; les articles 11, 12 et 13 relatifs, d’une part, à certaines conditions de délivrance d’un titre de séjour pour motif d’études et, d’autre part, aux frais d’inscription des étudiants étrangers dans certains établissements d’enseignement supérieur.
-
26.
La conformité à la Constitution de l’article L. 262-4 du Code de l’action sociale et des familles qui réserve le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) aux Français ou aux étrangers titulaires, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler a été admise par la décision Cons. const., QPC, 17 juin 2011, n° 2011-137.
-
27.
L’obligation de passer par une loi constitutionnelle pour mettre fin au droit du sol à Mayotte ne va pas de soi. En effet, la jurisprudence du Conseil constitutionnel n’établit pas que le droit du sol soit un « principe fondamental reconnu par les lois de la République ». Sa décision n° 93-321 DC du 20 juillet 1993 (loi réformant le Code de la nationalité) suggère même le contraire, puisqu’elle rattache le droit au sol à une circonstance contingente (les besoins de la conscription à la fin du XIXe siècle et au lendemain de la guerre de 1914-1918) et qu’elle admet deux sérieuses entorses à ce droit : la nécessité d’une manifestation de volonté de l’intéressé à sa majorité et la perte du droit au cas où l’intéressé aurait commis certaines infractions. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel admet que la singularité des circonstances locales justifie une dérogation à la loi commune. Un motif plus sérieux de recourir à une loi constitutionnelle pour supprimer le droit du sol à Mayotte est que cette suppression pourrait être regardée comme allant au-delà d’une « adaptation » de la loi aux particularités locales, au sens de l’article 73 de la Constitution, relatif aux départements d’outre-mer. Or, parfois pour son malheur, Mayotte est un département d’outre-mer. Même si elle était entérinée par le constituant, l’idée que l’on devienne ou non Français selon que votre mère est entrée en France par Mamoudzou ou par Vintimille malmène la notion d’indivisibilité de la République. Le problème ne se poserait pas si le droit du sol sur tout le territoire de la République était aboli, ce qui prendrait acte du fait que des personnes naissent en France de parents originaires de pays extra-européens dont la culture, les croyances et la mémoire historique sont très différentes et parfois opposées aux nôtres, et que même après avoir vécu en France avant leur majorité, mais dans des quartiers ghettoïsés, ces personnes ne partagent pas les us et coutumes françaises et n’entendent pas adhérer aux valeurs de la société française. Serait alors prévu que nul ne peut devenir Français, autrement que par filiation, s’il ne justifie de son assimilation à la société française.
-
28.
Cons. const., QPC, 15 oct. 2021, n° 2021-940 : « Selon l’article 12 de la Déclaration de 1789 : “La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée”. Il en résulte l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits. Cette exigence constitue un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ».
-
29.
« Ces dispositions ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec les dispositions des articles 9 et 10 du projet de loi initial réformant les conditions dans lesquelles certains étrangers peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion ou d’une décision d’obligation de quitter le territoire français ».
-
30.
Par exemple, Cons. const., DC, 19 janv. 2006, n° 2005-532, cons. 36.
-
31.
« Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception de l’asile, compte tenu de l’intérêt national. L’objectif en matière d’immigration familiale est établi dans le respect des principes qui s’attachent à ce droit ».
-
32.
Cons. const., DC, 7 janv. 1988, n° 87-234.
-
33.
J. Michelet, Cours au collège de France, 8e leçon, 1995, Gallimard, p. 359.
Référence : AJU012t2