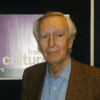Transparence de la vie publique : séparer le nécessaire de l’excessif

Maîtriser l’influence des intérêts particuliers sur la vie publique en assurant la transparence de celle-ci : « Vaste programme ! », eût dit le général de Gaulle. En effet, si le financement des élections et des partis s’inscrivait dans une problématique constitutionnelle relativement claire – et encore le législateur a-t-il dû s’y reprendre à plusieurs reprises pour compléter ou rectifier son ouvrage –, il n’en va pas de même s’agissant de la situation personnelle et des fonctions des décideurs politiques et administratifs. L’objectif poursuivi soulève de multiples questions touchant à la déontologie, aux conflits d’intérêts, sans oublier les patrimoines d’agents aux statuts différents, et aussi à la corruption – domaines régis par des dispositions spécifiques. Dispersé, le contrôle de cet ensemble hétérogène a finalement été confié à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique créée en 2013 ; sa mission s’est révélée si complexe que son président a pu récemment parler de « demi-teinte » à propos de certains résultats de son activité. L’article qui suit revient sur l’expérience de la HATVP ; il en examine la pratique et suggère les clarifications qu’elle pourrait appeler. À défaut d’une telle réforme de fond, il propose des améliorations, plus limitées mais, selon nous, indispensables.
Les difficultés rencontrées dans les débats sur la déontologie des agents publics (y compris celle des magistrats) ainsi que dans l’application de la législation, relative à la transparence et à la probité de la vie publique, tiennent, comme c’est souvent le cas, à une confusion des concepts. On mêle allègrement ce qui relève de la morale, de la déontologie proprement dite (c’est-à-dire des bons usages professionnels, codifiés ou non) et du droit positif (qui « permet, ordonne ou interdit »). Le domaine disciplinaire, qui superpose déontologie et droit, altère quelque peu ces catégories, mais de façon limitée : c’est ainsi que le Conseil d’État distingue les principes définis par la loi, qui obligent, et les bonnes pratiques, qui orientent. Dans ce domaine, le droit ne peut s’accommoder de frontières floues.
À la confusion des concepts s’ajoute celle des objectifs. S’agit-il de prévenir les agissements illégaux (enrichissement personnel, favoritisme, délit d’initié…) ? D’assurer la transparence des processus de décision ? De rechercher l’exemplarité des dirigeants ? D’éviter les conflits d’intérêts ? De préserver « les apparences » pour susciter la confiance ?
De ce fouillis se dégagent malgré tout trois types de « couplages » entre fins et moyens, qui se réclament tous du bon fonctionnement des institutions démocratiques :
-
lutter contre la corruption, au sens large du terme, au moyen des déclarations de patrimoine, en début et en fin de mandat, pour faire apparaître d’éventuels enrichissements personnels suspects. Nous sommes ici dans des procédures de déclaration et de constat, qui peuvent avoir des prolongements pénaux, après saisine du parquet, et qui concernent le comportement objectif des personnes ;
-
contribuer, par la transparence, à la neutralité des processus de décision. C’est ainsi qu’a été imposée la déclaration d’intérêts (pour les élus, les fonctionnaires et les responsables publics les plus importants) et mis en place un répertoire des « représentants d’intérêts », ceux-ci devant, de leur côté, déclarer les « actions d’influence » qu’ils sont amenés à conduire. Ces obligations pèsent sur ceux qui concourent à un processus de décision ou sont susceptibles de l’influencer ;
-
prévenir d’éventuels conflits d’intérêts en soumettant les décideurs à des règles déontologiques et en contrôlant le respect de ces dernières. Ces obligations contraignent les intéressés à raison non de leurs actes ou de leur participation à un processus décisionnel mais de la situation dans laquelle ils se trouvent.
L’expérience de la HATVP
Le contrôle de la bonne observation de ces trois catégories d’exigences, connexes mais différentes, a été confié, pour ce qui concerne les responsables publics, à un organisme unique, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), autorité administrative indépendante créée par la loi du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique, en remplacement de la commission pour la transparence financière de la vie politique.
Ce choix a sa logique : celle de l’efficacité. Il pouvait faire espérer que la Haute autorité construirait une cohérence qui a fait défaut lors de l’adoption des dispositions législatives sur la transparence et l’intégrité de la vie publique. Le législateur a procédé par superpositions et extension (par exemple, aux maires des communes de plus de 20 000 habitants). Mais tout seuil suscitera une discussion sur son relèvement, toute liste fera débattre sur la nécessité de la compléter. Le résultat a surtout été l’extension des pouvoirs de la HATVP, du fait d’un corpus « jurisprudentiel » de plus en plus élaboré et contraignant, qui traduit une logique propre et répond à des objectifs institutionnels multiples.
Aussi multiple que ses objectifs est l’action de la HATVP. Elle se manifeste d’abord par la revendication de moyens supplémentaires, matériels mais aussi juridiques, comme des pouvoirs de sanction, ainsi que de compétences nouvelles, le cas échéant en absorbant des entités proches (hier, la commission de déontologie des fonctionnaires, demain, peut-être, l’agence anticorruption). Elle se marque aussi, et c’est plus important, par une pratique.
L’article 2 de la loi du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique, définit le conflit d’intérêts comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». Cette définition a été validée sans sourciller par le Conseil constitutionnel : elle ne « méconnaît pas l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi », affirme-t-il, alors même qu’elle retient l’apparence comme critère1. Le Conseil constitutionnel a non moins admis, à propos des interdictions d’emplois familiaux2, des dérogations à l’égalité d’accès aux emplois publics motivées par la nécessité d’éviter des conflits d’intérêts.
La définition de ces derniers est cependant loin d’être claire puisque, comme le postule la théorie de l’apparence, ils tiennent non seulement à la réalité objective d’une incompatibilité entre deux situations de fait mais aussi à la perception subjective que peut avoir le citoyen de certaines situations. C’est donc de la croyance supposée commune, de la spéculation possible, du doute dans les esprits, que naît une obligation, avec les effets de droit qui s’y attachent. De ce fait, la HATVP est amenée à porter des appréciations à la fois in concreto et psychologiques. Elle opère à cet égard sur la base de critères inspirés du droit pénal, mais qui n’ont pas la précision du droit pénal, n’offrent pas les mêmes garanties au justiciable et ouvrent à la Haute autorité un champ d’extension de compétence potentiel considérable3.
Dès lors qu’elle procède à cet examen, sa tendance naturelle (éviter à l’intéressé de se placer dans une situation juridiquement fragile) comme sa logique institutionnelle (répondre au mieux à sa mission) la conduisent à prendre en compte l’ensemble des risques imaginables, tels que l’atteinte à la concurrence, le trafic d’influence, le favoritisme… même s’ils ne relèvent pas de son ressort. Comme l’écrit Maurice Hauriou4 : « La fonction n’est que la part déjà réalisée ou du moins déjà déterminée de l’entreprise ; il subsiste dans l’idée directrice de celle-ci une part d’indéterminé et de virtuel qui porte au-delà de la fonction ». Cette tendance naturelle de toute institution, surtout de toute autorité administrative indépendante, à poursuivre l’« idée directrice » qui en a motivé la création, touche ici le système représentatif lui-même : lien entre le peuple et ses élus. Et, tout naturellement, la Haute autorité appréhende et traite ces problèmes à travers le prisme de sa principale mission, qui est la lutte contre les conflits d’intérêts, et en usant des instruments à sa disposition : les injonctions et les réserves.
LA HATVP se trouve ainsi confrontée à un double risque : soit multiplier les contraintes sur l’intéressé (exprimées dans ses réserves) afin de le prémunir contre toutes les hypothèses d’infractions imaginables (d’autant qu’il faut prendre en compte « l’apparence ») ; soit, pour éviter tout excès, prendre le parti de minimiser les problèmes. Elle s’est efforcée d’échapper à ce dilemme en faisant des « appels à vigilance » qui indiquent au destinataire que tel ou tel contact, qu’il n’y a pas lieu de lui interdire, peut cependant conduire à la commission d’infractions et qu’il doit donc s’en garder.
Cette logique d’institution vaut également pour la transparence. Alors que, pour sauvegarder la vie privée, le Conseil constitutionnel a limité les déclarations de patrimoines et d’intérêt (exclusion des ascendants et descendants) et que, pour préserver la liberté d’entreprendre, il s’est prononcé pour la globalisation des déclarations des porteurs d’intérêts relatives à leurs interventions (le but étant de faire apparaître l’auteur et l’objet de l’intervention, non les modalités), le souci (compréhensible) de la HATVP de contrôler effectivement la sincérité des déclarations l’amène à demander des justificatifs contraires à l’esprit de cette jurisprudence.
En prenant le recul aujourd’hui possible, on peut apprécier les résultats auxquels aboutissent ces évolutions, en procédant à un examen mission par mission.
Appréciation
Pour ce qui concerne la lutte contre la corruption, menée au travers du contrôle de la variation des patrimoines, le résultat est dérisoire, en tout cas sans commune mesure avec les dizaines de milliers de déclarations remplies et examinées.
Ainsi, depuis 2021, seules deux affaires méritent être mentionnées : la première, en décembre 2021, concerne M. Griset (ministre délégué aux petites et moyennes entreprises) ; la seconde, en novembre 2022, touche Mme Cayeux (ministre déléguée aux collectivités territoriales). Dans les deux cas, le dossier est transmis au parquet pour « déclaration incomplète ou mensongère de situation patrimoniale ». Dans la plus récente de ces deux affaires, se trouve en cause la sous-évaluation de biens immobiliers en début de mandat, indicatrice d’une sous-déclaration fiscale. Il s’agit là, s’il est avéré, d’un agissement certes critiquable mais étranger à ceux visés par un contrôle destiné à appréhender la variation du patrimoine entre le début et la fin des fonctions et dont la finalité est de détecter un enrichissement personnel au cours et du fait du mandat. Le retentissement médiatique de l’affaire Cayeux ne doit donc pas faire illusion : dans cette affaire, la HATVP relève une sous-déclaration fiscale d’une héritière, non l’enrichissement d’une ministre. Il s’agit d’une insuffisance de valorisation qui aurait dû avoir été décelée par la direction des finances publiques plutôt que par la HATVP, qui joue ainsi en quelque sorte le rôle de service supplétif du fisc. Le gardien de but ne devrait pas avoir à pallier les défaillances de la défense et du sélectionneur.
Au strict regard de l’objectif poursuivi par les dispositions sur les déclarations de patrimoine des responsables publics, qui est, répétons-le, la détection d’un enrichissement personnel au cours et du fait du mandat, aucune évaluation des résultats du contrôle confié à la HATVP n’a été faite, ni même envisagée, alors pourtant que l’étendue du champ d’application de ce dispositif (qui concerne environ 17 000 personnes) et la complexité des obligations qu’il impose (pour la mesurer, on peut consulter le guide du déclarant) induisent des coûts administratifs considérables, financiers et, plus encore, temporels. Ajoutons-y la publication des déclarations : quoique limitée (pour les ministres et les membres de la HATVP, affichage sur le site de celle-ci ; pour les parlementaires, consultation par les électeurs à la préfecture du département), cette publication alimente des controverses souvent très éloignées du souci de bon fonctionnement des pouvoirs publics. Il suffit pour s’en convaincre de voir qui consulte les déclarations. Notons que la consultation prévue par la loi était assortie de l’interdiction d’en publier ou d’en diffuser les éléments « sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale ». Mais cette interdiction a disparu avec la loi organique du 15 septembre 2017.
En ce qui concerne les déclarations d’intérêts, l’utilité des exigences légales réside en principe dans la lumière jetée sur le processus de décision. Le danger d’exploitation « populiste » est toutefois le même que pour les déclarations de patrimoine et même plus grand puisque toutes ces déclarations sont accessibles sur le site de la HATVP.
On peut, certes, admettre, en première analyse, que ce danger trouve sa contrepartie dans le fait de donner à connaître que tel décideur, même en l’absence de prise illégale d’intérêts, est « intéressé », au sens neutre du terme, à tel ou tel sujet. Pour autant, en raison de l’imprécision de la notion d’« intérêts », les difficultés de mise en œuvre de ce dispositif ont compromis sa lisibilité et son efficacité, conduisant parfois à des situations schizophréniques. C’est particulièrement le cas pour les élus représentant leur collectivité dans des organismes satellites (sociétés d’économie mixte, associations, etc.) : la jurisprudence de la HATVP considère qu’ils ont des intérêts différents selon la « casquette » qu’ils coiffent. Ainsi, un élu communal devra se déporter quand le conseil municipal délibère sur l’attribution d’une subvention ou d’un contrat à l’organisme où il représente la commune. Cela ne le dispensera pas pour autant de rendre compte de son mandat et sa participation aux débats relatifs à la politique générale de l’institution « satellite » sera admise.
Sans doute le législateur a-t-il récemment resserré la notion de « conflits d’intérêts » applicable à ces représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé : c’est l’article 217 de la loi dite 3DS du 21 février 2022. Subsiste cependant une contradiction entre la portée extensive donnée à la notion de « conflit d’intérêts » (voire à la notion pénale de « prise illégale d’intérêts ») et notre tradition nationale d’économie mixte et d’intervention de la puissance publique dans le domaine économique et social, qui recherche la cohérence de l’action publique par la présence des mêmes personnes à diverses instances délibératives5. Cette contradiction place les élus, et la HATVP elle-même, dans des situations inconfortables. Que le cumul de fonctions publiques ait donné lieu dans le passé à des abus est incontestable. Mais la solution adoptée pour y remédier est excessive puisque, en remettant en cause les mécanismes de l’économie mixte, elle porte atteinte au bon fonctionnement de celle-ci. Cette contradiction n’a pas été évoquée dans le débat public.
Non moins problématique est la réglementation relative aux porteurs d’intérêts. Initialement conçue pour assurer la transparence et la clarté des débats parlementaires, elle a été étendue à d’autres décisions publiques, notamment celles des collectivités locales. On est ainsi passé de la mesure de « l’empreinte législative », inspirée par un souci de clarté du débat démocratique, au traçage des interventions des acteurs économiques dans une optique inquisitoriale, voire « pré-pénale ». Cette tendance risque, dans le climat actuel de défiance à l’égard des instituions, de perturber gravement le processus de décision publique.
Quant au répertoire des représentants d’intérêts, Didier Migaud, président de la HATVP, juge le bilan de sa mise en œuvre « en demi-teinte », notamment parce que les critères légaux d’identification du représentant d’intérêts sont « peu efficaces et peu lisibles » et permettent des « stratégies d’évitement ». Plus problématique encore est l’extension du répertoire (entrée en vigueur en juillet 2022 après plusieurs reports) aux collectivités territoriales.
Les ambiguïtés du contrôle du pantouflage
S’agissant de la déontologie des passages entre le public et le privé (« pantouflage » et « rétro-pantouflage » mais aussi reconversion professionnelle et cumul d’activités), la prévention des prises illégales d’intérêts, au sens pénal de cette expression, est (relativement) simple mais celle des conflits d’intérêts se heurte à de sérieuses difficultés. Il s’agit en effet d’anticiper des situations éventuelles, ce qui conduit nécessairement à une sorte de calcul de probabilités quant à leur réalisation. Ce calcul fait appel à l’imagination des membres de la HATVP et de ses services.
Il en résulte trois inconvénients.
Le premier est la tentation d’utiliser les réserves assortissant les avis relatifs aux pantouflages à des fins autres que la déontologie : garantir la libre concurrence, éviter le trafic d’influence, etc. Nous sommes là dans un chevauchement de pouvoir avec d’autres procédures, institutions ou juridictions, certes pavé des intentions les plus vertueuses.
Le second inconvénient est inhérent à toute application excessive du principe de précaution. À trop rechercher les risques possibles d’un passage entre le public et le privé, on tend à ne plus permettre que les mouvements de personnes n’ayant jamais rien fait, ni susceptibles de jamais faire quelque chose… C’est décourager les bons candidats et nuire in fine à l’intérêt général.
La seule solution à ce dilemme (en faire trop ou trop peu) serait de faire la balance – en assumant sa part inévitable de subjectivité – entre les risques encourus et les bénéfices attendus.
Le troisième inconvénient de l’anticipation des risques du passage entre le public et le privé tient à la portée juridique des réserves émises par la HATVP. Si elles n’ont pas par elles-mêmes le caractère de sanctions, ces réserves font néanmoins grief. Et leur méconnaissance par les intéressés peut entraîner des conséquences graves en dehors de toute procédure judiciaire (par exemple, pour un fonctionnaire recruté dans le secteur privé, la fin du contrat sans préavis ni indemnité).
Plus globalement, et bien qu’il soit difficile d’apprécier une législation encore en rodage, on peut considérer qu’elle produit trois types d’effets pervers.
Le premier vient de ce que le dispositif bouscule les principes du droit disciplinaire et du droit pénal (précision, interprétation stricte, non-rétroactivité) et provoque un brouillage de la frontière entre ces deux droits. En effet, s’appliquant aux mêmes faits, deux qualifications aussi proches que la prise illégale d’intérêts (notion pénale) et le conflit d’intérêts (notion déontologique) sont propres à alimenter une surenchère entre les juridictions pénales et la HATVP, leur commune tendance étant à l’extension de leur compétence et donc à l’interprétation extensive de ces notions.
La deuxième sorte d’effets pervers résulte de ce que les dispositifs mis en place pour « assainir » le climat politique contribuent à l’instauration d’une société de suspicion et de dénonciation. « S’il existait un peuple de Dieux », pour emprunter la formule à Jean-Jacques Rousseau, la transparence serait sans aucun doute le régime idéal. Mais, dans le monde tel qu’il est, pour reprendre les mots de Saint-Just en 1791, « les vertus farouches font les mœurs atroces ». Comme la fausse monnaie chasse la bonne, la régulation par la pression sociale prime de fait la procédure pénale, annihilant ainsi les garanties apportées par celle-ci.
Enfin, si le principe d’une institution spécialisée indépendante est adapté à des domaines très techniques (régulation de l’énergie, marchés financiers…), est-il approprié à un sujet aussi « sociétal » et extensif que la déontologie, sans qu’en soient bornés plus nettement les contours ?
Clarifications souhaitables et adaptations possibles
Les grandes lignes d’une réforme se déduisent de ce diagnostic. Elles résident dans la clarification des concepts, dans la définition corrélative des missions et dans la répartition des compétences entre les acteurs les mieux à même de les exercer.
Tentons de brosser ces grandes lignes, en citant Tocqueville : « Ce qu’il faut craindre d’ailleurs, ce n’est pas tant la vue de l’immoralité des grands que celle de l’immoralité menant à la grandeur »6.
Les sanctions pénales doivent rester évidemment à la justice et à la justice seule. À charge pour la Chancellerie de faire évoluer les incriminations, l’organisation des juridictions et la répartition des moyens afin de les préciser et de les adapter à l’évolution des conduites délictueuses. La déontologie doit rester un système de régulation interne et non singer ou anticiper un débat pénal.
S’agissant de la transparence, elle resterait l’apanage de la HATVP, à laquelle il reviendrait d’éclairer le processus d’élaboration des normes législatives ou réglementaires7 en repérant l’influence des intérêts. Son rôle serait de collecter les informations et de les mettre à la disposition des acteurs politiques et économiques et, plus généralement, de l’opinion.
En outre, sans méconnaître la charge politique et médiatique d’une telle mesure (surtout après l’affaire Cayeux), il serait rationnellement souhaitable de supprimer les déclarations de patrimoines8, inutilement étalées sur la place publique et ne servant pas à ce pour quoi elles étaient faites (déceler des enrichissements personnels en cours de mandat à l’issue de celui-ci). Ce n’est pas à leur patrimoine mais à leur action que nous devons juger nos élus. Tocqueville, encore lui, l’avait bien pressenti : « Dans la démocratie, les simples citoyens voient un homme qui sort de leurs rangs et qui parvient en peu d’années à la richesse et à la puissance ; ce spectacle excite leur surprise et leur envie ; ils recherchent comment celui qui était hier leur égal est aujourd’hui revêtu du droit de les diriger. Attribuer son élévation à ses talents ou à ses vertus est incommode, car c’est avouer qu’eux-mêmes sont moins vertueux et moins habiles que lui. Ils en placent donc la principale cause dans quelques-uns de ses vices, et souvent ils ont raison de le faire. Il s’opère ainsi je ne sais quel odieux mélange entre les idées de bassesse et de pouvoir, d’indignité et de succès, d’utilité et de déshonneur »9.
Si un tel changement paraissait irréaliste ou trop ambitieux, le dispositif actuel pourrait être au moins amélioré sur les points suivants :
-
comme dans la plupart des pays développés, il conviendrait de n’incriminer que les conflits d’intérêts « public/privé » en excluant les conflits « public/public » ;
-
les règles de transparence seraient réservées à l’élaboration des lois et actes réglementaires, en renonçant donc à contrôler toutes les « actions » des pouvoirs publics10. Si cette limitation paraissait trop restrictive (dans la mesure où elle ignore les décisions administratives qui, pour ne pas être normatives, n’en ont pas moins une portée générale), il conviendrait à tout le moins de se limiter aux actes énoncés dans le décret d’application de la loi de 2013 ;
-
il faudrait également préciser que les « intérêts » à déclarer sont ceux qui, par leur nature ou leur importance, sont susceptibles d’interférer avec l’exercice de la mission.
Enfin, peut-être est-il temps de s’interroger sur le maintien dans notre droit de la notion d’« apparence », et ce pour deux raisons :
-
l’idée qu’une apparence de dépendance à l’égard d’un intérêt étranger aux fonctions soit constitutive d’un conflit d’intérêts était admissible tant que cette dernière notion ne débordait pas du cadre strictement déontologique et n’avait pas d’implication répressive. Or, tel n’est plus le cas lorsque les réserves que la HATVP émet, en matière de conflits d’intérêts fondés sur l’apparence, s’imposent aux intéressés et peuvent être rendues publiques et, le cas échéant, faire l’objet de sanctions si elles ne sont pas respectées ;
-
plus généralement, est-il sain que l’on soit jugé, fût-ce seulement par le tribunal de l’opinion, non pour ses fautes ou indélicatesses mais pour celles dont les « apparences » donnent à penser qu’on pourrait les commettre ? Non pour ce que l’on a fait mais pour ce que l’on pourrait faire, alors même qu’on se refuse à le faire ? Le procès intenté aux apparences, loin de rétablir la confiance dans la vie publique, ne nourrit-il pas le soupçon ?
Prétendre éradiquer les conflits d’intérêts en traquant les apparences produit le contraire de l’objectif recherché : il sape la légitimité du système représentatif en légitimant la défiance.
Prenons garde à ce que l’excès de transparence, les exigences injustifiées et la lourdeur inutile des procédures ne discréditent le principe même du contrôle. Prenons garde surtout à ce qu’ils ne pénalisent aléatoirement la vertu et ne découragent objectivement le talent. Qui veut faire l’ange…
Notes de bas de pages
-
1.
Cons. const., DC, 9 oct. 2023, n° 2013-676.
-
2.
Cons. const., DC, 8 sept. 2017, n° 2017-752.
-
3.
En ce sens, RDP 2021, p. 895, note Y. Gaudemet.
-
4.
M. Hauriou, La théorie de l’institution et de la fondation, 1925, Cahiers de la nouvelle journée n° 4, Bloud et Gay, p. 12. V. aussi Y. Tanguy, « L’institution dans l’œuvre de Hauriou. Actualité d'une doctrine », RDP 1991, p. 61 et s. et p. 65 ; É. Millard « Hauriou et la théorie de l'institution », Droit et sociétés 1995, n° 30, p. 381 ; J. Schmitz, La théorie de l’institution du doyen Maurice Hauriou, 2013, L’Harmattan ; J. Barroche : « Maurice Hauriou, juriste libéral ou catholique ? », Revue Française d'Histoire des Idées Politiques 2008/2, n° 28, p. 307.
-
5.
En dépit de l’exigence nouvelle, d’inspiration anglo-saxonne, visant à garantir la moralité publique en séparant les rôles pour éviter tout risque de conflit d’intérêts.
-
6.
A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, t. 2, 1848, Pagnerre, partie 2, chap. 5.
-
7.
Avec, le cas échéant et prudemment, quelques décisions individuelles mais de portée générale.
-
8.
La partie des patrimoines des déclarants susceptible de les influencer dans l’exercice de leurs missions étant saisi par ailleurs dans les déclarations d’intérêts, ce qui suffit à assurer la transparence du processus de décision.
-
9.
A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, t. 2, 1848, Pagnerre, partie 2, chap. 5.
-
10.
L. n° 2013-907, 11 oct. 2013, relative à la transparence de la vie publique, art. 18-2.
Référence : AJU007u6