À huis clos
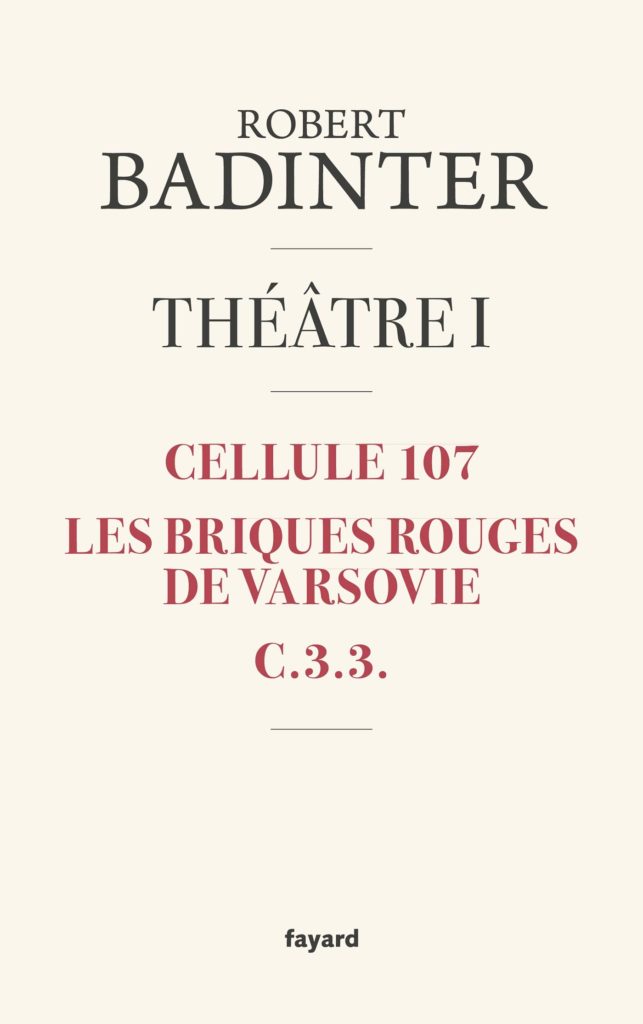
Fayard
Quels sont vos premiers souvenirs de théâtre, vos premières sensations face à une scène plongée dans la pénombre quand le rideau se lève… À cette question très personnelle, chacun se souviendra de son premier émoi ou parfois l’ennui qu’a pu provoquer une représentation loupée.
Mais bien souvent pour les passionnés de littérature, le théâtre a une place bien à part, car entre la littérature et le spectacle vivant, il y a souvent une symbiose qui s’installe et l’on devient vite un spectateur exigeant mais fidèle.
Robert Badinter nous surprend et est là où on ne l’attend pas ; alors que beaucoup souhaitent une biographie de cet éminent spécialiste du monde du droit, il publie chez Fayard, une recension de pièces de théâtre qu’il a lui-même écrites. Trois pièces, deux inédites et une déjà jouée au théâtre national de la Colline, en 1995.
Trois œuvres faites pour être jouées devant un public… Et pourtant, on apprécie la lecture de ces textes qui nous content la vie de personnages face à la justice. Car il a beau ne plus être garde des Sceaux, Robert Badinter n’en reste pas moins un homme de droit.
Ces pièces mettent en scène des hommes et des femmes face à leur destin, rattrapés par la justice des hommes, qu’elle soit institutionnelle (pour Cellule 107 ou C. 3.3.) ou personnelle voire divine (dans Les briques rouges de Varsovie).
Ce que l’on apprécie dans ce recueil, ce sont notamment les présentations faites par Robert Badinter. En effet, chaque pièce de théâtre est précédée d’un avant-propos qui nous explique comment il est venu à traiter le sujet. La démarche qui est la sienne, la volonté de retracer au plus près l’histoire de ces hommes et de ces femmes, personnages ayant réellement existés ou totalement fictifs. La précision historique est évidente, l’auteur ayant à cœur de se fonder sur des documents conservés dans des bibliothèques ou les Archives nationales.
La justice, ou du moins une certaine idée de la justice, est toujours au centre de l’histoire, des petites histoires personnelles qui font ou défont la grande histoire.
Ainsi dans la première pièce de ce recueil, Cellule 107, Robert Badinter fait dialoguer Pierre Laval, qui sera exécuté quelques heures plus tard, avec René Bousquet venu lui rendre une dernière visite dans sa cellule à Fresnes. Qu’ont bien pu se dire ces deux hommes marqués par le sceau de la collaboration et la réalisation de crimes contre l’humanité ? C’est ce dialogue imaginaire mais qui a bel et bien existé, à huis clos, que nous invite à assister Robert Badinter dans le premier acte de son recueil.
Dans le second acte de ce recueil, la pièce Les briques rouges de Varsovie, il s’agit là encore d’un huis clos. Enfermé dans une cachette dans le ghetto de Varsovie, en mai 1943, au dernier jour de l’insurrection, avant que tout ne soit totalement détruit, 4 personnages se rencontrent, tentent de s’accrocher à un espoir, cherchent à sauver leurs peaux, ou se battre contre l’ennemi.
Mais ce que cette pièce enseigne c’est que l’ennemi, dans cette période si trouble, c’est bien l’autre, celui qui partage pourtant la même religion, celui qui cohabite avec vous dans le ghetto. Comme cette pièce de Jean-Paul Sartre, oui, « l’enfer c’est les autres », mais quels autres ? Ceux qui vous condamnent d’avance pour des faits. L’enfer c’est l’autre : le bourreau, ou celui qui ne vous vient pas en aide…
Enfin, dans le dernier acte, la dernière pièce de ce recueil, C.3.3., seule pièce qui fut représentée à ce jour, Robert Badinter revient sur un procès historique ; celui d’Oscar Wilde en Angleterre, en 1895, pour des actes obscènes sur adulte consentant, c’est-à-dire pour homosexualité.
Robert Badiner s’interroge à cette occasion sur le sens même de la justice : « comment une justice respectueuse du droit (l’homosexualité était bien réprimée par la loi), qui rend une décision largement approuvée par la conscience collective, peut-elle nous apparaître, un siècle plus tard, si injuste ? » (p. 158).
C’est donc en retraçant grâce aux archives, commentaires dans la presse, correspondances et l’œuvre elle-même d’Oscar Wilde que Robert Badinter tire les leçons de ce procès historique. Tel un lanceur d’alerte, il nous prouve que ce qui est justice un jour, peut s’avérer quelques années plus tard une injustice et que l’on peut appliquer la justice et rendre une décision injuste… Ce qui encore aujourd’hui résonne particulièrement vrai.
Ainsi ces trois pièces se prêtent toutes au huis clos, même si dans C.3.3., l’unité de lieu n’est pas vraiment respectée, l’enfermement est au centre de ces trois pièces.
Enfermement dans ces convictions pour chacun des personnages, il y est toujours question de justice, de la justice des hommes pour Cellule 107 et pour C.3.3., mais aussi de ce qui l’accompagne, les juges voire le jugement dernier pour Les briques rouges de Varsovie… et de ce jugement à huis clos justement…
Tout le talent de Robert Badinter est de faire vivre ces hommes et ces femmes, ces Justes et ces crapules, en leur prêtant vie ; il sonde les âmes humaines, les héros comme les salauds… alors oui, l’enfer c’est les autres, mais on espère pouvoir les voir prochainement de chair et d’os pour vivre avec eux et voir ce que le sort de la justice leur réserve…






