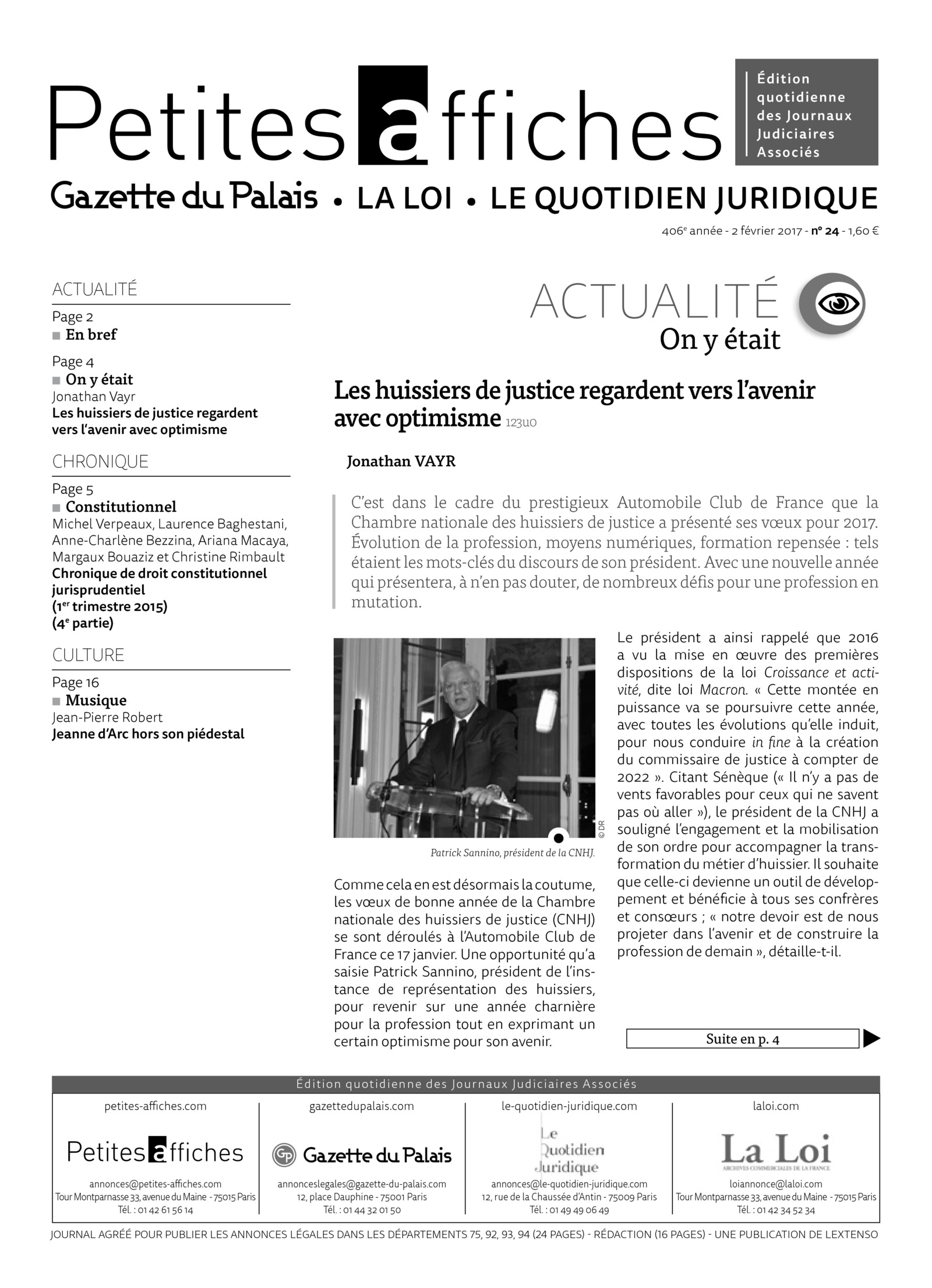Jeanne d’Arc hors son piédestal

Audrey Bonnet dans Jeanne d’Arc au bûcher, Opéra de Lyon, 2017.
Stofleth
C’est à la demande d’Ida Rubinstein qu’Arthur Honegger composa Jeanne au bûcher sur le texte de Paul Claudel : à l’heure de sa mort, Jeanne d’Arc se remémore son passé, selon le procédé du flash-back. Pensé comme un mystère médiéval, espéré comme « l’harmonieuse synthèse de deux aspects d’une même pensée », selon le musicien, cet oratorio dramatique ne se laisse pas aisément approcher. Car son caractère hybride – les deux rôles de la Pucelle et de Frère Dominique confiés à des acteurs, un mélange de déclamation et de chant, un orchestre luxuriant – conduit à des choix drastiques en termes de mise en scène. En la confiant à Romeo Castellucci, l’Opéra de Lyon – qui connut de l’œuvre une fugace création scénique en 1941 – frappe certainement un grand coup. On sait l’Italien visionnaire, provocateur souvent, toujours surprenant. Et donc bien dans l’ordre actuel sévissant dans le genre opéra, qui s’empare idéologiquement d’une pièce pour un résultat souvent en décalage avec ce qui est prôné, et partant, pose un problème de compréhension, sans parler de l’absence de repères pour le primo spectateur. Fidèle à sa manière, Romeo Castellucci, qui signe à la fois mise en scène, décors, costumes et lumières, accorde la primauté au visuel au point d’accaparer l’attention. Il dilate le temps. Avant même le Prologue, une longue scène muette introduit la pièce pour établir d’éloignés prémisses : une salle de classe d’antan est vidée bruyamment de tous ses meubles par un homme de ménage qui s’y est barricadé, foudroyé par la révélation de la destinée de Jeanne. Qui se déguise en femme, s’emploie à déterrer les objets cultes de la Pucelle et fait place à l’héroïne, par quelque singulière prestidigitation. Pour Romeo Castellucci, l’association de dialogues parlés et de passages chantés laisse de grands espaces de liberté. Dont il va user sans vergogne pour une dramaturgie elliptique faisant table rase de toute référence religieuse et gommant l’imagier du parcours terrestre de Jeanne. Est bannie toute illustration des diverses scènes, le jugement, l’Invention du jeu de cartes, etc. au profit d’un continuum linéaire. Est comme brouillée la subtile juxtaposition du divin et du populaire, de la ferveur et de l’ironie.
Il installe un huis clos : la salle de classe se métamorphose en un lieu neutre où Jeanne demeurera seule, Frère Dominique étant relégué dans le couloir adjacent, d’abord interrogateur vis-à-vis d’un événement incongru, puis passeur du récit de la vie de Jeanne. Chœurs et solistes vocaux sont cantonnés en coulisses. Leur chant nous parvient du lointain ou amplifié, pour un rendu ainsi artificiel. Selon le régisseur, il est temps de s’affranchir des symboles et de toute idée « de célébration de l’héroïne céleste », et ainsi de « dépouiller la personne de Jeanne de ses couches de peau successives pour pouvoir saisir l’être humain dans sa nudité ». De fait, l’actrice apparaît peu à peu complètement nue. Quelques tics animaliers, tel l’énorme cheval couché sur le flanc, sur le dos duquel Jeanne semble combattre, laissent place à des images fortes : Jeanne recroquevillée sous son épée gigantesque, parée du drapeau tricolore aux couleurs fanées, ou fébrilement accaparée à excaver la terre comme pour inscrire sa propre tombe. Car elle périra ensevelie dans cette glaise inhospitalière tandis qu’une vielle femme tout aussi dénudée – la Vierge – lui murmure à l’oreille « Jeanne, Jeanne, Jeanne, Fille de Dieu ! Viens ! Viens ! Viens ! ». Point de délivrance, point de transfiguration, mais la vision angoissante d’un être qui s’enfonce dans les ténèbres ; avant que la police, menée par un Dominique résigné, ne vienne constater les dégâts causés par le rêve d’un quidam.
Certes, ce spectacle capte l’attention et force est de reconnaître son achèvement, décuplé par le magnétisme de son héroïne. Car Audrey Bonnet accomplit un exploit. Outre la performance physique, l’identification au personnage-titre est totale et impressionne par une incandescence proche de la possession. À ses côtés, Denis Podalydès incarne parfaitement un Dominique paradoxal, réel et détaché. Les solistes vocaux, malgré le désavantage de leur placement dans un ailleurs peu propice, tirent leur épingle du jeu comme les Chœurs de l’Opéra de Lyon. Reste que l’équilibre voix-orchestre, si minutieusement recherché par les auteurs, est quelquefois malmené au détriment des premières. C’est que l’orchestre de Kazushi Ono se pare d’une somptuosité qui, pour rendre justice à la musique d’Honegger, à ses effets variés et à sa complexité polyphonique, prime souvent sur l’intelligibilité du texte. Au final, un spectacle d’esthète qui semble se suffire à lui-même, introduisant un illustratif fort distancié par rapport à l’œuvre qu’il est censé servir.