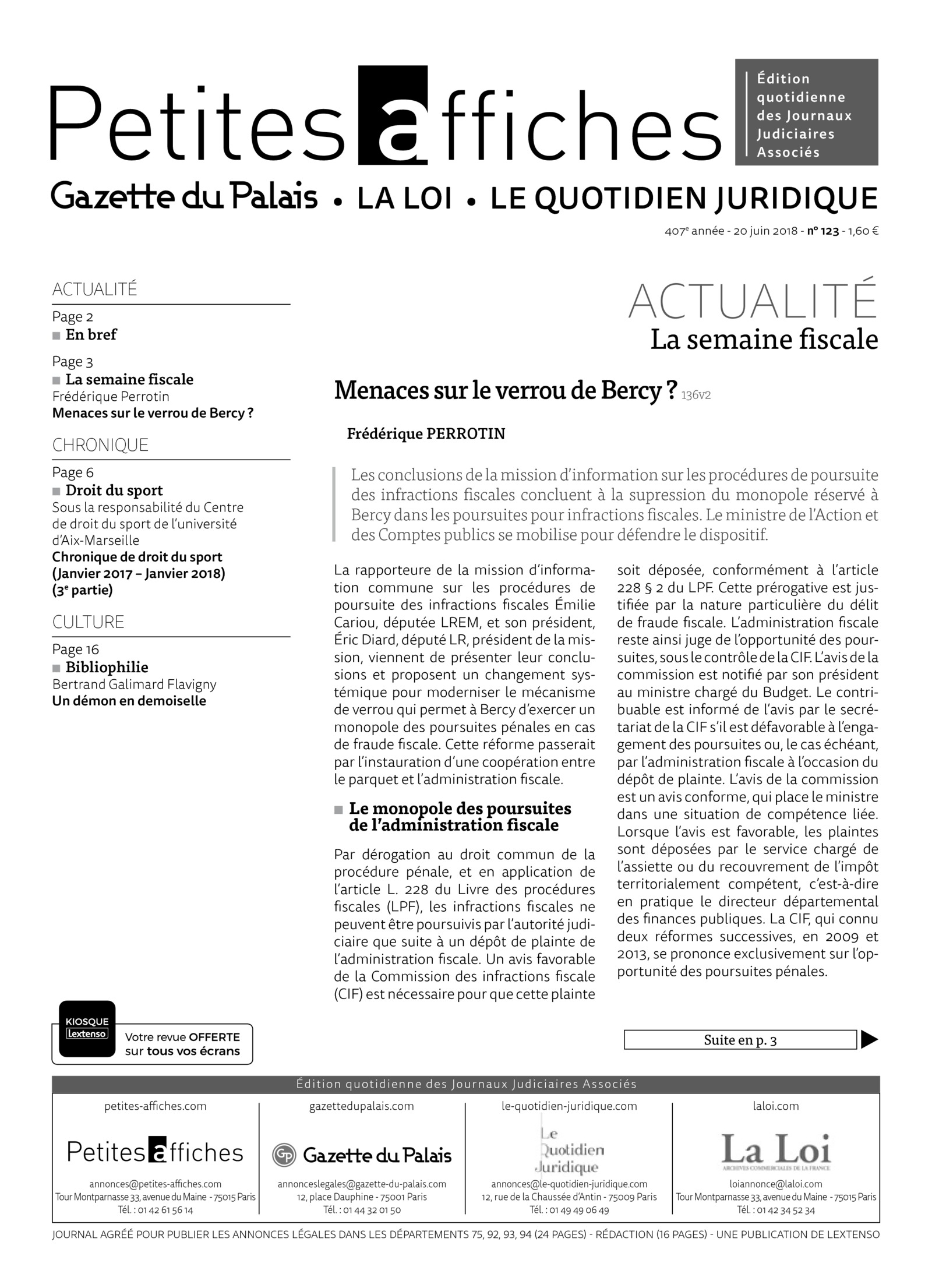Chronique de droit du sport (Janvier 2017 – Janvier 2018) (3e partie)
La présente chronique couvre la période située entre les mois de janvier 2017 et janvier 2018.
I – Le cadre juridique du sport
A – Les législateurs du sport
B – Les lois du sport
1 – Légalité des décisions des fédérations
2 – Concours de normes (…)
C – La justice du sport
1 – Droit disciplinaire
2 – Arbitrage : tribunal arbitral du sport
3 – Arbitrage : chambre arbitrale du sport (…)
4 – Justice publique
5 – Justice sportive (…)
II – Les acteurs du sport
A – Les groupements sportifs (…)
B – Le sportif
1 – Sports collectifs
2 – Sports individuels (…)
C – Les autres acteurs
1 – Entraîneurs
2 – Agents
3 – Arbitres (…)
4 – Médias
5 – Médecins (…)
III – L’activité sportive
A – Le théâtre de l’activité (…)
B – Les compétitions et manifestations sportives
1 – Accès aux compétitions
2 – Résultats des compétitions
Le juge judiciaire saisi d’un litige relatif à une décision d’arbitrage
CA Paris, 25 octobre 2017, n° 16/25771. Le juge judiciaire est rarement saisi de litiges afférents aux décisions des arbitres sportifs. C’est la raison pour laquelle l’arrêt rendu le 25 octobre par la cour d’appel de Paris mérite quelques observations. Dans cette affaire, une joueuse de tennis se plaignait du comportement antisportif de son adversaire lors d’une rencontre de l’édition 2016 du tournoi de Roland Garros. Reprochant à l’arbitre de la rencontre de ne pas avoir sanctionné cette attitude, elle a demandé au juge des référés de désigner un expert judiciaire afin qu’il vérifie la conformité des décisions d’arbitrage aux règles édictées par la fédération internationale de tennis. Confirmant l’ordonnance de première instance1, la cour d’appel a rejeté la requête de la joueuse2. Elle a considéré, tout d’abord, que selon l’article L. 223-1 du Code du sport, les arbitres exercent leur mission arbitrale en toute indépendance et impartialité, dans le respect des règlements édictés par la fédération sportive compétente. Ensuite, elle a estimé que la requérante n’apportait aucun élément permettant de juger utile et légitime sa demande. La joueuse n’a pas démontré la nécessité de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La solution apparaît bien fondée, mais on peut se demander si la cour n’aurait pas dû rejeter la requête au motif que le litige relevait de la compétence du juge administratif. En effet, le tournoi de Roland Garros étant organisé par la fédération française de tennis au moyen de prérogatives de puissance publique, sa responsabilité doit être recherchée devant le juge administratif si l’on invoque la faute d’un arbitre, qualifié de préposé de l’autorité fédérale. Néanmoins, si l’on estime que la dimension internationale du tournoi implique que son organisation relève de la responsabilité de la fédération internationale, il est possible de plaider que les conséquences d’une erreur d’arbitrage doivent être discutées devant le juge judiciaire. Au demeurant, l’une des rares décisions du juge judiciaire en cette matière a été rendue par la cour d’appel de Rennes3. Dans un litige relatif à la décision d’un arbitre refusant un but lors d’une rencontre de la coupe du monde football organisée en France en 1998, la cour avait refusé de retenir la responsabilité de la FIFA dans la mesure où l’association requérante n’avait pas réussi à apporter la preuve d’une faute volontaire commise dans l’intention de nuire ou d’une faute dolosive de l’arbitre.
En définitive, quel que soit le juge saisi, administratif ou judiciaire, l’erreur d’arbitrage susceptible d’engager la responsabilité de son auteur ou de son commettant est toujours très difficile à apporter.
Fabrice RIZZO
3 – Traitement du dopage
Compatibilité de l’obligation de localisation des sportifs avec la convention européenne des droits de l’Homme
CEDH, 18 janv. 2018, n° 48151/11 ; n° 77769/13, FNAS c/ France. Après les juridictions françaises4, c’est au tour de la Cour européenne des droits de l’Homme5 de considérer que l’obligation de localisation qui peut être imposée à certains sportifs (ceux du groupe cible6) ne heurte pas la convention européenne des droits de l’Homme et plus particulièrement ses articles 8 et 2 du protocole n° 47. Pour la Cour, l’obligation pour les sportifs du groupe cible désignés par l’Agence française de lutte contre le dopage de se localiser sans discontinuité pour permettre aux autorités compétentes de réaliser des contrôles antidopage non seulement pendant les compétitions, les entraînements, mais encore et surtout hors compétitions et entraînements, si elle porte atteinte à leur vie privée et familiale, ne viole pas l’article 8 de la CEDH dans la mesure où l’obligation de localisation d’une part, et les modalités de contrôle antidopage d’autre part sont prévues par la loi et apparaissent nécessaires à la protection de la santé, mais encore à celle des droits et libertés d’autrui.
Pour arriver à cette conclusion, la Cour répond tout d’abord à la question de savoir si l’obligation de localisation et les modalités de contrôle antidopage qui peuvent s’ensuivre portent atteinte à la vie privée et familiale des sportifs du groupe cible. Sans surprise, elle considère que le dispositif applicable à l’époque des faits, celui issu de l’ordonnance du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du Code du sport avec les principes du Code mondial antidopage, porte une atteinte incontestable à la vie privée des sportifs. On rappellera que ce dispositif permettait8, du fait de la localisation imposée au sportif, de réaliser un contrôle antidopage soit sur le lieu de la compétition, soit sur celui de l’entraînement, soit dans tout lieu choisi avec l’accord du sportif9, y compris son domicile10, dans une période se situant entre 6 h 00 et 23 h 00. Aussi pour la Cour11, les informations que doivent livrer les sportifs soumis à l’obligation de localisation « couvrent l’ensemble des espaces publics et privés qu’ils fréquentent. Elles portent, en effet, sur les lieux de toutes leurs activités, qu’elles soient professionnelles, comme les sites d’entraînement, ou qu’elles soient sans lien avec le sport. Elles englobent également leurs adresses privées, qu’il s’agisse de leur domicile privé ou d’un logement temporaire qu’ils occuperaient pour des raisons professionnelles ou personnelles. De plus, ces indications devant être communiquées pour chaque trimestre à venir, ils sont contraints de planifier leur vie privée en prévoyant longtemps à l’avance leur emploi du temps. En outre, ces prévisions sont contraignantes car toute modification au cours du trimestre doit être signalée. Enfin, les obligations litigieuses limitent les sportifs concernés dans leurs choix de vie car ils doivent impérativement être présents et disponibles chaque jour, pendant une heure, dans un lieu précis tel qu’il permette d’opérer un contrôle. Bien que prévisible pour les sportifs de haut niveau, cette exigence de transparence et de disponibilité suffit à la Cour pour considérer que les obligations critiquées par les requérants portent atteinte à la qualité de leur vie privée, avec des répercussions sur leur vie familiale et leur mode de vie. En particulier, elles réduisent l’autonomie personnelle immédiate des intéressés »12.
Pour autant, la Cour va également considérer que cette ingérence dans la vie privée des sportifs soumis à l’obligation de localisation répond aux conditions fixées par le § 2 de l’article 8. D’une part, cette ingérence est prévue par la loi13.
D’autre part, la réglementation examinée poursuit, pour la Cour, un but légitime au regard du § 2 de l’article 8. En effet, la Cour se rallie à l’opinion selon laquelle la lutte contre le dopage a pour objet de protéger la santé des sportifs, mais pas seulement celles des sportifs professionnels mais aussi des sportifs amateurs qui, à défaut de lutte efficace contre le dopage seraient incités à y recourir et à se mettre en danger. La Cour relève en outre, que le maintien de l’égalité des compétiteurs constituerait, un pan de la « protection des droits et liberté d’autrui », autrui étant ici tout à la fois les compétiteurs non dopés, mais également les spectateurs. Pour la Cour14, « la nécessité de combattre le dopage est depuis toujours admise dans le domaine sportif et elle renvoie à cet égard aux textes internationaux précités qui font du fair play et de l’égalité des chances l’un des fondements de la lutte antidopage. Or, la Cour estime que ce que le gouvernement qualifie de morale, s’agissant de la recherche d’un sport égalitaire et authentique, se rattache également au but légitime que constitue la « protection des droits et liberté d’autrui ». En effet, l’usage de substances dopantes pour obtenir des résultats dépassant ceux des autres sportifs, d’abord, écarte injustement les compétiteurs de même niveau qui n’y recourent pas, ensuite, incite dangereusement les pratiquants amateurs, et en particulier les jeunes, à utiliser de tels procédés pour capter des succès valorisants et, enfin, prive les spectateurs d’une compétition loyale à laquelle ils sont légitimement attachés ». Finalement, la Cour estime que la réglementation générale instaurant une lutte forte contre le dopage répond à certains des buts légitimes visés au § 2 de l’article 8, sans se concentrer ici sur les mesures spécialement incriminées. On notera à cet égard, que l’égalité de compétiteurs est considérée comme un but légitime justifiant qu’une réglementation régissant la matière sportive limite les droits fondamentaux des sportifs ou des groupements sportifs.
Mais les mesures attaquées doivent ensuite être examinées pour savoir si elles apparaissent nécessaires, dans une société démocratique, troisième condition pour qu’elles soient conformes au § 2 de l’article 8. Comme le rappelle la Cour, pour que tel soit le cas, il faut qu’il soit démontré que l’ingérence résultant de la réglementation examinée dans la vie privée réponde à un besoin impérieux, que les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier soient pertinents et suffisants et que cette ingérence soit proportionnée au but légitime visé, et ce d’autant plus que la Cour considère que cette ingérence est en l’espèce très importante, les sportifs visés étant soumis, ce que la Cour admet, à des obligations auxquelles la majorité de la population active n’est pas tenue.
Pour la Cour, les éléments précités sont établis. Les dangers du dopage sur la santé des sportifs sont scientifiquement avérés non seulement à l’égard des sportifs de haut niveau, mais encore à l’égard des sportifs amateurs et des jeunes qui prennent pour modèle les sportifs professionnels. À cet égard, pour la Cour, « la circonstance que le comportement des sportifs de haut niveau est de nature à exercer une grande influence sur les jeunes constitue une raison supplémentaire de légitimer les exigences qui leur sont imposées pendant la durée de leur inscription dans le groupe cible ».
En outre, la Cour observe l’existence d’un consensus international dans la lutte contre le dopage, laquelle nécessite la pratique des contrôles inopinés (et donc les mesures de localisation). Par conséquent, pour la Cour, cette pratique, admise par un concert international de nation démocratique doit être prise en considération pour décider de la nécessité de l’ingérence litigieuse dans une société démocratique15. Et du fait de la difficulté réelle de détection du dopage, la Cour considère finalement que les mesures sont équilibrées : « Au regard des périls établis par les éléments du dossier et des difficultés rencontrées pour les réduire efficacement, la Cour convient, avec le gouvernement, qu’il y a lieu de regarder comme justifiées les obligations de localisation prises en vertu des normes de droit international précitées ».
En conclusion : « La Cour ne sous-estime pas l’impact que les obligations de localisation ont sur la vie privée des requérants et de la requérante. Toutefois, les motifs d’intérêt général qui les rendent nécessaires sont d’une particulière importance et justifient, selon l’appréciation de la Cour, les restrictions apportées aux droits que leur accorde l’article 8 de la convention. Réduire ou supprimer les obligations dont ils se plaignent serait de nature à accroître les dangers du dopage pour leur santé et celle de toute la communauté sportive, et irait à l’encontre de la communauté de vue européenne et internationale sur la nécessité d’opérer des contrôles inopinés. La Cour juge donc que l’État défendeur a ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu, et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la convention ».
Le sportif professionnel membre du groupe cible est donc finalement vraiment une personne à part. L’atteinte à sa vie privée doit être admise, non seulement pour le protéger, mais également pour protéger une communauté, les sportifs, à raison de l’influence de ses performances et de son image sur cette dernière. Il doit donc être exemplaire, même si cette exigence conduit à restreindre, de façon substantielle le domaine de sa vie privée.
Didier PORACCHIA
Inconstitutionnalité du pouvoir de réformation sur auto-saisine de l’AFLD
Cons. const., 2 févr. 2018, n° 2017-688 QPC. Alors que la Cour EDH a validé l’obligation de localisation des sportifs du groupe cible au regard de la convention EDH16, le Conseil constitutionnel vient de déclarer contraire à la constitution le pouvoir de réformation de l’agence française de lutte contre le dopage sur auto-saisine.
L’AFLD, autorité administrative ou publique indépendante, a en effet le pouvoir, à la suite de la décision de sanction prise par l’organe disciplinaire en matière de dopage d’une fédération agréée, de s’auto-saisir et d’alourdir la sanction prononcée. Un requérant avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité en demandant si l’article L. 232-22, 3°, du Code du sport ne portait pas atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen selon lequel : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ». Et le Conseil d’État avait renvoyé cette QPC au Conseil constitutionnel17. Pour le requérant, en ne distinguant pas, au sein de l’AFLD, l’autorité décidant de la saisine d’office de l’agence et celle chargée du jugement à la suite de cette saisine, le législateur n’aurait pas garanti une séparation organique ou fonctionnelle entre les fonctions de poursuite et de jugement18. Le Conseil constitutionnel suit ce raisonnement. Il décide que : « (…), les dispositions contestées n’opèrent aucune séparation au sein de l’agence française de lutte contre le dopage entre, d’une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements ayant fait l’objet d’une décision d’une fédération sportive en application de l’article L. 232-21 et, d’autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements. Elles méconnaissent ainsi le principe d’impartialité »19. Pour ne pas être déclaré contraire à la Constitution, il aurait fallu que le pouvoir de réformation de l’AFLD soit attribué à une personne ou à un organe spécifique au sein de l’agence. Tel n’étant pas le cas, le 3° de l’article L. 232-22 précité est donc contraire à la constitution.
La solution20, prévisible et attendue21, est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel quant à l’obligation de séparation des fonctions de poursuite et de jugement au sein des autorités administratives indépendantes22. Elle rappelle, à quelques égards, l’inconstitutionnalité des saisines d’office des tribunaux de commerce en matière d’ouverture de procédure collective23.
Plus que dans son principe, la solution est surtout intéressante dans sa date d’entrée en vigueur. Le Conseil constitutionnel précise ici qu’en principe, « la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration »24. Or, selon le Conseil constitutionnel, « L’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait des conséquences manifestement excessives », en conséquence de quoi, « afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée », il décide de « reporter au 1er septembre 2018 la date de l’abrogation des dispositions contestées »25.
Néanmoins, le Conseil constitutionnel va plus loin. Outre d’envisager l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle qui abrogerait lesdites dispositions avant cette date, il considère que l’AFLD doit se saisir de toutes les décisions rendues en application de l’article L. 232-21 du Code du sport postérieurement à la présente décision et de toutes les décisions rendues antérieurement à cette décision dont elle ne s’est pas encore saisie dans les délais légaux. Il décide également que la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances relatives à une décision rendue sur le fondement de l’article L. 232-21 dont l’agence s’est saisie en application des dispositions contestées et non définitivement jugées à la date de la présente décision26. Comme cela a été relevé, « l’AFLD dont le rôle n’est normalement que supplétif, c’est-à-dire n’évoque qu’un nombre limité de décisions fédérales, se voit investie, pour les 7 mois à venir, de l’obligation de se saisir de tous les dossiers, ce qui change un peu la nature de sa fonction mais, au moins, règle complètement la question de l’auto-saisine, si la saisine devient systématique… »27.
Quant au requérant à l’origine de la QPC, il semblerait qu’il ait pu bénéficier de l’abrogation du pouvoir de réformation sur l’auto-saisine de l’AFLD.
Postérieurement à cette importante décision, le Conseil d’État a considéré, dans la même affaire revenant au fond, qu’il ne pouvait pas substituer sa propre sanction à celle de l’Agence28. Le Conseil constitutionnel a abrogé le 3° de l’article L. 232-22 précité, en reportant toutefois l’effet de la mesure au 1er septembre 2018. Cependant, la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances dont l’agence s’est saisie mais qui ne sont pas définitivement jugées à la date de la décision, soit le 2 février 2018. Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision du 11 avril, l’intéressé se trouvait précisément dans cette situation et il a donc exercé un recours contre la décision par laquelle l’AFLD a réformé, en l’aggravant, la sanction prononcée à son encontre par la Fédération française d’équitation. En réaction, l’AFLD, afin de maintenir effective la sanction, a demandé à ce que le Conseil d’État inflige lui-même une sanction, ce qu’il a refusé de faire, en toute logique. En effet, si un recours de pleine juridiction peut toujours être formé contre les décisions de l’AFLD, il ne lui appartient pas « lorsque, saisi d’un tel recours, il annule la décision de sanction prise par l’Agence, de se substituer à l’Agence pour apprécier s’il y a lieu d’infliger à l’intéressé une sanction à raison des faits qui lui sont reprochés ». La décision de l’AFLD est donc annulée. Toutes les instances cours dans lesquelles l’AFLD a mis en œuvre son pouvoir de réformation vont certainement connaître le même sort29.
Bastien BRIGNON
4 – Sécurité des compétitions
Constitutionnalité de la liste noire du PSG
Cons. const., déc., 16 juin 2017, n° 2017-637 QPC. Après les règles sur le dopage, c’est au tour des règles sur les violences sportives d’être soumises à l’épreuve du contrôle de constitutionnalité. Ainsi, dans une décision du 16 juin 201730, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de la loi n° 2016-564 du 10 mai 201631 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme, et modifiant l’article L. 332-1 du Code du sport, sont conformes à la constitution. Le législateur a en effet autorisé les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif, aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, à refuser ou annuler la délivrance de titres d’accès à ces manifestations, ou à refuser l’accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente des billets ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. Pour ce faire, les organisateurs peuvent, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux manquements relatifs aux conditions générales de vente et règlement intérieur relatives à la sécurité des manifestations. Précisément, l’Association nationale des supporters avait saisi le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2016-1954 du 28 décembre 2016 précisant les modalités de mise en œuvre de ces fichiers relatifs aux contrevenants des conditions générales de vente et des règlements intérieurs concernant la sécurité des manifestations sportives à but lucratif, et c’est à l’occasion de ce recours que s’est posée la présente question de constitutionnalité32. Le Conseil d’État a transmis au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la conformité à la constitution des nouvelles dispositions de l’article L. 332-1 du Code du sport.
Il était d’abord avancé que ce texte confiait ainsi aux organisateurs privés des pouvoirs de police en les autorisant à refuser ou annuler la délivrance de titres d’accès à des manifestations sportives ou à refuser l’accès aux personnes qui ne respecteraient pas les conditions générales de vente ou le règlement intérieur. Cela constituerait une violation de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 qui prévoit : « la garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force publique est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée »33. Il en résulterait qu’il ne peut être délégué à des personnes privées des compétences de police administrative générale. Le Conseil constitutionnel considère au contraire que le législateur n’a pas délégué de telles compétences aux organisateurs de manifestations sportives, dès lors que les pouvoirs confiés par le législateur sont limités, et ne s’analysent pas en des pouvoirs de police.
Ensuite, l’association des supporters soutenait qu’en autorisant les organisateurs à interdire l’accès à l’enceinte d’une manifestation sportive, le législateur avait méconnu le principe de la liberté d’aller et de venir. Le Conseil constitutionnel a cependant relevé que l’accès à la manifestation est subordonné à la présentation d’un titre. Le Conseil considère que le refus d’accès à la manifestation à une personne ayant manqué à ses obligations contractuelles relatives à la sécurité ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition, ni une mesure adoptée à l’issue d’une procédure juridictionnelle. En conséquence, les dispositions de la loi ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines, ni de la présomption d’innocence, ni des droits de la défense. Référence est ici expressément faite aux obligations contractuelles qui résultent manifestement de la relation entre l’organisateur d’une manifestation sportive à but lucratif et le supporter qui entend se rendre à cette manifestation. La sanction de l’inobservation des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatif aux mesures de sécurité est une sanction contractuelle d’ordre civil, mais en aucun cas elle ne présente des caractéristiques de nature pénale. Il en est de même des conditions générales de vente applicables pour l’accès aux lieux de manifestations artistiques et musicales. Le non-respect des règles de sécurité justifie le refus de délivrer un billet ou le refus d’accéder, et cela ne constitue pas une atteinte à la liberté d’aller et de venir faute de droit d’aller dans le stade.
Quant au fichier STADE34, l’association soutenait que l’autorisation donnée aux organisateurs de manifestations sportives d’établir le fichier relatif aux personnes n’ayant pas respecté les dispositions du règlement intérieur ou des conditions générales de vente était contraire au droit au respect de la vie privée. Mais, le Conseil écarte la violation du principe du droit au respect de la vie privée dans la mesure où le fichier ne peut être établi que par les organisateurs de manifestations sportives, qu’il ne peut recenser que les personnes qui ont contrevenu aux dispositions concernées, que le fichier ne peut être employé à d’autres fins que l’identification des personnes en vue de leur refuser l’accès à la manifestation. Le Conseil considère que le traitement de données est mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif d’intérêt général poursuivi par le législateur.
Au final, comme en matière d’obligation de localisation, la mesure est liberticide. Mais il faut admettre cette atteinte à la vie privée. Il faut espérer que l’atteinte reste limitée, dans le strict respect du cadre prévu par le décret.
Bastien BRIGNON
C – Les responsabilités
Responsabilité du fait des choses, acceptation des risques et dommages matériels : quand la rétroactivité de la jurisprudence rencontre la non-rétroactivité de la loi…
Cass. 2e civ., 14 sept. 2017, n° 16-21992. 28 août 2009, un accident survient lors des essais préparatoires d’une course automobile, ne provoquant que des dommages matériels. 28 août 2009, soit quelque 14 mois avant le célèbre arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 novembre 201035, arrêt aux termes duquel elle a posé solennellement le principe selon lequel « la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ». 28 août 2009, soit quelque 2 années et demie avant l’entrée en vigueur le 14 mars 2012 d’un nouvel article L. 321-3-1 du Code du sport prévoyant que « les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1384 du Code civil (désormais 1242), à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique », ce qui, d’une certaine manière, revient à cantonner la mise à l’écart de l’acceptation des risques aux seuls préjudices corporels. Quid, dès lors de la responsabilité du gardien du véhicule instrument du dommage sur le fondement de feu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil du fait des dommages matériels subis pas la victime ? La solution adoptée par l’arrêt du 4 novembre 2010 est-elle applicable à des faits qui lui sont pourtant antérieurs ? Oui, en vertu du principe de rétroactivité des décisions de jurisprudence, la Cour de cassation rappelant à l’envi que « la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application de la loi »36. Et c’est bien ce principe qu’applique implicitement la Cour de cassation dans son arrêt du 14 septembre 2017 puisqu’elle reprend, dans un attendu qui succède directement au visa de l’article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du Code civil, la solution posée par l’arrêt de revirement de 2010. Si cette décision est ainsi applicable au fait de l’espèce, qu’en est-il de l’article L. 321-3-1 du Code du sport ou à tout le moins de sa substance ? On comprend aisément l’enjeu : l’applicabilité de ce texte exclut toute responsabilité du gardien pour les dommages matériels, seuls dommages soufferts dans cette affaire. Sans appliquer expressément ce texte, la cour d’appel en a néanmoins, par anticipation, transposé l’esprit. Elle a ainsi relevé que l’application restrictive de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ne revêtait aucune légitimité s’agissant des dommages purement matériels causés aux véhicules et « que cela était si vrai que le législateur était intervenu par la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 ayant donné lieu à l’article L. 321-1-3 du Code du sport inapplicable à l’espèce comme étant postérieure de près de trois ans à l’accident objet du litige ». Et la cour d’appel de juger, pour écarter les demandes des victimes, que « l’accident purement matériel est survenu dans le cadre d’essais réalisés à la veille de la course, sur un circuit automobile, et que cette pratique sportive présente une dangerosité certaine, ce qui conduit à considérer que M. X a accepté, en sa qualité de pilote, de courir les risques normalement liés à cette activité ». En réalité, bien loin de commettre l’erreur grossière d’appliquer l’article L. 321-3-1 du Code du sport aux faits de l’espèce en contravention manifeste avec les termes de l’article 2 du Code civil, les juges d’appel ont adopté un raisonnement fin consistant à considérer que la précision législative de 2012 était déjà contenue, en germe et de manière évidente dans le revirement de 2010. Tellement évidente, d’ailleurs, que l’arrêt du 4 novembre 2010 n’avait pas à le préciser. Et tellement évidente, encore, que le législateur a pris le soin ensuite de le graver dans le marbre de la loi. Pour la cour d’appel, le tour était joué : puisque la réserve relative aux dommages matériels devait être considérée comme contenue dans le revirement de 2010, cette réserve était, elle aussi, applicable rétroactivement aux faits survenus le 28 août 2009. C’est précisément cette tentative, aussi séduisante qu’inefficace, que censure la Cour de cassation dans l’arrêt sous examen. En reproduisant la solution de principe de 2010, et en jugeant que, faisant application de la théorie de l’acceptation des risques au présent litige, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la Cour de cassation renseigne, s’il en était besoin, sur la manière dont doit être conçue l’articulation entre l’arrêt du 4 novembre 2010 et la loi du 12 mars 2012 : la seconde apporte une exception au premier, et non une confirmation de celui-ci. Par suite, les dommages matériels survenus avant l’entrée en vigueur de la loi le 14 mars 2012 peuvent être indemnisés sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, sans que la victime ne puisse se voir opposée son acceptation des risques.
Claude-Albéric MAETZ
Les sportifs et leurs employeurs peuvent-il engager leur responsabilité à l’égard des parieurs déçus ?
CA Riom, 19 avril 2017, n° 15/03002. Les circonstances qui ont donné lieu à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 19 avril 2017 sont loin d’être exceptionnelles. Et elles pourraient nourrir un contentieux abondant pour peu que les juridictions ne tarissent à la source les velléités belliqueuses des parieurs déçus. La question pourrait être ainsi résumée : un parieur peut-il engager la responsabilité du joueur (et/ou de son club employeur) qui a inscrit un but qui n’aurait pas dû être validé par l’arbitre – en l’occurrence du fait d’une position de hors-jeu – dès lors que ce but lui a fait manquer un gain ? On est bien loin de la tricherie caractérisée voire du sportif corrompu. Et on imagine les conséquences d’une réponse positive. En l’espèce, l’appelant avait validé une grille du jeu « loto foot » sur laquelle il avait correctement pronostiqué 13 des 14 résultats. Seul lui faisait défaut le pronostic de la rencontre Lille/Auxerre, Lille l’ayant finalement emporté 1-0 à la suite d’un but inscrit en position de hors-jeu à la fin du match. Et le parieur d’évaluer son préjudice à la somme de 375 000 € laquelle correspond à son manque à gagner. Confirmant la décision des premiers juges, la cour d’appel de Riom rejette la demande du parieur. Si nous souscrivons au résultat auquel aboutissent les juges, le chemin qui y mène mérite peut-être quant à lui quelques remarques. En effet, pour écarter la responsabilité personnelle du joueur, et celle du club pris en sa qualité de commettant, la cour relève que « seule la violation grave, délibérée ou caractérisée des règles du jeu constitue une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ou de l’association qui est son employeur et l’infraction aux lois du sport ne réside pas dans la transgression de simples règles techniques organisant le déroulement du jeu, telles que celles régissant le hors-jeu dans un sport collectif comme le football mais de celles destinées, en particulier, à préserver la sécurité et l’intégrité corporelle des pratiquants ou encore la parfaite loyauté de l’affrontement sportif ». À ces seuls motifs, le lecteur pourrait aisément croire qu’un dommage a été causé à un autre participant. En effet, entre autres explications, l’exigence d’une faute qualifiée se justifie par la nécessité de prendre en considération le risque qu’impose par nature, pour les autres pratiquants, l’exercice du sport. Mais des autres pratiquants il n’est ici point question ! La formule de la cour, clairement inspirée de la jurisprudence de la Cour de cassation dédiée à l’hypothèse d’un dommage causé à un autre sportif37, semble alors inappropriée. Ou à tout le moins incomplète sauf à considérer que la référence timide à « la parfaite loyauté de l’affrontement sportif » purge cette carence. On est également dubitatif quant à la mise en œuvre de cette formule au cas d’espèce. À raison certes, la cour relève que « la rapidité qui caractérise les actions menées au football de même que le rôle conféré à tout joueur qui, recevant le ballon et se trouvant en position offensive, se doit de réagir immédiatement dans le cadre de l’action de jeu, mettent un obstacle à ce qu’une telle action puisse recevoir la qualification d’une faute civile génératrice de responsabilité ». La suite pose néanmoins question : « dès lors, le score de la rencontre, fut-il l’enjeu d’un pari sportif, la simple transgression de la règle sportive, survenue dans le cours du jeu et non contre le jeu ne saurait, à elle seule, constituer une faute civile de nature à fonder l’action en responsabilité engagée par un parieur mécontent ». Et c’est la reprise de cette distinction entre la faute dans le jeu et la faute contre le jeu38 qui, en pratique, pourrait poser des difficultés. À quelle qualification auraient été éligibles, par exemple, les célèbres mains de Diego Maradona ou de Thierry Henry ? Et les comportements analogues à venir ? Et comment appréhender l’excès d’engagement d’un joueur qui, auteur d’un tacle sévère, prive l’adversaire très tôt dans la rencontre de son meilleur joueur de sorte qu’il impacte potentiellement le résultat final ? Si ce comportement constitue une faute caractérisée par la violation des règles du jeu susceptible d’engager sa responsabilité personnelle – et le cas échéant celle de son employeur – à l’égard de la victime, cette même faute engage-t-elle la responsabilité du sportif à l’égard des parieurs ? On imagine les conséquences d’une telle automaticité en termes de multiplication des recours et, par suite, de recours à l’assurance. Surtout, conscients que cette qualification ouvrirait la boîte de Pandore au profit des parieurs déçus, les juges pourraient devenir plus exigeants encore au moment de constater l’existence d’une faute qualifiée. Et ce sont alors les sportifs victimes qui en pâtiraient. Plusieurs voies pourraient être explorées pour remédier à ces difficultés. La première revient à rehausser encore le seuil de la faute dès lors que le demandeur est un parieur, ce dernier acceptant d’une certaine manière le risque que le résultat soit impacté par des fautes commises contre le jeu. Pour autant, il est difficile de concevoir que le caractère fautif d’un même comportement dépende de la personne qui s’en plaint. La théorie de la relativité aquilienne chère au droit allemand et dont le droit français n’est malheureusement pas familier, pourrait pourtant être ici utilement convoquée. Reposant sur le principe selon lequel « l’action invoquant la responsabilité pour faute n’est admise que dans la mesure où le dommage invoqué est bien de la nature de celui qu’entendait prévenir la loi qui donne son caractère illicite au comportement du défendeur »39, elle permettrait de cantonner le débat faute dans le jeu/contre le jeu aux dommages subis par les sportifs. Les recours des parieurs seraient alors limités aux hypothèses de matchs truqués, les règles qui sanctionnent les sportifs – et les autres acteurs – ayant précisément, entre autres vocations, d’assurer la police des paris sportifs. À défaut, et c’est certainement la voie la plus raisonnable, le salut devrait tenir dans une appréciation très stricte du lien de causalité entre le comportement litigieux et le préjudice, les juges considérant que le préjudice subi par le parieur, fut-il habilement libellé en termes de perte de chance, est trop incertain et indirect pour justifier une réparation.
Claude-Albéric MAETZ
D – Les assurances
Comment le droit de commun de la responsabilité vient compléter les lacunes du droit spécial des assurances sportives.
CA Paris, 2-2, 5 janv. 2017, n° 15/11586, Grégory V. c/ Allianz IARD et SA AC Arles-Avignon. La codification à « droit constant »40 de l’article 38 de la loi n° 84-6110 du 16 juillet 1984 dans le nouvel article L. 321-4 du Code du sport a supprimé la notion de « groupements sportifs » pour lui substituer les notions d’associations et de fédérations sportives41. L’obligation légale d’information sur l’utilité d’une police individuelle accident est désormais exprimée de la manière suivante : « Les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer ».
La question se posait donc de savoir si la substitution devait conduire à écarter du champ d’application de la nouvelle disposition les sociétés sportives que l’on pouvait aisément comprendre dans l’ancienne expression « groupements sportifs ». Une affaire récemment portée devant la cour d’appel de Paris aurait pu donner l’occasion de fournir une première réponse jurisprudentielle.
En effet, un footballeur professionnel, blessé lors d’un match amical organisé par une société commerciale gestionnaire d’un club professionnel, avait agi en réparation contre cette dernière et son assureur en invoquant notamment la violation de l’article L. 321-4 du Code du sport. Le TGI de Paris avait écarté l’application de cet article aux motifs justement que le club organisateur du match au cours duquel l’accident avait eu lieu « n’était pas tenu en sa qualité de société commerciale à l’obligation d’information imposée par l’article L. 321-4 ». Mais la cour d’appel ne consacra pas cette analyse en relevant que le joueur était à l’essai lors du match litigieux et que de ce fait il n’avait pas la qualité d’adhérent du club et n’y était pas licencié. Pour la cour, la question de l’applicabilité de l’article L.321-4 au club qui exerçait son activité sous la forme d’une société commerciale devenait « dès lors sans objet ».
La question de l’applicabilité du Code du sport réglée, il n’en restait pas moins selon la cour à s’interroger sur celle de l’application du droit commun et notamment de l’article 1383 du Code civil42. En l’occurrence, « en dehors même de toute obligation légale d’information, [le club] a [selon la cour] commis une faute sur le fondement de l’article 1383 du Code civil en n’attirant pas l’attention [du joueur] sur le fait qu’en sa qualité de joueur invité pendant une semaine pour faire un essai en vue d’un engagement, il ne bénéficiait pas de facto et par son intermédiaire d’un contrat d’assurance le garantissant en cas d’atteinte corporelle subie pendant son activité sportive au sein du club. Cette négligence qui n’est pas contestée par [le club] revêt d’autant plus d’importance qu’en l’espèce, [le joueur] qui était à la fin de son engagement auprès d’un club grec, pouvait ne plus être assuré a fortiori lors d’une activité sportive exercée en France sans lien avec son activité au sein du club grec. La qualité de joueur professionnel ne donne pas [au joueur] des compétences particulières en matière de couverture juridique et n’ôte pas au club son obligation d’information à telle enseigne que le législateur prenant en considération la nécessaire protection des sportifs de haut niveau et professionnels et la sécurisation de leur situation juridique et sociale a prévu au moyen de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 201543 qui a créé un article L. 321-4-1 du Code du sport d’imposer aux fédérations sportives délégataires de souscrire des contrats d’assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive de haut niveau peut les exposer et dit que la souscription des contrats d’assurance de personnes dispense les fédérations sportives délégataires, à l’égard de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau précitée, de leur obligation d’information prévue à l’article L. 321-4 ». On ne saurait mieux dire que celui qui profite d’une activité doit assumer quelques responsabilités à l’égard de tous ceux qui l’aident dans son entreprise et dont il profite à un degré ou un autre des compétences.
Jean-Michel MARMAYOU
IV – Le financement du sport
A – Le financement public (…)
B – Le financement privé
1 – Droits de propriété intellectuelle
2 – Paris sportifs en ligne
3 – Droits audiovisuels (…)
4 – Contrats de sponsoring (…)
5 – Contrats de transfert
6 – Contrats de billetterie (…)
7 – Exploitation de l’image des sportifs (…)
8 – Publicité
9 – Tabacs et alcools
(À suivre)
Notes de bas de pages
-
1.
TGI Paris, 29 sept. 2016, n° 06/25771.
-
2.
CA Paris, 25 oct. 2017, n° 16/25771 : Dict. Perm. Droit du sport 2018, p. 8, obs. Breillat J.-C.
-
3.
CA Rennes, 25 juin 2002, n° 00/04909 : Rev. jur. éco. sport 2002, n° 65, p. 48.
-
4.
CE, 24 févr. 2011, n° 340122 : Cah. dr. sport 2011, p. 79, note Lapouble J-C ; JCP G 2011, 564, note Collomb P. ; D. 2012, p. 704, obs. Dudognon C. Adde Brignon B., « Se localiser ou se doper : il faut choisir », Cah. dr. sport 2011, n° 26, p. 26 – CE, 29 mai 2013, n° 364839 : Cah. dr. sport 2013, n° 32, p. 191, note Colin F. – Cass. 1re civ., 16 oct. 2013, n° 13-15146, QPC : Bull. civ. I, n° 201 – CE, 9 juill. 2014, n° 373304 : Cah. dr. sport 2014, n° 37, note Colin F. ; Comm. com. élect. 2014, chron. 10, n° 2, obs. Brignon B.
-
5.
D. 2018, p. 171, obs. Vialla T. et Vialla F. ; Dict. Perm. Droit du sport 2018, n° 253 ; Lettre d’actualité droitdusport.com, n° 52.
-
6.
C. sport, art. L. 232-15.
-
7.
Nous ne développerons pas ce point, la Cour considérant que l’obligation de localisation ne porte pas atteinte à la liberté de circulation des sportifs, l’obligation de localisation ne pouvant pas spécialement s’assimiler à un placement sous surveillance électronique.
-
8.
La loi a encore été durcie, v. not. C. sport, art. L. 232-13-1 et s.
-
9.
Le sportif devait déterminer une période d’une heure durant laquelle il serait localisé en ce lieu pour permettre les contrôles éventuels.
-
10.
V. C. sport, art. L. 232-13-1, réd. O. 14 avr. 2010, art. 6.
-
11.
§ 157, la Cour considère également que la réglementation porte atteinte au respect du domicile des sportifs (§ 158).
-
12.
V. égal. § 169.
-
13.
Au sens matériel, v. § 160 et s.
-
14.
§ 166.
-
15.
§ 183
-
16.
V. préc. obs. Poracchia D. Adde JCP G 2018, 225, note Sudre F. ; Dictionnaire Permanent Droit du sport 2018, n° 253, p. 1, obs. Pettiti C.
-
17.
CE, 6 nov. 2017, n° 413349 : Dalloz actualité, 10 nov. 2017, obs. Pastor J.-M. Le Conseil d’État n’avait cependant pas renvoyé la QPC pour les articles L. 232-23-3-3 et L. 232-23-3-10 du Code du sport.
-
18.
V. considérant n° 3.
-
19.
V. considérant n° 9.
-
20.
Cons. const., 2 févr. 2018, n° 2017-688 QPC : AJDA 2018, p. 251 ; D. 2018, p. 297.
-
21.
Dictionnaire Permanent Droit du sport 2018, n° 253, p. 8, obs. Rémy D.
-
22.
Cons. const., 2 déc. 2011, n° 2011-200 QPC : AJDA 2012, 578, chron. Lombard M., Nicinski S. et Glaser E. ; D. 2012, p. 1908, obs. Martin D. R. et Synvet H. ; Constitutions 2012, 337, obs. Le Bot O – Cons. const., 12 oct. 2012, n° 2012-280 QPC : AJDA 2012, 1928 ; D. 2013, p. 1584, obs. Jacquinot N. et Mangiavillano A. ; RFDA 2013, 141, chron. Roblot-Troizier A. et Tusseau G. ; Constitutions 2013, 95, obs. Le Bot O., cité in Dalloz actualité, 8 févr. 2018, note Pastor J.-M. – Contra CE, 11 mars 2011, n° 341658 : Lebon, p. 81 ; D. 2012, p. 704, obs. Centre de droit et d’économie du sport – CE, 9 nov. 2011, n° 341658 : Lebon, p. 547 ; D. 2012, p. 704, obs. Centre de droit et d’économie du sport.
-
23.
Cons. const., 7 déc. 2012, n° 2012-286 : JCP E 2012, act. 773 ; JCP E 2013, 1048, note Fricero N. ; JCP E 2013, 1216, n° 1, obs. Pétel P. ; D. 2012, Actu., p. 2886, obs. Lienhard A. ; D. 2013, p. 338, note Vallens J.-L. ; Rev. sociétés 2013, p. 177, obs. Henry L.-C. ; RTD civ. 2013, p. 889, obs. Théry P. ; Dict. perm. diff. entrep. 2012, n° 343, obs. Roussel Galle P. ; Dr. & patr. sept. 2013, 50, obs. Monsèrié-Bon M.-H.
-
24.
V. considérant n° 11.
-
25.
V. considérant n° 12.
-
26.
V. considérant n° 13.
-
27.
Obs. Rémy D., préc.
-
28.
CE, 11 avr. 2018, n° 413349 : Dalloz actualité, 20 avr. 2018, obs. Pastor J.-M. ; Elnet, veille perm. dr. du sport, 11 mai 2018, obs. Rémy D.
-
29.
V. néanmoins, dans une autre affaire : CE, 26 avr. 2018, n° 416181 ; Elnet, veille perm. dr. du sport, 14 mai 2018, obs. Rémy D.
-
30.
Dictionnaire Permanent Droit du sport 2017, n° 247, p. 5, obs. Pettiti C.
-
31.
Sur laquelle v. nos obs. in Chronique de droit du sport 2e partie, LPA 11 août 2017, spéc. III B § n° 4.
-
32.
CE, 31 mars 2017, n° 406664 : Dictionnaire Permanent Droit du sport 2017, n° 244, p. 1, obs. Rémy D.
-
33.
C’est la première fois que l’article 12 de la DDHC est invoqué à l’occasion d’une QPC. Le Conseil constitutionnel a donc pu préciser qu’il s’agissait d’un des droits et libertés que la constitution garantit (art. 61-1) et donc invocable dans une QPC.
-
34.
Sur sa légalité, v. CE, 21 sept. 2015, n° 389815 : Cah. dr. sport 2016, n° 42, p. 187, note Colin F. ; Comm. com. électr. 2015, chron. 10, § 1 ; LPA 7 juill. 2016, n° 115w9, p. 7, obs. Marmayou J.-M.
-
35.
Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, n° 09-65947 : Bull. civ. II, n° 176 ; D. 2011, p. 690, note Mouly J. ; JCP G 2011, 435, obs. Bloch C. ; LPA 12 avr. 2011, p. 4, obs. Brignon B.
-
36.
Cass. 1re civ., 21 mars 2000, n° 98-11982 : Bull. civ. I, n° 97 ; D. 2000, p. 593, note Atias C. ; RTD civ. 2000, p. 666, obs. Molfessis N. – Cass. 3e civ., 2 oct. 2002, n° 01-02073 : Bull. civ. III, n° 200, p. 170 ; D. 2003, p. 513, note Astias C. Plus largement sur le sujet, v. not. Lagarde X., « Jurisprudence et insécurité juridique », D. 2006, Chron., p. 678 ; Dross W., « La jurisprudence est-elle seulement rétroactive ? », D. 2006, p. 472 ; Les revirements de jurisprudence, 2005, Litec.
-
37.
V. not. Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18141 : LPA 24 sept. 2007, p. 4, note Mouly J.
-
38.
V. p. ex. Cass. 2e civ., 2 mai 1988, n° 86-16947 : Bull. civ. II, n° 106.
-
39.
Legeais R., Grands systèmes de droit contemporains. Approche comparative, 2e éd., 2008, Litec, p. 326.
-
40.
Ord. n° 2006-596, 23 mai 2006.
-
41.
C. sport, art. L. 321-4 : Instr. n° 06-099 JS, 31 mai 2006.
-
42.
Aujourd’hui C. civ., art. 1241.
-
43.
Réc. amendée par la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017.