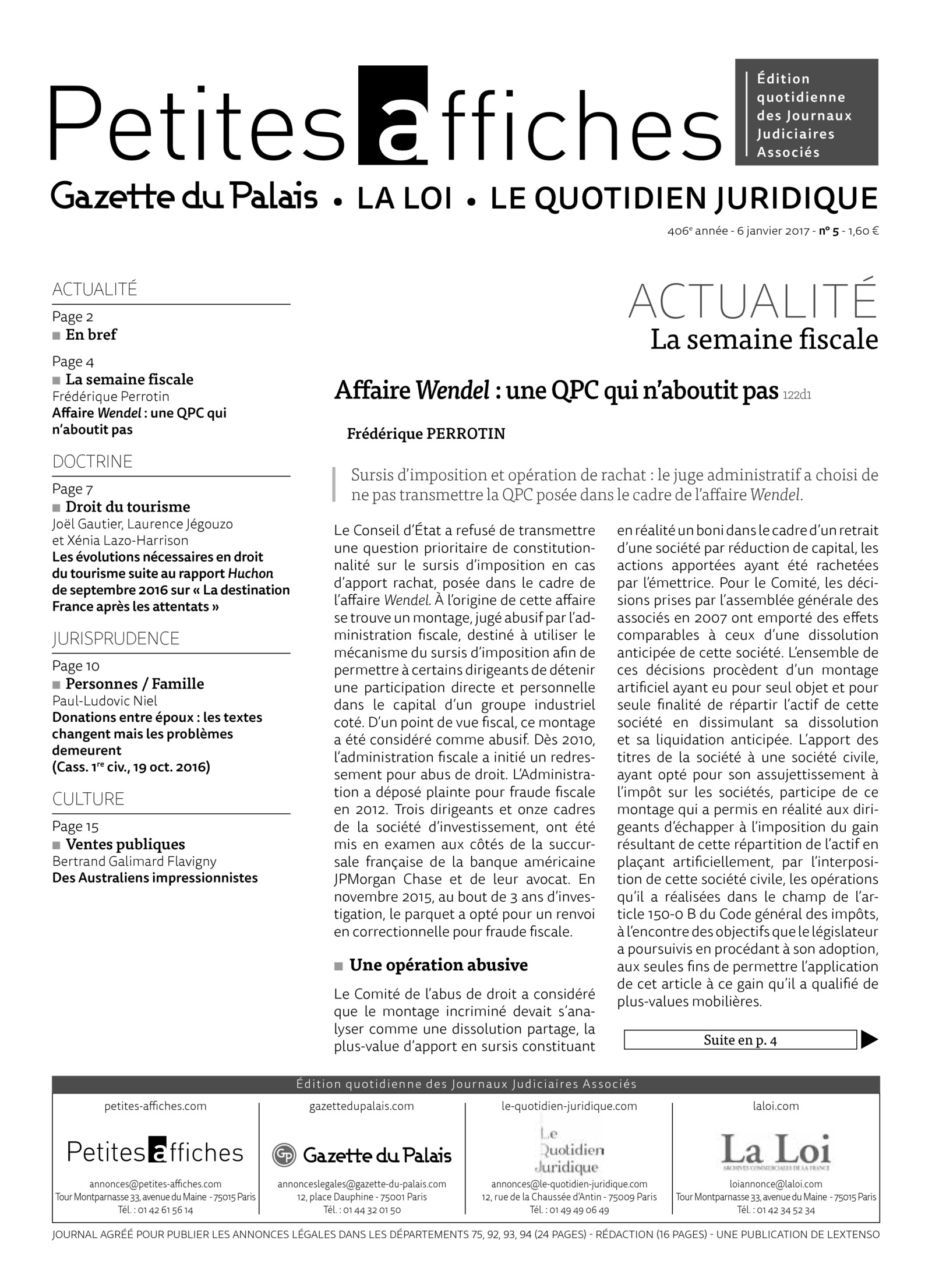Affaire Wendel : une QPC qui n’aboutit pas
Sursis d’imposition et opération de rachat : le juge administratif a choisi de ne pas transmettre la QPC posée dans le cadre de l’affaire Wendel.
Le Conseil d’État a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité sur le sursis d’imposition en cas d’apport rachat1, posée dans le cadre de l’affaire Wendel. À l’origine de cette affaire se trouve un montage, jugé abusif par l’administration fiscale, destiné à utiliser le mécanisme du sursis d’imposition afin de permettre à certains dirigeants de détenir une participation directe et personnelle dans le capital d’un groupe industriel coté. D’un point de vue fiscal, ce montage a été considéré comme abusif. Dès 2010, l’administration fiscale a initié un redressement pour abus de droit. L’Administration a déposé plainte pour fraude fiscale en 2012. Trois dirigeants et onze cadres de la société d’investissement, ont été mis en examen aux côtés de la succursale française de la banque américaine JPMorgan Chase et de leur avocat. En novembre 2015, au bout de 3 ans d’investigation, le parquet a opté pour un renvoi en correctionnelle pour fraude fiscale.
Une opération abusive
Le Comité de l’abus de droit a considéré que le montage incriminé devait s’analyser comme une dissolution partage, la plus-value d’apport en sursis constituant en réalité un boni dans le cadre d’un retrait d’une société par réduction de capital, les actions apportées ayant été rachetées par l’émettrice2. Pour le Comité, les décisions prises par l’assemblée générale des associés en 2007 ont emporté des effets comparables à ceux d’une dissolution anticipée de cette société. L’ensemble de ces décisions procèdent d’un montage artificiel ayant eu pour seul objet et pour seule finalité de répartir l’actif de cette société en dissimulant sa dissolution et sa liquidation anticipée. L’apport des titres de la société à une société civile, ayant opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, participe de ce montage qui a permis en réalité aux dirigeants d’échapper à l’imposition du gain résultant de cette répartition de l’actif en plaçant artificiellement, par l’interposition de cette société civile, les opérations qu’il a réalisées dans le champ de l’article 150-0 B du Code général des impôts, à l’encontre des objectifs que le législateur a poursuivis en procédant à son adoption, aux seules fins de permettre l’application de cet article à ce gain qu’il a qualifié de plus-values mobilières.
Le 5 janvier 20163, la première chambre du tribunal administratif de Paris a confirmé la position du Comité de l’abus de droit mais en opérant une ventilation entre les gains imposables, au motif qu’une partie de ces gains peuvent être assimilés à des plus-values, et a diminué le montant total du redressement. Les requérants qui se sont pourvus en appel contre les jugements qui ont laissé à leur charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l’année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes, ont soulevé à l’appui de leur appel une question prioritaire de constitutionnalité devant la cour administrative d’appel de Paris. La cour administrative d’appel de Paris a décidé de transmettre ces QPC au Conseil d’État4 lequel a décidé de les joindre pour statuer par une seule décision.
Une décision de non-renvoi
La QPC transmise est relative à l’article 150-0 B du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000. Conformément à l’article 150-0 B du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, « les dispositions de l’article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l’année de l’échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (…) ».
Lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’État a transmis à ce dernier la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. En l’espèce, le Conseil d’État a jugé qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée parce qu’il ne peut être sérieusement soutenu que les dispositions législatives en cause méconnaîtraient le principe d’égalité devant la loi fiscale et d’égalité devant les charges publiques (cf infra l’encadré « Plus de 80 % de décisions de non-renvoi »).
Une atteinte au principe d’égalité ?
Pour les requérants, ces dispositions sont contraires aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789, en tant qu’elles ne s’appliquent pas aux gains réalisés avant le 1er janvier 2014 par les actionnaires ou associés personnes physiques de sociétés non cotées à l’occasion du rachat de leurs titres par la société émettrice, gains dont l’imposition relève du régime des plus-values de cession en application de la décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014, dans l’hypothèse où un tel rachat est rémunéré par la remise, par la société émettrice, de titres d’une autre société.
Pour le Conseil d’État, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. D’autre part, en vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques garantie par l’article 13 de la Déclaration de 1789.
Il ressort des dispositions de l’article 150-0 B du Code général des impôts (CGI), éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 dont elles sont issues, que le législateur a, en les adoptant, entendu faciliter les opérations de restructuration d’entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l’octroi automatique d’un sursis d’imposition pour les plus-values résultant de certaines de ces opérations, notamment d’échanges de titres. Le législateur n’a, en revanche, pas entendu viser les opérations de rachat par une société, qu’elle soit cotée ou non cotée, de ses propres titres en vue d’une réduction de son capital non motivée par des pertes, quand bien même un tel rachat serait rémunéré non en numéraire mais par la remise de valeurs mobilières détenues par la société.
Si les requérants soutiennent que la différence de traitement fiscal ainsi opérée entre deux catégories d’opérations qui se traduisent toutes deux par un échange de titres susceptible de faire naître une plus-value mobilière méconnaîtrait le principe d’égalité devant la loi fiscale, il résulte de ce qui précède que les contribuables dont les titres sont rachetés par la société émettrice et qui, ce faisant, se désengagent de leur investissement, ne sont pas placés dans la même situation que ceux participant à l’une des opérations énumérées à l’article 150-0 B, lesquelles revêtent par nature un caractère intercalaire en ce qu’elles ont pour objet de poursuivre, sous une autre forme, l’investissement réalisé dans l’activité économique en cause. Il s’en déduit que la différence de traitement opérée, dans l’octroi du sursis d’imposition, par les dispositions contestées trouve sa justification dans une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi et ne méconnaît donc pas le principe d’égalité devant la loi fiscale.
Par ailleurs, ces dispositions ont seulement pour objet, en vue d’éviter que le paiement immédiat des impositions dues par les personnes physiques à raison des gains découlant de certaines opérations de restructuration d’entreprises fasse obstacle à la réalisation de ces opérations, de différer la liquidation et le paiement de ces impositions, sans en exonérer les redevables ni même en réduire le montant. Il en découle que la différence de traitement fiscal qu’elles opèrent par rapport aux opérations non incluses dans leur champ repose sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés par le législateur. En outre, la seule circonstance que les contribuables puissent être conduits, du fait du choix opéré par la société procédant au rachat de ses propres titres de rémunérer ce rachat par la remise d’autres titres, à acquitter un impôt sur la plus-value qu’ils réalisent à cette occasion sans que l’opération en cause leur procure par elle-même les liquidités nécessaires, ne suffit pas à faire regarder l’imposition correspondante comme établie en méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que les dispositions législatives en cause méconnaîtraient le principe d’égalité devant la loi fiscale et d’égalité devant les charges publiques. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, conclut que le Conseil d’État.