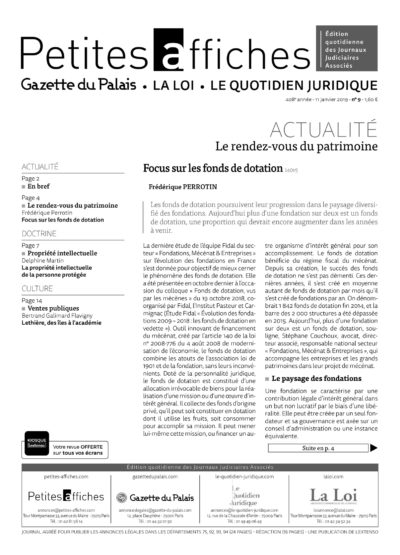Focus sur les fonds de dotation
Les fonds de dotation poursuivent leur progression dans le paysage diversifié des fondations. Aujourd’hui plus d’une fondation sur deux est un fonds de dotation, une proportion qui devrait encore augmenter dans les années à venir.
La dernière étude de l’équipe Fidal du secteur « Fondations, Mécénat & Entreprises » sur l’évolution des fondations en France s’est donnée pour objectif de mieux cerner le phénomène des fonds de dotation. Elle a été présentée en octobre dernier à l’occasion du colloque « Fonds de dotation, vus par les mécènes » du 19 octobre 2018, co-organisé par Fidal, l’Institut Pasteur et Carmignac (Étude Fidal « Évolution des fondations 2009 – 2018 : les fonds de dotation en vedette »). Outil innovant de financement du mécénat, créé par l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le fonds de dotation combine les atouts de l’association loi de 1901 et de la fondation, sans leurs inconvénients. Doté de la personnalité juridique, le fonds de dotation est constitué d’une allocation irrévocable de biens pour la réalisation d’une mission ou d’une œuvre d’intérêt général. Il collecte des fonds d’origine privé, qu’il peut soit constituer en dotation dont il utilise les fruits, soit consommer pour accomplir sa mission. Il peut mener lui-même cette mission, ou financer un autre organisme d’intérêt général pour son accomplissement. Le fonds de dotation bénéficie du régime fiscal du mécénat. Depuis sa création, le succès des fonds de dotation ne s’est pas démenti. Ces dernières années, il s’est créé en moyenne autant de fonds de dotation par mois qu’il s’est créé de fondations par an. On dénombrait 1 842 fonds de dotation fin 2014, et la barre des 2 000 structures a été dépassée en 2015. Aujourd’hui, plus d’une fondation sur deux est un fonds de dotation, souligne, Stéphane Couchoux, avocat, directeur associé, responsable national secteur « Fondations, Mécénat & Entreprises », qui accompagne les entreprises et les grands patrimoines dans leur projet de mécénat.
Le paysage des fondations
Une fondation se caractérise par une contribution légale d’intérêt général dans un but non lucratif par le biais d’une libéralité. Elle peut être créée par un seul fondateur et sa gouvernance est axée sur un conseil d’administration ou une instance équivalente. Le législateur, en 1990, a limité l’appellation à trois formes d’organisations : la fondation reconnue d’utilité publique, la fondation d’entreprise et la fondation abritée par un organisme habilité. Le fonds de dotation, qui n’a pas l’appellation de fondation, est venu compléter cette palette de dispositifs généralistes en 2008. Entre 2006 et 2009, le législateur, pour favoriser le développement des fondations au service de la recherche et de l’enseignement supérieur, a créé quatre dispositifs spécialisés, directement inspirés des statuts préexistants : la fondation de coopération scientifique, la fondation universitaire, la fondation partenariale et la fondation hospitalière. Ces huit outils juridiques (en incluant les fonds de dotation) sont classés traditionnellement en deux catégories. Il s’agit d’une part des fondations dites « généralistes » qui peuvent, selon leur forme et l’origine de leur fondateur, intervenir dans un ou plusieurs domaines d’intérêt général et d’autre part des fondations dites « spécialisées » qui peuvent être créées seulement par certains établissements publics pour soutenir la recherche et l’enseignement supérieur. La première catégorie regroupe les fonds de dotation, les fondations reconnues d’utilité publique, les fondations sous égide et les fondations d’entreprise. La deuxième catégorie regroupe les fondations de coopération scientifique, les fondations universitaires, les fondations partenariales et les fondations hospitalières.
Les fondations, dont les ressources sont privées pour les deux tiers, œuvrent dans tous les domaines de l’intérêt général, et notamment en faveur de l’action sociale. La redistribution réalisée par les fondations sous forme d’aides, de subventions, de bourses ou de prix représente plus d’1,5 milliard d’euros. Les principaux domaines d’intérêt général sont l’art, le patrimoine, l’environnement, la culture, la solidarité, le sport, l’éducation et la recherche. Depuis 2009, l’action sociale s’impose comme un domaine d’intervention privilégiée, mobilisant 29 % des fondations et représentant 34,5 % des aides et subventions distribuées. 38 % des fondations interviennent à l’échelle territoriale, de la région au quartier, traduisant une volonté citoyenne d’agir au plus près des besoins exprimés par la société.
Le modèle de flux privilégié
Il existe trois modèles financiers pour une fondation : les fonds et fondations de flux, les fonds ou fondations à dotation consomptible et les fonds ou fondations à dotation pérenne. Les premiers dépensent l’intégralité des dons qui leur sont consentis, et doivent donc être régulièrement abondés pour réaliser leur mission sociale. Les fondations d’entreprises relèvent de ce régime, ainsi que les fondations partenariales. Les fondations abritées, les fondations universitaires et les fonds de dotation peuvent également choisir ce modèle. Dans le cas du modèle à dotation consomptible, la dotation initiale qui peut être éventuellement abondée par la suite produit des revenus permettant de financer la cause d’intérêt général choisie. Au-delà, les fondateurs peuvent décider de dépenser une partie de cette dotation, selon un rythme prévu dans leurs statuts. Les fondations abritées, les fonds de dotation et beaucoup plus rarement les fondations reconnues d’utilité publique et les fondations de coopération scientifique peuvent opter pour ce dispositif.
Quant aux fonds ou fondations à dotation pérenne, la dotation constituée à l’origine est intangible. Seuls les revenus qu’elle génère seront dépensés pour la cause d’intérêt général choisie par la fondation. Cette forme est essentiellement l’apanage des fondations reconnues d’utilité publique et des fondations de coopération scientifique, mais les fondations abritées et les fonds de dotation peuvent également opter pour ce modèle. Le principe de pérennité, à l’origine consubstantiel du concept de fondation, tend à laisser la place au modèle de flux, par lequel les fondateurs privilégient le pragmatisme de l’impact à court ou moyen terme plutôt qu’un idéal d’éternité pour leur fondation : actuellement, seules deux fondations sur trois sont créées avec une dotation initiale, parmi lesquelles moins de la moitié ont une vocation pérenne. Actuellement, les fondations tendent à privilégier de plus en plus un modèle de flux plutôt que la capitalisation à visée pérenne.
Le modèle distributif s’impose
Deux modes opératoires peuvent être choisis, voire même coexister. Les fondations distributives ou bailleurs ou de financement se consacrent au financement de projets qui leur sont extérieurs par la distribution de subventions à des associations des institutions ou groupes, et de bourses ou de prix à des personnes physiques (chercheurs, étudiants…). Les fondations opératrices mettent en œuvre elles-mêmes en direct des activités via des équipes salariées (gestion d’un musée, d’une maison de retraite, d’un hôpital, etc.). Si les fondations opératrices restent prégnantes en volume financier et en puissance d’intervention, notamment dans les domaines social, sanitaire et de la recherche médicale, on observe ces quatre dernières années une importante progression du nombre des fondations distributives, et de leur poids économique. Réalisant un milliard d’euros d’aides, subventions, prix et bourses par an, ces fondations, constituées à 80 % de ressources privées (particuliers et/ou entreprises), marquent le développement d’une culture de la philanthropie privée au bénéfice de l’intérêt général en France. Aujourd’hui, 84 % des nouvelles fondations qui se créent optent pour ce modèle distributif. Elles traduisent une volonté citoyenne de participer directement, par-delà l’impôt et sans attendre la retraite (87 % des fondateurs particuliers sont en activité), à la résolution des problèmes qu’affronte la société.
Évolution des fondations en France
La croissance du secteur des fonds et fondations, très nette depuis 2001, se poursuit à un rythme rapide depuis le début des années 2010 : 45 % des fondations françaises ont été créées depuis 2001. En s’appuyant sur les données du Centre français des fonds et fondations et de l’Observatoire de la Fondation de la France, l’équipe du secteur « Fondations, Mécénat & Entreprises » de Fidal a réalisé un bilan objectif et critique de l’évolution des fondations en France entre 2011 et 2016 « (Bilan 2011- 2016 sur l’évolution des fondations en France »). Le nombre de fondations a très fortement augmenté au cours de ces cinq années : 2 733 fondations en 2011 à 4 546 fondations en 2016 soit une progression de 66 %.
En revanche, la situation s’avère très contrastée entre les 8 formes de fondations qui ne connaissent pas toute la même progression et le même succès sur cette période. Parmi les fondations dites « généralistes » (susceptibles d’intervenir dans l’un ou plusieurs domaines d’intérêt général : culture, social, environnement, sport, éducation,…), on note le succès incontestable du fonds de dotation dont le nombre a presque triplé en 5 ans et qui séduit de plus en plus les entreprises. En revanche, on observe une stagnation voire un repli des autres formes de fondations « généralistes » : fondation d’entreprise, fondation reconnues d’utilité publique, fondation sous égide. Autre observation : l’échec des fondations dites « spécialisées » : fondations universitaires, partenariales, de coopération scientifiques ou hospitalières lesquelles ont connu peu de création depuis 2011. « Dans ce paysage diversifié, les fonds de dotation se démarquent nettement », souligne Stéphane Couchoux. Depuis sa création en 2009, cet outil mécénal connaît un vif succès. Les fonds de dotation ont connu un grand succès depuis leur création en août 2008, puisqu’il continue à se créer, chaque mois, autant de fonds de dotation que de fondations en un an, soit entre 20 et 30. Les secteurs d’intervention sont très diversifiés : domaine culturel, artistique, secteur social ou domaine de l’environnement. En 2015, la publication du décret n° 2015-49 du 22 janvier 2015 relatif aux fonds de dotation qui fixait à 15 000 euros le montant minimum de la dotation initiale, pour lutter contre la création des fonds « coquilles vides », avait réduit le nombre de créations de fonds dotation. L’année 2016 a été marquée par une nette reprise des créations (306 contre 253 l’année précédente). Le rythme des créations a légèrement progressé en 2017 avec 313 créations. Début 2018, le niveau des créations se stabilise avec 216 créations pour les trois premiers trimestres. Il s’agit de la seule forme de fondation à poursuivre une nette progression, si bien qu’aujourd’hui plus d’une fondation sur deux est un fonds de dotation. Selon les projections du cabinet Fidal, cette proportion aura tendance à croître dans les années à venir. Si cette progression se poursuit et si les textes sur les fondations demeurent inchangés, les fonds de dotation représenteront les 3/4 des fondations d’ici cinq ans.
Les atouts du fonds de dotation
Comment expliquer un tel engouement pour le fonds de dotation ? « Le fonds de dotation est une véritable « pâte à modeler juridique », comme l’a voulu le législateur », résume Stéphane Couchoux. Toute personne physique ou morale peut créer rapidement cet outil et le modeler sur-mesure (adaptation de la gouvernance, nature des libéralités consenties, modalités d’utilisation de la dotation, typologie des ressources privées). Et quand bien même une dotation initiale de 15 000 € est obligatoire depuis 2015, le fonds de dotation est susceptible d’être créé par toute catégorie de fondateurs. On dénombre plusieurs catégories de fonds de dotation. Première catégorie, les fonds d’entreprise. Les entreprises privilégient largement cette forme de fondation au regard de la fondation d’entreprise stricto sensu. « Le fonds de dotation est à la fondation ce que la SAS est à la société commerciale », analyse Stéphane Couchoux. Deuxième catégorie, le fonds familial. Des familles, souvent grands donateurs, retiennent de plus en plus ce véhicule juridique pour s’engager autour d’un projet philanthropique fédérateur et/ou pérenniser un patrimoine familial (meubles ou immeubles), observe les avocats du cabinet Fidal. Troisième catégorie, le fonds actionnaire. Des dirigeants d’entreprise optent pour la transmission de titres à un fonds de dotation pour pérenniser leur entreprise (fondation-holding comme réponse à une problématique de transmission) et/ou pour conjuguer business et intérêt général. Quatrième catégorie, le fonds outil de financement des OSBL et des collectivités. Confrontés à des problématiques de financement, ces acteurs mettent en place un fonds de dotation pour organiser une stratégie de collecte de dons ou, dans certains cas, pour sanctuariser leur patrimoine (OSBL).