Le théâtre n’est plus « une activité politique dangereuse » !
Emmanuelle Saulnier-Cassia est une femme passionnée. Passionnée par le droit qu’elle enseigne à l’université Paris-Saclay ; mais également de théâtre dont elle chronique régulièrement les actualités dans sa rubrique : Du droit dans les arts, pour les Petites Affiches et Actu-Juridique. Elle travaille depuis longtemps sur les rapports entre le droit et les arts, notamment dans la perspective du courant de recherche droit et littérature. Pour preuve, elle est membre du conseil scientifique de la Revue Droit et littérature. Son travail l’a amené à réfléchir aux phénomènes de censure dans les domaines artistiques. C’est pourquoi, elle publie aux éditions Classiques Garnier, un essai sur le « Théâtre en procès ». À cette occasion, elle revient pour Actu-Juridique sur la genèse de cet ouvrage et les enseignements qu’elle en a tiré sur la place de la liberté d’expression dans notre société contemporaine. Entretien.
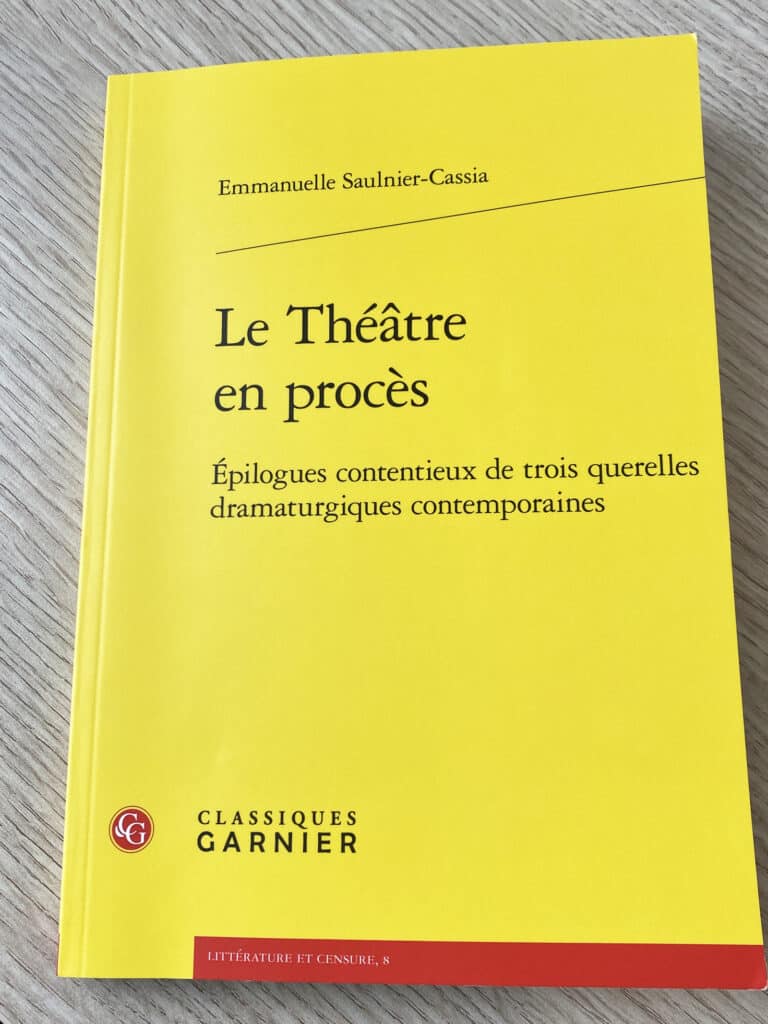
Actu-Juridique.fr
Actu-Juridique : Comment est née l’idée de cet ouvrage ?
Emmanuelle Saulnier-Cassia : L’idée de cet ouvrage a pour origine l’exploration, dans un séminaire de recherche en études théâtrales, des querelles dramaturgiques classiques, très nombreuses durant un siècle à partir de la première grande querelle du Cid en 1637, des raisons de leurs naissances, leurs évolutions et la manière selon laquelle elles finissaient par s’éteindre. La question de savoir si les controverses et les scandales dans le théâtre contemporain suscitaient des mécanismes semblables s’est rapidement imposée. Influencée par la médiatisation de certaines affaires dites de censure dans les domaines littéraire et artistique, je me suis interrogée sur le rôle du juge aujourd’hui dans le domaine théâtral et s’il pouvait être considéré comme un arbitre final dans les querelles dramaturgiques actuelles.
Actu-Juridique : Avez-vous été étonnée de constater que seules trois œuvres contemporaines ont fait l’objet d’un contentieux ?
ES-C : Ô combien ! J’imaginais que des dizaines de spectacles avaient suscité des saisines juridictionnelles, encore une fois influencée par les écrits sur la judiciarisation de la liberté d’expression et d’un retour à la moralité en matière artistique et aussi par ma connaissance en tant que juriste publiciste des contentieux en matière cinématographique. Le premier constat et la surprise préalable de cette recherche ont été de constater leur rareté dans le spectacle vivant, ce qui constitue déjà un premier apport, tout en ayant conscience qu’il ne fallait pas en faire l’arbre qui cache la forêt en raison de l’existence d’autres moyens de limiter la liberté d’expression et de création en matière de spectacle vivant. Les menaces de retrait de subventions et l’autocensure sont moins visibles (et impossibles à tracer de manière scientifique), mais peuvent être plus redoutables que la tenue d’un procès.
Il a donc fallu se concentrer sur les trois seuls spectacles (Sur le concept du visage du fils de Dieu de Romeo Castellucci, Golgota Picnic de Rodrigo Garcia et Exhibit B de Brett Bailey) concernés par des actions contentieuses, en écartant ceux qui ne relèvent pas de l’art dramaturgique (les spectacles de Dieudonné par exemple, sources de nombreux référés administratifs) ou qui mettent en jeu d’autres questions et régimes juridiques comme celui du droit moral. Les trois spectacles de mon corpus ont tout de même engendré 15 décisions au total !
Actu-Juridique : Vous soulignez dans votre ouvrage le flou qui entoure toujours la notion de blasphème qui a été invoquée à plusieurs reprises dans ces affaires. Pouvez-vous résumer quel est l’état du droit applicable à cet égard ?
ES-C : C’est en effet une question importante. Il faut dire d’emblée que le délit de blasphème n’existe plus en France depuis 1881, à la différence de nombreux pays encore aujourd’hui. Il n’est donc pas possible ou en tout cas inopérant de l’invoquer devant un juge français pour contester une atteinte au respect d’une religion. Le problème est que le terme en lui-même fait mouche et qu’il est utilisé à tort et à travers y compris par des avocats et des juges pour dire qu’il n’existe pas (ce qui entretient une forme de confusion par le fait même d’utiliser le terme) et notamment depuis l’affaire Charlie Hebdo des caricatures de Mahomet, les dessinateurs allant jusqu’à invoquer « un droit au blasphème ».
Néanmoins, le législateur a modifié la loi de 1881 en 1972 (loi contre le racisme dite Pleven) en créant les nouveaux délits d’injure, de diffamation et de provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance à une race, une ethnie, une nation ou une religion, qui permettent de contourner l’impossibilité d’utiliser la notion de blasphème pour contester une atteinte notamment à la religion et qui de fait fournit une base juridique fiable dans un cadre contentieux.
Curieusement les requérants n’ont invoqué ni le blasphème ni la provocation à la haine contre le spectacle de Romeo Castellucci, et ont utilisé le blasphème dans celui de Rodrigo Garcia.
Actu-Juridique : Justement, pouvez-vous nous indiquer quels étaient les reproches faits à ces pièces et les principes juridiques au cœur des moyens des requérants ?
ES-C : Les reproches faits à ces pièces étaient principalement de trois ordres.
La question de l’atteinte à la religion chrétienne concerne les pièces de Romeo Castellucci et de Rodrigo Garcia, qui ont beaucoup de points communs tant sur le plan esthétique (je renvoie à la première partie de mon livre qui comporte une analyse esthétique des trois œuvres) que sur les plans matériel et juridique. Les requérants reprochaient aux deux auteurs-metteurs en scène de porter atteinte au respect de la croyance par la présentation dégradante de l’image du Christ (dans Sur le concept du visage du fils de Dieu) allant jusqu’à parler de « christianophobie », et des paroles offensantes à son égard (dans Golgota Picnic). Les requérants ont également évoqué des moyens subsidiaires relatifs à la laïcité et l’utilisation des fonds publics, à la pornographie.
Ce sont des accusations de racisme et d’atteinte à la dignité de la personne qui ont été principalement évoquées pour Exhibit B de Brett Bailey.
Enfin, une atteinte au principe de dignité humaine a été soulevée s’agissant des trois spectacles.
Actu-Juridique : Qui étaient les requérants, quels étaient les recours et quelles juridictions furent saisies ?
ES-C : Pour les pièces de Romeo Castellucci et de Rodrigo Garcia, les requérants principaux sont des activistes catholiques déjà connus des prétoires, car auteurs de nombreux autres recours en matières cinématographiques, littéraire et artistique. Il s’agit de l’AGRIF (Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne), une association liée à des mouvements considérés comme d’extrême-droite (en particulier Civitas), et non représentative de la communauté chrétienne. Pour le spectacle de Brett Bailey, ce sont le Centre Dumas-Pouchkine des diasporas et cultures africaines et l’Alliance noire citoyenne qui ont été les principaux requérants.
Ils ont utilisé tant les procédures de référé que classiques au fond, aussi bien devant les juridictions de l’ordre judiciaire qu’administratif, et à tous les degrés.
Il faut préciser que pour le spectacle Sur le concept du visage du fils de Dieu il y a également eu une saisine du tribunal correctionnel par le Théâtre de la ville contre les contestataires ! En effet, les intrusions qui ont été opérées et les dégradations et interruptions d’une représentation qui ont suivi ont suscité une plainte pour délit d’entrave avec violence et voie de fait qui a été reconnue par les trois degrés de juridiction entre 2013 et 2017 condamnant la majorité des prévenus à des amendes et aux dépens. L’arroseur a été arrosé !
Actu-Juridique : Le théâtre contemporain semble plus à l’aise avec les notions de liberté d’expression que les autres arts, à quoi cela est dû selon vous ?
ES-C : Je ne sais pas si le théâtre contemporain est plus à l’aise que d’autres arts avec la liberté d’expression ou si c’est le juge qui est plus à l’aise avec la protection de cette liberté s’agissant du théâtre par rapport aux autres arts. En tout cas, cette impression résulte peut-être de différences essentielles entre les arts tous concernés par la défense de la liberté d’expression. La première tient à la relative confidentialité du théâtre. D’abord, si on le compare au cinéma, le nombre de jours de représentations d’une œuvre est très réduit et partant le nombre de spectateurs (à l’exception du Festival d’Avignon). Cette cible restreinte rend la couverture médiatique moins porteuse que pour le cinéma. La réduction des pages consacrées à la culture à la radio et dans la presse impacte de fait davantage le spectacle vivant que le cinéma, suscitant moins de débats dans le grand public, moins d’attention à l’usage que les auteurs et metteurs en scène font de leur liberté d’expression. Ensuite, l’accès aux salles de théâtre, pour des raisons principalement sociologiques (qui résultent évidemment de questions d’éducation, de moyens financiers et autres), n’est pas une évidence pour tous les spectateurs potentiels. Jack Lang constatait déjà il y a 55 ans dans sa thèse de doctorat (L’État et le théâtre), qu’au regard du faible nombre de spectateurs au théâtre par rapport à la télévision et au cinéma que le théâtre n’est plus « une activité politique dangereuse » !
Ce constat se traduit sur le plan juridique, puisqu’en effet la moindre dangerosité supposée du théâtre à l’époque contemporaine s’est traduite par un assouplissement de son encadrement. En effet, depuis l’ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, il n’existe plus de régime d’autorisation des spectacles avant qu’ils ne se produisent. À la différence du cinéma, pour lequel existe toujours une police administrative spéciale, les contestations contentieuses ne peuvent se faire qu’a posteriori d’une représentation, après l’échec d’une demande préalable d’interdiction pour raison de trouble à l’ordre public auprès des autorités administratives compétentes (maires ou préfets).
Enfin, il est difficile de faire une comparaison avec le contentieux littéraire, qui est majoritairement composée de recours pour atteinte grave à la vie privée dans le contexte actuel de développement du genre dit de l’autofiction, qui n’existe quasiment pas au théâtre.
Actu-Juridique : Que révèlent ces jugements sur notre société contemporaine ?
ES-C : D’abord, on doit convenir qu’il s’agit numériquement d’un contentieux anecdotique au regard du peu de décisions rendues. Mais qu’il est symboliquement important pour relativiser les conclusions systématiques de judiciarisation de la société et de danger d’une censure généralisée pour les arts. Ces jugements révèlent que face à des attaques aveugles, la liberté d’expression peut être protégée efficacement par les autorités publiques et in fine par le juge permettant de donner un véritable épilogue à ces contestations, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
Mais encore faut-il que le juge soit saisi, que les menaces n’entraînent pas de transactions qui se fassent au détriment des artistes et qui empêchent un règlement juridictionnel en faveur de la liberté d’expression.
Se pose également la question de la légitimité du juge à intervenir (sans formation) en matière artistique. Il arrive qu’il ne se cantonne pas au droit stricto sensu et qu’il se laisse aller à des analyses (pseudo) esthétiques. Le juge doit bien rester dans son office et se contenter, par exemple, pour le juge administratif de préserver l’ordre public ou pas, en utilisant le principe de proportionnalité et en continuant à faire référence à la liberté d’expression comme un « fondement essentiel d’une société démocratique » (formule reprise de la Cour européenne des droits de l’Homme). Finalement, je préfère quand un juge conclut avec humour pour défendre le principe de liberté d’expression que « le mauvais goût n’est pas interdit » ! (TGI de Paris en 2011) plutôt que lorsqu’il essaye d’interpréter la pensée ou l’intentionnalité d’un artiste.
Ces actions révèlent aussi quelque chose de plus préoccupant et maintes fois dénoncé, qui est la facilité pour des individus de rassembler autour d’eux, sans forcément être représentatifs des intérêts qu’ils prétendent défendre, en un temps très court, des contestataires (pour partie) d’opérette pour faire un jeu de mots facile dans ce contexte du spectacle vivant. En effet, jadis par des tracts, aujourd’hui par des pétitions en ligne circulant via les réseaux sociaux, des groupes de contestataires se forment sans pour autant qu’ils aient vu eux-mêmes l’objet de leur contestation. Pour les trois spectacles étudiés, la très grande majorité des pétitionnaires et des manifestants n’avaient pas vu les pièces qu’ils prétendaient contester, certains en ont même revendiqué le droit et la légitimité telle Marcela Iacub (cette autrice, qui elle-même a fait l’objet de poursuites dans son activité littéraire a écrit dans Libération du 12 décembre 2014 : « Même si je n’ai pas vu Exhibit B, je suis persuadée que la grogne, la colère, les pétitions que cette pièce a suscitées sont certainement plus intéressantes que l’œuvre elle-même » ?). En résumé, pourquoi se faire une idée soi-même de ce que l’auteur-metteur en scène a voulu dire, si on peut se contenter de quelques photos et extraits vidéos en ligne et de critiques et conférences de presse ? Bien sûr ce phénomène n’est pas nouveau, la sculptrice Germaine Richier (dont on peut voir actuellement une belle rétrospective au centre Pompidou, jusqu’au 12 juin 2023) se plaignait dans la presse en 1951 après que son Christ ait été retiré de l’Église d’Assy suite aux réclamations de catholiques ultra, que « les plus acharnés des détracteurs (…) sont ceux qui ne l’ont pas vu » ! Au temps des querelles dramaturgiques classiques, c’était le public qui était largement juge du devenir d’une pièce, après que le cas échéant les doctes et le pouvoir politique en alliance avec les autorités religieuses aient décidé d’autoriser la pièce. Si des associations ou des communautés prennent aujourd’hui le relais, ce devrait être à condition d’une véritable représentativité de ceux qu’elles sont censées défendre. Peut-être qu’une réflexion sur la question de la recevabilité des recours devrait être envisagée.
Référence : AJU008v2






