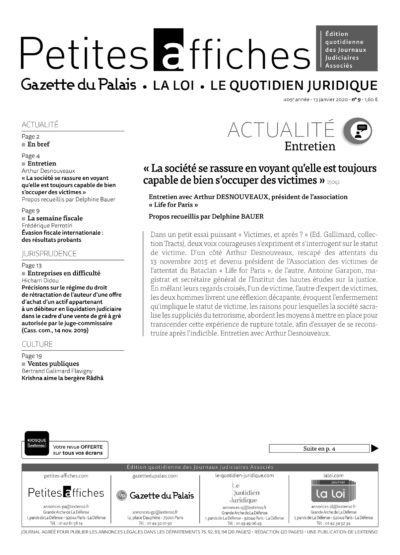« La société se rassure en voyant qu’elle est toujours capable de bien s’occuper des victimes »
Dans un petit essai puissant « Victimes, et après ? » (Ed. Gallimard, collection Tracts), deux voix courageuses s’expriment et s’interrogent sur le statut de victime. D’un côté Arthur Desnouveaux, rescapé des attentats du 13 novembre 2015 et devenu président de l’Association des victimes de l’attentat du Bataclan « Life for Paris », de l’autre, Antoine Garapon, magistrat et secrétaire général de l’Institut des hautes études sur la justice. En mêlant leurs regards croisés, l’un de victime, l’autre d’expert de victimes, les deux hommes livrent une réflexion décapante, évoquent l’enfermement qu’implique le statut de victime, les raisons pour lesquelles la société sacralise les suppliciés du terrorisme, abordent les moyens à mettre en place pour transcender cette expérience de rupture totale, afin d’essayer de se reconstruire après l’indicible. Entretien avec Arthur Desnouveaux.
Les Petites Affiches : Comment l’idée du livre est-elle née ?

Arthur Desnouveaux : Un peu par hasard. En étant président de « Life for Paris », je me suis retrouvé à parler devant une commission mémorielle mise en place par l’État, notamment par le ministère de la Justice. Un parterre de sages recevait individuellement un certain nombre de présidents d’associations et de victimes historiques comme Françoise Rudetzki, afin de comprendre ce que l’on attendait de l’État en termes de mémoire, autour de questions comme la nécessité de créer une journée de reconnaissance de victimes du terrorisme, s’il était intéressant d’ouvrir un musée pour les victimes du terrorisme… En somme, sur comment l’État pouvait faire sa part dans l’entretien de la mémoire. J’y suis allé, et j’ai répondu à toutes ces questions avec franchise. Pour ma part, j’estimais qu’il était très important d’avoir une journée nationale de reconnaissance des victimes du terrorisme ainsi qu’un musée, si toutefois ce musée était surtout dédié à faire de la recherche pour aider à comprendre un peu mieux ce qui arrivait aux victimes. Mon idée globale est que plus l’État prend à sa charge le sujet de la mémoire, moins les victimes ont à le faire, et plus cela va leur permettre de se détacher de leur statut de victime. Il y avait une grosse question sur la date : personnellement je me suis battu pour que ça ne soit pas le 13 novembre, en partant du principe que de toute façon, nous, les victimes du Bataclan, nous serions toujours reconnues puisque nous faisons désormais partie de la mémoire collective française. Nous ne voulions pas écraser les victimes d’attentats plus « petits ». Antoine Garapon faisait partie des sages. À la sortie, nous avons échangé, et il m’a dit que mes positions rejoignaient assez bien les siennes, lui qui avait rencontré un large panel de victimes, pas seulement de terrorisme. À l’occasion de son émission sur France Culture – il réalisait une série sur les victimes – il m’a demandé si je serais intéressé à l’idée d’y participer. Après cet épisode, il pensait qu’on pouvait creuser encore davantage et qu’il y avait sûrement matière à écrire un article sur le sujet. Il m’a envoyé une sorte de résumé de tout ce qu’on s’était dit par écrit, ce qui est devenu notre base de travail. Après des rajouts, des modifications, et plusieurs aller-retours, nous avons obtenu 65 pages, pas du tout le format article ! Par conséquent, nous l’avons envoyé à des éditeurs, en souhaitant une diffusion pas chère et au maximum. Gallimard a répondu présent, car ils relançaient une collection née dans les années 70. Nous étions très contents car c’est exactement le genre de format que nous envisagions. De mon point de vue, c’est l’accident heureux, mais Antoine Garapon avait peut-être en tête l’idée d’une publication plus longue qu’un article.
LPA : La société n’a-t-elle finalement pas « besoin » de la victime pour faire sens, pour retrouver des valeurs de solidarité et d’humanisme, de cohésion ?
A. D. : Vraiment, je partage cette analyse. La victime, pour la société, c’est quelqu’un à qui l’on doit du respect, de la bienveillance. Par elle, on retrouve des valeurs de partage et d’entraide qui ont été un peu perdues dans le reste de la société. Je n’irais pas jusqu’à dire que la société se réjouit, mais en tout cas elle se rassure de voir qu’elle est toujours capable de retrouver des valeurs humanistes en s’occupant bien des victimes. Et en ce sens-là, les victimes, et notamment les victimes de terrorisme, sont celles, qui par un jeu d’identification très simple, sont celles dont tout le monde se sent proche. Elles se retrouvent très entourées et au centre d’une communauté d’attentions très forte, dont on sent confusément que c’est ce qui est en train de s’effriter dans la société. Ainsi, la victime de terrorisme est rassurante, parce qu’on vérifie qu’on sait toujours bien s’occuper des autres, en prenant particulièrement bien soin d’elles. Et c’est nécessaire parce que le terrorisme est quelque chose qui brise les vies, et comme le dit Levinas, interrompt la continuité. Le problème, c’est aussi que dans un cadre où c’est très rassurant pour la société, la société n’a pas très envie de « lâcher » ce qu’elle fait pour les victimes. Cela peut devenir un enfermement pour les victimes. La victime, ou la manière dont on la prend en charge, symbolise la réaction à la dureté de la société actuelle. Métaphoriquement, il y a un filet de sécurité qui existe pour les gens pour qui tout va mal ; et on a choisi les victimes pour montrer que ce filet existait encore. C’est pour cela qu’il existe tant d’aides, d’associations, d’opportunités pour l’État de montrer qu’il peut s’occuper des victimes de terrorisme. Quand l’État s’engage, cela répond vraiment à une demande de la société. Je n’entends pas de voix dire « On en fait trop pour les victimes du terrorisme ». Il y a un consensus autour du fait qu’il faut les choyer.
LPA : Mais être autant choyé est un sentiment à double tranchant : à la fois nécessaire pour les victimes, cela les renvoie aussi à un statut de vulnérabilité parfois réducteur… En tout cas, c’est ce que vous exprimez.
A. D. : La pitié peut devenir un mode de vie. C’est très dur quand on est jeune, valide et sain d’aller boire un verre en terrasse ou d’aller à un concert et de se retrouver le lendemain créancier de pitié d’à peu près tout le monde, de devoir un tas d’aides au fait d’étaler sa douleur publiquement. C’est très difficile à vivre, sachant que le mécanisme d’indemnisation, notamment par le fonds de garantie, pousse un peu à ne pas aller mieux trop vite, car vous serez d’autant mieux indemnisé que vous n’irez pas bien. Il y a quelque chose d’un peu illogique. Quand on suscite la pitié, on est considéré comme une petite chose fragile. Et ça, c’est quelque chose dont il faut apprendre à se débarrasser mais ce n’est ni simple ni rapide. Ce qui est aussi dur, c’est d’accepter qu’on mérite de la pitié, puis de tout faire pour se remettre sur pied pour ne plus l’avoir à l’accepter.
LPA : Le processus judiciaire constitue une étape très importante pour se reconstruire, mais vous soulignez ses limites. Quelles sont-elles ?
A. D. : La place de la victime dans les procès au pénal est une question centrale. Actuellement, nous en sommes à la phase de clôture de l’instruction, et comme on nous l’a dit, notamment en matière de terrorisme, la victime n’est pas moteur de l’action publique. Quand les faits se sont produits le 13 novembre, le parquet s’en est saisi en flagrance, sans besoin que la moindre victime porte plainte. Ensuite, et nous en sommes contents, l’instruction s’est extrêmement bien déroulée. Mais finalement le rôle des victimes a été minime, dans le sens où même si des avocats ont fait des demandes d’expertise, le travail mené par la justice roulait tout seul. Nous n’avons pas pour autant été oubliés, dans le sens où il s’est tenu régulièrement des réunions de parties civiles pour nous tenir au courant des avancées, mais dans ces réunions, j’ai vu des parents endeuillés poser des questions très précises sur la mort de leur enfant, et se voir répondre par l’institution judiciaire : « Moi, vous savez, je n’enquête pas vraiment là-dessus, j’essaie de découvrir qui sont les commanditaires, les auteurs, les filières de financements et d’approvisionnement d’armes », donc des réponses très techniques et très judiciaires. Elles se comprennent complètement, on ne peut pas en vouloir aux juges d’instructions, qui sont dans leur rôle, mais elles manquent un peu d’humanité. Ainsi, il existe tout un pan de la prise en charge de la victime qui n’est pas simple. On peut se dire que ce « reste à explications » peut être dévolu aux avocats de la partie civile, mais ça reste quand même une charge très lourde. Dès lors, la question qui s’ouvre est la suivante : qu’est-ce qu’on fait dans un tel procès pour que les victimes se sentent entendues et écoutées, et éviter qu’on ne soit pas uniquement dans un procès de la technicité, mais qui prends en compte ce que les gens ont vraiment perdu ? Ces questions se posent dans tous les procès de terrorisme, mais celui du 13 novembre est en plus un procès de masse, avec plusieurs milliers de parties civiles, complètement hors norme. À ce jour, la façon dont chacune de victimes va pouvoir se sentir intéressée au procès individuellement n’est pas tranchée. J’ai l’impression que la justice est prête à faire un effort conséquent pour entendre un maximum de victimes, qu’elles puissent témoigner, que la géographie de la salle d’audience hors norme leur permettre de le faire dans des conditions un petit peu intimes, mais ça reste une question complètement en suspens. Le défi consiste à sortir d’un procès qui va se concentrer uniquement sur les faits, les auteurs et la condamnation des auteurs, pour qu’il devienne un moment, qui, dans une certaine mesure, peut-être une catharsis pour les victimes et leurs familles. Ce sera à la justice et aux associations de victimes de trouver un modus operandi où l’on respecte à la fois les règles de la justice mais où l’on laisse davantage les victimes parler. Ce qui est particulièrement difficile dans notre cas, c’est que c’est un acte de terrorisme qui a tellement ému la France, que la société civile se considère comme partie civile. N’importe quel Français se sent avoir été attaqué le 13 novembre. Alors, comment trouver un moyen pour que tout le monde se dise « On a vécu un moment de justice ensemble » ? C’est le gros défi qui nous attend. Je suis assez confiant dans le fait que ça va bien se passer, en revanche, cela va être épuisant.
LPA : Dans quel état d’esprit vous trouvez-vous ?
A. D. : Nous nous préparons à un épuisement énorme. Le procès va durer environ six mois, et il va alterner entre des moments d’émotions très fortes et une froideur judiciaire très dure à vivre. Autant il y aura des baisses d’intensité pour le grand public, autant, pour nous, victimes, toutes les descriptions des médecins légistes, ne nous passeront pas au-dessus de la tête. Avec Antoine Garapon, on réfléchit d’ailleurs au sens du procès, et comment il faut qu’il soit vécu et organisé pour que ça se passe bien.
LPA : Votre essai est truffé de références philosophiques. Cette dimension éthique était-elle essentielle pour définir l’essence de la victime ?
A. D. : L’un de nos souhaits était de ne pas uniquement parler des victimes de terrorisme. Si je devais retenir une seule fierté, c’est celle d’avoir été contacté par des victimes d’abus sexuels dans l’église, qui ont lu le livre et qui avaient des questions sur un certain nombre de points précis, sachant qu’elles sont dans des phases où elles manquent de la reconnaissance de leur statut de victime par l’État et la justice, notamment à cause des lois de prescriptions. Elles ont trouvé dans ce livre des choses qui les transcendaient. L’autre idée était de rapprocher cela d’une éthique, de faire passer un message aux victimes. Ce qu’on vit est tristement humain. C’est très dur mais cela fait partie de l’humanité depuis toujours, il y a des gens qui pensent depuis longtemps au sens de la victime. Ce n’est pas la modernité qui a engendré cela, c’est la condition humaine, entre autres, qui fait apparaître la notion de victime, avec tout ce qu’elle a de destructeur. C’est presque rassurant, car cela fait des millénaires que les victimes existent mais l’humanité est toujours là. C’était important de replacer notre réflexion dans un temps long, et de montrer qu’il y avait des penseurs qui esquissaient des kits pour s’en sortir. La grande difficulté que je vois là-dedans, c’est la grande différenciation entre expérience et expertise. Dans le livre, nous citons Simone Veil, figure par excellence de la victime qui a transcendé son expérience, notamment en faisant des choses incroyables lors de sa carrière, mais ce qui manque c’est peut-être un moment où les victimes deviennent penseuses de leur propre condition.
LPA : Vous dites aussi à quel point être une victime vous donne la parole sur la scène médiatique, pour des sujets que vous maîtrisez autant que sur des sujets connexes. C’est un sentiment étrange, non ?
A. D. : M’interroger sur le risque jihadiste en France ou la tenue du procès Merah, même si ça me touche, n’a pas vraiment de sens car je ne suis pas spécialiste de ces questions. Alors que cela en a davantage de m’interroger sur qu’est-ce que c’est être victime, comment cesser d’être victime… Ce qu’a réussi ce livre, c’est que j’ai été beaucoup interviewé sur des questions de fond. C’est un livre qui ouvre des portes, à d’autres, experts et victimes, de s’en emparer et de les refermer. Je crois par ailleurs qu’une bonne manière de sortir de la condition de victime, c’est de l’interroger soi-même. Ce qui est très difficile à faire et que je n’aurais peut-être pas réussi à faire sans Antoine Garapon comme « sparring-partner ». Il est crucial de se dire : « J’ai vécu quelque chose, et maintenant je peux le penser ».
LPA : C’est une façon de sortir de l’émotionnel pur, également !
A. D. : Oui, sans doute n’aurais-je pas été capable de l’écrire juste après l’attentat. Il faut que la poussière retombe, pour qu’on commence à analyser un peu plus. J’espère que dans les prochains mois ce livre poussera des gens qui ont été victimes d’attentat, même il y a plus longtemps, à s’en emparer et à se poser les mêmes questions.
LPA : Vous terminez par un hymne au bonheur encore possible. Pourquoi cet appel à la vie ?
A. D. : Ce que l’attentat m’a le plus rappelé, et c’est très partagé par les victimes, c’est à quel point la vie est fragile. Cela peut passer pour une banalité, mais finalement s’attacher aux moments présents et se dire : « Là en effet je vis quelque chose de difficile, telle ou telle chose me replonge dedans », mais savoir garder en tête qu’on ne pourra jamais s’extraire du présent, et que potentiellement l’avenir n’existe pas, cela aide. C’est un peu ce qui guide tous les gens de « Life for Paris », il faut se battre pour chacun des moments de bonheur qu’on peut grappiller au milieu des moments difficiles. Aujourd’hui, c’est peut-être bizarre, mais j’ai une vision court-termiste. J’ai pu faire ce livre, ça m’a fait plaisir, mais maintenant il est derrière moi, le présent c’est autre chose. Ce qui m’aide à tenir, c’est ce mantra : « Maintenant, c’est tout ce que j’ai ». En faisant cela, je crois qu’on se tient prêt à accepter beaucoup plus de moments difficiles, parce que finalement on ne se projette pas dans le fait qu’ils vont durer. Refuser de trop se projeter dans le bonheur futur, c’est aussi se forcer à ne pas être trop triste maintenant. La vraie difficulté que je vois, et c’est une situation que le livre laisse de côté volontairement, c’est le cas des gens qui ont perdu quelqu’un dans les attentats, les victimes indirectes, les parents endeuillés. Je ne suis pas sûr que pour eux cette éthique du bonheur puisse s’appliquer. C’est là que le livre ouvre des portes, mais pas toutes. C’est pourquoi je pense qu’il faut que des parents de victimes prennent la plume et écrivent ce qu’ils ressentent parce que là, c’est trop différent de mon vécu pour que je puisse m’avancer sur ce terrain, et je ne suis pas sûr que quand on a perdu son fils ou sa fille le 13 novembre, on puisse se dire que le bonheur va revenir… Mais quoi qu’il en soit, j’ai l’impression qu’en se concentrant sur le maintenant, en aidant les autres, pour ma part en étant par exemple président d’association, il y a une éthique de l’altruisme, qui fait aussi le bonheur maintenant.
LPA : Quel sera l’avenir de l’Association « Life for Paris » ? Et, puisque vous n’êtes pas qu’une victime, comment donnez-vous du sens à votre vie ?
A. D. : « Life for Paris » se divise en deux parties : l’association loi 1901, et le regroupement de personnes. Ce que je pense, c’est que la communauté des victimes perdurera, mais on n’a pas vocation à rester une association qui donne son avis sur les attentats pendant vingt ans. Une fois que la béquille sera moins nécessaire à nos adhérents, il sera temps de nous dissoudre. Là on fait tout un travail qui finalement nous survivra, et on s’implique avec l’État pour améliorer la condition des victimes. Ce n’est pas à nous que cela va bénéficier, mais malheureusement aux futures victimes de terrorisme. Ce n’est pas pour autant que l’on doit rester des interlocuteurs à vie, parce que c’est aussi une forme d’enfermement. Quand le temps des procès sera fini, qui devrait coïncider avec le temps des indemnisations, je pense que le groupe continuera, sur l’aspect social, l’organisation de sorties ou d’apéritifs, mais que le groupe interlocuteur de l’État disparaîtra. Pour ma part, je me dis que si j’ai une expertise assez particulière, je resterai en deuxième rideau, à toujours pouvoir être appelé par l’État, le cas échéant. Mais ce que j’ai découvert par la présidence de « Life for Paris », c’est que je me projette dans une vie professionnelle et personnelle. Je viens d’avoir un enfant – la vie c’est aussi prolonger la vie avec des générations suivantes – j’ai une vie professionnelle exigeante, une vie de famille, et encore, je peux trouver le temps pour essayer de faire quelque chose d’associatif afin d’aider les autres. L’associatif n’est pas réservé aux retraités ou aux gens qui ont des carrières pas très prenantes. L’altruisme est un état d’esprit. J’ai trouvé un nouveau plan sur lequel me réaliser.