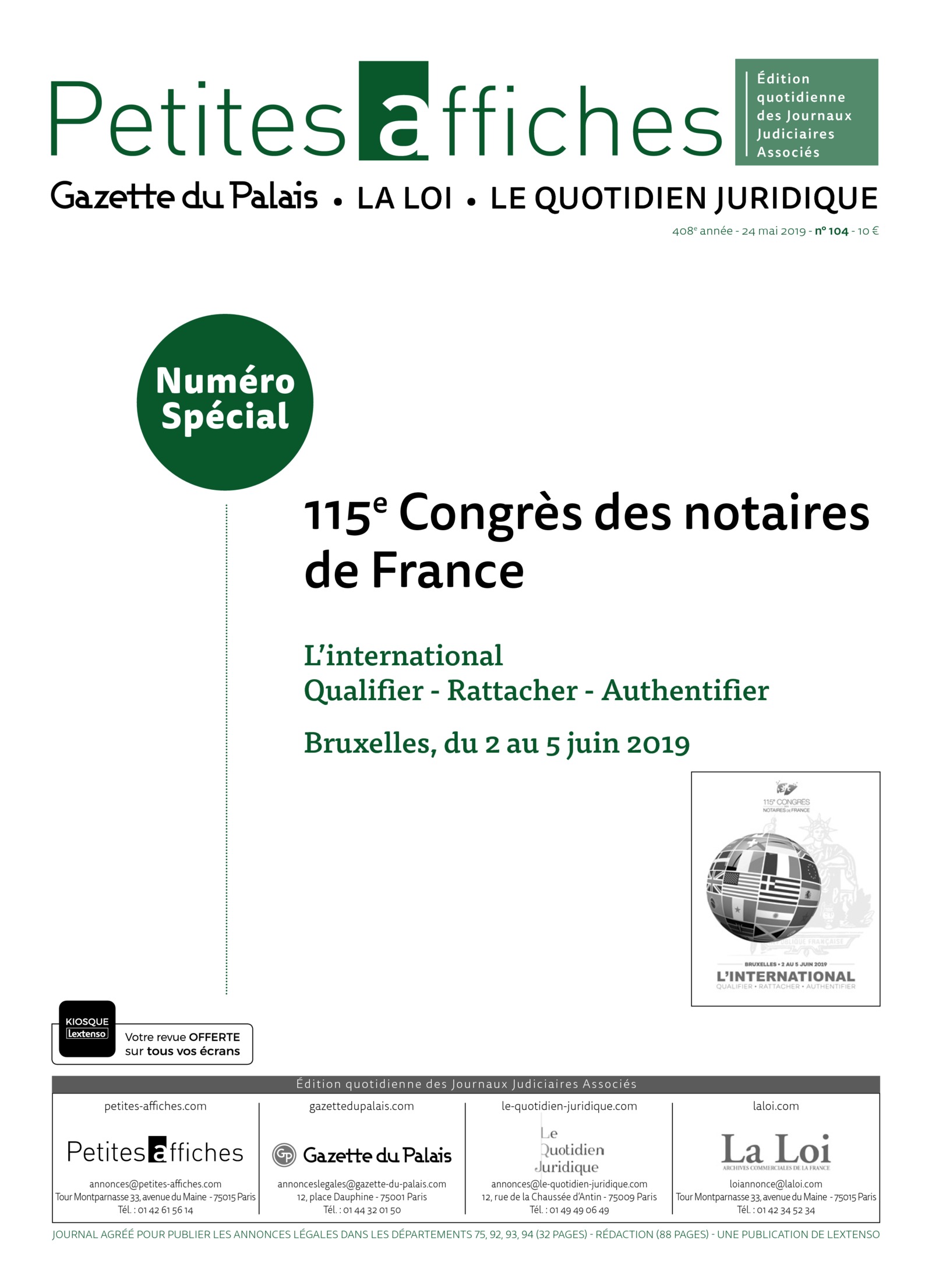« Accéder à un droit étranger peut s’avérer impossible pour des raisons techniques »
Pour la deuxième commission, il s’agissait d’offrir aux notaires les bons réflexes à développer lors de la rédaction d’un acte qui présente des éléments d’extranéité. La 2e commission a basé son travail avant tout sur la méthodologie, toutefois elle aborde également les problématiques fiscales propres à mettre le rôle de conseil du notaire à l’épreuve lorsque les clients sont expatriés ou non-résidents.
Les Petites Affiches
À quelles questions votre commission a-t-elle voulu répondre ?
Jean-Christophe Rega
L’objectif principal de cette deuxième commission était d’apporter des clés aux confrères confrontés à la rédaction d’un acte avec un élément d’extranéité contenu dans les dossiers ouverts dans leurs offices. Et donc de traiter et résoudre la difficulté de façon purement pratique. Peut-être plus que les autres commissions, la deuxième commission est avant tout une commission métier, dans le sens où elle est construite sur la méthodologie de l’acte. Nous sommes partis du principe de l’acte, la base du métier de notaire, en réfléchissant à l’introduction d’un élément d’extranéité à chaque paragraphe. Cela peut être la date de l’acte par exemple, l’an 2019 : nous avons réfléchit sur la pertinence d’appliquer une méthode d’horodatage, lorsque l’acte signé par exemple à Paris à 19 heures le 31 décembre peut avoir des conséquences fiscales à Melbourne, à compter du 1er janvier où le système fiscal australien est modifié. En horodatant notre acte au 31 décembre à Paris, on vise donc aussi les effets à produire le 1er janvier à 7 heures du matin en Australie. Cela nous permet alors de bénéficier d’un contexte plus avantageux en Australie tout en respectant l’heure de réception de l’acte à Paris. Les réflexions que nous avons portées amènent inévitablement à faire de la prospective sur les nouvelles technologies, avec les actes électroniques par exemple. Il y a aussi tout un chapitre relatif à l’identité des personnes : quelle méthode vertueuse adopter pour procéder correctement à l’identification d’une personne, pour s’interroger sur les règles d’identification, de capacité, de comparution… Tout cela en gardant toujours le contexte international en tête de manière à ce que le notaire acquière des réflexes nouveaux que l’on ne connaît pas en système interne. Cela devient plus délicat lorsque plusieurs instruments se télescopent au moment de résoudre des difficultés pour un client.
LPA
Cette complexité supplémentaire dans la pratique ne peut-elle pas créer des inquiétudes auprès de certains notaires ?
J. C.
Elle est de toute manière vécue par tous au quotidien et c’est justement l’objectif de ce 115e congrès, d’apporter des solutions et de présenter des vade-mecum pour que les notaires soient en capacité de pratiquer dans la sérénité. À chaque fois que l’on essaye de mettre en avant les particularités liées au caractère international, nous apportons immédiatement des réponses et propositions concrètes. En vérité, je ne pense pas qu’il faille le concevoir tant comme une complexité que comme une prise de conscience sur la nécessité de se poser les bonnes questions. Notre commission participe à cette œuvre pédagogique en reprenant par exemple les règles sur l’état civil pour faire des propositions sur la rédaction d’un régime matrimonial correct dans un couple international.
LPA
Comment l’équipe de cette deuxième commission a-t-elle été formée ?
J. C.
Lorsque Marc Cagniart, président du Congrès, a entamé la formation de l’équipe, il avait des prérequis dans les profils des membres de l’équipe parce qu’il fallait une vraie appétence pour la matière internationale, mais aussi une pratique avancée. Parmi les 8 membres constituant ce congrès au travers des 4 commissions on retrouve chez tous cette particularité : nous travaillons au quotidien avec une fenêtre ouverte à l’international. Comme nous rencontrons plus de dossiers de ce type que la moyenne, nous avons pu apporter notre vision des problématiques qui y sont liées et partager des solutions pratiques aux difficultés que rencontre le notaire au quotidien.
LPA
Pouvez-vous nous donner un exemple concret de cas d’extranéité auquel vous avez récemment été confronté dans votre pratique ?
J. C.
Je peux citer l’un d’eux qui m’a permis de développer un raisonnement sur les problèmes liés à l’état de minorité, une succession où la défunte, de nationalité française, s’était mariée aux États-Unis où elle vivait avec un époux de nationalité russe. Elle laisse un enfant mineur de 16 ans avec un patrimoine situé en France. On retrouve ici un dossier classique sur le papier, mais qui présente deux blocs de difficultés : la minorité et la succession. L’approche de la succession est très différente selon qu’on est en droit continental ou anglo-saxon. Droit continental, le mort saisit le vif, ce qui signifie une levée d’options successorales et l’ayant droit identifié par la loi (à défaut de testament) doit signifier s’il accepte ou non d’hériter. Ce concept est inconnu outre-Atlantique, car la succession est transmise aux biens : une fois qu’il y a décès, la succession s’ouvre, un administrateur transmet les biens de la succession aux héritiers et a terminé sa mission. Outre ce choc conflictuel dans les modalités de règlement de la succession, une strate supplémentaire avec l’état de minorité de l’ayant droit vient se rajouter. Elle appelle pour nous l’application d’une autorisation habilitante puisque le parent, administrateur légal sous contrôle judiciaire, doit être expressément autorisé par le juge des tutelles pour autoriser la succession de l’enfant. Quels sont les droits qui s’appliquent ? L’américain, le français ? Ce dossier en cours de traitement à l’étude illustre bien les difficultés qui peuvent apparaître au détour d’un dossier a priori lambda, mais qui concerne des expatriés.
LPA
Est-on au contraire parfois confrontés à des situations de vides juridiques ?
J. C.
Je ne parlerais pas de vide juridique, car le droit, comme la nature d’ailleurs, a horreur du vide ! On aura en revanche toujours des lacunes végétatives ou une insuffisance de normes qui nous interpellera. Dans ce cas de figure, la doctrine et la jurisprudence prennent toute leur place, pour résoudre l’insuffisance normative. On retrouve rapidement, en l’absence de textes, une complémentarité de la doctrine et de la jurisprudence dans la construction du raisonnement. De telle sorte qu’un vide juridique me paraît difficile à imaginer. En revanche, accéder à un droit étranger peut s’avérer impossible pour des raisons techniques, comme lorsque le droit étranger vise par exemple, des institutions qui ne peuvent pas, même conceptuellement, avoir d’équivalence dans notre système juridique interne. Je pense par exemple à un cas ancien du début du siècle dernier où un couple russe israélite devait faire appel à un rabbin orthodoxe pour faire prononcer un divorce, alors que c’est une autorité religieuse qui n’existe pas en France et qui ne pourrait de toute façon pas se voir reconnaître la même valeur juridique du fait de la séparation de l’Église et de l’État. L’impossibilité d’accès peut aussi être due à des raisons géopolitiques, par exemple parce que le système juridique de ce droit est matériellement inaccessible, car le pays est en guerre et que l’activité du corps de l’État est dans une situation chaotique.
LPA
Les nombreuses conventions fiscales signées par la France peuvent-elles parfois créer des difficultés ?
J. C.
Avec l’acte, on retrouve effectivement la fiscalité qui y est attachée. Le notaire pour remplir son rôle d’officier public doit donner le conseil adapté pour rendre son acte efficace au client, c’est pourquoi, nous avons aussi porté la réflexion sur le traitement fiscal de l’acte. Là encore, nous nous sommes concentrés sur la fiscalité dans un environnement international, notamment dans le cas de clients expatriés. Le sujet est particulièrement important puisqu’il existe aujourd’hui 1 200 conventions fiscales dans le monde entre États contractants. Avec une complication supplémentaire depuis le 1er juillet 2018 : la mise en place par l’OCDE, institution chargée de l’organisation des conventions internationales à caractère fiscal, de l’instrument multilatéral. À la différence des conventions qui étaient par nature bilatérales, on a ici un nouveau concept de multilatéralité qui possède un caractère modulable à volonté, en fonction des desiderata des États. L’idée de cet instrument multilatéral est de pousser un peu plus la lutte contre la planification fiscale agressive qui cherche par exemple à tirer profit de non-exonérations doublées dans deux États : c’est le projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) mis en place par l’OCDE et le G20 dès fin 2016. Cet instrument multilatéral (IM) est aujourd’hui signé par plus de 100 États, dont la France. Au fur et à mesure que la France va progressivement aménager et consolider les nouvelles versions des conventions fiscales avec ces normes d’IM, des modifications et nouvelles règles seront apportées aux conventions fiscales bilatérales. Cette modularité est la véritable difficulté, puisque les États peuvent choisir ce qu’ils veulent intégrer ou pas dans leurs conventions. Pour les notaires il faut donc acquérir de nouveaux réflexes pour consulter les sites appropriés et avoir une vision à jour des conventions qui nous intéressent.