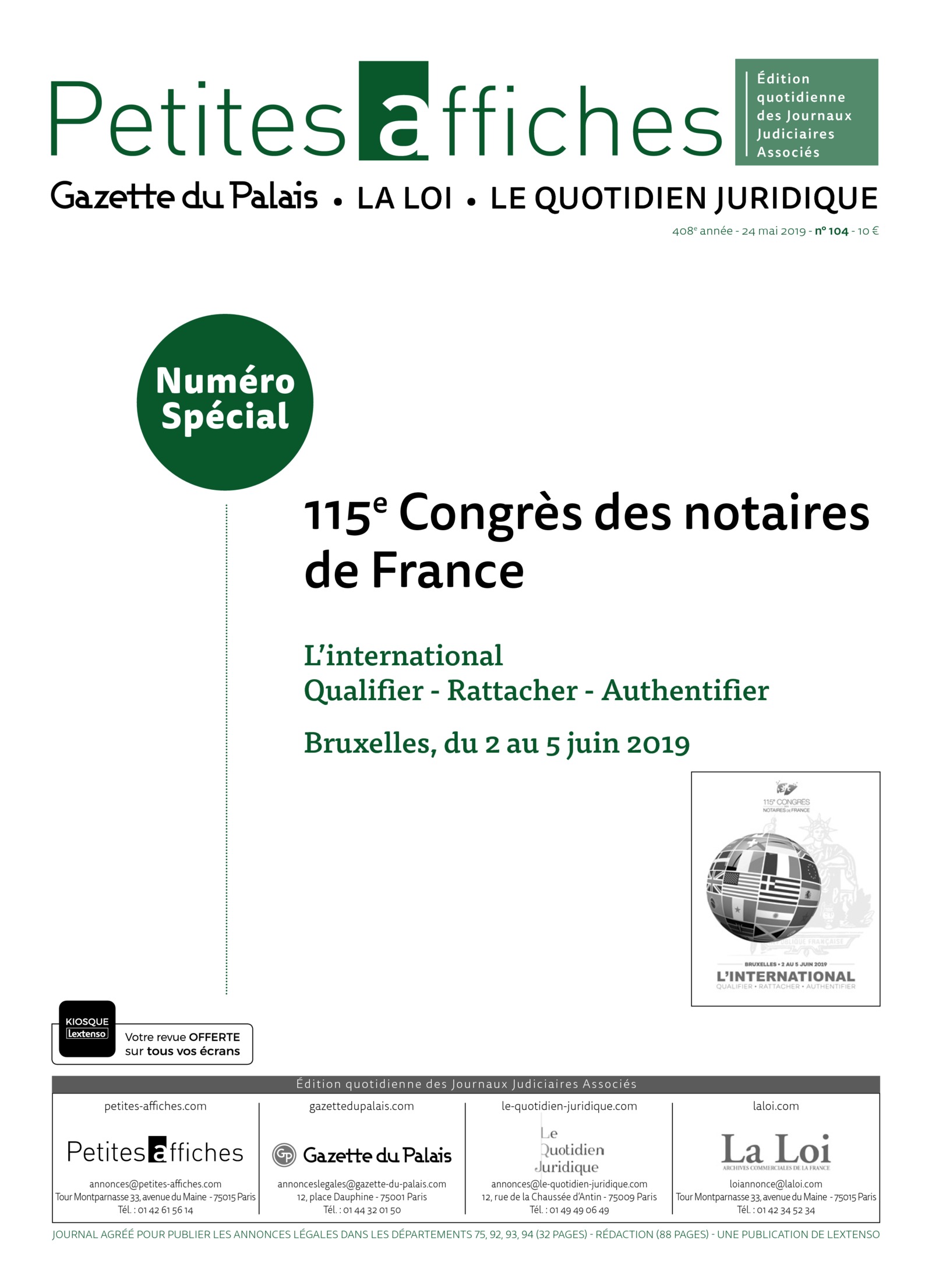« Le notaire doit parfois se demander si un document religieux qui a été produit constitue un contrat de mariage ou non »
Dans cette 3e commission, consacrée au droit de la famille, Me Valérie Marmey-Ravau, notaire à Lyon, s’est interrogée sur les conséquences pour l’unité familiale d’un monde globalisé. Les unions, séparations et transmissions vécues dans un contexte international exigent du notaire de prendre en compte de nouvelles règles applicables. Il s’agit également de savoir anticiper les pièges auxquels ses clients peuvent être confrontés en cas d’expatriation ou de succession à l’étranger.
Les Petites Affiches
Les liens qu’entretiennent les familles françaises avec l’étranger ont largement évolué au cours des dernières décennies. Comment cela affecte-t-il la pratique notariale ?
Valérie Marmey
Je peux commencer par citer un chiffre assez marquant : 27 % des mariages célébrés en France (ou à l’étranger, lorsque célébré au consulat) sont des mariages mixtes. Cela signifie donc qu’un mariage sur quatre consacre l’union de personnes de nationalité française et étrangère ! C’est un signe de l’évolution de la société, mais aussi de l’internationalisation des familles. Les difficultés qu’on observe en droit de la famille se retrouvent notamment en matière de transmission patrimoniale (donation et succession) lorsqu’un ou plusieurs enfants sont à l’étranger. Pour chaque transmission, il faut regarder quelle est la situation exacte en termes de droit civil et droit fiscal pour l’expliquer au mieux à l’héritier ou au donataire. L’élément d’extranéité rajoute donc une complication dans ces dossiers de successions et de donations.
LPA
Pourquoi la professio juris est-elle devenue un concept incontournable pour les notaires aujourd’hui ?
V. M. –R.
Le règlement Successions explique que dorénavant la loi applicable à la succession d’un individu est celle de sa résidence. Mais avec des personnes qui se déplacent beaucoup dans le monde et ont successivement différentes résidences, il devient vite très compliqué de faire de l’anticipation successorale. On ne sait pas où habitera la personne au moment du décès et donc quelle sera sa loi applicable. La professio juris devient très intéressante dans ce type de cas puisqu’elle permet d’appliquer la loi de la nationalité du futur défunt pour régir sa succession, le processus permet en quelque sorte de figer la loi applicable. Cette désignation ne sera appliquée que dans les pays qui la reconnaissent, de même les dispositions prises pourront être limités dans les pays qui connaissent la notion de réserve et qui l’applique au titre de leur ordre public international.
LPA
La religion peut-elle parfois rentrer en compte dans certains cas pratiques ? Avez-vous des cas atypiques qui se sont présentés ?
V. M. –R.
Oui, dans les mariages, par exemple, le notaire doit parfois se demander si un document religieux qui a été produit constitue un contrat de mariage ou non. C’est le cas de la religion juive où un document nommé la Ketouba est rédigé avant le mariage puis remis à la mariée lors de la cérémonie. Si l’on dit que ce document a valeur de contrat de mariage, cela aura des conséquences juridiques qu’il faut prendre en considération. Pour répondre à cette question, il faut examiner ce que contient la Ketouba : s’il y a des clauses qui régissent les relations pécuniaires entre les époux elle devient un contrat de mariage, mais si elle ne fait que rappeler les obligations des époux entre eux alors là elle n’a pas la valeur d’un contrat de mariage. On a également des particularités avec les pays de droits musulmans. Imaginons par exemple un Français de confession musulmane qui réside en France. Selon le règlement sur les successions, la loi française sera applicable, mais si cette personne possède des biens au Maroc, cet État appliquera la loi musulmane qui confère plus de droits au garçon qu’aux filles. Ce sont deux exemples où la religion peut créer des interférences au sein d’un dossier.
LPA
De quelle manière la gestion d’un divorce sans juge peut-elle parfois créer des difficultés ?
V. M.-R.
Notre divorce sans juge a beaucoup de mal à s’exporter en dehors de l’Union européenne, car de nombreux pays refusent de le reconnaître et considérant qu’il faut une autorité judiciaire pour prononcer un divorce. Dans les premiers temps qui ont suivi l’entrée en vigueur de la loi, nous ne nous sommes peut-être pas assez interrogés sur la compatibilité avec les autres pays de ces dispositions. On a parfois eu des difficultés importantes pour faire transcrire ces divorces sur leurs actes de naissance.
LPA
Quel élément de droit international privé a pu vous surprendre au cours de vos travaux préparatoires ?
V. M. – R.
Puisque nous évoquions les divorces, il y a un règlement européen en la matière qui désigne la loi applicable : cette loi est donc identique, quel que soit le tribunal choisi. Mais dans les faits, on peut s’apercevoir que ce tribunal appliquera la loi de façon différente en fonction de ses propres expériences et considérations. Si c’est la loi française qui est applicable lors d’un divorce, elle ne sera donc pas appliquée de la même manière dans un tribunal belge, français ou britannique. La prestation compensatoire ne sera par exemple pas regardée de la même façon par les juges belges et les juges français.
LPA
Le début de l’année a aussi vu l’entrée en vigueur d’un règlement largement soutenu par les notaires, celui sur les régimes matrimoniaux. Pourquoi est-il important pour la pratique notariale ?
V. M.-R.
C’est un instrument particulièrement crucial, parce qu’il a instauré un ensemble complet de règles de droit international privé en ce qui concerne les régimes matrimoniaux. Avec notamment des chapitres sur la loi applicable, la compétence judiciaire et certains aspects du régime primaire. On peut cependant noter deux limites à son application, la première est qu’il s’agit d’une application limitée dans le temps puisque le règlement est valable uniquement pour les personnes qui se marient après son entrée en application ou changent de loi applicable à leur régime matrimonial. Pour les notaires, cela signifie que les règles antérieures continuent de s’appliquer pour les personnes mariées avant le 29 janvier 2019. On remarquera également une limitation géographique puisqu’il ne s’applique de façon obligatoire que dans les 18 États qui participent à la coopération renforcée. Malgré cela, ce règlement reste un très bon instrument qui était attendu par les juristes.
LPA
Est-ce qu’au final être notaire aujourd’hui ce n’est pas aussi devoir gérer des figures juridiques étrangères ?
V. M. –R.
Il y a en effet des institutions qui sont inconnues en France, telles que le Trust qu’on retrouve dans la common law ou la Kafala dans le droit musulman. Ce qui est primordial est qu’il ne faut pas essayer de les rentrer dans une catégorie d’institution que l’on connaît en France, il faut respecter leur particularité. Je pense à la Kafala, qu’on ne peut pas considérer comme une adoption. Il faut prendre l’institution étrangère comme elle existe et ne pas essayer de la faire rentrer dans une case qui correspond à notre schéma de pensée juridique. Sur un autre point, notre commission a rédigé une partie pour amener le notaire à se méfier des mots lorsqu’il pratique le droit international privé : les mêmes mots peuvent en effet faire référence à des notions différentes. Par exemple, la notion de « conjoint survivant » n’est pas abordée de la même façon dans les différentes législations s’agissant de sa vocation successorale. Une autre solution qui peut paraître évidente au notaire français : « le démembrement de propriété », c’est-à-dire lors d’une donation les parents gardent l’usufruit et les enfants la nue-propriété d’un bien, peut parfois être totalement inconnue à l’étranger.
LPA
Que souhaitiez-vous apporter aux notaires qui vont lire ce rapport ?
V. M. –R.
J’espère qu’en lisant nos travaux, les notaires se rendront compte qu’il ne faut pas avoir peur d’aller chercher des éléments d’extranéités dans un dossier. On peut penser qu’un dossier est franco-français, alors qu’il suffit de poser des questions aux clients pour s’apercevoir que les personnes se sont mariées ailleurs, qu’elles ont des biens à l’étranger… et que l’on doit aller chercher ces éléments d’extranéités pour traiter au mieux ! Nous souhaitions aussi donner à tous les notaires des outils pour trouver des solutions en présence d’un élément d’extranéité en droit de la famille.