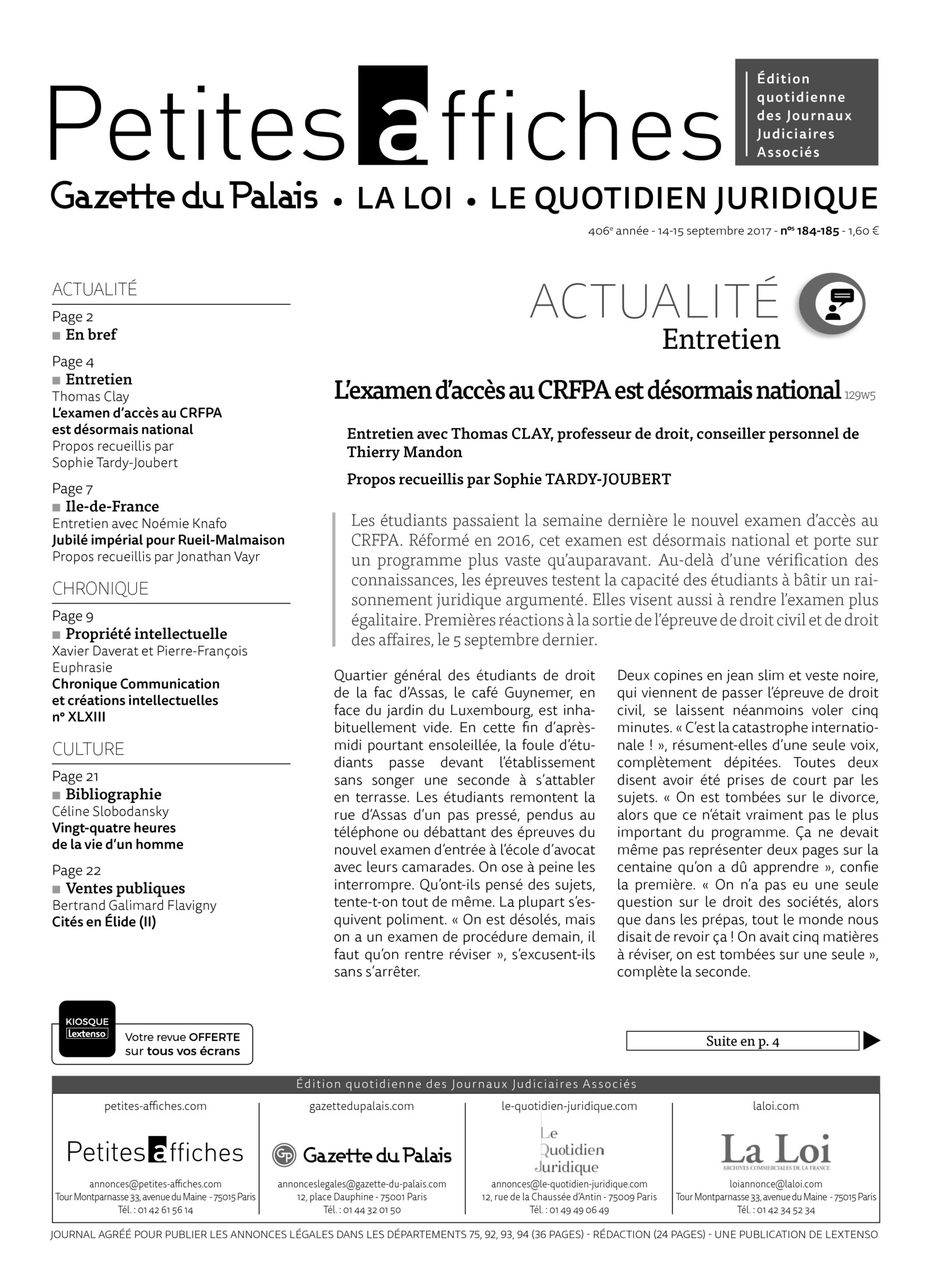L’examen d’accès au CRFPA est désormais national
Les étudiants passaient la semaine dernière le nouvel examen d’accès au CRFPA.Réformé en 2016, cet examen est désormais national et porte sur un programme plus vaste qu’auparavant. Au-delà d’une vérification des connaissances, les épreuves testent la capacité des étudiants à bâtir un raisonnement juridique argumenté. Elles visent aussi à rendre l’examen plus égalitaire. Premières réactions à la sortie de l’épreuve de droit civil et de droit des affaires, le 5 septembre dernier.
Quartier général des étudiants de droit de la fac d’Assas, le café Guynemer, en face du jardin du Luxembourg, est inhabituellement vide. En cette fin d’après-midi pourtant ensoleillée, la foule d’étudiants passe devant l’établissement sans songer une seconde à s’attabler en terrasse. Les étudiants remontent la rue d’Assas d’un pas pressé, pendus au téléphone ou débattant des épreuves du nouvel examen d’entrée à l’école d’avocat avec leurs camarades. On ose à peine les interrompre. Qu’ont-ils pensé des sujets, tente-t-on tout de même. La plupart s’esquivent poliment. « On est désolés, mais on a un examen de procédure demain, il faut qu’on rentre réviser », s’excusent-ils sans s’arrêter.
Deux copines en jean slim et veste noire, qui viennent de passer l’épreuve de droit civil, se laissent néanmoins voler cinq minutes. « C’est la catastrophe internationale ! », résument-elles d’une seule voix, complètement dépitées. Toutes deux disent avoir été prises de court par les sujets. « On est tombées sur le divorce, alors que ce n’était vraiment pas le plus important du programme. Ça ne devait même pas représenter deux pages sur la centaine qu’on a dû apprendre », confie la première. « On n’a pas eu une seule question sur le droit des sociétés, alors que dans les prépas, tout le monde nous disait de revoir ça ! On avait cinq matières à réviser, on est tombées sur une seule », complète la seconde.
Pour ceux qui ont choisi le droit des affaires, le constat est à peu près le même. L’épreuve, portant sur les sociétés par action simplifiées (SAS) et les sociétés par actions simplifiée unipersonnelle (SAS-U) était « tirée dans les coins », estime une étudiante. « Ça représente à peine une page, sur un énorme programme de révision », se désole-t-elle.
Directeur de l’institut d’études judiciaires de la faculté de droit de l’université de Paris 12 et auteur de l’ouvrage Droit civil, synthèse visant à préparer les étudiants à l’épreuve de spécialité de droit civil paru chez Lextenso en juin dernier, Romain Boffa dit « comprendre cette réaction, cette frustration ». « Ils ont accumulé une grande quantité de connaissance et ne sont interrogés que sur une petite partie d’entre elles. Cet examen n’est pas un contrôle des connaissances. On ne leur demande pas d’avoir bien révisé mais d’être capable de mener un raisonnement juridique », explique-t-il. Pour l’universitaire, les sujets proposés permettaient d’aller au fond du raisonnement, ce qui n’aurait pas été possible avec un sujet transversal. « Avoir en tête une multitude de connaissances et savoir lesquelles mobiliser, c’est ce qui les attend en tant qu’avocat », précise-t-il.
Architecte de la réforme, qu’il a initié lorsqu’il était conseiller personnel de Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Thomas Clay revendique cette approche professionnalisante de l’examen. « Ces épreuves sont le sas pour entrer dans la profession d’avocat. Cela ne doit donc pas être un examen universitaire comme c’était devenu. Les étudiants sont déjà titulaires d’un master 1 et souvent d’un master 2. À ce stade, il s’agit donc de mettre en application les connaissances. On sort de la logique antérieure, qui était trop scolaire », affirme-t-il.
La réforme, amorcée en 2015 et dévoilée à l’été 2016 à l’issue d’une concertation entre le ministère de la Justice, le ministère de l’Enseignement supérieur et les professionnels du droit, visait surtout à harmoniser l’examen. En plus du caractère pratique de l’examen, l’autre grand changement de cette rentée est le caractère national des épreuves. Jusqu’en 2016, chacun des 48 instituts d’études judiciaires produisait ses propres sujets. Cette année en revanche, tous les étudiants, y compris ceux résidant dans les DOM-TOM, ont, pour la première fois, planché au même moment sur des sujets élaborés au mois de janvier dernier par une commission nationale, composée de quatre avocats et de quatre universitaires. Cet examen national n’a pas été évident à organiser. « Le principal risque était qu’il y ait des fuites. Outre-mer, les étudiants ont dormi dans les salles et les sujets ont été décachetés juste avant l’examen, pour qu’ils composent en même temps que les étudiants de l’Hexagone », explique Thomas Clay. Romain Boffa avoue pour sa part qu’il s’interrogeait sur « la faisabilité » de ce nouvel examen. Au lendemain de la dernière épreuve, il estime que « tout s’est bien passé ». « L’organisation a été très fluide, et il faut saluer pour cela le travail de Pierre Crocq, directeur de l’association des présidents d’IEJ », estime-t-il.
Certains étudiants, néanmoins, dénoncent un certain flottement concernant les règles du concours. « Les années précédentes, les étudiants avaient le droit de mettre des post-it dans leurs codes », explique Aurélien, étudiant de l’IEJ d’Assas, son sac de lycéen sur le dos. « Cette année, on nous a d’abord dit qu’on était seulement autorisés à souligner des passages. Puis, le jour des épreuves, on nous a dit qu’on pouvait stabiloter les tranches de nos codes. Malheureusement, c’était un peu tard. On voit à ce genre de choses qu’on est la première année après la réforme. On essuie les plâtres », estime-t-il.
La finalité de ce nouvel examen est de garantir plus d’égalité entre les candidats. « Il y avait auparavant des disparités énormes. Les taux de réussite des IEJ variaient de 13 % à Perpignan à 65 % à Paris 5 », explique Thomas Clay, qui estime que cette situation était due au fait que les épreuves variaient d’un IEJ à l’autre. « Les étudiants le savaient, et lorsqu’ils avaient déjà fait plusieurs tentatives, ils faisaient en sorte de s’inscrire dans des IEJ qui avaient les meilleurs résultats, comme Paris 5 », avance-t-il. D’après lui, le caractère national devrait limiter ces disparités. Comme lui, Romain Boffa estime que « les sujets communs et les grilles d’évaluation devraient garantir une forme d’homogénéité à l’examen, et renforcer l’équité entre les candidats ».
Pierre Crocq, directeur de l’association des présidents d’IEJ, est en revanche loin de partager cet enthousiasme. Très sceptique, il affirme que « cet objectif d’harmonisation est illusoire ». « Il y aura toujours des différences de réussite car les populations ne sont pas les mêmes », développe-t-il. « Il faut comparer des choses comparables. Paris 5, qui affiche un taux de réussite de 65 %, est l’IEJ qui accueille tous les étudiants venus de Sciences-Po. Cela n’est donc pas très surprenant ». S’il a contribué à mettre en œuvre la réforme dans de bonnes conditions, Pierre Crocq faisait partie des principaux opposants au projet. Tout en précisant que « les IEJ ont toujours été favorables à la réforme » et en jugeant la modification du contenu des épreuves « intéressante », il met en garde contre les conséquences du caractère national de l’examen. Celui-ci pourrait, d’après lui, produire l’effet inverse à celui escompté. « Ayant les mêmes sujets d’examens, les étudiants vont vouloir comparer les taux de réussite. Il risque alors de se passer la même chose que pour l’École nationale de la magistrature : les étudiants vont aller vers les établissements qui ont les meilleurs taux de réussite, et délaisser les autres », estime-t-il, rappelant qu’aujourd’hui, seules quelques universités préparent à l’ENM et que l’IEJ de Paris 2 fournit plus d’un tiers des auditeurs de justice. « Je ne veux pas être pessimiste, mais je crains que cette réforme ne génère plus de complications que de satisfactions », prévient-il. Les résultats d’admissibilité sont attendus pour le 23 octobre prochain. Les épreuves orales, organisées cette fois par chaque IEJ, débuteront quant à elles le 13 novembre.
Thomas Clay revient pour les Petites Affiches sur les prémices de la réforme et les avantages escomptés.
Les Petites Affiches – Pourquoi fallait-il réformer l’examen ?
Thomas Clay – Cela faisait 25 ans qu’il en était question. Lorsque Thierry Mandon a été désigné secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en juin 2015, il a été saisi par le président du Conseil national des barreaux (CNB), Pascal Eydoux, et par le bâtonnier Pierre-Olivier Sur, pour faire enfin aboutir cette réforme. Les grandes lignes ont été annoncées le 18 décembre 2015 au conseil national du droit et détaillée ensuite le 10 juillet 2016, pendant les journées de formation Campus.
LPA – Êtes-vous satisfait de voir cette réforme mise en œuvre ?
T. C. – C’était une réforme nécessaire, qui rendra l’examen plus équitable. La mise en place s’est très bien passée. Je regrette néanmoins que le gouvernement n’ait pas jugé utile de communiquer sur ce sujet. J’aurais par ailleurs aimé qu’on aille encore plus loin. Je souhaitais que les étudiants, en plus de passer les mêmes épreuves, composent dans un lieu unique. Cela aurait facilité et sécurisé le processus d’acheminement des sujets. Cela aurait permis de solenniser encore davantage cet examen et d’en faire un événement médiatique, comme l’est le concours d’entrée à l’École nationale de la magistrature ou celui de l’internat de médecine. Cela contribuerait à rehausser le prestige de la profession d’avocat.
LPA – Cette réforme a suscité l’opposition des directeurs d’IEJ. Pourquoi ?
T. C. – C’est une réforme de bon sens, qui a fait consensus et reçu l’appui du CNB, de la Conférence des bâtonniers, de l’ordre des avocats, de la conférence des doyens, de la directrice générale de l’enseignement supérieur. Les résistances sont venues uniquement des directeurs d’IEJ qui y voyaient, pour certains d’entre eux seulement – car d’autres nous ont soutenus – une perte d’influence. Ils ont perdu en effet certaines de leurs prérogatives, puisqu’ils ne feront plus les sujets et devront comparer leurs moyennes. J’estime pour ma part que l’on ne peut pas être à la fois centre d’examen et centre de préparation à cet examen. Cette séparation entre les centres de préparation et la commission qui élabore les sujets me semble saine.