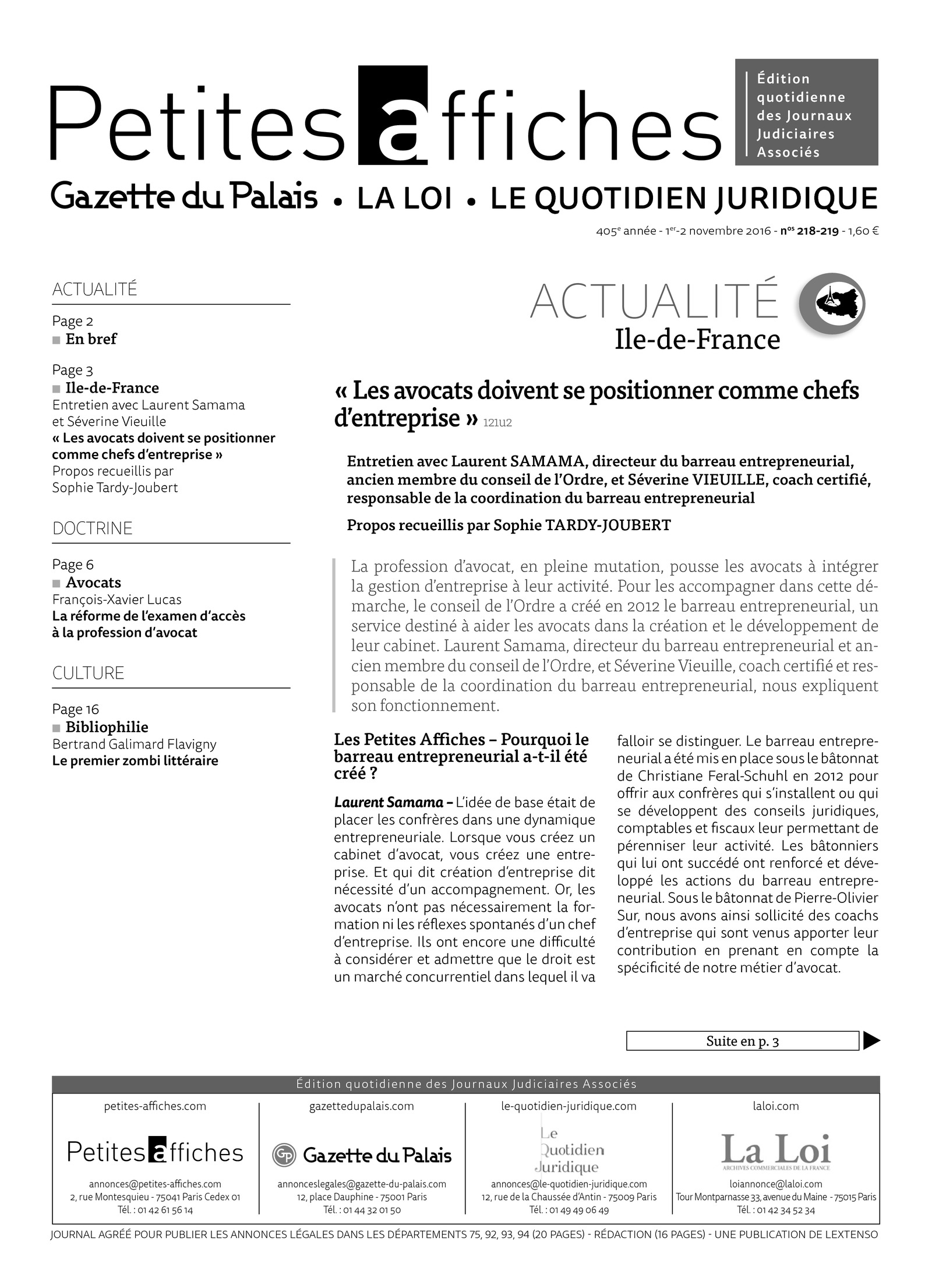La réforme de l’examen d’accès à la profession d’avocat
L’examen d’accès à la profession d’avocat, tout en restant organisé localement par des centres d’examen régionaux, acquiert une dimension nationale au sens où les candidats composeront le même jour sur des sujets d’épreuves écrites qui, conçus par une commission nationale, seront les mêmes pour tous. Cette réforme comporte des défauts mais il lui sera beaucoup pardonné compte tenu de l’excellente idée qu’ont eu ses promoteurs d’étendre le domaine de l’épreuve de grand oral à l’appréciation de la culture juridique du candidat, évolution dont on saluera la pertinence.
1. Deux nouveaux textes applicables à la session 20171. La réforme de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats (ci-après CRFPA), dont les modalités étaient débattues depuis plusieurs mois, vient d’être rendue publique dans sa forme définitive qu’expriment un décret2, modifiant le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, et un arrêté3, publiés au Journal officiel du 18 octobre 2016. Ceux – dont nous sommes – qui espéraient voir sortir de cette réforme le véritable examen national que ses promoteurs appelaient de leurs vœux ne peuvent qu’être déçus par l’insuffisance des innovations introduites. Le régime de l’examen n’est modifié qu’à la marge puisqu’il reste organisé localement par les centres d’examen habilités et selon un programme qui n’est que retouché. Cette réforme aurait pu être l’occasion de simplifier considérablement les épreuves en faisant passer aux candidats deux compositions seulement, l’une sur un sujet agrégeant les matières fondamentales (sources du droit, droit constitutionnel, droit civil des biens, des contrats et de la responsabilité civile), l’autre sur un sujet portant sur la procédure, puis un grand oral permettant de vérifier leur culture juridique et leur aptitude à l’argumentation. Même en maintenant la note de synthèse, les épreuves auraient ainsi été ramenées au nombre de quatre, ce qui aurait permis la simplification espérée et la mise en place d’une correction confiée à un jury national et partant un véritable examen unifié.
2. Satisfecit. Œuvre de compromis, la présente réforme ne va pas aussi loin. Elle n’en est pas moins digne d’approbation, tant par la simplification qu’elle réalise que par l’opportune introduction de la culture juridique dans un grand oral qui trop souvent tournait à vide sur le thème des libertés et droits fondamentaux auquel se limitait jusqu’à présent son objet. Cette innovation est bien autre chose qu’un simple réglage par voie de modification du programme de l’examen. Elle exprime une ambition, celle de ne pas sélectionner de purs techniciens du droit mais des juristes cultivés qui seront en mesure de développer une réflexion personnelle sur la règle de droit. On ne peut que savoir gré aux auteurs de la réforme d’avoir traduit dans les textes cette ambition, dont la profession ne peut tirer que le plus grand profit.
Au-delà, cette réforme permet de rationaliser l’examen d’accès à la profession d’avocat en lui assurant une plus grande unité que celle que présentent les 42 examens régionaux aujourd’hui organisés par les 42 universités habilitées à cette fin. La simplification qui va en résulter est aussi évidente que digne d’approbation puisque, au lieu de faire établir de nombreux sujets (16 sujets par centre à vrai dire compte tenu du nombre de matières proposées) par chacun de ces 42 centres d’examen, l’innovation la plus spectaculaire que réalise cette réforme est de ne plus concevoir qu’un sujet unique par matière donnant lieu à une épreuve écrite d’admissibilité, que chaque centre recevra et sur lequel il lui reviendra de faire composer les étudiants qu’il a inscrits.
Ainsi rationalisé, l’examen devient aussi plus équitable au sens où les candidats composeront tous sur les mêmes sujets, dont on peut espérer qu’ils seront particulièrement pertinents puisqu’ils auront été forgés par une commission ad hoc réunissant des personnes avisées et de surcroît autorisées à s’assurer le concours de sapiteurs pour l’élaboration de sujets dans les matières qui pourraient leur être peu familières. L’un des objectifs poursuivis par cette nationalisation des sujets d’écrit est de mettre un terme aux disparités choquantes pouvant exister d’un IEJ à un autre où le taux de succès à l’examen peut varier de un à trois, ce qui n’est guère satisfaisant. Les avocats espèrent que ce lissage des statistiques se traduira par une diminution du nombre de candidats reçus et que cette reprise en main des épreuves écrites de l’examen permettra de limiter le nombre de nouveaux arrivants dans une profession qui s’inquiète de manière parfaitement légitime de voir ses effectifs exploser. La réforme n’introduit aucun numerus clausus mais donne les moyens à la profession de peser sur les résultats. Non pas tant lors des délibérations, car chacun des 42 jurys locaux conserve sa souveraineté et peut parfaitement, en dépit de l’uniformisation des sujets d’examen, afficher un taux de réussite bien en deçà ou bien au-delà de la moyenne nationale, mais en permettant de rappeler à l’ordre un IEJ qui se singulariserait, voire en supprimant à terme son habilitation à organiser l’examen, ce que les nouveaux textes permettent puisque c’est le recteur qui dresse la liste des centres d’examen… La reprise en main de l’examen par la profession d’avocat est engagée et, à vrai dire, si elle s’opère avec prudence et raison et dans le respect du principe d’indépendance des universitaires, cette évolution n’a rien d’anormal.
Enfin, la réforme présente l’avantage de donner plus de lustre à cet examen, qui ne sera plus organisé confidentiellement dans chaque centre mais le sera une fois par an à une même date pour tous les candidats de France, comme c’est le cas pour des examens ou concours prestigieux, tels le baccalauréat ou le concours de l’internat de médecine.
3. Inquiétudes. S’il existe de vrais motifs d’approuver cette réforme, il en est de non moins sérieux de s’inquiéter de certaines innovations malheureuses qu’elle charrie aussi. D’abord, l’avenir des IEJ n’apparaît guère assuré dans cette nouvelle configuration et à vrai dire, même les universités ne sont pas certaines de conserver la mission d’organiser l’examen4. Les rédacteurs de la réforme ont aussi eu la légèreté d’ignorer totalement les questions d’intendance que pose l’organisation de cet examen, là où elles sont centrales. Organiser un examen d’une telle importance, ce n’est pas seulement rédiger des sujets, c’est aussi concevoir de véritables corrigés, ce que le texte ne prévoit même pas5, mais c’est également de manière plus prosaïque et ingrate régler une foule de questions pratiques qui conditionnent le bon déroulement des épreuves et le traitement équitable des candidats. Or sur tous ces points essentiels, tant le décret que l’arrêté sont hélas bien discrets6. Enfin, et plus grave malheureusement, on ne peut que déplorer que certaines règles imposées au jury risquent de rendre purement et simplement impossible l’organisation de l’examen, telle celle qui interdit à toute personne ayant participé à la préparation des étudiants de jouer le moindre rôle dans le déroulement des épreuves7.
En vue de donner une image complète des nouveaux textes qui réalisent cette réforme de l’examen d’accès, nous évoquerons les innovations qui touchent à l’organisation (I) et au contenu (II) de cet examen.
I – L’organisation de l’examen
Le décret et l’arrêté du 17 octobre 2016 fixent un nouveau cadre pour l’examen (A) et modifient son contenu (B).
A – Le nouveau cadre de l’examen
La nouveauté tient à ce qu’une unité est désormais donnée à cet examen d’accès à la profession d’avocat qui, tout en demeurant régional et organisé dans 42 universités réparties sur tout le territoire comme autant de centres régionaux d’examen (2), voit son organisation confiée à une commission nationale (1) chargée de concevoir des sujets communs dans toutes les matières sur lesquelles les candidats vont composer à l’écrit.
1 – La commission nationale
4. La constitution d’une commission nationale. Une commission nationale est instituée par la réforme8, composée de huit membres et comprenant un nombre égal de femmes et d’hommes (ouf, on est rassuré… la parité est respectée… les rédacteurs du texte s’attaquent aux vrais sujets…). Nommée pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois pour la moitié des membres de la commission, par arrêté conjoint du garde des Sceaux et du ministre chargé de l’Enseignement supérieur, cette commission est composée de quatre professeurs des universités ou maîtres de conférences et « personnels assimilés » (sic.), chargés d’un enseignement juridique. Ces enseignants doivent relever de quatre établissements d’enseignement supérieur distincts et être issus d’au moins deux académies différentes, précision opportune destinée à éviter que cette commission ne devienne un club de parisiens. L’un d’entre eux au moins doit être « un directeur de composante préparant à l’examen d’accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats », formule peu intelligible qui paraît renvoyer à un directeur d’institut d’études judiciaires. Il faut le souhaiter car la présence au sein de la commission d’un directeur d’IEJ qui a eu en charge, pendant plusieurs années, l’organisation de l’examen peut permettre d’éclairer cette commission sur la façon de concevoir des sujets pertinents et d’élaborer des corrigés mais aussi sur de nombreuses difficultés pratiques qui ne peuvent qu’échapper à ceux qui découvriront les joies de l’organisation de cet examen. La commission est également composée de quatre avocats proposés par le Conseil national des barreaux. Même si rien n’est prévu à cet égard, il faut espérer que le CNB aura à cœur d’assurer la diversité géographique mais aussi professionnelle des avocats invités à siéger, et de privilégier des praticiens pouvant justifier d’une certaine pratique de l’enseignement et des examens. Il n’est pas prévu de suppléants mais il est remédié à la démission ou à l’empêchement définitif d’un membre par la désignation d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. On signalera que le président de la commission est désigné par le garde des Sceaux et le ministre chargé de l’Enseignement supérieur, et qu’il doit l’être parmi les universitaires membres de la commission, ce qui n’est pas neutre dès lors que ce président dispose d’une voix prépondérante.
5. L’élaboration des sujets des épreuves écrites. Le cœur de la réforme réside dans la modification de l’article 51 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. Si, pour accéder à un centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent aujourd’hui comme hier avoir subi avec succès l’examen d’accès à ce centre, l’originalité tient à ce que désormais « pour chacune des épreuves écrites d’admissibilité, les candidats composent sur les mêmes sujets quel que soit le centre d’examen », ce qui a fait dire que l’examen d’accès était devenu national, ce qui n’est pas exact dès lors que, pour qu’il le devienne, il aurait fallu ne pas se contenter d’établir un sujet unique pour les épreuves d’admissibilité mais faire en sorte que les notes soient attribuées par un jury national unique coordonnant les corrections y compris pour les épreuves d’admission qui, en l’état, demeurent régionales, les sujets étant forgés et les notes attribuées par chaque centre d’examen.
Cette commission nationale, se voit d’abord reconnaître le soin d’élaborer les sujets de chacune des épreuves écrites d’admissibilité, soit onze sujets au total : un sujet de note de synthèse, un sujet de droit des obligations, un sujet pour chacune des six matières de spécialité, à savoir le droit civil, le droit des affaires, le droit social, le droit pénal, le droit administratif et le droit international et européen, ainsi qu’un sujet dans chacune des trois matières de procédure civile, pénale et administrative. La rédaction de ces sujets par une commission qui ne comporte que huit membres pourra être facilitée par la précision apportée par le décret, selon lequel la commission peut faire appel, pour ses travaux, à des personnalités extérieures, qui doivent avoir la qualité d’avocat ou d’enseignant éligibles aux fonctions de membres de la commission, auxquelles la commission pourra sous-traiter l’établissement de sujets et surtout – même si le texte ne le prévoit pas avec suffisamment de netteté – des corrigés détaillés.
6. L’harmonisation des critères de correction. C’est en effet une question essentielle de savoir sur la foi de quelles indications les correcteurs vont devoir noter les copies des candidats ayant composé sur les sujets établis par la commission nationale. Habituellement cette question ne se pose pas dès lors que le professeur qui corrige les copies est aussi celui qui a conçu le sujet, de sorte qu’il est le mieux à même d’apprécier ce qu’il attend des candidats et ainsi de les noter. Il peut pour cela se faire assister mais il prend soin alors de fournir à ses assistants un corrigé et un barème de notation. Les IEJ qui doivent s’assurer le concours d’équipes de correcteurs veillent aujourd’hui à leur fournir un corrigé détaillé, étant précisé qu’en cas de difficulté le concepteur du sujet est disponible pour fournir toute demande d’éclaircissement. En faisant établir les sujets par la commission nationale, la réforme crée une situation inédite tenant à ce que les personnes chargées de corriger les copies, non seulement n’auront pas donné le sujet, mais n’auront pas la possibilité d’être encadrées par celui qui l’aura conçu. Il y a là une vraie difficulté car c’est déjà peu enthousiasmant de corriger des copies sur un sujet dont on est soi-même l’auteur, cela devient particulièrement rebutant si, le sujet ayant été fait par un autre, il faut se livrer au préalable à un important travail pour se l’approprier. Ainsi, voit-on combien il va être essentiel que la commission nationale fournisse aux correcteurs un corrigé détaillé comportant un barème précis. Or, les textes qui gouvernent son fonctionnement ne le prévoient pas puisqu’ils se bornent à lui assigner une mission d’harmonisation des critères de correction des épreuves sous forme de recommandations qui peuvent prendre la forme de grilles de notation à destination des jurys et des correcteurs. Cette dernière formulation est insatisfaisante. Prise à la lettre, et si les membres de la commission assurent le service minimum, elle signifie que celle-ci se bornera à rédiger un sujet dans chacune des matières d’écrit, à savoir onze sujets, et à formuler des recommandations en vue de la correction et des conseils en vue de la notation, ce qui serait évidemment insuffisant. Il faut en effet bien saisir la situation originale qui va se présenter pour les centres d’examen puisqu’ils auront à faire corriger des copies traitant de sujets qu’ils n’ont pas conçus, ce qui complique la correction particulièrement si les correcteurs ne sont pas spécialistes de la matière. Ce que les auteurs de la réforme n’ont pas mesuré, c’est que si aujourd’hui de nombreux enseignants acceptent de corriger – bénévolement le plus souvent – des copies de l’examen d’accès, c’est parce qu’ils ont donné le sujet et que celui-ci porte sur un thème qui leur est familier. À présent que les sujets sont imposés par une commission nationale, la difficulté d’avoir à corriger des copies en nombre important dans des délais contraints (12 000 copies à corriger en trois semaines dans un IEJ comme celui de Paris I) risque d’être insurmontable – tout simplement faute de correcteurs – si le sujet proposé n’est pas accompagné d’un corrigé détaillé.
Sous cette réserve, la réforme apparaît convaincante, en ce qu’elle évite à chacun des 42 centres d’examen d’avoir à préparer des sujets et des corrigés. La mutualisation a du bon, surtout si la commission chargée d’arrêter les sujets et les corrigés travaille bien et en conçoit des particulièrement pertinents et adaptés à chaque épreuve. On ne peut que le souhaiter.
2 – Les centres régionaux d’examen
7. Des universités aux centres d’examen. Le décret modifié prévoit désormais que ce ne sont plus les universités qui organisent l’examen mais des centres d’examen désignés par le recteur d’académie, après avis du garde des Sceaux. Cette évolution terminologique est tout sauf neutre ne serait-ce parce qu’elle permet de retirer aux universités le monopole de l’organisation de l’examen d’accès. En effet, là où l’article 51 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat prévoyait que cet examen « est organisé par les universités qui sont désignées à cet effet par le recteur d’académie », il dispose désormais, pris en sa nouvelle rédaction issue du décret du 17 octobre 2016, que « des centres d’examen sont désignés par le recteur d’académie », lesquels centres d’examen n’ont plus nécessairement à être des universités. L’article 53 est modifié en conséquence pour prévoir que ce n’est plus le président de l’université qui désigne les professeurs des universités ou maîtres de conférences, membres du jury de l’examen mais le « responsable du centre ». Ce ne sont d’ailleurs plus les seuls professeurs des universités ou maîtres de conférences en droit qui peuvent siéger dans les jurys mais également les « personnels assimilés » (sic.). Certes, l’arrêté du 17 octobre 2016 évoque toujours l’organisation de l’examen par les universités mais pourquoi avoir modifié le décret (dont on sait – s’agissant d’un décret en Conseil d’État – combien il est délicat à modifier) en lui faisant prévoir que n’importe quelle officine désignée par un recteur pourra le moment venu (il suffira d’un simple arrêté) organiser l’examen ? La réponse n’est pas douteuse : les concepteurs de la réforme ont voulu se réserver la possibilité de confier l’organisation de l’examen à d’autres interlocuteurs que les universités. C’est ainsi qu’un scénario parfaitement concevable désormais pourrait être d’ériger les centres régionaux de formation professionnelle à la profession d’avocat en centres d’examens, que le recteur d’académie désignerait, après avis du garde des Sceaux. Voilà qui va être de nature à maintenir une affectueuse pression sur les universités qui conservent pour le moment une vocation à organiser l’examen mais doivent comprendre que, si elles ne donnent pas satisfaction, par exemple en ne suivant pas des suggestions qui pourraient leur être adressées relativement au nombre de candidats qu’elles admettent, elles ne sont pas assurées de la conserver. Cette destitution des universités pourrait d’ailleurs intervenir de manière globale, en confiant aux CRFPA l’organisation de l’examen dans son ensemble, mais aussi de manière plus ciblée en écartant au cas par cas tel centre d’examen jugé insuffisamment performant ou trop peu coopératif. Le recteur d’académie serait alors parfaitement libre de ne pas renouveler telle ou telle université dans ses fonctions d’organisation de l’examen. D’ores et déjà se trouve abrogé l’arrêté du 6 janvier 1993 portant désignation des universités (42 dont 6 dépourvues d’IEJ) chargées d’organiser l’examen d’entrée dans les CRFPA.
Cette situation n’est pas satisfaisante. Ces perspectives d’évolution de l’organisation de l’examen n’ont jamais été évoquées lors des nombreux échanges qui ont précédé la réforme, au cours desquels tous les interlocuteurs ont au contraire protesté de la nécessité de maintenir le maillage d’IEJ répartis sur tout le territoire. Si une telle déclaration est rassurante, elle l’aurait été plus encore si les rédacteurs du texte avaient d’emblée exposé les motifs les conduisant à se réserver la possibilité de ne plus confier aux universités la responsabilité de l’examen d’accès.
À vrai dire, il ne serait pas absurde que la profession d’avocat se charge intégralement de l’organisation de cet examen – comme les nouveaux textes le lui permettent désormais – et l’on ne comprend pas pourquoi la réforme ne va pas au terme de cette évolution qu’elle se contente de suggérer. Les IEJ auraient pu être déchargés de leur mission d’avoir à organiser l’examen pour se concentrer sur une mission pédagogique de préparation des candidats, lesquels auraient été invités à passer l’examen au sein des centres régionaux sous l’égide du CNB. On s’étonne qu’une telle solution n’apparaisse qu’en filigrane dans la présente réforme et comme une modalité possible et future de l’examen que le garde des Sceaux se réserve le droit d’activer…
8. Le jury régional. La commission nationale, on l’a dit, n’est chargée que d’élaborer les sujets des épreuves écrites. Elle ne se substitue pas au jury d’examen de chacun des centres d’examen habilités, ce qui permet de dire que l’examen demeure fondamentalement local et propre à chaque université chargée de l’organiser.
Ce jury d’examen reste composé de deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, auxquels la réforme ajoute des « personnels assimilés », chargés d’un enseignement juridique, désignés localement, par le responsable du centre qui organise l’examen, c’est-à-dire, pour le moment, par des présidents d’université. Un magistrat de l’ordre judiciaire ainsi qu’un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ainsi que trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d’avocats concernés localement complètent ce jury. S’y ajoutent des enseignants chargés de faire passer les épreuves en langues étrangères, qui ne siègent que pour les candidats qu’ils ont examinés.
9. Confidentialité et conflits d’intérêts. Les membres du jury se voient assujettis par le décret à une obligation de confidentialité, ce qui allait de soi mais est encore moins douteux à présent que les textes le prévoient expressément.
Plus contestable est la précision apportée par l’alinéa 3 de l’article 4 de l’arrêté, selon lequel « les examinateurs et les membres du jury ne peuvent enseigner simultanément dans une formation publique et privée préparant à l’examen d’accès aux CRFPA au cours de l’année universitaire au titre de laquelle l’examen est organisé et l’année universitaire précédant celle-ci ». Ce texte se préoccupe de situations de conflits d’intérêts qu’il croit avoir identifiées lorsqu’un examinateur chargé de noter des candidats intervient par ailleurs dans un établissement qui délivre une formation à ces candidats sous forme de préparation annuelle ou estivale. En somme, les auteurs de la réforme ont considéré qu’il était peu satisfaisant qu’une personne puisse être examinateur ou membre du jury si elle a été précédemment rémunérée pour préparer ces mêmes étudiants. Sans doute ont-ils cru que celui qui est payé pour préparer se trouve privé d’objectivité lorsqu’il s’agit de noter, de sorte qu’il y aurait lieu de prohiber absolument ce mélange des genres. Cette disposition est en réalité malheureuse et sans doute l’une des plus dommageables de toutes celles introduites par les nouveaux textes. À suivre un tel raisonnement, il faudrait considérer que tous les enseignants qui ont participé à la formation (y compris au cours du cursus universitaire antérieur ?) et partant à la préparation à l’examen d’un candidat sont frappés d’une incompatibilité qui leur interdit de participer à l’examen soit en tant que membre du jury, soit en tant que correcteur. Une telle conception méconnait le fait que les universitaires passent leur temps à préparer des étudiants pour ensuite leur faire passer des examens. Où a-t-on vu qu’il faudrait séparer les fonctions d’enseignement et d’évaluation, comme on distingue les fonctions d’instruction et de jugement ? Cet interdit qui vient frapper les enseignants est désobligeant pour ne pas dire plus, par ce qu’il sous-entend. On comprend en effet que l’enseignant qui a préparé des étudiants ne va pas les noter de manière impartiale mais les favoriser inévitablement. Ce risque est assumé depuis toujours par les universités, qui acceptent que chaque professeur corrige les devoirs de ses propres étudiants, c’est-à-dire ceux qu’il a préparés. L’université a toujours procédé ainsi et il apparaît difficile de rompre avec une pratique aussi ancienne sur la foi d’un alinéa tiré d’un arrêté trop vite rédigé. Ce que n’ont pas compris les rédacteurs de cette règle inopportune, c’est qu’elle risque de rendre impossible la constitution d’équipes suffisamment étoffées pour corriger les copies. Qu’il soit permis de faire ici état de l’expérience de l’IEJ de Paris I. Tout au long de l’année, les étudiants y sont préparés et mis en mesure de s’entraîner en passant des examens blancs. Des milliers de copies sont ainsi corrigés par des collaborateurs qui se forment à l’exercice de correction, ce qui permet lorsque vient le moment d’organiser l’examen officiel de disposer de bataillons de correcteurs que l’on a pu former au travail de correction, tester et sélectionner. Dans un IEJ où les candidats et partant les copies sont en nombre aussi important (12 000 copies compte tenu de la double correction), il est miraculeux de pouvoir mobiliser des correcteurs en nombre suffisant. Si l’on affirme que ceux qui ont déjà participé à la préparation des candidats dans le cadre de l’IEJ sont exclus d’office de toute participation à l’examen, c’est le blocage assuré, aucun collaborateur habituel de l’IEJ ne pouvant plus être sollicité au sein de l’université pour contribuer à l’organisation des épreuves. Il faudra alors trouver des centaines de correcteurs sans lien avec l’IEJ, et probablement sans aucun attrait pour l’exercice, ce qui est purement et simplement impossible. Et que dire de la compétence de ces ouvriers de la dernière heure qui, par hypothèse, ignoreraient tout d’un examen qu’on leur demande de découvrir puisque cette fraîcheur innocente face aux paquets de copies, serait, si l’on en croit cet article 4, alinéa 3 du décret, le gage de la qualité de leur correction, ce dont il y a lieu de douter précisément. On ajoutera pour finir que cette interdiction excessive risque d’être délicate à mettre en œuvre, dès lors que les correcteurs de copies ne sont nullement tenus de déclarer s’ils ont participé à une préparation.
Bref, à tous égards, on ne peut qu’être préoccupé par l’introduction de cette règle absurde. Fort heureusement, elle devrait pouvoir être neutralisée. Un moyen d’y parvenir pourrait être de considérer que les simples correcteurs de copies ne sont pas des examinateurs, catégorie qui ne renverrait qu’aux examinateurs des oraux… Même si la lettre du texte ne suggère pas une telle lecture, il n’en serait pas moins pertinent de la retenir, au besoin en prenant un nouvel arrêté, en tenant compte du fait que toutes les copies sont anonymes, de sorte que ceux qui les corrigent ne sont pas en mesure de reconnaître des candidats qu’ils auraient pu rencontrer précédemment en leur qualité d’enseignant. Tout cela n’a guère de sens, encore une fois…
10. Harmonisation des notes au sein du ressort d’un CRFPA. Conscients du défaut d’une réforme qui ne règle nullement le problème de la disparité de taux de succès d’un centre d’examen à un autre, les promoteurs de la réforme ont introduit un dispositif visant à harmoniser les notes, non pas sur l’ensemble du territoire, mais au sein du ressort d’un même centre régional de formation professionnelle des avocats. L’ambition en la matière est toutefois bien mince puisque l’article 10 de l’arrêté se borne à prévoir une comparaison des moyennes obtenues par les candidats et des prévisions de réussite avec celles des autres centres d’examen organisant l’accès au même CRFPA. Outre que cette mise en perspective ne concernera que les centres d’examen d’une même région (alors que les disparités sont constatées d’une région à une autre et particulièrement entre Paris et la province), elle ne présente qu’un caractère incitatif. L’idée n’est toutefois pas absurde et l’on peut espérer que, informé du caractère atypique des résultats qu’il s’apprête à proclamer, un jury d’examen en tiendra compte pour se déterminer à l’occasion d’une délibération. L’influence d’une telle information ne sera toutefois que marginale car, par hypothèse, les notes auront déjà été attribuées et saisies sur le logiciel d’édition du procès-verbal de délibération. On imagine mal que toutes les notes puissent être modifiées sur la foi de comparaisons de moyennes d’un IEJ à un autre et ce d’autant moins que les délais très brefs, prévus pour l’annonce des résultats, excluent de fait que l’on procède à un nouvel examen des copies.
B – Le déroulement de l’examen
11. Recevabilité de la candidature. Les conditions de présentation à l’examen d’accès ne sont pas modifiées. S’agissant des diplômes dont doit justifier le candidat, l’arrêté prévoit désormais qu’il doit s’agir des 60 premiers crédits d’un master en droit ou de l’un des titres ou diplômes prévus au 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971. Si ces 60 crédits n’ont pas été obtenus antérieurement, ils pourront l’être au cours de l’année universitaire. Il reviendra au centre d’examen de vérifier la recevabilité du dossier de candidature. On regrettera à cet égard que n’ait pas été reprise la règle, posée par l’article 4 de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au CRFPA, selon laquelle le président de l’université arrête, huit jours avant la date de la première épreuve de chaque session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l’examen, formalité qui présentait l’avantage de donner un tour officiel à l’arrêté définitif de la liste des candidats.
De même, reste inscrite dans le décret gouvernant l’examen, la règle selon laquelle « nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen ». Faut-il comprendre que ces trois présentations au maximum ne valent que pour l’examen nouvelle mouture, issu de la présente réforme, qui remettrait alors à zéro le compteur des présentations autorisées, ou bien que la permanence de cet examen d’accès suffit à considérer que c’est toujours le même qui est passé, de sorte que les échecs sous l’empire des textes antérieurs doivent être décomptés en dépit des aménagements dont les épreuves font l’objet ? Les textes n’apportent aucun éclaircissement à cet égard et les deux analyses peuvent être soutenues. Celle qui se fonde sur la continuité dans l’organisation de l’examen paraît plus convaincante, même si elle prive les candidats de cette aubaine de ne pas se voir opposer leurs précédentes tentatives infructueuses.
12. Calendrier. L’examen d’accès au CRFPA comporte toujours des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission. Deux sessions doivent donc se succéder selon un calendrier plus contraint que par le passé. Jusqu’à présent, il était prévu que l’examen avait lieu une fois par an à partir du 15 septembre, selon un calendrier fixé par le président de chaque université chargée de l’organiser. Aucune date limite n’était alors indiquée pour l’affichage des résultats, même si les contraintes de fonctionnement du CRFPA local imposaient de lui fournir le plus tôt possible dans le courant du mois de décembre une liste d’étudiants admis à suivre la formation. Un calendrier est désormais imposé puisque les épreuves d’admissibilité débuteront dans tous les centres d’examen le 1er septembre de chaque année – ou le premier jour ouvrable qui suit – selon un calendrier fixé par arrêté conjoint du garde des Sceaux et du ministre chargé de l’Enseignement supérieur. Les résultats d’admissibilité devront être publiés le même jour par tous les centres d’examen et ce, dix jours avant le début des épreuves orales d’admission qui débuteront le 2 novembre de chaque année – ou le premier jour ouvrable qui suit – selon un calendrier fixé par le président de l’université. Une autre contrainte de délai fait son apparition dans le régime de l’examen puisque le jury devra arrêter le 1er décembre de l’année de l’examen – ou le premier jour ouvrable suivant – la liste des candidats déclarés admis.
On notera enfin que si les résultats d’admission sont arrêtés et publiés par chaque centre régional d’examen, les listes des candidats admis sont rendues publiques au niveau national, ce qui symboliquement permet d’insister sur la dimension nationale que la réforme a entendu conférer à cet examen.
13. Intendance ? Connais pas… Si l’on sait que c’est une commission nationale qui forge les sujets des épreuves écrites, rien n’est dit sur les modalités de transmission de ces sujets aux centres régionaux ou encore sur la nécessité de prévoir un sujet de secours en cas de difficultés rencontrées avec le premier. Ces questions sont pourtant importantes et l’on espère que la commission nationale les abordera dès qu’elle sera constituée. Il aurait fallu prévoir que, non seulement la commission nationale va devoir rédiger les sujets, mais encore qu’elle va devoir en assurer la reproduction et l’expédition à chacun des 42 centres d’examen. À défaut, le risque de divulgation des sujets est considérable. Même adressés par courrier recommandé aux 42 universitaires responsables, les sujets risquent de ne plus demeurer secrets si l’on procède ainsi. La seule solution est que les sujets en nombre suffisant parviennent dans chaque centre d’examen sous pli scellé qui ne sera ouvert que le jour de l’épreuve par une personne habilitée par le président du jury. Il n’y a là qu’un exemple des nombreuses difficultés matérielles qui ne vont pas manquer de se présenter et qui ont totalement échappé aux rédacteurs des nouveaux textes, peu diserts sur cette logistique de l’examen pourtant décisive.
On peut espérer que la commission nationale d’élaboration des sujets se dotera rapidement d’un règlement intérieur, qui s’emploiera à régler toutes les difficultés matérielles susceptibles de se présenter, ce que l’article 3 de l’arrêté l’invite à faire lorsqu’il indique qu’il revient à son président de fixer les conditions de son fonctionnement.
14. Détermination des documents utilisables. Selon l’article 8 de l’arrêté, il revient à la commission nationale d’indiquer quels sont les documents pouvant être utilisés par les candidats au cours des épreuves écrites d’admissibilité. Elle doit le faire au moins deux mois avant le début de chaque épreuve et l’on peut espérer qu’elle le fera le plus en amont possible pour permettre aux étudiants d’entreprendre leurs révisions et leur préparation en ayant connaissance des ouvrages qu’ils seront autorisés à utiliser. Étonnamment, il n’est pas prévu d’établir une liste de documents autorisés pour l’épreuve de grand oral, silence qui paraît exclure l’usage de tous codes et recueils désormais, ce qui nous paraît être le résultat d’un regrettable oubli.
15. Notation. Les modalités de correction des copies n’évoluent guère. Il reste prévu que les épreuves d’admissibilité sont organisées de manière à préserver l’anonymat des candidats, que chaque copie est évaluée par deux correcteurs et qu’elle reçoit une note de 0 à 20. Pour être admissibles, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves écrites. Il en va de même à l’issue des épreuves d’admission puisque, pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves d’admissibilité et d’admission. On saluera le rejet des surenchères peu opportunes, proposées au cours de la préparation de la réforme, visant à prévoir des notes éliminatoires ou une moyenne renforcée à 12/20.
II – Le contenu de l’examen
Le mérite de la réforme est d’opérer une simplification du contenu de l’examen qui repose désormais sur un nombre plus limité tout à la fois d’épreuves et d’options proposées. En revanche la distinction entre des épreuves d’admissibilité et d’admission demeure structurante, les étudiants n’étant admis à passer les oraux qu’à la condition d’avoir obtenu la moyenne aux écrits.
A – Les épreuves d’admissibilité
16. Maintien du nombre d’épreuves et limitation du nombre de matières. Après comme avant la réforme, il est prévu que l’admissibilité n’est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise, ce qui va de soi mais méritait sans doute d’être précisé.
Sur le fond, l’effort de simplification est moins net en ce que sont en cause les épreuves d’admissibilité, qui restent au nombre de quatre, là où une précédente mouture de la réforme avait proposé de supprimer l’épreuve de droit des obligations. Cette piste a finalement été abandonnée, le ministre allant même jusqu’à affirmer non sans humour que cette suppression n’avait jamais été envisagée9.
Au programme de ces épreuves d’admissibilité, on retrouve la note de synthèse d’un dossier constitué à partir de documents relatifs aux aspects juridiques des problèmes sociaux, politiques, économiques ou culturels du monde actuel. Toujours rédigée en cinq heures, elle voit son cœfficient passer de deux à trois, ce que nous sommes enclin à regretter.
La deuxième épreuve porte sur le droit des obligations. Toujours d’une durée de trois heures, l’arrêté ne prévoit plus qu’elle doit permettre « d’apprécier l’aptitude du candidat au raisonnement juridique ». On se gardera toutefois d’en déduire quoi que ce soit quant à la finalité de cette épreuve, dont on voit mal quel autre objet elle pourrait avoir. L’importance du droit des obligations se voit rehaussée puisque la note passe d’un cœfficient un à deux. L’annexe de l’arrêté précise que le programme de cette épreuve inclut non seulement le droit des contrats et de la responsabilité civile, le régime général de l’obligation mais encore le droit de la preuve.
Une troisième épreuve écrite de trois heures porte sur une matière de spécialité. Affectée d’un cœfficient deux, elle a pour objet un ou plusieurs cas pratiques traitant, au choix du candidat, d’une des six matières parmi le droit civil, le droit des affaires, le droit social, le droit pénal, le droit administratif ou le droit international et européen. Le choix par le candidat de la matière de spécialité dans laquelle il entend composer doit intervenir en même temps que l’inscription, c’est-à-dire avant le 31 décembre de l’année précédent l’examen. Cette troisième épreuve n’est pas sans évoquer celle qui existe aujourd’hui et qui se trouve donc maintenue au prix d’une heureuse limitation du nombre de matières proposées, dont on rappellera qu’il était avant la réforme au nombre excessif de onze10.
Pour dissiper l’incertitude pouvant découler de l’imprécision des intitulés de matière retenus, l’arrêté précise opportunément pour chacune d’elles les limites du programme de l’examen. L’épreuve de spécialité de droit civil portera ainsi sur le droit des biens, le droit de la famille, le droit des régimes matrimoniaux, le droit des contrats spéciaux et le droit des sûretés. L’épreuve de spécialité de droit des affaires portera sur ce que l’on désigne comme le droit commercial général (commerçants, actes de commerce, fonds de commerce), le droit des sociétés commerciales, le droit des procédures collectives et le droit des opérations bancaires et financières. Cette dernière branche du droit gagnerait à vrai dire à être mieux identifiée car le terme « opérations financières » est ambiguë et peut renvoyer à des domaines très variés selon que l’on en retient une acception large ou étroite. L’épreuve de spécialité de droit du travail portera sur le droit du travail, le droit de la protection sociale, le droit social international et européen. L’épreuve de droit pénal aura pour objet le droit pénal général, le droit pénal spécial, le régime spécial de l’enfance délinquante, le droit pénal des affaires, le droit pénal du travail, le droit pénal international et européen. L’épreuve de spécialité de droit administratif portera sur le droit administratif général et spécial. Celle de droit international et européen portera sur le droit international privé, le droit international public, le droit du commerce international et le droit européen. On le voit l’étendue de ces différents programmes est assez variable et l’on peut redouter que certains candidats déterminent leur choix de matière de spécialité sur la foi de critères d’opportunité, c’est-à-dire en considération de la plus ou moins grande amplitude du programme.
Enfin la quatrième épreuve écrite portera, au choix du candidat, sur la procédure civile et les modes alternatifs de règlement des conflits, la procédure pénale ou la procédure administrative contentieuse. Désormais, le candidat n’est plus libre de choisir la matière de procédure qu’il passera puisque ce choix sera déterminé par la matière de spécialité pour laquelle il aura opté. Ceux qui auront choisi le droit civil, le droit des affaires ou le droit social devront passer l’épreuve de procédure civile, ceux ayant choisi le droit pénal devront composer en procédure pénale, ceux ayant choisi le droit administratif en procédure administrative contentieuse et ceux ayant choisi le droit international et européen auront le choix entre la procédure civile ou administrative. L’épreuve intitulée « procédure civile et modes alternatifs de règlement des différends » portera sur ces deux objets d’étude mais également sur les procédures civiles d’exécution. L’épreuve de procédure pénale ne se limitera pas à cette matière mais portera également sur le droit de l’exécution des peines. Quant à la procédure administrative contentieuse, son programme est articulé autour du triptyque : compétence, recours, instance.
Les textes ne précisant pas la nature de l’épreuve de droit des obligations et de procédure, il reviendra à la commission nationale de le préciser, ce qu’il faut espérer qu’elle fera rapidement pour permettre aux étudiants de se préparer à une épreuve pouvant prendre la forme d’un cas pratique, d’un commentaire d’arrêt ou de texte, voire de manière plus improbable, d’une dissertation.
B – Les épreuves d’admission
17. Simplification. C’est au stade de l’admission que la simplification apparaît la plus spectaculaire puisque sont purement et simplement supprimées les épreuves orales dites de spécialité, de sorte que disparaît avec elles le dispositif de dispenses prévu par l’article 54 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, lequel se trouve abrogé. Les candidats ne subissent plus l’épreuve orale qui pouvait porter sur le droit des personnes et de la famille, le droit patrimonial, le droit pénal général et spécial, le droit commercial et des affaires, les procédures collectives et sûretés, le droit administratif, le droit public des activités économiques, le droit du travail, le droit international privé, le droit communautaire et européen ou le droit fiscal des affaires. Ils échappent également à l’épreuve orale portant sur les procédures civiles d’exécution ou sur la procédure communautaire et européenne ainsi qu’à celle portant sur la comptabilité privée ou les finances publiques.
L’article 51 du décret n’en prévoit pas moins que l’examen comporte une ou plusieurs épreuves d’admission. La formule est intéressante car elle signifie que les rédacteurs du décret ont entendu se réserver la possibilité de modifier le nombre d’épreuves d’admission. En l’état de l’article 7 de l’arrêté tel qu’il vient d’être publié, il y en a deux, l’une dite de grand oral, l’autre de langue.
18. Le grand oral. Le grand oral est maintenu mais son objet et son régime se trouvent modifiés. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire lorsque les promoteurs de la réforme font imprudemment passer sa durée à 45 minutes, durée sans équivalent pour des épreuves orales. Désormais, à l’issue d’une préparation d’une heure, le candidat présente un exposé de quinze minutes, suivi d’un entretien de trente minutes avec le jury. Trente minutes de jeu de question/réponse… Ce n’est plus de grand oral qu’il faut désormais parler mais du « long oral », très long, trop long… La durée d’un tel examen est parfaitement inhabituelle dans nos facultés et même au-delà. Certes, c’est la durée du grand oral de l’ENA ou celle d’une leçon pour le concours d’agrégation de droit mais, précisément, cet examen d’accès – qui n’est pas un concours – n’est ni le grand oral de l’ENA, ni l’agrégation, étant précisé que les épreuves de ces deux concours sont passées par quelques dizaines de candidats, là où ils sont des milliers pour l’examen d’accès à la profession d’avocat. Cet allongement de la durée de l’épreuve n’est un cadeau ni pour le candidat, qui risque de se trouver à la peine, ni pour le jury, qui risque de se battre les flancs pour consommer tout ce temps disponible, là où tout examinateur un peu expérimenté sait bien que trente minutes suffisent amplement pour se faire une idée de la qualité de la prestation du candidat.
Plus convaincante est en revanche la modification de l’objet même de l’épreuve qui porte toujours sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux mais qui doit permettre désormais d’apprécier les connaissances du candidat, sa culture juridique (et non pas « la » culture juridique comme il est écrit par erreur à l’article 7, 1° de l’arrêté), et son aptitude à l’argumentation et à l’expression orale, là où jusqu’à présent le sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux ne visait qu’à apprécier l’aptitude à l’argumentation et à l’expression orale du candidat. La note est affectée d’un cœfficient qui passe de trois à quatre. Le programme de l’épreuve fixé par l’annexe de l’arrêté prévoit quatre thèmes : la culture juridique générale, l’origine et les sources des libertés et droits fondamentaux, le régime juridique des libertés et droits fondamentaux, les principales libertés et les principaux droits fondamentaux. Cette introduction de la culture juridique dans le programme du grand oral est à nos yeux l’innovation la plus convaincante de toutes celles que consacre la réforme.
19. L’épreuve de langue anglaise. Enfin, une épreuve de langue est maintenue pour une interrogation dont les textes ne prévoient ni la nature ni la durée puisqu’ils se bornent à prévoir que le candidat devra composer en langue anglaise. Cette note est affectée d’un cœfficient un.
Les concepteurs de la réforme n’étaient sans doute pas très sûrs de leur fait en consacrant ce triomphe de l’anglais puisqu’ils ont prévu que, à titre transitoire, et jusqu’à la session 2020 incluse, les candidats pourront choisir d’être interrogés non seulement en anglais mais encore en allemand, arabe classique, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, portugais ou russe, comme le permet aujourd’hui le régime de l’examen. De fait, cette réduction de l’horizon linguistique à la seule langue anglaise est contestable à de nombreux égards, au point que l’on peut se demander s’il n’y a pas là une discrimination prohibée, tant il est choquant d’imposer à tous les candidats de composer en langue anglaise, là où certains n’ont jamais pratiqué cette langue et ne comptent jamais le faire. La meilleure des solutions n’aurait-elle pas été de supprimer purement et simplement l’épreuve de langue ? Bien sûr qu’il est souhaitable de pratiquer des langues étrangères et que pour beaucoup de praticiens l’anglais sera rien de moins qu’une langue de travail. Mais n’est-ce pas alors à l’avocat de faire son affaire de la pratique de la langue si cela présente un intérêt pour son exercice professionnel ? Il est bien d’autres choses que l’avocat devra connaître et dont l’examen d’accès ne vérifie pas la maîtrise. Quel avocat pourra, par exemple, pratiquer la fiscalité ou le droit des fusions et acquisitions s’il ne maîtrise pas la comptabilité et l’analyse financière ? Pourtant, fort opportunément, les textes ne se préoccupent plus de vérifier la maîtrise de ces matières et c’est très bien ainsi. Il aurait dû en aller de même pour les langues et ce d’autant plus que c’est une vue de l’esprit d’imaginer que tous les avocats exercent leur profession en pratiquant des langues étrangères. Même s’il n’existe pas, semble-t-il, de statistiques connues sur le sujet, on peut estimer qu’une majorité d’avocats ne pratique pas de manière habituelle une langue étrangère dans leur cadre professionnel. C’est dire si l’idée n’allait pas de soi de faire de la maîtrise d’une langue étrangère une condition de l’accès au barreau et ce même si la portée de cette exigence reste limitée puisque la note n’est affectée que d’un cœfficient un.
Quant au choix de se limiter à la seule langue anglaise, il présente une incontestable vertu simplificatrice mais l’inconvénient d’afficher une préférence pour un idiome qui ne peut que susciter des passions par les valeurs et les images qu’il véhicule. Politiquement, ce choix de la seule langue anglaise est désastreux. Alors que nos meilleurs ennemis anglais viennent de quitter l’Union, que le prestige des Américains reste durablement terni par le scandale Wikileaks et par le fiasco de leur politique étrangère belliciste, il est étonnant de payer un tel tribut à cette langue qui, pour être celle du commerce international, n’en est pas moins celle d’une civilisation anglo-saxonne qui n’est pas complétement la nôtre. Au plan des symboles, ce choix de soumission au modèle « anglo-saxon » par adoption de la langue qui le véhicule est une décision politique aussi forte que malheureuse par le peu de cas qu’elle fait des liens d’intense affection qui nous lient à d’autres peuples européens. Indépendamment de l’utilité qu’elles présentent pour l’exercice de la profession d’avocat, il nous semble que toutes les langues européennes proposées (allemand, anglais, espagnol, italien, portugais et russe) auraient dû être maintenues.
Notes de bas de pages
-
1.
On peut se demander s’il n’aurait pas été préférable de prévoir une entrée en vigueur immédiate des nouveaux textes, sans préjudice de la soumission aux textes anciens de la session d’examen actuellement en cours. Il est prévu que le décret entrera en vigueur le 1er janvier 2017 et l’arrêté « à la session de l’examen 2017 ». Cette formulation est malheureuse. Outre que l’on ne comprend pas bien la justification de cette différence de libellé pour préciser la date d’entrée en vigueur de ces deux textes qui poursuivent un unique objet, on peut regretter l’imprécision de la formule retardant l’entrée en vigueur de l’arrêté « à la session de l’examen 2017 ». Faut-il comprendre que cette session commence dès que les étudiants s’inscrivent à l’université, c’est-à-dire en octobre 2016, ou bien que la session de l’examen 2017 ne débute qu’avec les premières épreuves de l’examen, c’est-à-dire le 1er septembre 2017 ? Cette seconde analyse apparaît plus conforme à la lettre du texte mais elle présente l’inconvénient de retarder l’entrée en vigueur de cet arrêté au 1er septembre 2017, là où certaines de ses dispositions gouvernent en réalité les conditions de l’inscription au centre d’examen, laquelle intervient pour la prochaine session bien avant septembre 2017 et dès le dernier trimestre 2016. Par exemple, comment imposer à un étudiant de s’inscrire avant le 31 décembre de l’année précédente l’examen, et donc cette année avant le 31 décembre 2016, comme l’impose désormais, l’article 2 de l’arrêté, si ce texte ne rentre en vigueur qu’en septembre 2017 ?
-
2.
D. n° 2016-1389, 17 oct. 2016 qui modifie les conditions d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats.
-
3.
A. 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats (ci-après l’arrêté).
-
4.
V. infra n° 7.
-
5.
V. infra n° 6.
-
6.
V. infra n° 13.
-
7.
V. infra n° 9.
-
8.
D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 51-1 nouv.
-
9.
Mandon T., Entretien in JCPG 2016, 1059, provocant les remarques malicieuses de Mazeaud D., in « Du rififi chez les juristes », JCP G 2016, 1126.
-
10.
A. 11 sept. 2003, art. 6, 3° prévoyait la possibilité de choisir entre le droit des personnes et de la famille, le droit patrimonial, le droit pénal général et spécial, le droit commercial et des affaires, le droit des procédures collectives et des sûretés, le droit administratif, le droit public des activités économiques, le droit du travail, le droit international privé, le droit communautaire et européen et droit fiscal des affaires.