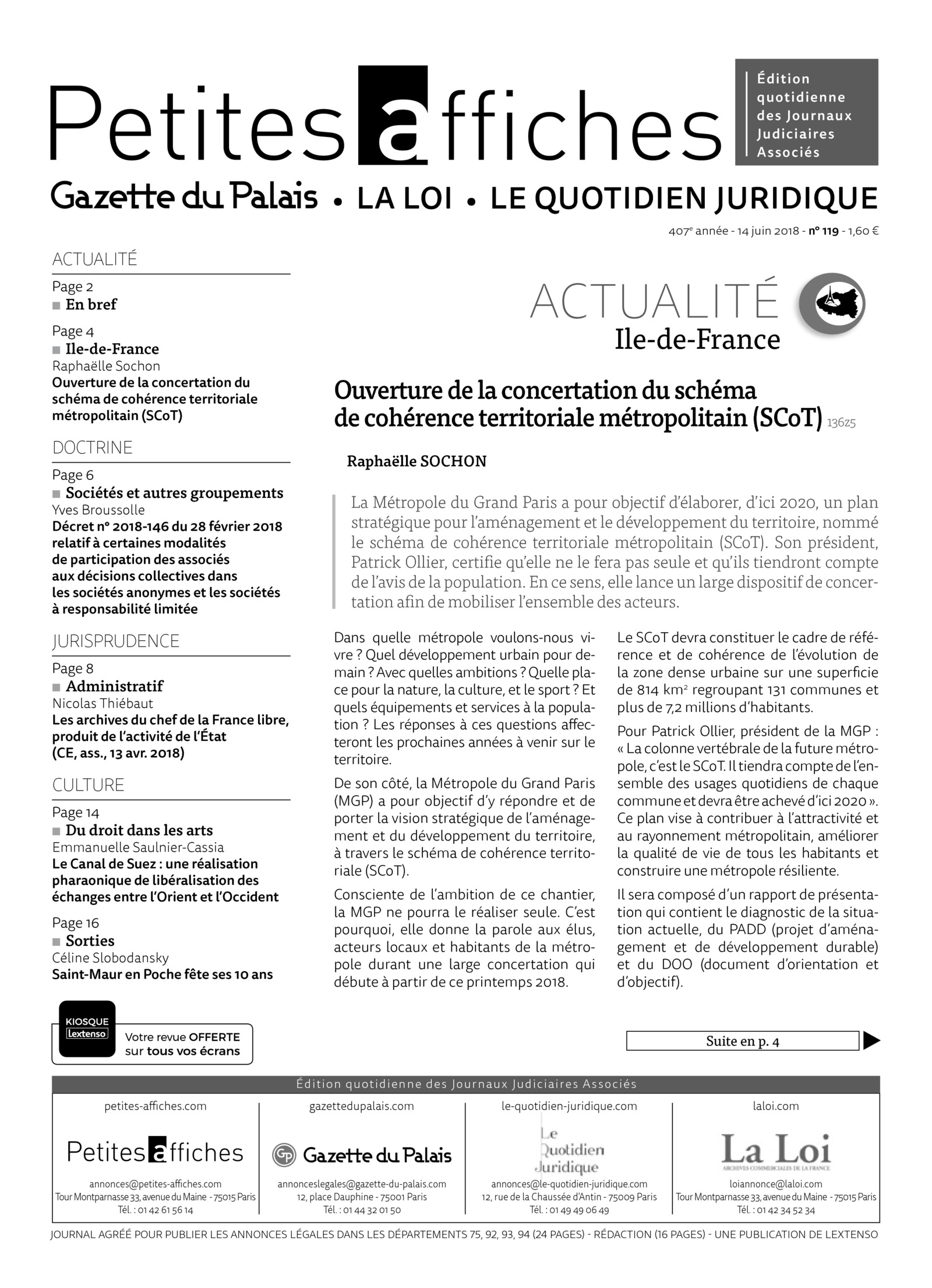Les archives du chef de la France libre, produit de l’activité de l’État
La France libre agissait-elle pour le compte de l’État durant la Seconde Guerre mondiale ? C’est à cette délicate question que le juge administratif devait répondre afin de déterminer si des brouillons de télégrammes rédigés par le général de Gaulle alors qu’il était à la tête de cette organisation revêtaient la qualité d’« archives publiques ». Dans sa formation la plus solennelle, le Conseil d’État répond par l’affirmative en estimant que la France libre et ses diverses expressions ont été, à compter du 16 juin 1940, « dépositaires de la souveraineté nationale et ont assuré la continuité de la République ».
CE, ass., 13 avr. 2018, no 410939, Assoc. du Musée des lettres et manuscrits et a.
Le juriste ne porte pas la même paire de lunettes que l’historien. Les faits qui sont portés à sa connaissance « n’ont aucune consistance propre, s’ils n’ont d’abord reçu leur signification d’une loi »1. C’est en ayant à l’esprit cette idée – qui rappelle que le juriste est chargé de dire au sujet d’une situation ce qu’il en est en droit – qu’il convient d’aborder l’analyse de cette décision par laquelle le Conseil d’État, amené à statuer sur la nature d’archives publiques de documents produits par Charles de Gaulle lorsqu’il était à la tête de la France libre, va reconnaître que cette organisation et ses diverses expressions ont été, à compter du 16 juin 1940, « dépositaires de la souveraineté nationale et ont assuré la continuité de la République ».
Dans cette affaire, le ministre de la Culture et de la Communication revendiquait2 313 brouillons de télégrammes adressés par le général de Gaulle entre 1940 et 1942 à divers responsables civils et militaires de la France libre ainsi qu’à plusieurs chefs d’État. Ces documents étaient à l’origine détenus par la secrétaire de l’état-major du général à Londres puis à Alger. Ils ont été vendus en 2010 par son héritier à la société Aristophil et au Musée des lettres et manuscrits. En novembre 2011, quelques jours avant l’inauguration d’une exposition qui devait être consacrée à ces documents dans ce musée, le ministère de la Culture et de la Communication formait une action en revendication. La société et le musée demandèrent toutefois le retrait de cette demande et refusèrent de se plier à celle en restitution formulée par le ministère à cette occasion. En conséquence, l’État décida de les faire citer devant le tribunal de grande instance de Paris en avril 2012 aux fins de revendication de ces manuscrits.
Si le TGI avait retenu le caractère d’archives publiques de ces documents et fait droit à la demande en revendication3, la cour d’appel, saisie dans la foulée, avait pour sa part estimé que « les débats sur le statut de la France libre dans les années 1940-1942 ne sont pas sans soulever des difficultés tant d’un point de vue juridique qu’historique »4. En conséquence, faisant application pour la première fois de la réserve relative à la compétence du juge judiciaire en matière d’actions en revendication formulée par le Tribunal des conflits dans sa jurisprudence Murat de Chasseloup-Laubat5, la cour d’appel, confrontée à « une difficulté sérieuse » quant à « l’appartenance ou non de ces manuscrits au domaine public », décidait de formuler une question préjudicielle à l’adresse du juge administratif. Confirmant le jugement du tribunal administratif du 12 mai 20176, le Conseil d’État reconnaît en l’espèce la qualité d’archives publiques des documents en cause.
Pour ce faire, la haute juridiction administrative a dû résoudre plusieurs difficultés. Il s’agissait tout d’abord de préciser dans quelle mesure les dispositions permettant à l’État de procéder à la revendication d’archives publiques, issues de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, étaient applicables à des documents produits en 1940-1942. Le juge administratif admet en l’espèce la possibilité de revendiquer en dégageant, sans référence textuelle, un principe préexistant à la loi de 1979 selon lequel « tout document procédant de l’activité de l’État constitue, par nature, une archive publique » (I). Cet obstacle surmonté, il s’agissait de s’interroger sur la nature d’archives publiques des documents en cause. Le Conseil d’État leur octroie cette qualité après avoir reconnu, sur le fondement de l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, que la France libre et les organisations lui ayant succédé ont été les seules autorités légales ayant agi pour le compte de l’État à compter du 16 juin 1940 (II). Le juge administratif estime toutefois qu’une telle conclusion est sans incidence sur la possibilité d’engager la responsabilité de l’État du fait des agissements de « l’autorité de fait se disant “gouvernement de l’État français” », non plus que sur la qualité d’archives publiques des documents produits par ladite autorité (III).
I – La « découverte » d’un principe général de « publicité » des archives procédant de l’activité de l’État
La reconnaissance du caractère d’archives publiques des documents produits par le général de Gaulle entre 1940 et 1942 posait un problème d’applicabilité de la loi dans le temps. En vertu de l’article L. 212-1, alinéa 3, du Code du patrimoine, l’État est habilité à revendiquer des archives publiques qui se trouvent en mains privées. La décision de revendiquer les brouillons de télégrammes du général de Gaulle découlait donc de leur qualification d’archives publiques. Or c’est la loi du 3 janvier 1979 qui a défini cette notion. Se trouvait ainsi posée la question de l’applicabilité à des documents produits en 1940-1942 d’une définition posée en 1979.
À l’audience, le rapporteur public a rappelé la contradiction que posait l’application de ces dispositions aux documents d’espèce avec l’article 2 du Code civil qui prohibe tout effet rétroactif de la loi7. En conséquence, il a encouragé le Conseil d’État à soulever le moyen d’ordre public relatif à l’applicabilité ratione temporis de l’article L. 211-4 du Code du patrimoine. Afin de résoudre cette difficulté, le Conseil d’État, suivant en cela la proposition de son rapporteur public, a « découvert » une définition des archives publiques préexistante à la loi de 1979. Il a ainsi partiellement déconnecté la définition d’archive publique de ce texte en estimant que « tout document procédant de l’activité de l’État constitue, par nature, une archive publique » (pt 2). En essentialisant la notion d’archive publique, le juge administratif est amené à considérer que cette définition « a été reprise par l’article 3 de la loi du 3 janvier 1979 aujourd’hui codifié à l’article L. 211-4 du Code du patrimoine » (pt 2, nous soulignons).
Le juge judiciaire s’était déjà attelé à la résolution de ce problème d’applicabilité de la loi dans le temps. À propos de la revendication de documents d’un maréchal d’Empire, le TGI de Paris avait ainsi estimé que cette opération ne représentait pas « une atteinte à la non-rétroactivité des lois de 1979 et 2009, celles-ci portant seulement rappel, définition et codification d’un principe ancien préexistant de l’imprescriptibilité du domaine public »8.
La solution dégagée par le juge administratif permet de mettre en conformité une opération de revendication d’archives publiques antérieure à 1979 avec le principe de non-rétroactivité de la loi. Elle répond dans le même temps à la nécessité de pouvoir revendiquer des documents importants pour l’histoire nationale avant cette même date. À cet égard, si l’intérêt patrimonial d’un document n’en fait pas une archive publique, il incite le juge à adapter son raisonnement pour faire entrer le document dans cette qualification. Toutefois, en conformité avec les principes qui le guident lorsqu’il dégage notamment des principes généraux du droit9, la « découverte » à laquelle procède le Conseil d’État n’apparaît pas comme « le fruit d’une démarche arbitraire »10. Une telle solution peut en effet certainement se prévaloir de l’ancienneté du caractère public des archives produites par l’État. Celui-ci paraît en effet déjà attesté sous l’Ancien Régime où le roi rappelle régulièrement le droit de la couronne sur les documents produits par ses agents11.
Si l’autonomisation de la définition d’archive publique à laquelle le Conseil d’État procède rend à l’avenir indifférent pour cette qualification « la date à laquelle [les documents] ont été produits », il faut enfin noter que sont également indifférents selon lui leur « état d’achèvement » tout comme « l’intention de l’auteur ». Ainsi, le caractère de « brouillon » n’empêche pas un document d’accéder à la qualité d’archive publique12, pas plus que le fait que son auteur ne les considérait pas comme tel.
Ces éléments étant indifférents, le problème de la qualification comme archive publique des documents en cause se concentre dès lors sur leur caractérisation comme « procédant de l’activité de l’État ».
II – La qualité d’archives publiques déduite de la qualification de la France libre comme gouvernement légal de l’État
La définition des archives publiques étant applicable à la période de la France libre, encore convenait-il de démontrer que les brouillons de télégrammes en cause « procéd[aient] de l’activité de l’État ». Ceux-ci ayant été produits par le général de Gaulle alors qu’il était à la tête de la France libre, il s’agissait de déterminer si cette organisation avait agi pour le compte de l’État.
Pour ce faire, à l’origine de cette affaire, le TGI de Paris avait adopté une approche in concreto. Il avait ainsi retenu que la France libre et les organisations qui lui avaient succédé s’étaient employées à « assurer la représentation de la France sur le terrain de la politique internationale », que le général de Gaulle avait « signé des actes normatifs, procédé à des nominations et donné des instructions » qui « constitu[aient] des actes de gouvernement », etc. Le choix de cette approche paraissait devoir s’expliquer par le fait que, selon le juge judiciaire, la France libre ne disposait pas d’une reconnaissance légale, ce qui impliquait de rechercher dans les faits si elle avait agi au nom de l’État. Admettant la qualité d’archives publiques des documents en cause sans pour autant reconnaître le caractère légal de la France libre, le TGI paraissait de ce fait considérer cette organisation comme un « gouvernement de fait », ainsi que l’avait défendu le ministère de la Culture et de la Communication. Or ce n’est pas l’approche que va retenir le Conseil d’État dans l’affaire commentée. En effet, si la haute juridiction administrative reconnaît également que la France libre a agi pour le compte de l’État, c’est sur le fondement de l’ordonnance du 9 août 194413.
L’article 1er de cette ordonnance dispose que « la forme du gouvernement de la France est et demeure la République. En droit celle-ci n’a pas cessé d’exister » ; l’article 2 de la même ordonnance en déduit que « sont, en conséquence, nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels législatifs ou réglementaires, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, sous quelque dénomination que ce soit, promulgués sur le territoire continental postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu’au rétablissement du gouvernement provisoire de la République française. » À partir du rappel de ces dispositions, le juge administratif parvient à la conclusion selon laquelle « la France libre et la France combattante et, par la suite, le comité français de la libération nationale et le gouvernement provisoire de la République française, ont été, à compter du 16 juin 1940, dépositaires de la souveraineté nationale et ont assuré la continuité de la République » (pt 4). Dès lors, selon le Conseil d’État, les documents d’archives en cause constituent un produit de l’État et revêtent la qualité d’archives publiques : « Il s’ensuit que les documents qui émanent de ces institutions et de leurs dirigeants procèdent de l’activité de l’État et constituent, dès lors, des archives publiques » (pt 4).
Ainsi, si le juge judiciaire comme le juge administratif admettent que la France libre a agi pour le compte de l’État, ils n’empruntent pas le même chemin pour parvenir à cette conclusion. Les deux juges paraissent ainsi réaliser une analyse différente de la portée de l’ordonnance de 1944 et en particulier de son article 1er qui prévoit l’intangibilité de la République. Certes, ainsi que l’écrivait Georges Vedel, il faut déduire de l’ordonnance de 1944 que, « depuis le 16 juin 1940, il n’y a pas eu sur le territoire métropolitain d’autorité politique juridiquement habilitée à émettre valablement, fût-ce à titre provisoire, une règle de droit »14. Pour autant faut-il déduire a contrario du principe d’intangibilité de la République que la France libre et ses diverses expressions sont rétroactivement instituées comme seules autorités ayant agi légalement au nom de la France depuis le 16 juin 1940 ?
Parmi les premiers commentateurs de l’ordonnance de 1944, un certain nombre d’auteurs paraît n’avoir attaché qu’une portée politique et idéologique à l’énoncé du principe selon lequel « en droit [la République] n’a jamais cessé d’exister. » En 1947, Georges Burdeau écrit ainsi que « cette affirmation ne doit pas être entendue comme signifiant que la Troisième République, fondée sur les lois de 1875, a survécu aux événements de juin 1940 et que, provisoirement éliminée sur le territoire métropolitain, elle serait demeurée en vigueur dans les institutions de la France libre. (…) En réalité, la proclamation de la survivance de la République a une portée moins constitutionnelle que philosophique et politique »15. De même, un peu plus tôt, Marcel Waline avait noté que la « République » qui était maintenue au sens de l’article 1er de l’ordonnance, consistait dans « un régime démocratique, électif, et, au moins politiquement, libéral », avant d’ajouter : « Une telle affirmation sort, malgré les apparences, du domaine juridique. Elle ressort du droit naturel et de la politique »16. Ces auteurs ne semblent donc pas déduire du texte de l’ordonnance que la France libre et ses successeurs auraient été institués rétroactivement en tant que gouvernement légal de la France depuis le 16 juin 1940. Si l’on admet que le juge judiciaire a adopté cette interprétation de l’ordonnance de 1944, on comprend qu’il ait dû rechercher si, à défaut de disposer d’un titre légal à gouverner, la France libre avait malgré tout effectivement gouverné.
Pour sa part, le juge administratif franchit le pas. Dans son jugement du 12 mai 2017, le tribunal administratif de Paris avait déjà déduit des deux premiers articles de l’ordonnance que « la République française n’a pu avoir pour gouvernement légal, postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu’au rétablissement du GPRF, que la France libre, puis la France combattante, puis le GPRF, qui ont assuré la continuité républicaine, reniée dans le même temps par l’autorité de fait se disant “gouvernement de l’État français” ». À ce titre, le rapporteur public avait estimé que « si la République s’incarne, au jour de l’ordonnance, dans le GPRF, alors les ancêtres de ce gouvernement provisoire ont été, du 16 juin 1940 à la Libération, les seules autorités légales placées à la tête de l’État »17. C’est à la même conclusion que paraît parvenir Emmanuel Cartier dans sa thèse, quand il estime que l’ordonnance de 1944 désigne la France libre « comme la seule autorité légale en charge des intérêts de la République, qui, en droit, n’a jamais cessé d’exister, depuis le 16 juin 1940 »18. Cette interprétation paraît s’inscrire dans l’intention de ses auteurs, plaçant la France libre dans la continuité de la IIIe République19. À Georges Bidault qui le pressait de proclamer la République le 25 août 1944 à l’hôtel de ville de Paris, de Gaulle aurait ainsi répondu : « La République n’a jamais cessé d’être. La France libre, la France combattante, le Comité français de la libération nationale l’ont, tour à tour, incorporée. Vichy fut toujours et demeure nul et non avenu. Moi-même suis le président du gouvernement de la République. Pourquoi irais-je la proclamer ? »20.
Si le Conseil d’État déduit la qualité d’archives publiques de la reconnaissance du titre légal de la France libre à gouverner, il a tenu à assurer la coordination de cette jurisprudence avec celle relative aux agissements du gouvernement de Vichy.
III – La compatibilité avec la reconnaissance juridique des faits et agissements du gouvernement de Vichy
Si le caractère d’archives publiques est reconnu à des documents produits par la France libre, était-il possible de qualifier de la même manière des documents produits au même moment par le gouvernement de Vichy ?
Le Conseil d’État répond positivement à cette question et prend ainsi la peine de certifier la compatibilité de la décision qu’il prend en l’espèce avec deux séries de décisions antérieures rendues en matière de responsabilité de la puissance publique et d’archives publiques. Il estime en effet qu’est « sans incidence » à l’égard de la reconnaissance du caractère d’archives publiques des documents d’archives en cause « la circonstance que les faits et agissements de l’autorité de fait se disant “gouvernement de l’État français” et de l’administration française qui en dépendait engagent la responsabilité de la puissance publique, le débiteur de cette responsabilité ne pouvant être que l’État. N’y fait pas davantage obstacle la circonstance que doivent être regardés comme des archives publiques les documents procédant de l’activité politique et administrative de cette autorité de fait » (pt 5).
En matière de responsabilité, le Conseil d’État paraît ainsi écarter une contradiction qui pourrait résider dans le fait d’indemniser des requérants pour des actes commis par une autorité dont il rappelle en l’espèce l’inexistence juridique en même temps que l’exclusivité du statut légal de la France libre. D’ailleurs, pendant longtemps, le Conseil d’État avait estimé que la constatation de nullité des actes du gouvernement de Vichy qui découlait de l’ordonnance de 1944 valait « pour les effets découlant de l’application » de ces actes et, qu’en conséquence, une mesure en ayant fait application devait « être regardée comme constituant un acte dépourvu de base juridique » ne pouvant donner lieu à réparation21. En l’espèce, l’absence de contradiction relevée par le Conseil d’État paraît constituer un rappel de sa décision Papon22 et, surtout, de son avis Hoffman-Glémane23 par lequel il avait au contraire estimé que l’obligation pour l’État de réparer découlait de cette déclaration de nullité. Dans son avis de 2009, le juge avait en effet relevé qu’« en sanctionnant l’illégalité manifeste de ces actes qui, en méconnaissance des droits fondamentaux de la personne humaine tels qu’ils sont consacrés par le droit public français, ont établi ou appliqué une telle discrimination, les dispositions de l’ordonnance du 9 août 1944 ont nécessairement admis que les agissements d’une exceptionnelle gravité auxquels ces actes ont donné lieu avaient le caractère d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ».
En matière d’archives, le juge paraît vouloir écarter l’objection selon laquelle la qualité d’archives publiques pourrait être reconnue à deux autorités concurrentes qui auraient représenté l’État à un même moment. Le Conseil d’État l’admet nécessairement en l’espèce mais distingue leurs statuts au travers du prisme de l’ordonnance de 1944, en délivrant à la France libre un brevet de légalité tout en qualifiant le gouvernement de Vichy d’« autorité de fait ». Sur le plan du droit des archives, il reconnaît que des documents produits par une autorité de fait peuvent être considérés comme procédant de l’État au sens de l’article L. 211-4 du Code du patrimoine24. À ce titre, il faut donc considérer qu’il existe un critère alternatif pour déterminer si un document « procède de l’activité de l’État » au sens de cette disposition : « D’une part, le caractère légal de l’autorité dont le document émane ; d’autre part, le caractère effectif de l’autorité exercée, même illégalement, par l’auteur du document »25. En cela, le Conseil d’État rejoint, quant au résultat à tout le moins26, la position de la Cour de cassation qui a reconnu la qualité d’archives publiques de plusieurs documents rédigés par le maréchal Pétain lorsqu’il se trouvait à la tête de l’« État français »27.
Ainsi, si l’analyse juridique conduit le juge à reconnaître un caractère légal à la France libre, son office l’amène toutefois à ne pas faire sortir la réalité historique de son champ de vision.
Notes de bas de pages
-
1.
Thomas Y., « La vérité, le temps, le juge et l’historien », Le Débat 1998/5, n° 102, p. 22.
-
2.
Le Code du patrimoine prévoit la possibilité pour l’État de revendiquer des archives détenues en mains privées mais dont il estime qu’elles revêtent un caractère public. L’alinéa 3, de l’article L. 212-1, du Code du patrimoine dispose ainsi : « Le propriétaire du document, l’administration des archives ou tout service public d’archives compétent peut engager une action en revendication d’archives publiques ».
-
3.
TGI Paris, 20 nov. 2013, n° 12/06156, ministre de la Culture et de la Communication c/ Assoc. du Musée des lettres et manuscrits et Sté Aristophil.
-
4.
CA Paris, 15 mai 2015, n° 13/23875, Assoc. du Musée des lettres et manuscrits et Sté Aristophil c/ ministre de la Culture et de la Communication.
-
5.
Conscient de l’atteinte au droit de propriété privée qu’une action en revendication implique, le Tribunal des conflits a retenu dans sa décision ministre de la Défense c/ Murat de Chasseloup-Laubat la compétence de principe du juge judiciaire pour connaître du contentieux relatif à ces actions. Il avait toutefois précisé qu’une telle solution était valable « sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle posée au juge administratif en cas de difficulté sérieuse portant sur la détermination du caractère public desdites archives » (T. confl., 9 juill. 2012, n° 3857, Murat de Chasseloup-Laubat).
-
6.
TA Paris, 12 mai 2017, n° 1602472/6-1.
-
7.
« La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. »
-
8.
Il ajoutait : « À défaut toute revendication d’archives historiques serait impossible, étant antérieures à ces dates. Or des arrêts rendus au XIXe siècle rappelaient déjà que les manuscrits sont partie intégrante du domaine public et propriété de l’État, même en possession de tiers. » (TGI Paris, 12 mai 2016, n° 14/16060).
-
9.
Genevois B. et Guyomar M., « Principes généraux du droit : panorama d’ensemble », in Répertoire de contentieux administratif, juin 2017, Dalloz, § 32.
-
10.
Ibid.
-
11.
V. not. Canavaggio P., « Les archives du pouvoir exécutif en France et à l’étranger I », La Revue administrative 1991, n° 259, p. 68-70.
-
12.
Sur ce point, v. déjà Cass. 1re civ., 22 févr. 2017, n° 16-12922, Sté Librairie Jean-Claude Vrain c/ État français, ministère de la Culture.
-
13.
Dans son jugement du 20 novembre 2013, le TGI avait eu recours à cette ordonnance mais uniquement pour constater que ce texte avait reconnu aux actes juridiques adoptés par la France libre et ses différentes expressions la qualité de « documents d’État ».
-
14.
Vedel G., Manuel élémentaire de droit constitutionnel, 1949, rééd. 2002, Paris, Dalloz, Bibliothèque Dalloz, p. 273.
-
15.
Et l’auteur de poursuivre : « Ce qui demeure en vigueur, c’est l’idéologie de la troisième République, c’est-à-dire, sur le plan politique, l’attachement au régime démocratique et représentatif, et, sur le plan social, le respect des libertés essentielles de l’homme, légalité des individus et leur affranchissement à l’égard de toute oligarchie. » (Burdeau G., Manuel de droit constitutionnel, 1947, Paris, LGDJ, p. 200).
-
16.
Waline M., « L’ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité républicaine », JCP G 1945, I, 441.
-
17.
Le fait que les articles 5 et 6 de l’ordonnance intégraient un grand nombre de textes de ces organisations à l’ordonnancement juridique applicable sur le territoire continental de la France devait selon lui être conçu comme une conséquence de ce statut qui leur était reconnu (AJDA 2017, p. 1569, concl. Marthinet L.).
-
18.
Cartier E., La transition constitutionnelle en France (1940-1945). La reconstruction révolutionnaire d’un ordre juridique « républicain », 2005, Paris, LGDJ, Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, p. 112.
-
19.
Mathieu B. et Verpeaux M., « La transition juridique : l’ordonnance du 9 août 1944 », in Fondation Charles de Gaulle, Le rétablissement de la légalité républicaine-1944, actes de colloque (Caen, 6, 7 et 8 oct. 1994), Paris, Éd. Complexe, Interventions, p. 815, 818-819.
-
20.
De Gaulle C., Mémoires de guerre, t. 2, 1956, rééd. 2010, Paris, Plon, Pocket, p. 361.
-
21.
CE, ass., 4 janv. 1952, Époux Giraud : Rec. 14.
-
22.
Par laquelle le Conseil d’État avait rompu avec sa jurisprudence antérieure en admettant la possibilité d’engager la responsabilité de l’État pour faute pour des actes commis par le gouvernement de Vichy (CE, ass., 12 avr. 2002, n° 238689, Papon : Lebon, p. 139).
-
23.
CE, ass., avis, 16 févr. 2009, n° 315499, Hoffman-Glémane : Lebon, p. 43.
-
24.
Dans le cas contraire, tout document produit, par exemple, par un gouvernement révolutionnaire devrait être écarté de la qualification d’archive publique.
-
25.
AJDA 2017, p. 1569, concl. Marthinet L.
-
26.
La Cour de cassation, comme le TGI à l’origine de l’affaire commentée au sujet de la France libre, n’a pas retenu dans l’affaire relative aux documents du maréchal Pétain, l’ordonnance du 9 août 1944 comme grille de lecture afin de déterminer la nature de l’« État français ». Elle s’est en effet contentée de relever que les documents en cause « émanaient de Philippe Pétain, alors chef de l’État français » (Cass. 1re civ., 22 févr. 2017, préc., nous soulignons). Demeure là une divergence entre les deux cours suprêmes.
-
27.
Cass. 1re civ., 22 févr. 2017, préc.