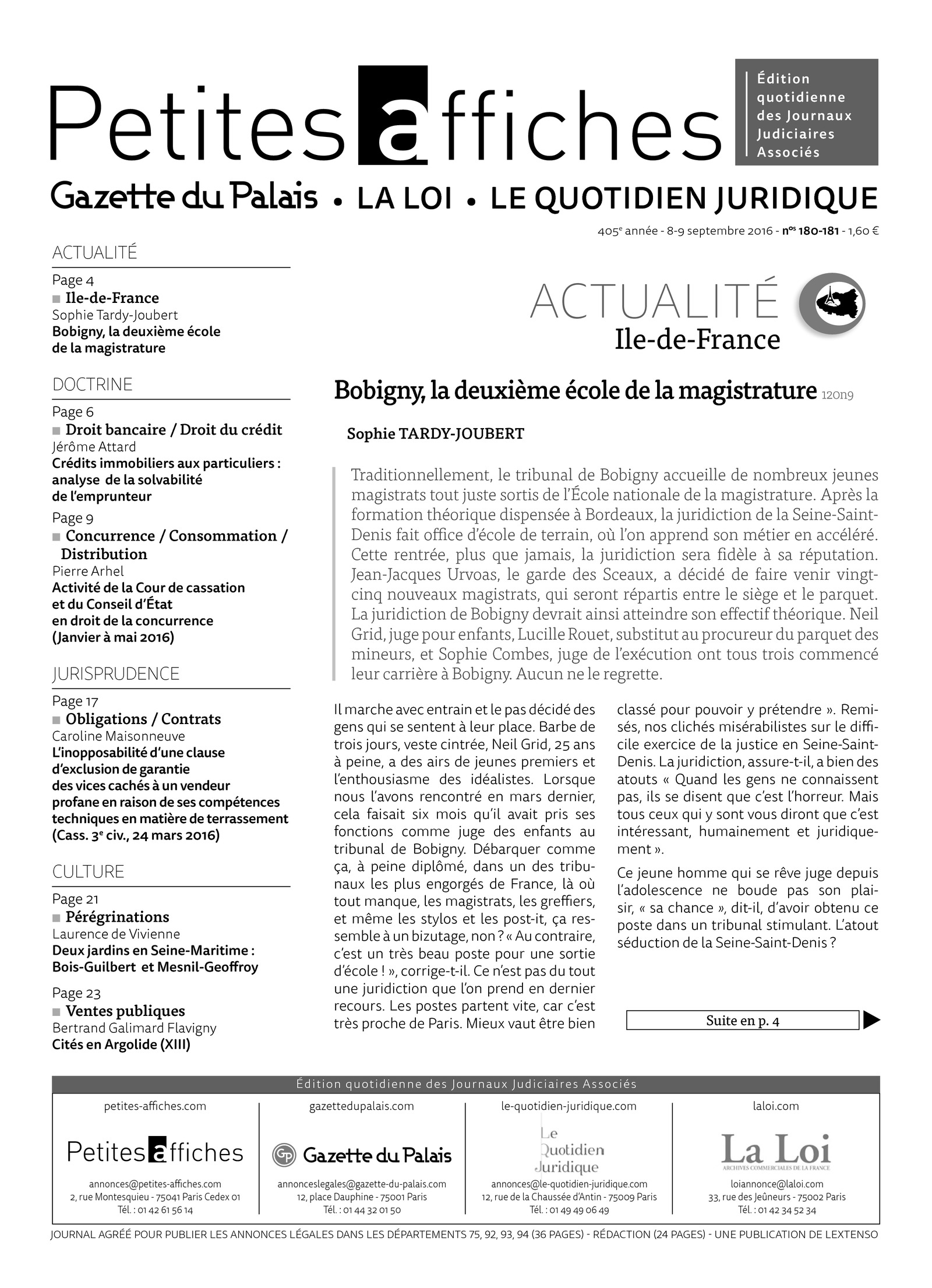Activité de la Cour de cassation et du Conseil d’État en droit de la concurrence (Janvier à mai 2016)
La présente étude porte sur les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d’État en droit de la concurrence au sens du livre IV du Code de commerce. Plusieurs domaines sont théoriquement concernés. La Cour de cassation se prononce d’abord sur les arrêts que la cour d’appel de Paris rend lorsqu’elle est saisie d’un recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence ; elle est également saisie des arrêts rendus par les cours d’appel en matière de « transparence », « pratiques restrictives de concurrence » et « autres pratiques prohibées », au sens du titre IV du livre IV du Code de commerce ; elle est aussi compétente en matière de visite et de saisies opérées sur le fondement de l’article L. 450-4 du Code de commerce ; enfin, elle se prononce sur les décisions rendues dans le cadre de litiges entre opérateurs économiques. Quant au Conseil d’État, il suffit, pour mesurer l’étendue de sa compétence, de rappeler que le droit de la concurrence fait partie intégrante du bloc de la légalité administrative. L’étude porte sur la période de janvier à mai 2016.
I – Questions prioritaires de constitutionnalité
A – Question relative à la conformité des dispositions du paragraphe III de l’article L. 442-6 relatives à l’amende civile
La chambre commerciale a, le 18 février 20161, saisi le Conseil constitutionnel, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société ITM Alimentaire International SAS sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe III de l’article L. 442-6 du Code de commerce qui permet au ministère public, au ministre chargé de l’Économie et au président de l’Autorité de la concurrence de demander le prononcé d’une amende civile visant à sanctionner les pratiques restrictives de concurrence énumérées par le texte.
Selon la société requérante, il résulte de ces dispositions qu’une personne morale bénéficiaire d’une fusion absorption peut se voir infliger une amende civile à raison de pratiques restrictives de concurrence imputables à une autre personne morale disparue dans le cadre de cette fusion absorption. Il en résulterait une méconnaissance du principe de personnalité des peines selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait.
À l’appui de ce grief, elle faisait valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation repose sur le fait que la répression des pratiques restrictives de concurrence vise des entreprises, et qu’il est donc possible de sanctionner la personne morale à laquelle l’exploitation de l’entreprise est transmise. Or les textes relatifs à la répression des pratiques restrictives de concurrence font expressément référence à l’« auteur » des pratiques, et la logique de la Cour de cassation pour la répression des ententes et des abus de position dominante ne saurait être dupliquée pour la répression des pratiques restrictives.
Pour le Conseil constitutionnel, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe de personnalité des peines.
Dans une motivation de principe, il observe que « appliqué en dehors du droit pénal, le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait peut faire l’objet d’adaptations, dès lors que celles-ci sont justifiées par la nature de la sanction et par l’objet qu’elle poursuit et qu’elles sont proportionnées à cet objet » (pt 6).
En ce qui concerne, en premier lieu, l’amende civile instituée par les dispositions contestées, qui sanctionne les pratiques restrictives de concurrence, le Conseil relève qu’elle a la nature d’une sanction pécuniaire (pt 7).
S’agissant de l’objet que poursuit la disposition en cause, il observe qu’en définissant au paragraphe I de l’article L. 442-6 du Code de commerce, « l’auteur » passible de ces sanctions pécuniaires comme étant « tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre des métiers », le législateur se réfère à des activités économiques, quelles que soient les formes juridiques sous lesquelles elles s’exercent (pt 8).
Ne peut donc être retenu l’argument de la société requérante, selon lequel le législateur aurait distingué la répression des pratiques restrictives, qui viserait des « auteurs », de la répression des ententes et abus de position dominante, laquelle viserait des « entreprises ». Une telle distinction dans la répression en matière de concurrence revêt un caractère artificiel.
Le Conseil a par ailleurs constaté que « les amendes civiles prévues par les dispositions du paragraphe III de l’article L. 442-6 ont pour objectif, pour préserver l’ordre public économique, de sanctionner les pratiques restrictives de concurrence qui sont commises dans l’exercice des activités économiques mentionnées par le paragraphe I de cet article » (pt 8). Dès lors, il est cohérent avec l’objectif poursuivi par cette répression que soit apporté un tempérament de cette nature au principe de personnalité des peines. Le Conseil relève à cet égard que « l’absorption de la société auteur de ces pratiques par une autre société ne met pas fin à ces activités, qui se poursuivent au sein de la société absorbante » (pt 8). Il pose cependant une limite au tempérament apporté au principe de personnalité des peines en précisant que seule une personne bénéficiaire de la transmission du patrimoine d’une société dissoute sans liquidation est susceptible d’encourir l’amende prévue par les dispositions contestées (pt 9)2.
B – Question mettant en cause l’absence de voie de recours immédiate et autonome contre les mesures d’enquête simple
À l’occasion du pourvoi formé par la société Brenntag contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 septembre 2015 dans le cadre de l’affaire des commodités chimiques, la Cour de cassation a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions suivantes : faute de prévoir une voie de recours immédiate et autonome contre les mesures d’enquête simple adoptées sur le fondement de l’article L. 450-3 du Code de commerce, les articles L. 450-3 et L. 464-8 sont-ils : (i) contraires au droit à un recours juridictionnel effectif, consacré à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ? (ii) contraires aux droits de la défense et au droit au procès équitable, consacrés à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ? (iii) contraires au droit de ne pas s’auto-incriminer, consacré à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ? (iv) contraires au droit à la protection du domicile privé, au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances, consacrés aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 au profit des opérateurs économiques professionnels, qu’ils exercent en tant que personne morale ou en tant que personne physique ? (v) entachés d’incompétence, au regard de l’article 34 de la Constitution3?
Dans la décision qu’il a rendue le 8 juillet 2016, le Conseil constitutionnel répond par la négative à l’ensemble des questions. Il déclare en effet conforme à la Constitution les dispositions contestées. Ainsi, n’est pas méconnu le droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789.
Selon le Conseil constitutionnel, les demandes de communication d’informations et de documents formulées sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 450-3 du Code de commerce ne sont pas en elles-mêmes des actes susceptibles de faire grief. En effet, si les dispositions contestées imposent de remettre aux agents habilités les documents dont ces derniers sollicitent la communication, elles ne leur confèrent ni un pouvoir d’exécution forcée pour obtenir la remise de ces documents, ni un pouvoir général d’audition ou un pouvoir de perquisition. Il en résulte que seuls les documents volontairement communiqués peuvent être saisis. La circonstance que le refus de communication des informations ou documents demandés puisse être à l’origine d’une injonction sous astreinte prononcée par l’Autorité de la concurrence, d’une amende administrative prononcée par cette autorité ou d’une sanction pénale ne confère pas une portée différente aux pouvoirs dévolus aux agents habilités par les dispositions contestées (pt 7).
Et d’ajouter que si une procédure est engagée contre une entreprise à la suite d’une enquête administrative pour pratique anticoncurrentielle ou si une astreinte ou une sanction est prononcée à l’encontre d’une entreprise, la légalité des demandes d’informations peut être contestée par voie d’exception. En outre, en cas d’illégalité de ces mesures, même en l’absence de décision faisant grief, le préjudice peut être réparé par le biais d’un recours indemnitaire4.
II – Contentieux des opérations de visite et de saisie
A – Contentieux de l’autorisation des opérations de visite et de saisie
Dans son pourvoi n° 14-85324 contre l’ordonnance n° 379 du premier président de la cour d’appel de Rennes, en date du 2 juillet 2014, qui a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la DGCCRF à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, la société Compagnie armoricaine de transports a fait valoir que le juge n’a pas vérifié que le ministre chargé de l’Économie avait, conformément aux exigences des articles L. 450-5 et D. 450-3 du Code de commerce, informé le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, avant leur déclenchement, des investigations qu’il souhaitait voir mener, et dès lors, n’a pas procédé au contrôle qui lui incombait aux termes des dispositions de l’article L. 450-4, alinéa 2 du Code de commerce.
Le moyen est rejeté au motif que la demanderesse est sans qualité pour invoquer l’absence d’information du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence par le ministre chargé de l’Économie, prévue par l’article 450-5 du Code de commerce, dès lors que cette disposition constitue une mesure d’administration dont l’éventuelle méconnaissance ne lui fait pas grief.
Par un deuxième moyen, la demanderesse reprochait par ailleurs à l’ordonnance attaquée de n’avoir pas mentionné la faculté pour la personne visée de saisir le juge des libertés et de la détention de tout incident au cours des opérations effectuées chez elle.
La chambre criminelle le rejette également en énonçant qu’aucune disposition de l’article L. 450-4 du Code de commerce ne prévoit que les occupants des lieux doivent recevoir une information sur la possibilité de recourir au juge des libertés et de la détention ayant autorisé les opérations de visite et saisie aux fins qu’il exerce son contrôle sur la régularité des mesures en cours, la faculté de contester cette décision devant le premier président de la cour d’appel leur garantissant un recours juridictionnel effectif5.
B – Contentieux du déroulement des opérations de visite et de saisie
1 – Opérations de visite et de saisie dans les locaux de la Société réunionnaise du radiotéléphone
Des opérations de visite et de saisie dans les locaux de la Société réunionnaise du radiotéléphone, dans le but de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, ont été l’occasion, pour la chambre criminelle, de préciser comment l’entreprise visitée peut saisir le juge des libertés et de la détention d’un incident lié au déroulement des opérations.
En l’espèce, au cours desdites opérations, le 12 septembre 2013, les enquêteurs de l’administration de la DGCCRF, agissant en vertu d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 10 septembre 2013, ont effectué des opérations de visite et de saisie dans les locaux de la Société réunionnaise du radiotéléphone, dans le but de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. À 18h15, l’avocat de cette société a, par l’intermédiaire d’un substitut du procureur, joint au téléphone le juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des opérations, afin de lui demander de régler un incident relatif à la saisie d’un certain nombre de documents couverts par le secret des correspondances entre avocat et client, mais le juge a refusé d’examiner cette requête.
Pour annuler l’ensemble des opérations, le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a retenu que la Société réunionnaise de radiotéléphone, qui avait le droit de saisir le juge des libertés et de la détention sans passer par l’intermédiaire de l’officier de police judiciaire, n’a pas bénéficié de façon effective de la garantie fondamentale du contrôle de l’exécution de la visite et des saisies par ce magistrat, alors qu’elle invoquait un incident sérieux relatif à la saisie de correspondances avocat-client.
Cette analyse n’est pas partagée par la Cour de cassation qui, au visa de l’article L. 450-4 du Code de commerce, énonce que l’occupant des lieux ne dispose pas du droit de saisir lui-même le juge qui a autorisé la visite et la saisie, les officiers de police judiciaire chargés d’assister aux opérations devant, au cours de la visite, tenir ce magistrat informé des difficultés rencontrées.
Rappelons à cet égard que l’article L. 450-4 dispose, dans son troisième alinéa, que « La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne le chef du service qui devra nommer les officiers de police judiciaire chargés d’assister à ces opérations et d’apporter leur concours en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires, ainsi que de le tenir informé de leur déroulement ». Quant au dernier alinéa, il prévoit que « Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières ».
Au final, la Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l’ordonnance du premier président de la cour d’appel et, pour qu’il soit à nouveau jugé, renvoie la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion autrement présidée6.
2 – Opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société Compagnie armoricaine de transports
Par son pourvoi n° 14-85325 contre l’ordonnance n° 380 du premier président de la cour d’appel de Rennes, en date du 2 juillet 2014, qui s’est prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées par la DGCCRF en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, la société Compagnie armoricaine de transports a fait valoir diverses violations de ses droits de la défense.
La chambre criminelle juge l’ordonnance attaquée exempte d’insuffisance comme de contradiction. Ce faisant, elle confirme qu’aucune disposition de l’article L. 450-4 du Code de commerce ne prévoit que les occupants des lieux doivent recevoir une information sur la possibilité de recourir au juge des libertés et de la détention ayant autorisé les opérations de visite et saisie aux fins qu’il exerce son contrôle sur la régularité des mesures en cours.
La chambre criminelle répond par ailleurs à un moyen par lequel la société Compagnie armoricaine de transports reprochait aux enquêteurs la saisie massive et indifférenciée de messageries informatiques dans ses locaux brestois alors que les techniques informatiques actuelles permet la sécabilité des messageries et que la saisie globale de données informatiques non limitées aux faits reprochés dans de telles conditions est prohibée. À cet égard, elle approuve l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a constaté que les saisies opérées sur les postes de trois personnes ont été circonscrites et non massives et proportionnées aux nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles.
Enfin, la Cour rappelle que l’annulation de la saisie de pièces couvertes par le secret de la correspondance entre avocat et client ne saurait avoir pour effet d’invalider la saisie de tous les autres documents7.
III – Recours en annulation contre des actes de soft law
Réuni en assemblée du contentieux, formation qui statue sur les affaires d’importance majeure et les grandes étapes de la jurisprudence, le Conseil d’État s’est déclaré compétent pour connaître des recours en annulation contre des actes de soft law tels que des communiqués de presse ou des prises de position d’autorités publiques, jugés jusqu’alors non susceptibles de recours juridictionnels dès lors qu’ils ne produisent aucun effet juridique.
Retiendra plus particulièrement l’attention l’affaire relative à l’exécution de la décision par laquelle l’Autorité de la concurrence avait, le 23 juillet 2012, autorisé le rachat de TPS et CanalSatellite par Vivendi et le groupe Canal Plus sous certaines conditions, y compris la condition, dite « injonction 5(a) », qui a posé des difficultés d’application à la suite de la prise de contrôle exclusif de SFR par Numericable, en novembre 2014. Le groupe Canal Plus avait alors, par une lettre en date du 23 janvier 2015, demandé à l’Autorité de la concurrence de constater la fusion des plates-formes de Numericable et de SFR et de prendre position sur l’incidence de cette fusion sur l’exécution de l’injonction 5(a) à cet égard. Par une délibération de la commission permanente de l’Autorité de la concurrence du 23 mars 2015, dont le sens et les motifs ont été révélés à la société requérante par la lettre en date du 31 mars 2015 que lui a adressée le président de l’Autorité, celle-ci a répondu qu’elle estimait que, de fait, une des obligations en résultant était devenue sans objet. Cette prise de position de l’Autorité de la concurrence, qui ne modifiait pas par elle-même l’injonction 5(a) a fait l’objet d’un recours en annulation par la société Numericable.
Le Conseil d’État rappelle d’abord que les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les autorités de régulation dans l’exercice des missions dont elles sont investies, peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou lorsqu’ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance.
Il innove ensuite en énonçant que « ces actes peuvent également faire l’objet d’un tel recours, introduit par un requérant justifiant d’un intérêt direct et certain à leur annulation, lorsqu’ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s’adressent ; que, dans ce dernier cas, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité de ces actes en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité de régulation ; qu’il lui appartient également, si des conclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d’injonction qu’il tient du titre Ier du livre IX du Code de justice administrative » (cons. 5).
En l’espèce, la haute juridiction administrative considère que la prise de position adoptée par l’Autorité de la concurrence le 23 mars 2015 est de nature à avoir des effets économiques notables ; elle a, en outre, pour objet de modifier le comportement des opérateurs sur le marché de l’acquisition de droits de distribution de chaînes de télévision ; dans ces conditions, la délibération attaquée doit être regardée comme faisant grief à la société NC Numericable ; la fin de non-recevoir soulevée par l’Autorité de la concurrence est donc écartée (cons. 6).
La haute juridiction écarte par ailleurs un moyen tiré de ce que l’Autorité de la concurrence n’était pas compétente pour modifier la portée pratique de l’injonction 5(a). Elle juge en effet que, en vertu de l’article L. 430-7 du Code de commerce, il appartient à l’Autorité de veiller à la bonne exécution des engagements pris par les parties devant elle aux fins de remédier aux effets anticoncurrentiels d’une opération de concentration, des injonctions dont elle a assorti aux mêmes fins l’autorisation de l’opération, ou des prescriptions, imposées aux parties, de nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence, tout au long de la période d’exécution de ces engagements, injonctions ou prescriptions (cons. 8)8.
On notera enfin que, le même jour, le Conseil d’État a adopté une position analogue en acceptant de juger un recours en annulation contre des communiqués de presse de l’Autorité des marchés financiers appelant les investisseurs à la vigilance9.
IV – Communication de documents
A – Documents couverts par le secret des affaires
À l’origine de cette affaire, la société E-Kanopi, qui exploitait plusieurs sites internet pour lesquels elle avait souscrit un compte AdWords auprès de la société Google et qui éditait, également, les sites « iadah » pour lesquels elle avait ouvert un compte AdSense, a saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le groupe Google dans le secteur de la publicité en ligne liée aux recherches, en soutenant que les coupures brutales de ses comptes AdWords et AdSense par la société Google, en mai et juin 2010, présentaient un caractère discriminatoire et constituaient des pratiques d’abus de position dominante ayant pour effet l’éviction des entreprises concurrentes de la société Google. Le 21 décembre 2012, le rapporteur général de l’Autorité a donné acte à la société Google de sa demande de protection de documents au titre du secret des affaires et dit que seuls la version non confidentielle et le résumé des documents visés seraient communiqués aux autres parties à la procédure. Par décision du 28 février 2013, l’Autorité a rejeté la saisine de la société E-Kanopi, sur le fondement de l’article L. 462-8 du Code de commerce, faute d’être étayée d’éléments suffisamment probants. Enfin, par deux arrêts du 24 juin 2014, la cour d’appel de Paris a rejeté les recours formés par la société E-Kanopi contre chacune de ces décisions.
La chambre commerciale rejette les pourvois introduits contre ces arrêts de la cour d’appel. Ce faisant, elle approuve notamment l’arrêt des juges du fond en ce qu’ils ont jugé irrecevable le recours d’E-Kanopi contre la décision du rapporteur général de l’Autorité accordant la protection du secret des affaires.
Elle énonce à cet égard que le droit des parties de prendre connaissance des pièces remises à l’Autorité n’est pas un droit absolu et illimité et doit être mis en balance avec le droit des entreprises à la protection du secret de leurs affaires.
Et de préciser que ni le droit à un recours effectif ni le principe de la contradiction n’impliquent que la partie saisissante, qui n’a pas de droits de la défense à préserver dans le cadre de la procédure ouverte par l’Autorité sur sa saisine, laquelle en outre n’a pas pour objet la défense de ses intérêts privés, puisse obtenir la communication de documents couverts par le secret des affaires concernant la personne qu’elle a mise en cause, ni qu’elle puisse contester la décision de protection du secret des affaires prise à ce titre.
La Cour de cassation approuve également la cour d’appel de Paris d’avoir rappelé qu’il résulte des dispositions des articles L. 463-4 et R. 463-15 du Code de commerce qu’indépendamment de la faculté pour le rapporteur de demander le déclassement de pièces faisant l’objet d’une protection au titre du secret des affaires, s’il considère que ces pièces sont nécessaires à l’exercice des droits de la défense d’une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l’Autorité, seule une partie mise en cause peut demander la communication ou la consultation de la version confidentielle d’une pièce qu’elle estime nécessaire à l’exercice de ses droits. C’est donc à bon droit que les juges du fond ont retenu que la société E-Kanopi, partie saisissante, ne dispose pas d’une telle faculté et qu’elle n’est pas recevable à exercer un recours contre la décision accordant la protection du secret des affaires à l’égard de pièces concernant la personne qu’elle a mise en cause dans sa saisine.
Ajoutons pour ne plus y revenir que le même arrêt de la chambre commerciale rappelle qu’aucune disposition n’impose que le rapport oral du rapporteur et celui du rapporteur général aient préalablement revêtu une forme écrite et aient été communiqués aux parties. Dès lors, ayant constaté que la société E-Kanopi avait été mise en mesure de répliquer aux observations orales du rapporteur, la cour d’appel a, à bon droit, retenu que cette société n’était pas fondée à invoquer la violation du principe de la contradiction résultant de ce que les observations orales du rapporteur s’appuyaient sur un document écrit dont elle n’avait pas eu connaissance10.
B – Communication au plaignant d’un procès-verbal et d’un rapport d’enquête
Le Conseil d’État rejette le pourvoi contre un jugement du tribunal administratif de Paris qui a notamment enjoint à la DGCCRF de communiquer à un plaignant les documents recueillis dans le cadre d’une enquête de concurrence.
À l’origine de cette affaire, la DGCCRF a enregistré une plainte de la SARL Alter Nego, contre la société Euronext, pour pratiques discriminatoires et abus de position dominante. À l’issue de l’enquête, le directeur du cabinet du ministre de l’Économie a répondu que « au vu des éléments recueillis lors des investigations menées par les services du ministère, les pratiques d’Euronext ne semblent pas contrevenir aux dispositions du droit de la concurrence. Par conséquent, la DGCCRF n’entend pas poursuivre les investigations à ce titre ». Par un jugement du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la SARL Alter Nego, annulé la décision implicite de refus de communication de documents que l’Administration avait opposée à la société et enjoint au ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie de communiquer à la SARL Alter Nego le rapport ou le procès-verbal faisant ressortir les conclusions de l’enquête.
Pour rejeter le pourvoi contre ce jugement, le Conseil d’État rappelle d’abord que, aux termes des dispositions de la loi de 1978 : (i) « sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ; (ii) constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux ; (iii) ces documents doivent être communiqués aux personnes qui en font la demande ».
Il observe ensuite qu’en se bornant à soutenir, d’une part, que les seules pièces existantes dans le dossier, qui sont déjà en la possession de la SARL Alter Nego, seraient la plainte et les documents transmis par Euronext et, d’autre part, que la DGCCRF n’a produit ni rapport d’enquête, ni procès-verbal de recueil de déclarations, et pas davantage de procès-verbal d’analyse et de synthèse des documents reçus, le ministre ne fournit aucun élément ni explication permettant d’apprécier comment l’Administration a forgé sa position, ni à l’issue de quel processus interne et sur quels fondements elle a décidé l’arrêt des investigations relatives aux pratiques d’Euronext. Dans ces conditions, conclut le Conseil d’État, c’est sans entacher son jugement ni de dénaturation des pièces du dossier et ni d’erreur de droit au regard de la loi du 17 juillet 1978, que le tribunal administratif a estimé que l’inexistence des documents sollicités ne pouvait être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme établie.
Le Conseil ajoute que le tribunal administratif, pour estimer que des documents, parmi ceux dont la communication était sollicitée, avaient été établis au cours de l’enquête réalisée par la DGCCRF et pour en déduire, contrairement à ce que soutenait le ministre en défense, qu’ils existaient, a pu, sans commettre d’erreur de droit, se fonder, parmi d’autres circonstances, sur les dispositions de l’article L. 450-2 du Code de commerce qui prévoient que les enquêtes donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, et, le cas échéant, de rapports11.
V – Sanction pécuniaire pour manquement à l’obligation de notification d’une opération de concentration
On se souvient que, par décision n° 13-D-22 du 20 décembre 2013, l’Autorité de la concurrence a sanctionné à hauteur de 4 millions d’euros la société mère de Castel Frères, Copagef, pour ne pas avoir soumis à l’examen de l’Autorité, avant sa réalisation, la prise de contrôle de six sociétés du groupe Patriarche.
Cette décision a été réformée par le Conseil d’État qui a réduit le montant de la sanction à 3 millions d’euros. Certes, celui-ci estime, après l’Autorité de la concurrence, qu’un manquement à l’obligation de notification d’une opération de concentration constitue, en tant que tel et quelle que soit l’importance des effets anticoncurrentiels de cette opération sur le ou les marchés pertinents concernés, un manquement grave, dès lors qu’il fait obstacle au contrôle des opérations de concentration qui incombe à l’Autorité de la concurrence. Il estime par ailleurs que, pour fixer le montant de la sanction, il doit également être tenu compte, notamment, du caractère plus ou moins évident de l’existence d’une obligation, au regard des articles L. 430-1 et L. 430-2 du Code de commerce, de notifier l’opération de concentration, de la taille de l’entreprise concernée et de ses moyens humains, du caractère délibéré du manquement qu’elle commet, de l’intention qu’elle a, en le commettant, de contourner les règles de la concurrence, de la coopération qu’elle apporte au cours de la procédure ainsi que de sa situation financière.
En outre, pour fixer la sanction infligée à la société Copagef au montant de 4 millions d’euros, qui représente environ 10 % du montant maximum encouru et 0,5 % du chiffre d’affaires consolidé réalisé par le groupe en France, l’Autorité a pu, à bon droit, prendre en compte, la nécessité de conférer à cette sanction un caractère dissuasif compte tenu de la gravité intrinsèque d’un manquement à l’obligation de notification, de l’absence de toute difficulté à déterminer que l’opération en litige relevait bien du champ de cette obligation, du caractère délibéré du manquement, des moyens dont le groupe Castel disposait et de sa connaissance du mécanisme de contrôle des concentrations en raison de la notification récente d’une précédente opération.
Toutefois, le Conseil d’État réforme la décision de l’Autorité pour deux raisons. D’abord, la notification de l’opération de concentration litigieuse ayant été effectuée dans un bref délai après les premières demandes de justifications de l’Autorité, c’est à tort que celle-ci a, sur ce point, relevé l’absence de coopération de la société Copagef.
La haute juridiction estime par ailleurs qu’il y a lieu, de tenir compte de l’absence d’intention du groupe Castel de contourner les règles de la concurrence en réalisant sans notification préalable cette opération12 (l’Autorité avait au contraire retenu que l’unique objectif poursuivi par l’entreprise était la réalisation rapide de la concentration et que le groupe Castel s’est exonéré consciemment de la vérification du caractère contrôlable de l’opération, alors même que cette obligation était évoquée dans le protocole d’acquisition et qu’il avait la possibilité d’effectuer cette vérification).
VI – Rupture brutale de relation commerciale établie
Une entreprise se disant victime d’une rupture brutale de relation commerciale établie, au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, ne peut se prévaloir, pour le calcul de la durée de la relation commerciale, de la relation entretenue antérieurement par une autre entreprise de son groupe avec l’auteur de la rupture. Telle est la solution retenue par la chambre commerciale en approuvant un arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 juillet 2014.
En l’espèce, le 1er mai 2006, la société NMPP, devenue la société Presstalis, a conclu un contrat à durée déterminée pour la gestion du retour des journaux et périodiques invendus en France, avec la société Medialog, appartenant, comme la société Michel Logistique, prestataire antérieur pour cette activité de la société Presstalis, au groupe Transalliance ; la relation a été poursuivie pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, par un avenant précisant qu’à défaut de résiliation expresse dans les six mois, le contrat se poursuivrait par tacite reconduction pour une durée indéterminée, chacune des parties pouvant le résilier sous réserve d’un préavis de six mois ; par lettre du 29 mars 2011, la société Presstalis a résilié le contrat pour le 30 septembre suivant ; le 20 juillet 2011, elle a refusé la proposition de la société Medialog en réponse à son appel d’offres pour l’exploitation de son centre de retour CRL Nord ; cette dernière l’a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie.
Elle faisait d’abord grief aux juges du fond d’avoir dit que les relations commerciales entre elle et la société Presstalis ont débuté le 1er mai 2006, mais le moyen est rejeté. La Haute juridiction relève notamment que la lecture des contrats, signés par la société NMPP le 15 octobre 2003 avec la société Michel Logistique et le 1er mai 2006 avec la société Medialog, ne démontre pas la volonté des parties de faire reprendre par la société Medialog les droits et obligations de la société Michel Logistique, le second contrat ne se référant ni au nom de cette dernière, ni à une reprise d’un contrat antérieur. Par ailleurs, si le préambule du contrat signé le 1er mai 2006 mentionne l’appartenance de la société Medialog au groupe Transalliance, c’est pour justifier la capacité du prestataire à exploiter le contrat. Enfin, les prestations prévues et le centre de stockage ne sont pas les mêmes. Les hauts magistrats en concluent que la cour d’appel a pu déduire que les relations commerciales nouées entre la société NMPP et la société Medialog ont débuté par le contrat du 1er mai 2006 et, partant, que la relation commerciale établie entre les parties a existé du 1er mai 2006 au 30 septembre 2011.
La Cour de cassation a également rejeté un deuxième moyen qui se prévalait d’une rupture brutale après le lancement d’un appel d’offres : attendu que l’arrêt relève que dès le 29 mars 2011, la société Medialog savait que le contrat allait être résilié et qu’elle n’avait aucune garantie de remporter l’appel d’offres initié le 15 avril 2011 ; qu’il retient encore que le fait qu’elle n’ait été informée que le 20 juillet 2011 que ses offres n’étaient pas retenues est sans incidence ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que la société Medialog n’était pas fondée à croire que le préavis notifié le 29 mars 2011 n’avait pas couru, la cour d’appel a légalement justifié sa décision13.
Notes de bas de pages
-
1.
Cass. com., 18 févr. 2016, n° 15-22317.
-
2.
Cons. const., 18 mai 2016, n° 2016-542 QPC.
-
3.
Cass. com., 4 mai 2016, nos 15-25699 et 15-25701.
-
4.
Cons. const., 8 juill. 2016, n° 2016-522 QPC.
-
5.
Cass. crim., 9 mars 2016, n° 14-85324.
-
6.
Cass. com., 9 mars 2016, n° 14-84566.
-
7.
Cass. crim., 9 mars 2016, n° 14-8532.
-
8.
CE, 21 mars 2016, n° 390023.
-
9.
CE, 21 mars 2016, n° 368082.
-
10.
Cass. com., 19 janv. 2016, nos U 14-21670 et V. 14-21671.
-
11.
CE, 2 mai 2016, n° 375428.
-
12.
CE, 15 avr. 2016, n° 375658.
-
13.
Cass. com., 5 janv. 2016, n° 14-25397.