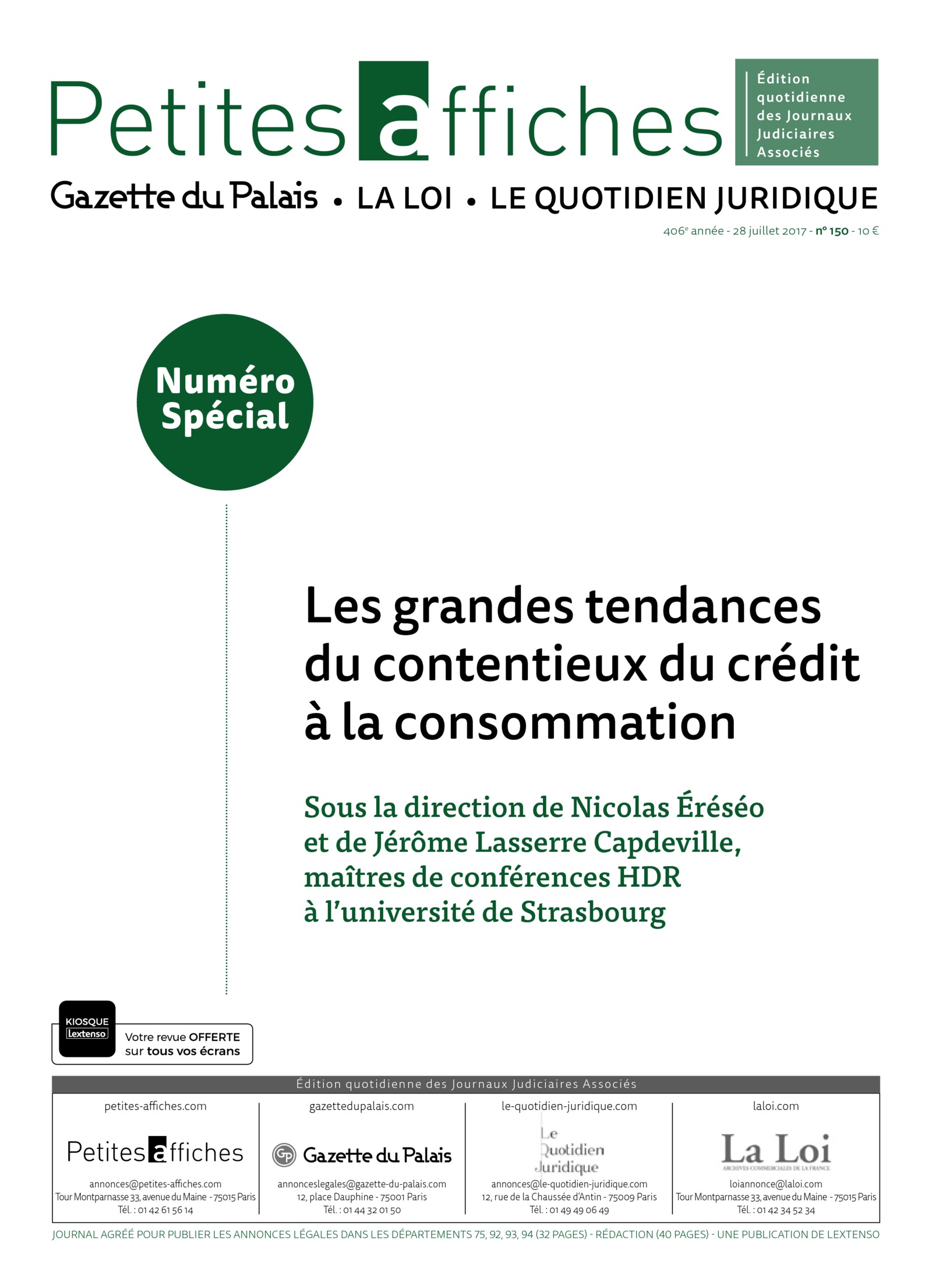La taille des caractères du contrat
De prime abord, en matière de prêt à la consommation, le droit offre un critère simple et objectif relativement à la taille des caractères du contrat : le prêteur est sanctionné s’il utilise une police inférieure à huit points. Des difficultés subsistent cependant quant à la manière de mesurer ces huit points, car différentes tailles de points coexistent.
« Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit »1. Le droit de la consommation participe de ces lois dont l’objectif affiché réside en la protection de la partie (prétendument) faible, ici le consommateur et le non-professionnel. Parce que les cocontractants n’ont pas la même puissance lors des négociations, le contrat conclu inquiète et il ne saurait être question de le soumettre, sans discernement, aux dispositions de l’article 1103 du Code civil2. Il en ressort une défiance certaine quant à son contenu, lequel échappe partiellement au principe de l’autonomie de la volonté. Pour ne citer qu’un seul exemple, il est des clauses qui, parce qu’elles sont considérées comme déséquilibrées, seront qualifiées d’abusives et réputées non écrites3.
Bien plus rares sont en revanche les interventions du législateur relativement à la forme du contrat. L’enjeu est pourtant loin d’être insignifiant. Dans les rapports entre consommateurs et professionnels, la convention est rarement le fruit d’une négociation : le contrat d’adhésion est rédigé et imposé comme un tout par la partie (prétendument) forte. Le risque est alors que cette dernière profite du fait d’être à l’origine de ce contrat – d’avoir seule la plume entre ses mains – pour y cacher des clauses défavorables à l’autre partie. Il ne s’agit plus de sanctionner un contenu abusif ou déséquilibré, mais d’assurer « la protection du consentement du consommateur, avec pour finalité de [justement] rétablir l’autonomie de la volonté des parties »4. L’illustration est classique : le consommateur, au jour où naît une contestation, se voit opposer les termes d’une clause qu’il n’avait simplement pas vue, écrite au bas du document, dans une police minuscule et de préférence dans une couleur claire sur un fond blanc.
Face à de tels comportements, certaines branches du droit ont réagi de manière ancienne, tout du moins s’agissant des stipulations les plus dangereuses. Il en est ainsi du Code des assurances dont l’article L. 112-4, alinéa 3, considère que « les clauses de police édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ». La taille des caractères est expressément mentionnée.
Le droit de la consommation, dans ses dispositions générales, est moins explicite. L’article L. 211-1 du Code de la consommation énonce uniquement que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible »5. Au contraire, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont plus précises : « le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit »6.
Cette exigence d’une taille minimum de la police du contrat est en réalité ancienne et largement évoquée, au-delà des seuls crédits à la consommation. Sa consécration dans ce dernier domaine, par le Code de la consommation, rassure a priori. Elle apparaît telle une démarche objective, vectrice de sécurité juridique (I). Il n’en demeure pas moins que la définition de cette taille « huit » continue de susciter de multiples débats (II).
I – Un critère objectif
L’article L. 211-1 précité, dès lors qu’il ne vise pas seulement la rédaction des clauses, mais également leur présentation, concerne assurément la mise en forme du contrat. La refonte du Code de la consommation7 conforte ce sentiment puisque le texte se situe désormais au sein d’un chapitre relatif à la « présentation des contrats ». Celle-ci doit être claire.
L’exigence, qui reprend en réalité les dispositions de l’ancien article L. 133-2, se rapproche assurément de la notion de lisibilité8. C’est d’ailleurs ce terme qui avait été proposé par l’article L. 97 du projet de Code de la consommation de 1990, réputant inopposables les clauses « peu lisibles en raison de leur présentation »9. L’interprétation de l’article 5 de la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives10, dont découle l’ancien article L. 133-2, va dans le même sens : « Le terme “clair” se rapporte à la présentation extérieure [du contrat], le terme “compréhensible” à l’intelligibilité »11. Cette exigence de clarté intéresse de la sorte divers aspects formels des caractères employés, notamment leur espacement12, leur couleur13 et, naturellement, leur taille.
À propos de ce dernier élément, il est largement invoqué par la Commission des clauses abusives, et ce de manière ancienne. Dès les années 1980, elle a pu recommander « que les conditions générales (…) soient intégralement, lisiblement et clairement reproduites »14. Elle est alors allée plus loin puisqu’elle a adopté des recommandations positives15 et objectives en ce domaine. Pour des contrats proposés par les clubs de sport à caractère lucratif, elle dénonçait un « manque de lisibilité » et proposait que la présentation matérielle des conventions obéisse à diverses règles, dont le fait « que les documents contractuels soient imprimés avec des caractères dont la hauteur ne saurait être inférieure au corps 8 »16. Cette même exigence sera reprise dans des domaines divers tels la location de certains biens mobiliers autres que les véhicules automobiles17, les contrats concernant la télésurveillance18 ou encore les formules d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples19.
Cette pratique des recommandations positives avait toutefois été abandonnée à partir de 2002. La Commission se contentait de mentionner ces défauts de forme dans les considérants introductifs des recommandations, déplorant par exemple qu’un document contractuel remis au non-professionnel ou au consommateur manque « de lisibilité contrairement aux exigences de l’[ancien] article L. 133-2 »20. Une récente recommandation en date du 24 mars 2016 a cependant renoué avec l’ancienne pratique, la Commission souhaitant, pour les contrats de déménagement, garde-meubles et stockage en libre-service, « que le contrat soit présenté de façon lisible et, notamment, avec des caractères qui ne soient pas inférieurs au corps 8 »21.
La jurisprudence invoque, pour sa part, les mêmes exigences. Dans un jugement du 31 janvier 2002, le tribunal de grande instance de Grenoble relevait de la sorte qu’il « résulte de l’examen du contrat type produit qu’il est rédigé en petits caractères rendant la lecture difficile »22. La cour d’appel d’Orléans critiquera pour sa part une clause « rédigée en petits caractères difficilement lisibles »23. De même, la cour d’appel de Nîmes invoquera des conditions générales « difficilement lisibles », car « les conditions de garantie sont écrites en très petits caractères »24. Soucieux de définir un critère plus objectif, le jugement précité du 31 janvier 2002 était allé plus loin, affirmant qu’il « y a lieu d’ordonner la suppression [des clauses qui seraient imprimées] en caractères inférieurs au corps 8 »25. À nouveau, le critère objectif semble résider dans une police de caractère de taille huit, lequel sera d’ailleurs repris dans une réponse ministérielle du 3 avril 201226.
Dans le domaine du crédit à la consommation, cette référence à une police de « taille huit » est également présente, mais cette fois de manière impérative. Elle est inscrite dans le Code de la consommation. Son article R. 312-10 dispose que « le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ». Il en va de même des contrats de location avec option d’achat27, des contrats en vue d’un découvert en compte28 et des documents d’information relatifs au regroupement de crédits29.
La sanction de ce texte est en outre très vigoureuse. L’article L. 341-4 du Code de la consommation dispose que « le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par [l’article L. 312-28] est déchu du droit aux intérêts ».
Le droit applicable aux crédits à la consommation consacre en définitive une tendance ancienne de la jurisprudence et de la Commission des clauses abusives, à savoir la volonté de mettre en œuvre un critère objectif quant à l’appréciation de la lisibilité du contrat. En faisant référence à une taille de police, la sécurité juridique semble, de prime abord, mieux préservée puisque la marge d’appréciation des juges serait largement restreinte. Toute forme de débat n’est pourtant pas écartée, la notion de corps huit devant être définie.
II – Un critère à définir
L’utilisateur, même néophyte, d’un logiciel de traitement de texte sait pertinemment que toutes les polices de caractère ne se valent pas en termes de lisibilité. Les éditeurs et imprimeurs en favorisent certaines et en déconseillent d’autres. Partant, le critère objectif précédemment affiché, s’il échappe aux aléas de l’appréciation des juges, risquerait désormais d’être fonction de la technique informatique, voire de l’inventivité des informaticiens.
La difficulté surgit en effet lorsque l’on cherche à traduire cette « taille huit » sous la forme d’un nombre exprimé en millimètres. Le corps huit correspond à des lettres faisant huit points de hauteur. Il faut donc à la fois définir la manière de mesurer la taille desdites lettres, mais également convertir ces huit points en une donnée correspondant au système métrique.
La première question ne soulève guère de difficulté. La cour d’appel de Rennes a pu, dès 1999, affirmer qu’il fallait partir de l’extrémité supérieure d’une lettre montante (b, f, l, …) et ce jusqu’à l’extrémité inférieure d’une lettre descendante (g, p, …)30. La méthode de mesure a largement été réaffirmée par les juges du fond31.
Récemment, la Cour de cassation est venue apporter une autre précision, ayant été saisie de la question de savoir si la mesure devait se faire ligne par ligne, ou bien s’il était possible de mesurer l’intégralité du paragraphe, puis de diviser la mesure obtenue par le nombre de lignes qu’il contient. Les demandeurs au pourvoi faisaient valoir que, dans le cas d’une mesure globale, chaque ligne pouvait faire moins de huit points de hauteur s’il existait par ailleurs un espacement entre les lignes du paragraphe. La Cour a admis ladite technique de la mesure globale32.
Plus délicate est la conversion en millimètres de ces huit points, car plusieurs tailles de points coexistent. Deux peuvent être citées : le point Didot, créé en 1785 par François-Ambroise Didot, et le point pica d’origine anglo-saxonne33. Leur taille varie sensiblement puisque le premier correspond à 0,3759 mm, lorsque le second mesure 0,351 mm34. Appliquées à un caractère de corps huit, ces valeurs conduisent à des tailles respectives de la police de 3,0 mm ou 2,8 mm, soit une différence d’un peu moins de 7 %.
Traditionnellement, en France, le point Didot était la seule référence envisageable et, en 1978, la norme Afnor NF Q 60-010 l’a défini comme mesure typographique de référence35. Le débat n’est pas pour autant clos. Dans la pratique des imprimeurs, il convient d’observer que le point pica tend à s’imposer : bon nombre de logiciels étant édités outre-Atlantique, ils prennent ce point comme référence. Ce recul de la typographie traditionnelle s’est d’ailleurs traduit dans certains textes. Ainsi, s’agissant des normes de lignage pour les annonces légales, les mesures sont étalonnées, depuis le 1er janvier 2015, sur la base du point pica36.
De manière générale, les juridictions retiennent néanmoins, toujours encore, le point Didot comme référence, parfois sans même le nommer. La cour d’appel de Dijon, en 2015, a pu affirmer qu’il résultait de l’ancien article R. 311-6 du Code de la consommation37 « que la hauteur des caractères de l’offre préalable ne doit pas être inférieure à 3 millimètres »38. D’autres juridictions assument leur choix, estimant que « le corps huit [fait] référence au point Didot et correspond donc à une hauteur de 3 millimètres »39. Certaines, tout en retenant la même solution, la relativisent. Les cours d’appel de Pau et Dijon ont de la sorte pu souligner « l’absence de définition légale ou réglementaire du corps huit »40, le tribunal d’instance de Rennes étant allé jusqu’à affirmer que « le corps 8 ne fait l’objet d’aucune norme officielle, l’autorité réglementaire [ayant] entendu se référer aux usages professionnels, avec toutes les possibilités d’évolution et de variation qu’ils comportent »41.
La Cour de cassation, si elle a récemment pu se prononcer sur ce point, ne l’a fait que de manière incidente. Elle a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que « chaque ligne de l’acte occupait au moins trois millimètres de hauteur en points Didot »42. Le pourvoi, déjà cité, ne critiquait cependant pas le choix du point Didot en tant que tel, mais la méthode de calcul de la hauteur de chaque ligne.
Ce choix du point Didot relève de la sorte davantage, au regard de la jurisprudence actuelle, du consensus des juridictions que d’une norme certaine. Surtout, le débat semble loin d’être définitivement clos, car le point auquel les magistrats font aujourd’hui référence est, dans la pratique des imprimeurs et des éditeurs de logiciels, de moins en moins utilisé. Si un écart de quelques dixièmes de millimètre peut paraître insignifiant, l’enjeu consistant à obtenir une déchéance du droit aux intérêts du prêt est, quant à lui, bien réel.
Notes de bas de pages
-
1.
Lacordaire H.-D., « Cinquante-deuxième conférence. Du double travail de l’Homme », in Conférences de Notre-Dame de Paris, Tome III, 1848, Paris, Sagnier et Bray, p. 246.
-
2.
C. civ., art. 1134 anc.
-
3.
C. consom., art. L. 212-1 et C. consom., art. L. 241-1.
-
4.
Lokiec P., « Clauses abusives et crédit à la consommation », RD bancaire et fin. 2004, p. 221 ; Sauphanor-Brouillaud N., « Les contrats de consommation, Règles communes », in Ghestin J. (dir.), Traité de droit civil, 2012, LGDJ, n° 648.
-
5.
Et la règle est également applicable aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels (C. consom., art. L. 211-4).
-
6.
C. consom., art. R. 312-10.
-
7.
Ord. n° 2016-301, 14 mars 2016 : JO, 16 mars 2016, texte 29.
-
8.
V. not. : Jamin C., « Loi n° 95-96 du 1er février 1995 », RTD civ. 1995, p. 437 ; Paisant G., « Les clauses abusives et la présentation des contrats dans la loi n° 95-96 du 1er février 1995 », D. 1995, p. 99, spéc. n° 39.
-
9.
Calais Auloy J., Propositions pour un Code de la consommation. Rapport de la commission de codification du droit de la consommation au Premier ministre, 1990, La Documentation Française.
-
10.
Dir. n° 93/13/CEE, 5 avr. 1993 : JO CE, 21 avr. 1993, n° L. 95, p. 29.
-
11.
Micklitz H., « Atelier 4 : Obligation de clarté et interprétation favorable au consommateur (article 5) », in La directive « Clauses abusives », 5 ans après, Évaluation et perspectives pour l’avenir, 2000, Office des publications officielles des Communautés européennes, p. 159.
-
12.
Déclarant inopposables au consommateur les clauses des conditions générales d’un contrat de vente mobilière qui « se trouvaient au milieu de nombreuses autres dispositions figurant au dos du bon de commande signé au recto seulement », au motif qu’en signant l’intéressé « n’avait certainement pas remarqué que ce bon portait au verso diverses dispositions » : Cass. 1re civ., 3 mai 1979, n° 77-14689 : Bull. civ. I, n° 128 ; D. 1980, p. 262, note Ghestin J.
-
13.
À propos de l’utilisation d’une encre si pâle qu’elle tend à se confondre avec la couleur du papier. V. Cass. com., 23 oct. 1984, n° 83-13683 : Bull. civ. IV, n° 279.
-
14.
Comm. clauses abusives, recomm. n° 82-01 : BOCC, 27 mars 1982.
-
15.
La recommandation positive « vise à l’insertion de nouveaux éléments dans les modèles de contrats ». À l’inverse, la recommandation négative « se limite à préconiser l’élimination des clauses qui selon l’appréciation de la Commission présentent un caractère abusif » (Paisant G., « À propos des vingt-cinq ans de la Commission des clauses abusives en France », in Études offertes à Jacques Béguin, 2005, Litec, p. 605, n° 8).
-
16.
Comm. clauses abusives, recomm. n° 87-03 : BOCC, 16 déc. 1987.
-
17.
Comm. clauses abusives, recomm. n° 91-04 : BOCC, 6 sept. 1991.
-
18.
Comm. clauses abusives, recomm. n° 97-01 : BOCC, 11 juin 1997.
-
19.
Comm. clauses abusives, recomm. n° 02-02 : BOCC, 30 mai 2002.
-
20.
Comm. clauses abusives, recomm. n° 10-01 : BOCC, 25 mai 2010. Dans le même sens : Comm. clauses abusives, recomm. n° 04-02 : BOCC, 6 sept. 2004 ; Comm. clauses abusives, recomm. n° 10-02 : BOCC, 25 juin 2010 ; Comm. clauses abusives, recomm. n° 11-01 : BOCC, 26 avr. 2012.
-
21.
Comm. clauses abusives, recomm. n° 16-01, disponible sur : http://www.clauses-abusives.fr.
-
22.
TGI Grenoble, 6e ch., 31 janv. 2002.
-
23.
CA Orléans, ch. com., 12 janv. 2012, n° 11/00419.
-
24.
CA Nîmes, 2e ch. civ., 6 mars 2012, n° 11/01436.
-
25.
TGI Grenoble, 6e ch., 31 janv. 2002.
-
26.
Rép. min., 3 avr. 2012 : JO, 3 avr. 2012, p. 2714.
-
27.
C. consom., art. R. 312-14.
-
28.
C. consom., art. R. 312-33.
-
29.
C. consom., art. R. 314-20.
-
30.
CA Rennes, 1re ch. civ., sect. B, 25 juin 1999.
-
31.
Not. : CA Dijon, ch. civ., 30 juin 2016, n° 15/01374 ; CA Reims, 1re ch. civ., 6 juin 2014, n° 13/02737 ; CA Versailles, 1re ch. civ., sect. 2, 4 févr. 2014, n° 12/08197 ; CA Paris, 4-9, 21 févr. 2013, n° 10/17470 ; CA Douai, ch. 8, sect. 1, 25 oct. 2012, n° 12/00021 ; CA Chambéry, 2e ch. civ., 20 sept. 2012, n° 11/01729 ; TI Vienne, 16 mai 2003, n° 11-00-001014 ; TI Rennes, 8 août 2000, n° 11-99-000814.
-
32.
Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, n° 14-29444.
-
33.
Ces deux références ne sont pas les seules, mais les plus usuelles. Ainsi, l’Imprimerie nationale française dispose de son propre point, le « point IN », qui vaut 0,398 millimètre. Il n’est toutefois guère utilisé en pratique.
-
34.
Wambre J. et Hourdain P., Les imprimeurs : Les hommes qui ont écrit l’Histoire, 2006, HPC, p. 142 ; Dubesset M., Le manuel du système international d’unités, 2000, Technip, p. 140.
-
35.
Il convient de rappeler que « les normes sont d’application volontaire », même si elles « peuvent être rendues d’application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l’Industrie et du ou des ministres intéressés » (D. n° 2009-697, 16 juin 2009, art. 17 : JO, 17 juin 2009, p. 9860). Tel n’est pas le cas de la norme Afnor NF Q 60-010.
-
36.
A. 25 juill. 2014 : JO, 22 août 2014, p. 13963.
-
37.
C. consom., art. R. 312-10.
-
38.
CA Dijon, 2e ch. civ., 18 juin 2015, n° 14/00626.
-
39.
CA Chambéry, 2e ch. civ., 20 sept. 2012, n° 11/01729. Dans le même sens, CA Riom, ch. civ. et 3e ch. com., 25 mai 2016, n° 15/00078 ; CA Reims, 1re ch. civ., 6 juin 2014, n° 13/02737 ; CA Paris, 4-9, 21 févr. 2013, n° 10/17470 ; CA Douai, ch. 8, sect. 1, 25 oct. 2012, n° 12/00021.
-
40.
CA Dijon, ch. civ., 30 juin 2016, n° 15/01374 ; CA Poitiers, 2e ch. civ., 17 avr. 2012, n° 11/04029.
-
41.
TI Rennes, 8 août 2000, n° 11-99-000814.
-
42.
Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, n° 14-29444. Dans le même sens, dans une décision de 2009, la question du choix du point Didot ou Pica avait été posée par le demandeur au pourvoi, mais la cassation de l’arrêt d’appel avait été prononcée sur un autre moyen (Cass. 1re civ., 22 janv. 2009, n° 03-16718).