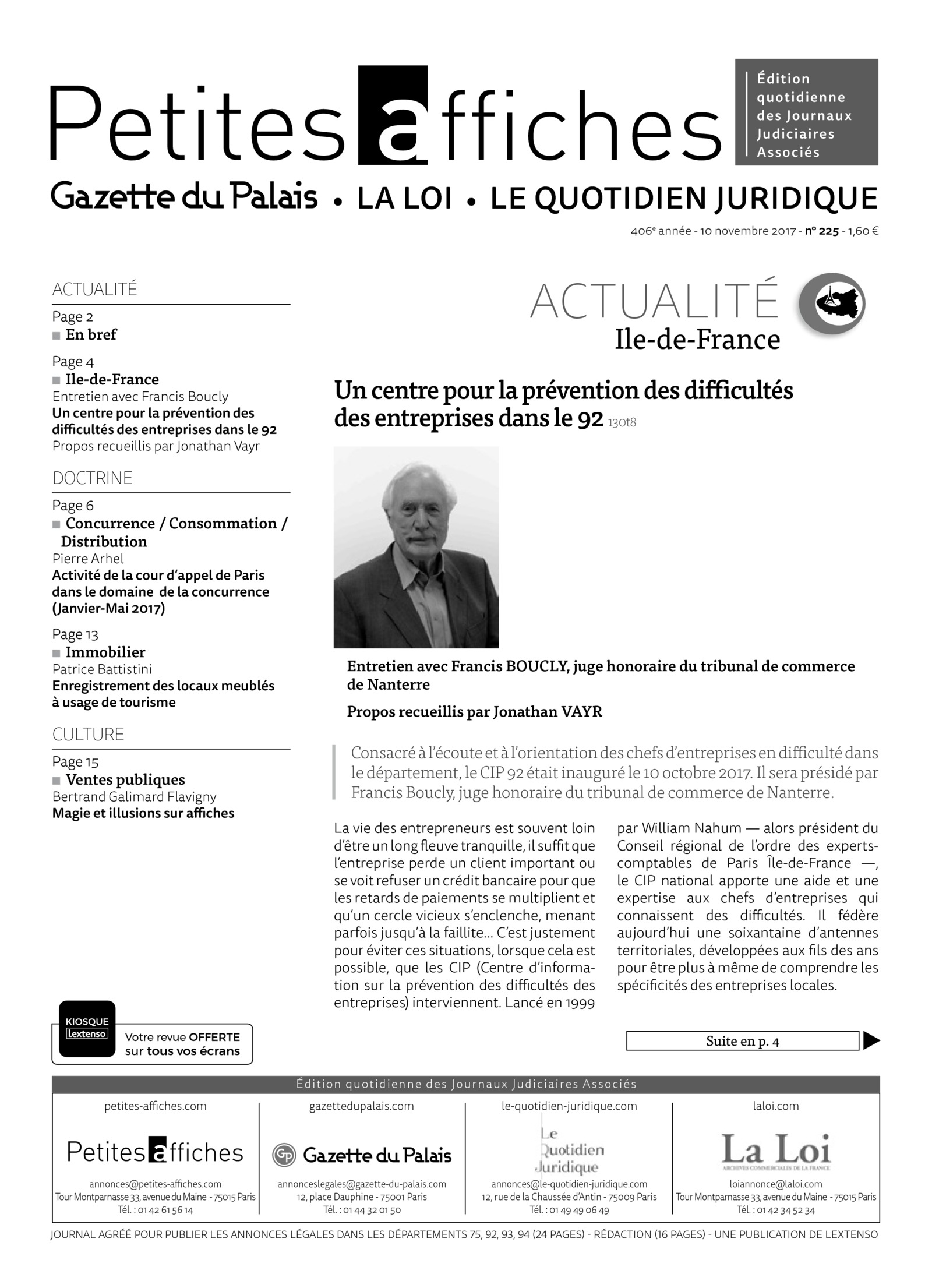Activité de la cour d’appel de Paris dans le domaine de la concurrence (Janvier-Mai 2017)
Le présent article porte sur les arrêts rendus par la cour d’appel de Paris en droit de la concurrence, au sens du livre IV du Code de commerce, au cours de la période de janvier à mai 2017. La cour s’est en particulier penchée sur les questions suivantes : (I) irrecevabilité d’une demande tardive de transmission d’une QPC portant sur la constitutionnalité de la jurisprudence Manpower ; (II) équilibre entre les nécessités de la procédure et le respect dû à l’avocat d’une partie ; (III) usage en délibéré d’éléments dans l’ignorance desquels les entreprises en cause ont été maintenues ; (IV) refus d’agrément d’un ancien concessionnaire par l’acquéreur du fonds de commerce de l’ancien concédant ; (V) divulgation d’informations couvertes par le secret de l’instruction dans le cadre du contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles ; (VI) déséquilibre significatif invoqué dans une procédure de référé ; (VII) preuve de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.
I – Irrecevabilité d’une demande tardive de transmission d’une QPC portant sur la constitutionnalité de la jurisprudence Manpower
Faute d’avoir été déposée dans le délai imparti à l’article R. 464-12 du Code de commerce, la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité par le groupe Ravate dans l’affaire des armatures métalliques et des treillis soudés sur l’Île de la Réunion est jugée irrecevable par la cour d’appel de Paris.
L’affaire, on s’en souvient, remonte à la décision du 12 mai 2016 par laquelle l’Autorité de la concurrence a sanctionné plusieurs entreprises pour avoir participé à différentes ententes. Le 30 juin 2016, les sociétés du groupe Ravate ont formé un recours en annulation et, subsidiairement, en réformation de cette décision. Par ailleurs, le 23 février 2017, ces sociétés ont demandé à la cour d’appel de transmettre à la Cour de cassation une QPC portant sur l’interprétation constante des dispositions de l’article L. 464-2, III, du Code de commerce. Elles ont fait valoir que l’Autorité de la concurrence a fait application à leur égard de la jurisprudence, dite jurisprudence Manpower, consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mars 2011 en décidant que « la renonciation à contester les griefs suffit pour permettre à l’Autorité de considérer que l’ensemble des infractions en cause est établi à l’égard des parties qui ont fait ce choix procédural. Seule doit être discutée la question de la participation aux pratiques anticoncurrentielles des parties qui n’ont pas renoncé à contester les griefs ». Or, selon elles, cette interprétation serait non conforme aux droits et libertés garantis par la constitution, en ce qu’elle porterait une atteinte grave aux droits de la défense.
Devant la cour, l’Autorité a soulevé, à titre principal, l’irrecevabilité de la demande de transmission de la QPC, au motif qu’elle aurait dû être présentée dans les 2 mois suivant la notification de sa décision. La cour d’appel lui donne raison. Ce faisant, elle rejette les prétentions des requérantes qui faisaient valoir que la demande de transmission de la QPC constitue non pas un « moyen » qui viendrait au soutien de leurs prétentions, mais la « prétention de voir une question de droit soumise au Conseil constitutionnel et qu’en conséquence elle n’est pas enfermée dans le délai de 2 mois.
La cour d’appel commence par rappeler le dernier alinéa de l’article R. 464-12 du Code de commerce qui dispose que lorsque la déclaration de recours ne contient pas l’exposé des moyens invoqués, « le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence ».
Et d’ajouter que l’inconstitutionnalité d’une disposition législative soulevée, dans le cadre d’un litige, par une partie constitue un moyen au soutien de ses prétentions, ainsi qu’il résulte des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Ainsi, conclut la cour, avant de déclarer irrecevable la demande de transmission de la QPC, les prétentions qui lui sont soumises par les requérantes dans le cadre du présent recours consistent – conformément à la lettre même du premier alinéa de l’article L. 464-8 du Code de commerce – dans l’annulation et, subsidiairement, la réformation de la décision déférée, et l’inconstitutionnalité qu’elles allèguent fonde, non pas une prétention qui serait distincte des précédentes, mais un moyen qu’elles développent en vue d’obtenir de la cour qu’elle annule ou réforme cette décision. Dès lors, la demande de transmission d’une QPC doit suivre le régime particulier, dérogatoire au droit commun processuel, fixé par l’article R. 464-12 du Code de commerce et, en conséquence, figurer, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct déposé au greffe de la cour d’appel le même jour que la déclaration de recours ou, à défaut, dans les 2 mois suivant la notification de la décision de l’Autorité1.
II – Équilibre entre les nécessités de la procédure et le respect dû à l’avocat d’une partie
L’Autorité de la concurrence peut-elle, sans violer les droits de la défense, maintenir dans le dossier communiqué aux parties, au ministre de l’Économie et au collège, des accusations graves et infondées, énoncées par le représentant d’une des parties, sans que les rapporteurs se démarquent de ces accusations auxquelles ils ont manifesté qu’ils leur accordaient un certain crédit ?
La cour d’appel apporte une réponse négative à cette question dans l’affaire des commodités chimiques, relevant en l’espèce une atteinte caractérisée consistant dans le fait que la défense des requérantes, les sociétés Brenntag, n’a pu s’exercer librement devant l’Autorité.
Les requérantes avaient soutenu qu’une atteinte irrémédiable à leur droit de la défense a résulté de la jonction à la notification de griefs et au rapport de documents ou de procès-verbaux par lesquels M. P. (mandataire de la société Solvadis, entreprise qui a, dans cette affaire, déposé la première demande de clémence) a énoncé des accusations outrageantes à l’égard de leur avocat, le mettant gravement en cause. Elles avaient fait valoir que ces documents ont été joints à la notification de griefs, puis au rapport des rapporteurs, sans que ces derniers émettent la moindre réserve.
La cour d’appel est sensible à cette argumentation. Elle commence par énoncer que la garantie des droits de la défense implique que soit respecté le principe de la libre défense, qui commande de permettre à un avocat d’exercer en toute indépendance et sans pression les droits de la défense de son client (pt 54).
Il s’en déduit, selon elle, que si au cours d’une procédure, sont exprimées des accusations contre l’avocat d’une partie, celles-ci doivent être recueillies de façon prudente et de manière à ce que soit assuré un juste équilibre entre les nécessités de la procédure et le respect dû à cet avocat tant en ce qui concerne sa personne qu’en ce qui concerne sa qualité de défenseur d’une partie (pt 55).
Et d’ajouter que les rapporteurs de l’Autorité sont investis du pouvoir de conduire les investigations qu’ils estiment nécessaires à l’instruction des dossiers qui leur est confiée et apprécient librement l’opportunité des mesures à mettre en œuvre. S’ils n’ont pas, dans ce cadre, le pouvoir d’annuler une pièce ou de la retirer du dossier, ils peuvent néanmoins émettre en toute objectivité un avis sur la validité des preuves qui leur sont soumises et doivent, dans le cadre de leur mission, assurer le respect des droits de la défense des parties, de même que celui de leur vie privée (pt 56).
La cour observe encore que, si les déclarations et imputations en cause n’ont pas été reprises dans la décision, celle-ci ainsi que la notification de griefs et le rapport mentionnent toutefois, à plusieurs reprises, les documents dans lesquels elles figurent parmi d’autres informations. Elle rappelle sur ce point qu’à la suite de la notification de griefs, les parties ont, en application de l’article L. 463-2 du Code de commerce, accès aux pièces de la procédure qu’elles peuvent consulter dans les services de l’Autorité, puis que le rapporteur doit joindre à son rapport la copie des documents sur lesquels il se fonde (pt 58).
Pour elle, le maintien des pièces analysées, sans occultation des éléments mettant en cause personnellement le conseil des sociétés Brenntag, ou sans distanciation expresse des rapporteurs, maintien auquel s’est ajouté une phrase donnant un certain crédit aux accusations de M. P., a vicié la procédure en laissant se développer, jusque devant le collège, le soupçon que ces sociétés étaient défendues par un conseil dont on pouvait pour le moins douter (pt 69).
De ce fait, la défense des sociétés Brenntag a été nécessairement décrédibilisée, tant dans ses développements écrits qu’oraux, ce qui ne pouvait qu’altérer et fausser la présentation de cette défense à la suite du rapport et, de surcroît, déstabiliser l’avocat des sociétés Brenntag lorsqu’il s’est présenté devant le collège. En effet, à supposer même que le collège n’ait pas ajouté foi aux accusations portées contre l’avocat des sociétés Brenntag, ce que tend à démontrer l’absence de toute référence dans la décision attaquée, il n’en reste pas moins que celui-ci n’a pu qu’être déstabilisé lorsqu’il s’est présenté devant la formation de jugement de l’Autorité, eu égard à la crainte légitime qu’il n’en soit pas ainsi (pt 70).
Les droits de la défense n’ayant pas été respectés, le rapport, par lequel l’atteinte aux droits de la défense a été constituée, est annulé, de même que la décision attaquée en ce qu’elle a sanctionné les sociétés Brenntag (pt 72).
En revanche, la cour refuse d’étendre l’annulation à d’autres actes de la procédure. En effet, si les pièces qui mettent en cause leur conseil ont été de nature à avoir faussé la défense des sociétés Brenntag, les mises en cause personnelles relevées n’ont été ni citées par les actes de la procédure, ni utilisées par les rapporteurs pour fonder les griefs notifiés. En conséquence elles n’ont pas, par leur présence dans le dossier, vicié l’instruction en ce qu’elle a porté sur les agissements des parties et il n’y a, en conséquence, pas lieu d’annuler la demande de clémence de la société Solvadis, l’avis de clémence qui lui a été accordé, la saisine d’office et la notification de griefs (pt 74).
Néanmoins, l’annulation de la décision de l’Autorité s’étend à la société DB Mobility Logistics dès lors que les sanctions prononcées à l’encontre de cette société sont intégralement liées à sa qualité de société mère de la société Brenntag et ont pour assiette les sanctions prononcées à l’encontre de celle-ci (pt 78).
Enfin, la cour estime que l’atteinte aux droits de la défense des sociétés Brenntag n’est pas irrémédiable. Elle relève en effet que cette atteinte consiste dans le fait que la défense des sociétés Brenntag n’a pas pu s’exercer librement devant l’Autorité. Si ce vice de procédure a pu s’étendre à la procédure de recours dans la mesure où les pièces en cause, ainsi que le rapport, ont été communiqués à la cour dans le même état que devant l’Autorité, il n’en demeure pas moins que la cour non seulement n’accorde aucun crédit aux accusations proférées dans les pièces en cause, mais aussi rétablit la réalité des faits en constatant, d’une part, qu’elles n’étaient étayées d’aucune preuve, d’autre part, que l’avocat concerné a été expressément réhabilité par le délégué du Bâtonnier de Paris dans un avis public du 10 décembre 2012 précisant qu’il ne s’est vu reprocher aucun manquement de quelque nature que ce soit à la suite de dénonciations diligentées contre lui par M. P. (pt 80).
Il s’ensuit qu’à la suite du présent arrêt, la défense des sociétés Brenntag peut se développer sans contrainte et sans être faussée devant la cour, dans le cadre d’un nouveau débat contradictoire, permis par la réouverture des débats ordonnée par la cour2.
III – Usage en délibéré d’éléments dans l’ignorance desquels les entreprises en cause ont été maintenues
La cour valide pour l’essentiel l’analyse développée par l’Autorité de la concurrence dans la décision du 11 mars 2015 qu’elle a rendue dans l’affaire des produits laitiers frais et aux termes de laquelle elle a condamné diverses entreprises pour avoir violé les règles relatives aux ententes en s’informant des hausses passées, en se mettant d’accord sur les hausses futures et en concluant des pactes de non-agression consistant à se répartir les volumes et à geler les positions, notamment en faussant les appels d’offres lancés par les enseignes de la grande distribution, auxquels elles répondaient.
Cependant, elle annule partiellement la décision pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, faisant ainsi droit à un argument soulevé par plusieurs entreprises qui reprochaient à l’Autorité d’avoir, pendant le délibéré, détenu et utilisé des pièces qui ne leur avaient pas été communiquées.
De fait, les rapporteurs ont, dans le cours de leur intervention orale, procédé à une analyse nouvelle du dommage à l’économie, qui ne figurait pas dans leur rapport notifié et qui comportait, en particulier, une quantification de ce dommage sur la base de deux méthodes économétriques n’ayant pas, jusqu’alors, été utilisées. Les entreprises en cause ont protesté auprès du président de séance en faisant valoir que la présentation de cette analyse, divergente, selon elles, de celle précédemment développée dans le rapport, constituait une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense dans la mesure où, faute d’en avoir eu préalablement connaissance, elles n’avaient pu y répondre utilement. Ayant fait savoir qu’elles souhaitaient avoir communication des données utilisées au soutien de cette analyse, l’Autorité y a fait droit en adressant aux entreprises les éléments sur lesquels s’est appuyée la nouvelle analyse et leur a imparti un délai de sept jours ouvrables pour leur faire parvenir « une note en délibéré dont l’objet unique sera de produire, sans réouverture des débats, vos observations qualitatives sur la méthodologie des services d’instruction, à l’exclusion de toute nouvelle étude économétrique ».
La cour rappelle à cet égard qu’au cours de leur intervention orale en séance les rapporteurs peuvent ne pas reprendre à l’identique l’opinion exprimée dans leur rapport et sont en droit de modifier leur appréciation des faits de la cause, à condition que les entreprises en cause aient été mise en mesure de répliquer dans des conditions conformes au principe du contradictoire (pt 34).
Elle précise qu’il est loisible à l’Autorité dans l’hypothèse où l’intervention des rapporteurs en séance ne permettrait pas de débattre contradictoirement et utilement des éléments nouveaux, de renvoyer l’affaire à l’instruction ou de rouvrir les débats. Elle n’y est, cependant, pas tenue et elle peut choisir de recourir à toute autre procédure, notamment, comme en l’espèce, en communiquant aux parties le support écrit de l’intervention orale des rapporteurs et en les autorisant à produire une note en délibéré, à la condition notamment que cette procédure s’avère propre à garantir pleinement le respect du principe du contradictoire (pt 36).
Cette condition n’était pas satisfaite en l’espèce. Pour la cour, les notes en délibéré, outre que leur production était enfermée dans un délai trop bref compte tenu de la complexité des questions en jeu, ne pouvaient pas porter sur toute l’analyse du dommage à l’économie développée par les rapporteurs, y compris dans ses aspects quantitatifs, mais seulement sur la méthodologie que ceux-ci avaient retenue (pt 38).
Or, si l’Autorité était fondée à refuser, comme elle l’a fait, le dépôt au dossier de nouvelles études économétriques, il convenait, pour garantir le caractère contradictoire de la procédure, que les parties puissent répliquer à l’ensemble des éléments nouveaux présentés par les rapporteurs et figurant dans le support écrit de leur intervention, ce dont, en l’espèce, elles ont été privées (pt 39).
Par ailleurs, certaines entreprises ont adressé des notes en délibéré à l’Autorité mais faute de communication de ces notes aux entreprises en cause, il en est résulté que l’Autorité a, dans le cours de son délibéré, disposé et fait usage d’éléments dans l’ignorance desquels elles ont été maintenues, en méconnaissance du principe du contradictoire (pt 41).
Ces constatations conduisent la cour à annuler l’article 3 de la décision attaquée en tant qu’il fixe le montant des sanctions infligées à diverses entreprises. Elle fixe ensuite elle-même les sanctions à un niveau sensiblement inférieurs à celui imposé par l’Autorité3.
IV – Refus d’agrément d’un ancien concessionnaire par l’acquéreur du fonds de commerce de l’ancien concédant
Un litige opposant un ancien concessionnaire automobile à l’acquéreur du fonds de commerce de l’ancien concédant offre l’occasion à la cour d’appel de rappeler la jurisprudence bien établie selon laquelle l’exclusion du bénéfice d’une exemption par catégorie ne permet pas d’établir l’existence d’une entente anticoncurrentielle ; il lui permet également de rappeler que l’exemption d’un refus d’agrément ne fait pas pour autant échapper celui-ci au droit général des contrats.
En l’espèce, une entreprise qui assurait, en France, l’importation et la distribution de véhicules automobiles a cédé son fonds de commerce et, en parallèle, résilié l’ensemble des contrats conclus avec ses concessionnaires. L’acquéreur du fonds a par ailleurs annoncé au réseau de concessionnaires qu’elle reprendrait la distribution et a invité les distributeurs à faire acte de candidature à la signature de nouveaux contrats.
Estimant que le refus d’agrément auquel il s’est heurté était fautif et engageait la responsabilité du nouveau concédant, l’ancien concessionnaire Catia Automobiles a assigné celui-ci devant le tribunal de commerce de Paris, lequel a rejeté sa demande. Saisie à son tour, la cour d’appel refuse d’accéder à la demande du concessionnaire sur le fondement du droit de la concurrence mais, en revanche, lui donne (partiellement) raison sur le fondement du droit des obligations.
Après avoir relevé que le nouveau concédant a refusé à la société Catia Automobiles son agrément à la signature de contrats de distributeur agréé et de réparateur agréé, dans le cadre de systèmes de distribution sélective quantitative (distributeur) et qualitative (réparateur), la cour d’appel rappelle les règles pertinentes du droit de la concurrence et les applique en l’espèce.
Le règlement n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile définit, dans son article 1er, g), le système de distribution sélective quantitative dans les termes suivants : « un système de distribution sélective dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs, des critères qui limitent directement le nombre de ceux-ci. ». Ce règlement d’exemption permet d’exonérer, au titre de leur contribution au progrès économique sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 101 du TFUE, les ententes résultant de pratiques menées au sein des réseaux de distribution sélective quantitatif qui seraient qualifiables sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article 101 du TFUE, dès lors que le concédant détient une part de marché inférieure à 40 %, en vertu de son article 3 qui dispose : « (…) le seuil de part de marché pour l’application de l’exemption est de 40 % pour les accords établissant des systèmes de distribution sélective quantitative pour la vente de véhicules automobiles neufs ». Echappent toutefois à cette exemption automatique les clauses dites « caractérisées », constituées de restrictions à la libre formation des prix ou des restrictions territoriales.
En l’espèce, la part de marché du nouveau concédant sur le marché de la distribution des véhicules neufs des marques pertinentes est inférieure à 40 % et permet donc de faire bénéficier le réseau de l’exemption automatique, sous réserve des éventuelles pratiques caractérisées qu’elle pourrait mettre en œuvre. Les refus d’agrément discriminatoires ou injustifiées, ne constituant pas des « restrictions caractérisées », ils sont couverts par les seuils de minimis et le règlement d’exemption. En revanche, sur le marché de la réparation, nouveau concédant détient nécessairement une part supérieure à 80 % et ne bénéficie donc pas d’une exemption automatique. Toutefois, il n’en résulte pas pour autant que cette pratique constitue une entente anticoncurrentielle.
Mais, souligne la cour, l’exemption d’un refus d’agrément, qui le fait échapper à la qualification de pratique anticoncurrentielle, ne le fait pas pour autant échapper au droit général des contrats, le concédant étant tenu, dès la phase précontractuelle, de respecter son obligation générale de bonne foi dans le choix de son cocontractant. Indépendamment de l’article L. 420-1 du Code de commerce ou de l’article 101 du TFUE, s’il appartient, en stricte application du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, à tout fournisseur d’organiser le mode de distribution de ses produits et de procéder aux modifications et rationalisations jugées nécessaires sans que ses cocontractants ne bénéficient d’un droit acquis à y demeurer, le titulaire du réseau se doit, néanmoins, de sélectionner ses distributeurs sur le fondement de critères définis et objectivement fixés et d’appliquer ceux-ci de manière non discriminatoire. Il ne peut sélectionner ses concessionnaires à la suite d’un appel à candidature, sans justifier les motifs de son choix au regard des critères de sélection qu’il s’est lui-même fixé.
Ayant choisi d’adopter un système de distribution sélectif quantitatif, le concédant se devait, dans le processus de sélection de ses concessionnaires auquel il procédait après leur avoir préalablement adressé un courrier d’appel à candidature, de sélectionner ses concessionnaires selon les critères qu’il s’était fixé, au nom du principe général de bonne foi, applicable dès la phase précontractuelle, même si le choix de ces critères relevait de sa libre appréciation.
En l’espèce, la cour estime que le refus d’agrément était fautif. Elle observe à cet égard que le processus de sélection objectif nécessite que le refus soit motivé et permette ainsi de vérifier que les candidatures ont été examinées avec sérieux. Or le refus d’agrément était insuffisamment motivé, puisqu’il n’était pas accompagné d’appréciations littérales ou chiffrées au regard des critères de sélection.
Par ailleurs, le véritable motif du refus d’agrément de la société Catia Automobiles résultait de l’action en justice engagée contre l’ancien concédant et la critique dirigée contre certains modèles des véhicules de sa marque.
Enfin, la cour juge également fautif le retard de notification du refus d’agrément4.
V – Contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles : divulgation d’informations couvertes par le secret de l’instruction
On se souvient que, par décision n° 09-D-36 du 9 décembre 2009, l’Autorité de la concurrence a retenu qu’Orange Caraïbe et sa société-mère France Télécom (devenue Orange) avaient enfreint les dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce ainsi que celles des articles 101 et 102 du TFUE et commis des pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la téléphonie mobile dans la zone Antilles-Guyane.
Près de huit ans plus tard, par un arrêt du 10 mai 2017, la cour d’appel de Paris s’est prononcée dans le cadre du volet indemnitaire de cette affaire en confirmant partiellement le jugement du 16 mars 2015 par lequel le tribunal de commerce de Paris a en partie fait droit à la demande d’Outremer Télécom de réparation des préjudices causés par les pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l’Autorité.
Au préalable, la cour a rejeté une exception d’irrecevabilité visant un procès-verbal établi dans le cadre de l’instruction de l’Autorité. Outremer Télécom soutenait que ce document était irrecevable car produit en violation de l’article L. 463-6 du Code de commerce selon lequel : « Est punie des peines prévues à l’article 226-13 du Code pénal, la divulgation par l’une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n’a pu avoir connaissance qu’à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé ».
La cour s’inspire de la jurisprudence Semavem de la Cour de cassation pour rejeter l’exception. Elle énonce en effet que : « Le principe du respect des droits de la défense justifie la divulgation, dans un procès civil, d’informations couvertes par le secret de l’instruction devant l’Autorité de la concurrence, si cette divulgation, incriminée par l’article L. 463-6 du Code de commerce, est nécessaire à l’exercice de ces droits, sans qu’il y ait lieu de réserver cette exception à la production en justice de pièces d’une instance civile opposant les mêmes parties que celles mises en cause devant l’Autorité de la concurrence. »
Dès lors, le procès-verbal, qui décrit l’appréciation portée par la société Outremer Télécom sur ses conditions d’entrée sur le même marché pertinent que celui où ont eu lieu les pratiques d’Orange Caraïbe et d’Orange, était utile à la société Orange pour faire valoir en défense l’absence d’effets des pratiques dont elle était l’auteur et dont la société Outremer Télécom lui demandait réparation. Et la cour de préciser que le fait que cette pièce soit issue d’une procédure devant l’Autorité de la concurrence, visant à sanctionner les pratiques de différenciation tarifaire mises en œuvre par SRR à la Réunion, pratiques dont Orange Réunion et Outremer Télécom avaient saisi cette Autorité et qui étaient sans lien avec les pratiques poursuivies dans la présente procédure relative à des pratiques commises par Orange Caraïbe et Orange, ne saurait s’opposer à l’usage de cette pièce en défense.
La question s’est par ailleurs posée de savoir si la filiale Orange Caraïbe pouvait faire valoir les mêmes arguments. La cour répond par la négative car la filiale n’a aucunement eu accès en tant que personne morale distincte de la société Orange, à la pièce en cause, n’ayant pas été partie mise en cause ou plaignante devant l’Autorité pour cette procédure. Le fait qu’elle constitue pour l’Autorité une entreprise unique au sens du droit de la concurrence dans la présente procédure de sanction contre les deux sociétés ne peut suffire à modifier cette appréciation. En revanche, la pièce étant licitement versée dans les débats par la société Orange, et aucune disjonction d’instance n’ayant été sollicitée, la société Orange Caraïbe y a eu librement accès, comme les autres parties à la procédure, et peut donc l’utiliser5.
VI – Déséquilibre significatif invoqué dans une procédure de référé
La cour a, une nouvelle fois hors du domaine de la grande distribution, été saisie d’un litige dans lequel était invoquée la règle relative au « déséquilibre significatif » visée à l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce. Dans un arrêt fort intéressant, elle a rejeté une demande en référé après avoir retenu que le déséquilibre significatif invoqué par le défendeur constituait une contestation sérieuse dont l’appréciation relève du juge du fond.
L’affaire opposait la société Vinci à une entreprise de travail temporaire à laquelle elle reprochait le défaut de paiement de plusieurs factures émises notamment au titre des primes de volume. Condamnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre à payer les factures à titre de provision, le débiteur a interjeté appel devant la cour d’appel de Versailles, puis un second appel devant la cour d’appel de Paris.
Celle-ci commence par rejeter un moyen tiré de l’irrecevabilité du second appel opposé par la société Vinci. L’entreprise faisait valoir que le second appel a été formé hors le délai de l’article 538 du Code de procédure civile. Elle contestait que ce délai de recours n’ait pas pu courir du fait d’une mention prétendument erronée sur les modalités de la voie de recours figurant sur l’acte de signification de l’ordonnance querellée, à savoir la mention que l’appel doit être porté devant la cour d’appel de Versailles (au lieu de la cour d’appel de Paris selon l’appelante), puisque sa demande portait sur le paiement d’une provision fondée sur l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile et que l’appelante n’invoquait pas le déséquilibre significatif du contrat de référencement au sens de l’article L. 442-6 du Code de commerce comme un moyen permettant de soulever l’incompétence de la juridiction de Nanterre mais comme un moyen de fond permettant au juge des référés, après avoir apprécié le sérieux de sa contestation, de constater que celle-ci échappait à son pouvoir.
La cour énonce à cet égard que lorsque le droit des pratiques restrictives de concurrence est invoqué comme moyen de défense, le juge territorialement compétent pour connaître de la demande en paiement principale doit d’office constater qu’il est dépourvu du pouvoir juridictionnel pour statuer sur cette défense, sans examiner le bien-fondé de cette défense.
Or pour l’application de l’article L. 442-6, l’article D. 442-3 du Code de commerce donne pouvoir juridictionnel exclusif en première instance à huit juridictions et en appel à la seule cour d’appel de Paris. En conséquence, la cour d’appel de Paris, investie du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 est seule compétente pour connaître de l’appel interjeté par l’entreprise de travail temporaire.
Aussi, c’est à juste titre que celle-ci a fait valoir que le délai de recours pour former cet appel n’a pas pu courir, en raison de l’indication erronée portée sur l’acte de signification de l’ordonnance querellée relative aux modalités d’ouverture de la voie de recours.
La cour annule ensuite l’ordonnance querellée en raison du défaut de pouvoir juridictionnel du juge du tribunal de commerce de Nanterre (qui ne fait pas partie des 8 juridictions précitées visées en annexe 4-2-1 du C. com, art. D. 442-3).
Ce faisant, à raison du caractère d’ordre public de l’article D. 442-3, elle écarte l’application de la clause attributive de compétence contenue dans la convention des parties.
Et de préciser que le juge aurait dû soulever d’office la fin de non-recevoir d’ordre public tirée de l’évocation en défense de l’article L. 442-6. En statuant sur le caractère sérieux de la contestation fondée sur cet article, il a donc méconnu l’étendue de son pouvoir juridictionnel.
Enfin, la cour évoque la contestation tirée de l’article L. 442-6 et opposée par le débiteur. Elle observe d’abord que l’analyse des clauses contractuelles et des pièces produites par la société Vinci pour apprécier une absence ou non de réelle négociation entre les parties au moment de la conclusion de la convention ressort des pouvoirs du seul juge du fond. Elle énonce ensuite que les dispositions de l’article L. 442-6 n’empêchent pas une partie s’estimant victime de pratiques restrictives de concurrence d’invoquer la nullité de clauses ou du contrat lui-même, et rappelle que les contrats contraires aux dispositions des articles L. 442-6 sont entachés d’une nullité absolue.
Dès lors, l’annulation du contrat sollicitée devant le juge du fond priverait de cause les primes dont la société Vinci demande le paiement, ce qui constitue une contestation sérieuse dont l’appréciation ne relève pas du juge des référés.
La cour rejette donc la demande de paiement en référé de la société Vinci6.
VII – Preuve de la rupture brutale d’une relation commerciale établie
On ne s’attardera pas longuement sur l’arrêt rendu par la cour dans le cadre d’un litige opposant la société Nelly, qui commercialise des vêtements, et le groupement Le Galec auquel il était reproché une rupture brutale d’une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce. Il présente néanmoins l’intérêt de rappeler qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une faute d’en apporter la preuve.
La cour déboute en effet la société Nelly de sa demande fondée sur la rupture brutale après avoir observé que : « La faute devant être démontrée par celui qui s’en prétend victime, la société Nelly France ne démontre pas à suffisance de droit avoir été victime d’une rupture brutale des relations commerciales de la part de la société Coopérative Groupements d’achats des Centres Leclerc, l’imputabilité même de la rupture à cette société n’étant pas établie par les pièces du dossier ».
Ce faisant, elle approuve les premiers juges qui ont souligné que la société Nelly n’a pas démontré avoir adressé le moindre courrier au Galec, à compter de mars 2008, date qui marquerait selon elle la fin des relations commerciales. Elle n’a pas non plus prouvé s’être inquiétée à un quelconque moment de la rupture prétendue, ni même d’une rupture partielle qu’elle prétend avoir subi à compter de 2005. Elle ne s’est plainte de la rupture des relations commerciales que par courriers transmis en 2010 et l’engagement de la présente action, soit 2 ans plus tard7.