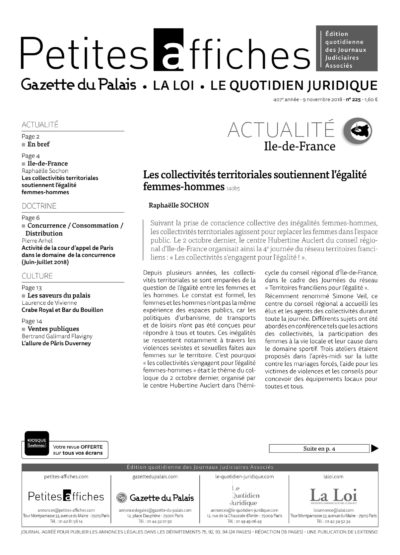Activité de la cour d’appel de Paris dans le domaine de la concurrence (Juin-Juillet 2018)
Le présent article porte sur les arrêts rendus par la cour d’appel de Paris en droit de la concurrence, au sens du livre IV du Code de commerce, au cours de la période de juin à juillet 2018. Les décisions suivantes ont plus particulièrement retenu notre attention : déclaration d’irrecevabilité des saisissantes à la procédure de recours contre la décision sanctionnant l’obstruction à l’instruction dans l’affaire des commodités chimiques (I) ; rectification de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2018 dans l’affaire du zinc laminé et des produits ouvrés en zinc destinés au bâtiment (II) ; confirmation pour l’essentiel de la décision de condamnation du cartel de la messagerie et de la messagerie express (III) ; confirmation de la condamnation d’Orange à plus de 50 millions d’euros de dommages et intérêts pour abus de position dominante sur le marché de la téléphonie résidentielle secondaire interruptible (IV) ; rejet du recours en révision de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 septembre 2015 dans l’affaire des bases de données d’information médicale (V).
I – Déclaration d’irrecevabilité des saisissantes à la procédure de recours contre la décision sanctionnant l’obstruction à l’instruction dans l’affaire des commodités chimiques
On se souvient que par sa décision n° 17-D-27 du 21 décembre 2017, l’Autorité de la concurrence a fait, pour la première fois, application des dispositions du 2e alinéa du V de l’article L. 464-2 du Code de commerce en infligeant une sanction pécuniaire de 30 millions d’euros à des entreprises du groupe Brenntag pour avoir, lors des investigations sur des pratiques anticoncurrentielles reprochées au groupe, fourni des renseignements incomplets ou inexacts et refusé de communiquer les renseignements et justifications dans les délais impartis.
Le groupe Brenntag ayant fait appel de cette décision, les plaignants dans l’affaire au fond ont réagi par des interventions volontaires auxquelles s’est opposée la cour d’appel de Paris.
Rappelant les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile selon lesquelles : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie », celle-ci énonce que l’intervention pour être recevable doit viser à la conservation des droits de la partie intervenante.
Elle rejette ensuite l’argument des requérantes qui soutenaient qu’elles ont intérêt à intervenir à la procédure de recours contre la décision attaquée car elles sont plaignantes devant l’Autorité de pratiques commises à leur détriment par la société Brenntag SA.
La cour d’appel répond en effet que la décision attaquée ne porte pas sur les pratiques en cause, mais seulement sur le comportement procédural adopté par les sociétés Brenntag. Dans ce cadre, les parties plaignantes ne disposent pas de droit propre à conserver. En effet, celles-ci n’ont, dans le cadre de l’instruction de l’affaire ouverte à la suite de leurs plaintes, pas de droit à faire valoir.
Et la cour d’ajouter que s’il existe un lien étroit entre la procédure d’obstruction et la procédure d’instruction dans laquelle elle s’inscrit, il n’en demeure pas moins que la procédure d’obstruction est une procédure autonome qui concerne la mise en œuvre des pouvoirs de coercition conférés à l’Autorité pour assurer la mission de défense de l’ordre public économique qui lui est confiée et dans laquelle les parties plaignantes ne disposent d’aucun droit à faire valoir. De même, si les parties plaignantes ont intérêt à voir leurs plaintes examinées, et ce dans les meilleurs délais, un tel intérêt ne leur confère pas de droit à ce que lesdites plaintes aboutissent à une notification de griefs et, a fortiori, à ce qu’une sanction soit prononcée. Elles ne peuvent de ce fait intervenir devant la cour d’appel dans le cadre de la procédure pour obstruction, qui relève de la phase d’instruction du dossier ouvert à la suite de leur plainte.
Enfin, la décision attaquée porte sur le seul comportement procédural passé des sociétés Brenntag. Une éventuelle annulation ou réformation ne porterait donc que sur ce comportement passé, sans que l’instruction, qui se poursuit, puisse en être affectée1.
II – Rectification de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2018 dans l’affaire du zinc laminé et des produits ouvrés en zinc destinés au bâtiment
La cour revient sur l’affaire du zinc laminé et des produits ouvrés en zinc destinés au bâtiment en rectifiant l’arrêt du 17 mai 2018 par lequel elle avait confirmé la décision de l’Autorité de la concurrence n° 16-D-14 du 23 juin 2016 mais avait réduit sensiblement, de 69 243 000 à 56 653 000 € le montant de la sanction infligée au groupe Umicore.
Elle s’est en effet saisie d’office aux fins de réparer une erreur matérielle qu’elle estimait avoir commise dans cet arrêt. Il avait été précisé, dans la convocation des parties à l’audience, que « l’erreur en cause porterait sur l’omission par la cour, dans son calcul de sanction, du coefficient d’aggravation de 10 % pour l’appartenance à un groupe, cause d’aggravation qui n’avait pas été contestée sur le fond par les sociétés requérantes et que la cour n’a pas annulée ».
Les sociétés Umicore ont contesté l’existence d’une erreur et, si tant est qu’une erreur ait été commise, la possibilité de la réparer par voie de rectification. Elles ont fait valoir qu’il ressort de l’arrêt du 17 mai 2018 que la cour a entendu exercer son pouvoir de pleine juridiction quant à l’amende infligée. Elle pouvait parfaitement considérer que l’autorité avait été trop sévère et, substituant son appréciation à celle de l’autorité, réduire la sanction sans avoir l’obligation de donner en détail les éléments de calcul qui l’ont conduite à la sanction prononcée.
Selon elles, si la cour devait estimer que le défaut d’application du coefficient de majoration de 10 % constituait une erreur, celle-ci ne serait pas suffisamment évidente pour constituer une erreur matérielle de nature à permettre une simple rectification. Il s’agirait plutôt d’une erreur d’appréciation ou de raisonnement affectant la substance même de la décision.
La cour rejette ces arguments en rappelant que, comme toute juridiction, elle est tenue, dans son appréciation du recours, par les prétentions des parties et elle ne peut statuer ultra-petita, ni soulever un moyen d’office, à moins qu’il ne soit de pur droit et que les parties aient pu s’exprimer sur ce moyen.
Or l’appartenance à un groupe, justifiant une majoration de 10 % de la sanction, n’ayant pas été contestée au fond, la cour était tenue, sauf à statuer ultra petita, d’appliquer au montant de base de la sanction la majoration de 10 %. En omettant de le faire, elle a commis une erreur, qui n’est pas une erreur de raisonnement ni une erreur d’appréciation, mais une erreur matérielle qu’il convient de rectifier2.
III – Confirmation pour l’essentiel de la décision de condamnation du cartel de la messagerie et de la messagerie express
On se souvient que, par décision n° 15-D-19 du 15 décembre 2015, l’Autorité de la concurrence, après s’être saisie d’office, a condamné une vingtaine d’entreprises des secteurs de la messagerie et de la messagerie express pour s’être concertées sur les hausses tarifaires annuelles qu’elles appliquaient à leurs clients respectifs (grief n° 2). La décision a par ailleurs sanctionné 15 de ces mêmes entreprises pour s’être entendues sur le principe et la méthode de répercussion de la hausse du gazole à leurs clients (grief n° 1).
En confirmant cette décision, la cour d’appel de Paris rejette pour l’essentiel les moyens de procédure comme les moyens de fond du recours.
A – Saisine d’office de l’Autorité
Sur la procédure, on retiendra surtout le moyen pris de la violation de l’article L. 462-5 III du Code de commerce, aux termes duquel « [l]e rapporteur général peut proposer à l’Autorité de la concurrence de se saisir d’office des pratiques mentionnées aux I et II (…) ».
Le groupe XPO a fait valoir qu’en l’espèce, aucun élément concret permettant d’attester de l’existence effective d’une telle proposition ne figure au dossier, les rapporteurs se contentant de faire référence à un « rapport oral ». Et le groupe d’ajouter que l’article L. 462-5 III ne donne pas compétence au rapporteur général adjoint pour proposer, au nom du rapporteur général, la saisine d’office de l’Autorité. La saisine d’office étant en l’espèce proposée par un rapporteur général adjoint, elle serait irrégulière.
Le moyen est rejeté sans réserve. Pour la cour d’appel, il se déduit du libellé même de l’article L. 462-5 III ainsi que de l’interprétation qu’en a donné le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, que l’Autorité de la concurrence ne peut se saisir d’office de pratiques anticoncurrentielles que si la proposition lui en est préalablement faite par le rapporteur général (pt 99).
En revanche, aucune disposition légale ou réglementaire n’exige que la proposition adressée à l’autorité de se saisir d’office prenne la forme d’un avis écrit, une recommandation orale, à condition qu’elle émane du rapporteur général, apparaissant suffisante (pt 100).
De même, aucune disposition légale ou réglementaire n’exige qu’une telle proposition soit communiquée aux parties. Au demeurant, la proposition de se saisir d’office adressée par le rapporteur général à l’autorité, si elle est suivie par l’autorité, ouvre une phase de la procédure qui n’est pas contradictoire et, au travers de la notification des griefs, qui ouvre la phase contradictoire, et du rapport des rapporteurs, les parties sont pleinement informées de la position du rapporteur général. Aussi la non-communication de ladite proposition est-elle en tout état de cause insusceptible de porter atteinte à leurs droits (pt 101).
En l’espèce, les deux saisines d’office successives, qui sont à l’origine de la procédure ayant abouti à la décision attaquée, ont été faites sur proposition d’un rapporteur général adjoint, et non à l’initiative de l’Autorité (pt 103).
Par ailleurs, ledit rapporteur général adjoint disposait d’une délégation de fonctions en cas d’absence ou d’empêchement, consentie par la rapporteure générale (pt 104).
Certes, une autorité publique investie d’une compétence ne peut s’en déposséder, fût-ce temporairement et partiellement, que si la possibilité lui en a été expressément conférée par une disposition normative d’un niveau approprié (pt 107).
Cependant, aucun texte ni aucun principe n’exigent que la possibilité de déléguer des compétences attribuées par un texte de valeur législative soit prévue par un texte de même valeur (pt 108).
Selon la cour, à partir du moment où la loi elle-même prévoit la désignation d’adjoints au rapporteur général et en fixe les modalités (C. com., art. L. 431-4), l’article R. 461-3 alinéa 5 du Code de commerce constitue une disposition normative de niveau approprié pour conférer au rapporteur général la possibilité de déléguer à un rapporteur général adjoint tout ou partie de ses attributions, fussent-elles attribuées au rapporteur général par un texte de loi (pt 109).
Le rapporteur général peut donc déléguer à un rapporteur général adjoint le pouvoir de proposer à l’autorité de se saisir d’office (pt 111).
S’agissant des moyens de fond, ils sont pour l’essentiel également rejetés, mais l’analyse de la cour d’appel diffère de celle de l’autorité sur certains points auxquels sont consacrés les développements qui suivent.
B – Sanction du grief n° 1 infligée à DHL
La société DHL a fait valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qui concerne la méthode de calcul de la sanction de 200 000 € qui lui a été infligée au titre du grief n° 1, ce qui lui a empêché de comprendre sur quels critères l’autorité s’est fondée pour définir les trois tranches de montants forfaitaires retenus.
La cour est sensible à cette analyse. Elle observe à cet égard que l’autorité s’est bornée à dire qu’elle regrouperait les entreprises en trois catégories « pour refléter le poids économique respectif de chacune d’entre elles », la lecture du tableau figurant au même paragraphe permettant de comprendre qu’en fonction de leur appartenance à l’une ou l’autre de ces trois catégories, les entreprises se sont vu infliger une sanction de 50 000 €, 100 000 € ou 200 000 € (pt 681).
Il était donc impossible, à la lecture de la décision attaquée, de comprendre que pour classer les entreprises en trois catégories, l’autorité s’était fondée sur la valeur des prestations en relation avec le grief n° 1 réalisées par chacune d’elles en 2005 (pt 682).
Ce défaut de motivation ayant fait obstacle à la compréhension par les requérantes de la façon dont leur sanction a été calculée par l’autorité, la cour annule l’article 3 de la décision attaquée, en tant qu’il inflige à DHL une sanction pécuniaire de 200 000 € au titre du grief n° 1 (pt 683).
Procédant ensuite elle-même au calcul de la sanction encourue par DHL, elle parvient au même montant de 200 000 € qu’avait fixé l’Autorité (pt 695).
C – Participation de Geodis aux pratiques relevant du grief n° 2
Dans la décision attaquée, l’autorité a constaté que la société Geodis, si elle n’avait participé, au cours de la campagne 2005-2006, à aucune des réunions visant à une collusion, figurait néanmoins au nombre des destinataires des circulaires de revalorisation tarifaire qu’avaient diffusées les sociétés Graveleau, Schenker-Joyau, Mory et Alloin entre le 18 octobre et le 4 novembre 2005. Elle en a conclu qu’elle avait « reçu des informations sensibles dont elle a pu tenir compte dans l’élaboration de sa propre politique tarifaire » et que sa participation au grief n° 2 était dès lors établie.
La cour d’appel ne partage pas cette analyse. Elle rappelle au préalable que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence tant nationale que de l’Union, la présomption de participation à une entente, sauf distanciation publique de la part de l’entreprise en cause, trouve à s’appliquer lorsque celle-ci a assisté, même passivement, c’est-à-dire sans avoir communiqué elle-même d’informations sensibles à ses concurrents, à une ou plusieurs réunions de mise en œuvre de cette entente. En effet, l’entreprise, par sa seule présence, a donné à penser aux autres participants qu’elle souscrivait au résultat de ces réunions et s’y conformerait, manifestant ainsi qu’elle adhérait à l’entente, tandis que les autres participants voyaient se réduire l’incertitude relative au comportement futur de leurs concurrents (pt 331).
En revanche, l’absence de distanciation ne saurait être opposée à l’entreprise qui, n’ayant assisté à aucune réunion collusoire, aurait reçu de ses concurrents des informations sensibles qu’elle n’a ni sollicitées ni acceptées, et dont il n’est pas démontré qu’elle aurait tiré parti (pt 332).
En l’espèce, il est constant qu’aucun élément susceptible de démontrer la participation de Geodis à l’entente n’était invoqué par l’autorité avant la réception des courriers électroniques par lesquels Graveleau, Schenker-Joyau, Mory et Heppner ont diffusé leurs circulaires de hausse tarifaire. Notamment, il n’était pas allégué qu’elle avait déjà participé à une réunion anticoncurrentielle (pt 333).
Dès lors, le seul constat que Geodis a figuré, avec d’autres entreprises, parmi les destinataires de ces courriers électroniques ne peut suffire, nonobstant l’absence de manifestation de distanciation de sa part, à caractériser sa participation à l’entente reprochée, à défaut de démonstration qu’elle aurait sollicité ces envois ou préalablement donné son accord pour les recevoir, ou que son comportement sur le marché en aurait été modifié (pt 334).
La participation de Geodis au grief n° 2 n’est donc pas établie en ce qui concerne la campagne 2005-2006 (pt 336). La cour annule donc l’article 2 de la décision attaquée en tant qu’il a dit que la société Geodis avait participé au grief n° 2 entre le 17 octobre 2005 et le 27 septembre 2006 (pt 337). La cour en tire les conséquences et réduit de 3,20 à 2,50 le coefficient de durée à appliquer pour le calcul du montant de base de la sanction (pt 1051).
D – Participation de DHL aux pratiques relevant du grief n° 2
La cour d’appel reproche à l’autorité de ne pas avoir recherché si DHL avait participé au grief n° 2 au titre des campagnes 2006-2007 à 2009-2010. Elle annule en conséquence l’article 2 de la décision attaquée en tant qu’il dit qu’il est établi que DHL a participé au grief n° 2 entre le 2 mars 2006 et le 1er mars 2010 (pt 211).
Examinant elle-même si DHL avait participé à la pratique pendant cette période, elle se montre peu convaincue par les arguments de l’entreprise visant à démontrer qu’elle s’est distanciée à l’égard des pratiques en cause. Elle observe en effet qu’il ne ressort nullement du dossier que cette société aurait fait connaître à ses concurrents qu’elle entendait ne pas leur communiquer d’informations d’ordre tarifaire ni en recevoir de leur part et qu’elle se serait ainsi distanciée de leurs pratiques. Au contraire, DHL a indiqué à ses concurrents qu’elle envisageait de développer une politique commerciale agressive afin de reconquérir des parts de marché et elle leur a ainsi fourni des informations à caractère sensible sur sa stratégie tarifaire à venir, les mettant ainsi en mesure d’adapter leur propre comportement en fonction de ces données (pt 383).
E – Montant de la valeur des ventes prise en compte au titre du grief n° 2
Pour la détermination de l’assiette des sanctions, l’autorité a retenu, au titre de la valeur des ventes, le chiffre d’affaires lié aux prestations de messagerie et de messagerie express domestique sur le territoire français, dont elle a déduit le chiffre d’affaires réalisé lorsque les entreprises ont agi exclusivement comme sous-traitant d’un autre transporteur, le chiffre d’affaires réalisé lors de prestations intragroupe et le chiffre d’affaires réalisé lors de prestations internationales.
Divers requérants ont fait valoir que l’autorité a, ce faisant, commis des erreurs de chiffrage. La cour d’appel fait droit à ces arguments et réduit en conséquence les sanctions. Étaient notamment visés des cas où la somme retenue par l’autorité incluait (I) des activités, telles que le fret, étrangères aux activités de messagerie et de messagerie express (DHL) (pt 815) ; (II) le chiffre d’affaires résultant des activités de sous-traitance (TNT) (pt 817) ; (III) le chiffre d’affaires réalisé lors de prestations intragroupe (XPO) (pt 826) ; (IV) le chiffre d’affaires réalisé lorsque l’entreprise a agi exclusivement comme sous-traitant des postes étrangères (Chronopost) (pt 828).
F – Abattement au titre de la participation inégale au grief n° 2
L’autorité avait accordé un abattement de 10 % afin de tenir compte du fait que certaines entreprises participantes se sont bornées à participer aux échanges organisés dans le cadre du Conseil de métiers, sans y ajouter des échanges bilatéraux ou multilatéraux en dehors de ce cadre.
La société Dachser ayant participé à des échanges bilatéraux ou multilatéraux en dehors des réunions du conseil de métiers, c’est à juste titre que l’autorité ne les a pas fait bénéficier de cet abattement (pt 1063). L’entreprise a cependant fait valoir que, ce faisant, l’autorité a violé le principe de l’individualisation de la sanction. La cour est sensible à l’argument. Elle estime en effet que la requérante est fondée à souligner que sa participation aux réunions du Conseil de métiers a été relativement faible. En effet, entre 2004 et 2010 – durée de la participation de Dachser aux pratiques – celle-ci n’a participé qu’à 6 des 17 réunions au cours desquelles les entreprises participantes ont échangé des informations commerciales sur les prix, soit à peine un tiers d’entre elles (pt 1064).
Cette constatation justifie, selon la cour, que soit accordée une réduction de la sanction (pt 1065). Un abattement de 10 % est en conséquence accordé à l’entreprise (pt 1066).
La cour tient par ailleurs compte de la spécificité du calendrier des hausses tarifaires suivi par la société TNT (pt 1151) et accorde en conséquence à l’entreprise un abattement supplémentaire de 5 % (pt 1152). En effet, compte tenu de l’envoi anticipé, par rapport à ses concurrents, de ses circulaires de hausse, marquant le début des négociations tarifaires avec ses clients, une partie sensible de ces négociations se déroulaient et s’achevaient alors que TNT ne disposait d’aucune information précise sur les intentions de ses concurrents (pt 1149).
G – Réduction de la sanction au titre de la procédure de non-contestation des griefs
Chronopost, qui avait obtenu, au titre de la procédure de non-contestation des griefs, un taux de réduction de la sanction de 18 %, s’est prévalue de la qualité, de l’importance et de l’originalité de son programme de conformité à l’appui d’un moyen par lequel elle demandait le bénéfice d’un taux plus élevé. La cour accueille l’argument. Elle relève en effet que le programme de conformité de l’entreprise est étendu à toutes les activités du groupe, à l’exception de l’activité financière, qui disposait déjà de son programme propre, et porte en conséquence le taux de réduction à 20 % (pt 1331)3.
IV – Confirmation de la condamnation d’Orange à plus de 50 millions d’euros de dommages et intérêts pour abus de position dominante sur le marché de la téléphonie résidentielle secondaire interruptible
À l’origine du litige opposant Orange à SFR à propos des services offerts aux propriétaires de résidences secondaires, SFR a souhaité lancer une offre alternative à l’offre « Résidence secondaire » (RS) d’Orange qui permettait à un client de bénéficier d’un abonnement à une ligne téléphonique et, lorsque la résidence est inoccupée, l’abonné avait la possibilité de suspendre la ligne entre 1 et 12 mois, moyennant le paiement d’une somme minime. SFR a dû y renoncer du fait, selon elle, du comportement d’Orange : celle-ci proposait aux opérateurs alternatifs, tels que la société SFR, une offre de gros de revente de l’abonnement au service téléphonique (offre VGAST) qui était la réplique de l’abonnement téléphonique classique qui ne permettait pas, en cas de suspension temporaire de la ligne fixe par le client final, de suspendre temporairement le paiement des redevances mensuelles de l’offre GVAST payées par la société SFR à Orange.
S’estimant victime d’un effet de ciseau tarifaire constitutif d’un abus de position dominante, SFR a saisi le tribunal de commerce de Paris qui a condamné Orange au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 51,38 millions d’euros.
La cour d’appel de Paris avait, dans un arrêt du 8 octobre 2014, infirmé le jugement de première instance après une discussion portant sur la définition du marché pertinent. Analysant la substituabilité du côté de la demande puis du côté de l’offre, elle était parvenue à la conclusion que SFR n’avait pas établi l’existence d’un marché pertinent limité aux résidences secondaires (sur lequel Orange détiendrait une position dominante).
Par arrêt du 12 avril 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel. Elle a estimé qu’« en se déterminant (comme elle l’a fait), sans s’expliquer sur le test réalisé par la société SFR sur la base des hypothèses d’occupation des résidences secondaires retenues par la société Orange, ni préciser en quoi les éléments qu’il contenait ne permettaient pas d’établir une différence de coût, fût-elle variable, selon la fréquence et la durée des séjours, entre les offres classique et RS, la cour d’appel a privé sa décision de base légale »4.
Saisie sur renvoi, la cour d’appel de Paris confirme pour l’essentiel la condamnation d’Orange à plus de 50 millions d’euros de dommages et intérêts pour abus de position dominante.
Ce faisant, elle estime que SFR a établi l’existence d’un marché pertinent de la téléphonie résidentielle secondaire interruptible.
Cette preuve a d’abord été rapportée par l’analyse classique portant sur les caractéristiques objectives, le prix et l’usage du service. La cour d’appel estime à cet égard que la faculté d’interruption ne représente pas une simple modalité tarifaire mais une caractéristique essentielle de l’offre RS.
L’existence d’un marché pertinent de la téléphonie résidentielle secondaire interruptible a également été établie par le test SSNIP5 dont il résulte que dans le cas d’une augmentation légère mais significative et permanente du prix de l’offre RS, les clients de l’offre RS et, parmi eux ceux qui n’ont pas eu recours l’année précédente à la faculté de désactivation, ne se tourneraient pas nécessairement vers l’offre classique Orange facilement accessible ou vers d’autres offres fournisseurs, à raison de la faculté de suspension de la ligne accompagnée de l’interruption du paiement de l’abonnement.
S’agissant de l’abus, la cour d’appel estime qu’en refusant la suspension du paiement de la redevance mensuelle de l’offre VGAST dans la proportion de la désactivation de l’offre RS, Orange a réalisé un acte fautif d’abus de position dominante.
Elle précise à cet égard qu’il importe peu que le paiement par la branche aval soit réalisé ou suspendu. En effet, soit le paiement par la branche aval est réalisé et dans ce cas la vente au client final est réalisée à perte, ce qui constitue une pratique anticoncurrentielle de prédation soit le paiement est suspendu par la branche aval au profit de la branche amont, ce qui constitue une pratique de ciseau tarifaire, qui constitue également une pratique anticoncurrentielle6.
V – Rejet du recours en révision de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 septembre 2015 dans l’affaire des bases de données d’information médicale
Le litige opposant la société Cogedim à la société Euris a donné lieu à une double procédure. D’une part, la société Cogedim, qui a développé une base de données dénommée « Pharbase » a assigné en contrefaçon la société Euris, soutenant que cette dernière utilisait des extractions de la base de données « Pharbase » pour constituer et mettre à jour une base de données concurrente intitulée « Médibase ». Dans le cadre de cette procédure, un expert judiciaire a été nommé et chargé de relever les ressemblances entre les deux bases de données. Par jugement confirmé dans toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 avril 2014, la société Cegedim a·été déboutée de son action.
D’autre part, l’Autorité de la concurrence a, par une décision n° 14-D-06 du 8 juillet 2014 considéré qu’il était établi que la société Cegedim avait enfreint les dispositions des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce en mettant en œuvre un abus de position dominante caractérisé par le refus discriminatoire de vendre sa base de données aux utilisateurs actuels et potentiels de solutions logicielles commercialisées par la société Euris.
La société Cegedim a formé contre cette décision un recours, qui a été rejeté par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 septembre 20157, devenu irrévocable après le rejet par la Cour de cassation du pourvoi dont elle avait été saisie8.
La société Cegedim a par la suite formé un recours en révision contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 septembre 2015. À l’appui de son recours, elle a fait valoir que, postérieurement à cet arrêt, elle a établi que deux anciens salariés de la société Euris, contactés pour recueillir leur témoignage sur les conditions dans lesquelles s’étaient déroulées les saisies-contrefaçons ordonnées par le tribunal de commerce, ont affirmé qu’à la demande de leurs supérieurs hiérarchiques, ils avaient effacé certaines informations contenues dans la base de données « Medibase », de sorte que les données soumises à l’expert pour qu’il remplisse sa mission s’étaient trouvées altérées et falsifiées.
La société Cegedim a expliqué qu’elle n’a pas demandé la révision de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 avril 2014, car un tel recours aurait été, en pratique, voué à l’échec. Selon elle, en effet, les actions en contrefaçon dont elle a été déboutée impliquent de pouvoir comparer les bases « Pharbase » et « Médibase » ; or, du fait de la falsification et de l’altération des données saisies, il ne serait plus possible de replacer les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient à l’époque de cette procédure.
La cour d’appel de Paris rejette le recours en révision. Elle rappelle d’abord que le recours en révision n’est possible que si la fraude alléguée a été décisive dans le jugement, en ce sens que, si elle avait été connue du juge, sa décision aurait été différente. Or en l’espèce, l’Autorité de la concurrence, approuvée par la cour d’appel de Paris, a observé que la contrefaçon, quand bien même elle serait établie, ne pouvait pas justifier la pratique anticoncurrentielle qui a été sanctionnée. Partant, même si la contrefaçon avait pu être établie, la décision de la cour d’appel de Paris aurait été identique, l’existence d’actes de contrefaçon ne pouvant pas être l’élément justificatif d’un refus de vente caractérisant un abus de position dominante.
En tout état de cause, ajoutent les juges parisiens, les deux témoignages produits par la société Cegedim au soutien de son recours en révision, sont impuissants à rapporter la preuve de la contrefaçon. Or le simple soupçon de contrefaçon, fût-il renforcé par la connaissance des agissements décrits dans les témoignages, n’aurait pas pu amener la cour d’appel de Paris à prendre une décision différente, faute que la contrefaçon soit positivement établie9.
Notes de bas de pages
-
1.
CA Paris, 14 juin 2018, n° 18/02036.
-
2.
CA Paris, 5 juill. 2018, n° 18/10061.
-
3.
CA Paris, 19 juill. 2018, n° 16/01270.
-
4.
Cass. com., 12 avr. 2016, n° 14-26815.
-
5.
Le test SSNIP (small but significant non transitory increase in price) permet de déterminer si les clients des entreprises se tourneraient vers des produits de substitution facilement accessibles ou vers des fournisseurs implantés ailleurs, en cas d’augmentation légère (de 5 à 10 %), mais permanente, des prix relatifs des produits considérés dans les territoires concernés.
-
6.
CA Paris, 8 juin 2018, n° 16/19147.
-
7.
CA Paris, 24 sept. 2015, n° 14/17586.
-
8.
Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-25941.
-
9.
CA Paris, 21 juin 2018, n° 17/11795.