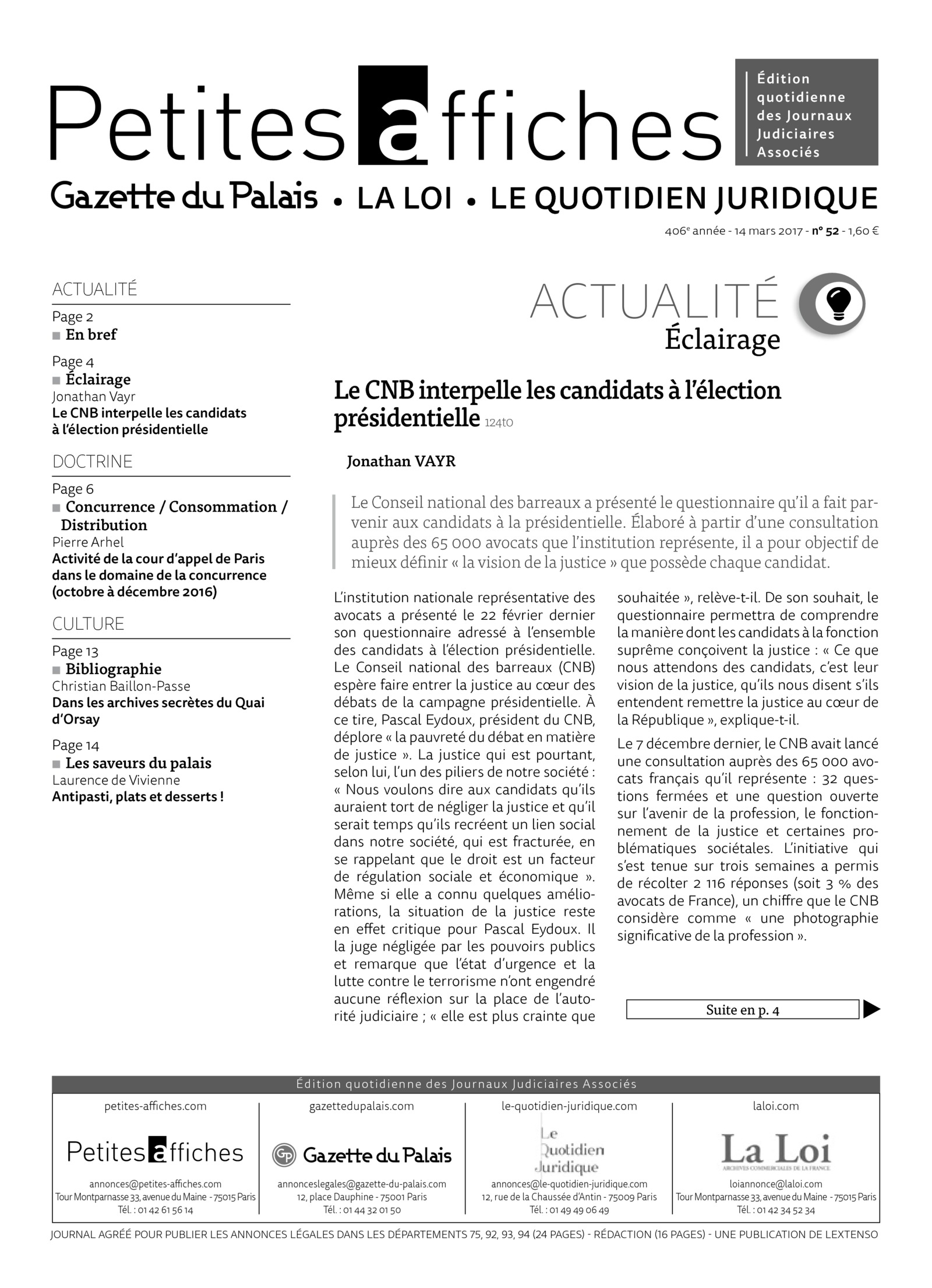Activité de la cour d’appel de Paris dans le domaine de la concurrence (octobre à décembre 2016)
Le présent article porte sur les arrêts rendus par la cour d’appel de Paris en droit de la concurrence, au sens du livre IV du Code de commerce, au cours de la période d’octobre à décembre 2016. La cour s’est en particulier penchée sur les questions suivantes : présence du rapporteur et du rapporteur général au délibéré de l’Autorité de la concurrence (I) ; refus d’intégrer un distributeur dans un réseau de distribution sélective (II) ; discrimination tarifaire (III) ; non-respect d’engagement (IV) ; valeur des ventes servant au calcul du montant de base des sanctions (V) ; mise en œuvre cumulée des procédures de clémence et de non-contestation des griefs (VI) ; contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles (VII) ; perte du bénéfice d’une exclusivité territoriale – rupture brutale des relations commerciales établies (VIII).
I – Présence du rapporteur et du rapporteur général au délibéré de l’Autorité de la concurrence
Sans surprise, la cour d’appel de Paris, saisie à la suite d’un troisième renvoi après cassation dans la très ancienne affaire des travaux routiers, du terrassement, des canalisations et de l’assainissement dans le département du Var, annule, en tant qu’elle concerne les sociétés Colas Midi Méditerranée et Jean-François, la décision n° 96-D-65 du 30 octobre 1996 par laquelle le Conseil de la concurrence a infligé des sanctions pécuniaires à 14 entreprises, pour s’être livrées à des pratiques prohibées par l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l’article L. 420-1 du Code de commerce.
Ce faisant, elle fait droit à un moyen tiré de la présence du rapporteur et du rapporteur général au délibéré du Conseil de la concurrence, devenu Autorité de la concurrence. Elle rappelle à cet égard que, bien que prévue par les dispositions, alors applicables, de l’article 25 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, la participation au délibéré, serait-ce sans voix délibérative, du rapporteur ayant procédé aux investigations utiles pour l’instruction des faits dont le Conseil était saisi et du rapporteur général, sous le contrôle duquel cette instruction a été menée, est contraire aux exigences du procès équitable posées par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Ayant annulé la décision déférée, la cour, faisant usage de son pouvoir d’évocation, statue à nouveau et confirme pour l’essentiel les sanctions infligées par la Conseil de la concurrence1.
II – Refus d’intégrer un distributeur dans un réseau de distribution sélective
La cour d’appel a confirmé le jugement du 12 mars 2014, par lequel le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Élysées Shopping de sa demande d’agrément au réseau de distribution sélective de Rolex. Ce faisant, elle rejette l’argument du distributeur qui faisait valoir que le refus d’agrément est constitutif d’une entente prohibée par l’article 101 du TFUE.
La cour commence par rappeler que la distribution sélective limite nécessairement la concurrence entre les différents acteurs économiques en entravant l’accès au marché des revendeurs non membres du réseau.
Elle rappelle également qu’un système de distribution sélective qualitative peut être considéré comme licite au regard des prévisions du paragraphe 1 de l’article 101 du TFUE ou de l’article L. 420-1 du Code de commerce, si trois conditions sont réunies cumulativement : (i) la nature du produit en question doit requérir un système de distribution sélective, c’est-à-dire qu’un tel système doit constituer une exigence légitime eu égard à la nature du produit concerné afin d’en préserver la qualité et d’en assurer l’usage ; (ii) les revendeurs doivent être choisis sur la base de critères objectifs de caractère qualitatif, qui sont fixés de manière uniforme pour tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire ; (iii) les critères définis ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire.
Elle se place ensuite sur le terrain de l’exemption par catégorie en observant, dans un premier temps, que la société Élysées Shopping n’invoque l’existence d’aucune clause au sens de l’article 4 du règlement de la Commission n° 330/2010 du 13 avril 2010 ayant pour effet d’éliminer toute concurrence et qui serait donc constitutive d’une entente illicite ni aucune clause comportant des restrictions exclues au sens de l’article 5 du règlement.
Elle répond, dans un deuxième temps, à l’argument de la société Élysées Shopping selon lequel l’exemption automatique dont se prévaut la société Rolex, n’a pas vocation à s’appliquer.
Elle rappelle que le règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010, prévoit une exemption de l’interdiction stipulée au paragraphe 1 de l’article 101 du TFUE, en faveur des accords de distribution, lorsque, notamment, la part détenue par le fournisseur sur le marché pertinent sur lequel il vend ses biens et services ne dépasse pas 30 % et ce, sous réserve que ces accords ne comportent pas de restrictions caractérisées énumérées à l’article 4 du règlement, à savoir, pour l’essentiel, celles qui obligent chaque distributeur à respecter un prix de vente identique, à s’interdire de revendre à un autre distributeur du réseau ou à s’interdire de répondre passivement à des commandes de clients situés hors de sa zone d’exclusivité.
Cependant, la cour constate que Rolex n’a pas démontré que sa part de marché est inférieure à 30 %.
Pour autant, l’accord de distribution sélective n’est pas présumé relever de l’interdiction du paragraphe 1 de l’article 101 du traité. Selon les magistrats parisiens, il appartenait en effet à la société Élysées Shopping de démontrer que le refus d’agrément qui lui a été opposé, constitue une entente prohibée, en d’autres termes, qu’il soit de nature à éliminer la concurrence ou de permettre cette élimination.
Or la société Élysées Shopping n’a pas rapporté cette preuve. La cour observe à cet égard que le nombre de marques de montres de luxe et de prestige est conséquent et la société Élysées Shopping commercialise vingt-cinq de ces marques dans son magasin sans subir d’entrave de la part de la société Rolex.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
La société Élysées Shopping soutenait, à titre subsidiaire, que le refus d’agrément qui lui a été opposé était constitutif d’une discrimination abusive, c’est-à-dire, d’un abus de droit constitutif d’une faute.
La cour rejette cependant l’argument. Elle rappelle à cet égard qu’à la suite de la loi du 1er juillet 1996 qui a supprimé le principe de l’interdiction du refus de vente entre professionnels, la loi du 4 août 2008 a mis fin à l’interdiction des pratiques discriminatoires. La discrimination ne constitue donc plus, en soi, une faute civile et elle n’est prohibée que si elle constitue une entente illicite visée à l’article L. 420-1 du Code de commerce, un abus de position dominante visé à l’article L. 420-2 du Code de commerce (ce qui n’est pas le cas en l’espèce) ou un abus de droit.
La société Élysées Shopping a encore soutenu, à titre subsidiaire, que Rolex a également engagé sa responsabilité pour avoir refusé de lui communiquer malgré ses demandes répétées, ses conditions générales de vente prévues à l’article L. 441-6 du Code de commerce alors qu’elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.
Le moyen est jugé inopérant dans la mesure où, selon la cour, la société Élysées Shopping ne peut être acheteur à l’égard de la société Rolex qui ne l’a pas agréé en qualité de distributeur de sorte qu’aucune faute de la société Rolex France à cet égard n’est établie2.
III – Discrimination tarifaire
La cour d’appel, saisie en référé sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile, a accédé à la demande d’un revendeur (et graveur) de boules de pétanque qui estimait que les tarifs de la société La Boule Obut applicables à partir de 2016 étaient discriminatoires et constitutifs d’un abus de position dominante. Ce faisant, elle a infirmé l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille qui avait rejeté la demande du distributeur tendant à faire interdiction à la société La Boule Obut d’appliquer ses nouvelles conditions commerciales 2016 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
La cour d’appel a, en premier lieu, tranché un débat sur les conditions de référé. Le distributeur soutenait que la société La Boule Obut n’était pas fondée à invoquer, devant le juge des référés en matière civile, la jurisprudence relative aux conditions de gravité et d’immédiateté de l’atteinte à la concurrence, applicable aux demandes de mesures conservatoires formulées auprès de l’Autorité de la concurrence, puisqu’elle fondait son action sur l’article 873 du Code de procédure civile, dont les conditions sont moins restrictives.
La cour fait droit à l’argument du distributeur. Après avoir rappelé que l’article 873 permet de solliciter, du juge des référés, des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, les deux conditions étant alternatives, elle observe que le juge des référés, même lorsqu’il applique le droit de la concurrence, n’a pas à interpréter ces conditions, autonomes, à la lumière de celles, plus restrictives, imposées par l’article L. 464-1 du Code de commerce qui régit les demandes de mesures conservatoires effectuées devant l’Autorité de la concurrence. L’atteinte à la concurrence justifiant l’octroi de mesures conservatoires doit, en effet, devant l’Autorité, revêtir un double caractère de gravité et d’immédiateté. Ces critères ne sont pas requis devant le juge des référés. Les deux procédures d’urgence ne se recoupent pas, diligentées devant des autorités différentes. Outre les critères de déclenchement, les conditions de prononcé sont différentes, puisqu’une demande de mesures conservatoires devant l’Autorité est toujours accessoire au fond et l’Autorité de la concurrence n’est pas liée par les mesures demandées, tandis que le juge des référés est saisi directement, et ne peut octroyer que les mesures sollicitées par les saisissants.
La cour estime ensuite que les conditions de l’article 873 sont remplies en l’espèce. S’agissant en premier lieu de l’existence d’un trouble manifestement illicite, elle rappelle que généralement, les différenciations tarifaires (différences de prix selon les clients ou catégories de clients concernés, ou remises, rabais, ristournes) sont licites si elles constituent la contrepartie d’une différence de coûts et ne visent pas, en réalité, à restreindre ou éliminer la concurrence. En sens inverse, des différenciations tarifaires qui ont pour objet de désavantager, sans raison objective, une catégorie d’opérateurs, peuvent s’avérer anticoncurrentielles. Une entreprise, même en position dominante, est donc libre de choisir sa stratégie tarifaire, sous réserve de ne pas commettre d’abus.
La cour ne s’attarde pas sur l’existence d’une position dominante. Dès lors qu’elle détient 80 % du marché, la société La Boule Obut pouvait difficilement contester sa position dominante.
À propos de l’existence d’un abus de position dominante, la cour relève que, alors que l’ancien barème de la société La Boule Obut prévoyait une remise uniforme de 20 % au-delà d’un certain seuil d’achats (50 000 €), rabais purement quantitatif qui se justifiait par les économies de coûts procurés au fabricant par la massification des commandes, le nouveau barème de remises pour 2016 distingue trois catégories de clients, qui bénéficient de remises différentes. La catégorie « graveurs de boule », à laquelle appartient la société appelante, est soumise à un barème spécial, distinct des revendeurs détaillants non agréés et des revendeurs agréés. Elle ne présente aucune homogénéité et aucun seuil quantitatif en termes de chiffre d’affaires ne permet de justifier une différence de traitement avec les autres catégories tarifaires.
Le seul élément avancé par la société La Boule Obut est sa volonté de décourager l’activité de graveurs de boules, qu’elle s’estime seule capable de réaliser sur ses propres produits. La discrimination n’est donc pas justifiée par une raison objective (seuil en termes d’achats), mais par la volonté d’évincer un concurrent.
La cour estime par ailleurs que l’augmentation brutale des prix de gros consentis aux revendeurs résultant directement du nouveau barème, signifié quinze jours avant la fin de l’année 2015 pour entrer en vigueur en 2016, est susceptible de constituer, également, une rupture brutale partielle des relations commerciales établies.
S’agissant en second lieu du dommage imminent, il résulte en l’espèce de l’imminence de l’affaiblissement très conséquent de la marge de la société appelante, de nature à perturber son activité, sans qu’il soit nécessaire de démontrer, à ce stade, que sa pérennité même serait menacée.
Les deux conditions du référé étant réunies, alors qu’une seule suffit, la cour infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et, au regard du comportement litigieux qui cause un trouble manifestement illicite susceptible de causer un dommage imminent à la société appelante, fait interdiction à la société La Boule Obut de lui appliquer ses nouvelles conditions commerciales 2016 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par l’Autorité de la concurrence sur la pratique dénoncée3.
IV – Non-respect d’engagement
La cour confirme la décision du 26 février 2015 par laquelle l’Autorité de la concurrence a sanctionné le groupement d’intérêt économique Les Indés Radios à hauteur de 300 000 € pour ne pas avoir respecté des engagements qu’il avait lui-même souscrits en 2006 pour répondre aux préoccupations de concurrence soulevées par le Conseil de la concurrence à la suite d’une plainte. Elle rejette en effet le recours du GIE et maintient donc le montant de la sanction en dépit du fait qu’elle a jugé que deux des manquements relevés par l’Autorité n’étaient pas établis.
On retiendra notamment l’analyse de la cour à propos de l’appréciation que l’Autorité a portée sur la gravité du prétendu non-respect de ses engagements. La requérante a rappelé que la procédure d’engagement est, d’une façon générale et par principe, réservée aux pratiques les moins graves, l’Autorité ayant elle-même indiqué dans son communiqué du 2 mars 2009 qu’elle avait pour objet d’« accélérer des affaires ne portant pas sur des pratiques dont la nature ou les effets sont tels qu’ils appellent a priori le prononcé d’une sanction ». Elle en a conclu qu’il est contradictoire de considérer, comme l’a fait l’Autorité, que le non-respect des engagements souscrits en 2006 constituerait une infraction particulièrement grave et elle soutient que « dans le pire des scenarii », l’inexécution de ces engagements n’entraînerait que le maintien de « préoccupations de concurrence » dont les conséquences sont par définition limitées.
La cour rejette l’argument : au cas d’espèce, la décision contestée n’a pas sanctionné les pratiques reprochées au groupement, lesquelles avaient été examinées par le Conseil de la concurrence dans sa décision de 2006, mais la méconnaissance des engagements qu’il avait souscrits. Or une telle méconnaissance constitue un manquement grave en lui-même, d’autant plus que c’est à l’initiative du GIE que l’Autorité peut accepter les engagements proposés par celui-ci, dont il s’avèrera ensuite qu’ils n’ont pas été respectés. Il est certes reproché au groupement d’avoir manqué, non à tous ses engagements, mais à certains d’entre eux seulement. La cour souligne néanmoins les conséquences négatives, en ce qui concerne l’accès à la publicité radiophonique nationale, résultant de l’effet cumulatif de ces manquements. On ne saurait donc, selon la cour, considérer que ceux-ci n’ont présenté, comme le prétendait le groupement, qu’« un caractère de gravité limité ».
Le groupement reprochait par ailleurs à l’Autorité d’avoir substitué à l’examen du dommage à l’économie, auquel elle s’est abstenue de procéder, une « appréciation de l’incidence des manquements constatés sur la concurrence que les engagements visaient à préserver ». Il faisait valoir, en outre, qu’il n’est résulté des pratiques en cause aucun dommage à l’économie puisque l’objectif poursuivi – favoriser l’accès des radios locales au marché de la publicité radiophonique nationale – a été atteint, comme en atteste le fait que le nombre de radios adhérentes a cru de 2006 à 2016, que le rejet des candidatures s’est fondé sur des raisons objectives, transparentes et non discriminatoires, et que de 2006 à 2009, seules 9 radios sont sorties du GIE.
Cet argument n’a pas plus de succès : faute pour l’article L. 464-3 du Code de commerce de renvoyer aux critères de détermination de la sanction pécuniaire définis par l’article L. 464-2 I, alinéa 3, le groupement ne peut reprocher à l’Autorité de ne pas avoir procédé à une analyse du dommage à l’économie résultant des pratiques en cause. Pour la cour, le reproche de la requérante est d’autant moins fondé que l’Autorité s’est attachée dans sa décision à « apprécier l’incidence que le comportement du GIE a pu avoir sur la concurrence que les engagements visaient à préserver ». L’Autorité s’est ainsi conformée aux principes d’individualisation et de proportionnalité de la sanction, en prenant en considération la nature et l’importance des pratiques en cause, leur contexte et leurs conséquences sur la situation concurrentielle au regard de laquelle les engagements ont été pris4.
V – Valeur des ventes servant au calcul du montant de base des sanctions
Dans l’affaire des produits d’entretien et d’hygiène les requérantes ont soutenu que l’Autorité de la concurrence a inclus à tort les marges arrière dans la valeur des ventes des fournisseurs, qui sert au calcul du montant de base des sanctions, en retenant un chiffre d’affaires « double net » qui comprend la rémunération de la coopération commerciale, au lieu d’utiliser le chiffre d’affaires « triple net », qui ne les inclut pas. En refusant de déduire de la valeur des ventes les montants versés aux distributeurs au titre de la coopération commerciale, l’Autorité aurait commis une erreur de droit et aurait enfreint les principes de proportionnalité des peines et d’égalité de traitement.
Le moyen est rejeté. En effet, la jurisprudence n’a jamais admis la déduction des coûts, du chiffre d’affaires servant de base au calcul des sanctions. Au contraire, il existe, dans tous les secteurs industriels, des coûts inhérents au produit final que le fabricant ne peut maîtriser, mais qui constituent néanmoins un élément essentiel de l’ensemble de ses activités et qui, partant, ne sauraient être exclus de son chiffre d’affaires lors de la fixation du montant de la valeur des ventes. En effet, la valeur des ventes reflète le prix tel qu’il est facturé au client, sans déduction pour les coûts ou autres frais qui sont intégrés dans le prix et font partie intégrante de la vente du produit (pt 189).
Et la cour d’ajouter que, au cas d’espèce, les pratiques de concertation sanctionnées ont eu pour effet de faire échec à la baisse des prix de détail aux consommateurs, qui sont le reflet des prix double net, souhaitée par les pouvoirs publics de 2003 à 2006, lesquels espéraient atteindre cet objectif par une remontée des services de coopération commerciale en marges avant et par une modération des tarifs des fournisseurs aux distributeurs, toutes mesures auxquelles les fournisseurs se sont précisément opposés de concert par les pratiques litigieuses, afin de maintenir à leur profit l’équilibre tacite qui existait sous l’empire de la loi Galland, au détriment des consommateurs. Ces pratiques ont abouti à ce que les prix de détail aux consommateurs, alignés sur le double net, augmentent à un niveau supra-concurrentiel (pt 192)5.
VI – Mise en œuvre cumulée des procédures de clémence et de non-contestation des griefs
On se souvient que l’affaire des produits d’entretien et d’hygiène a été l’occasion pour l’Autorité d’appliquer de façon cumulée les procédures de clémence et de non-contestation des griefs, cumul qui est possible depuis le revirement de la position de l’Autorité dans l’affaire des lessives et qui est même envisagé par le communiqué de procédure relatif à la non-contestation de griefs du 10 février 2012 « lorsque l’Autorité estime que les gains procéduraux attendus d’un tel cumul sont suffisants ». Tel est en particulier le cas « lorsque le champ des griefs notifiés à l’organisme ou à l’entreprise en cause diffère sur un ou plusieurs point(s) important(s) de l’entente telle que décrite par l’intéressé dans sa demande de clémence, au vu de l’ensemble des informations et des éléments de preuve dont il disposait ou pouvait disposer »6.
En l’espèce, l’application cumulée des deux procédures a donné lieu à une discussion devant la cour d’appel de Paris. Les sociétés Colgate Palmolive et Henkel, qui pouvaient prétendre au bénéfice d’une application cumulée des deux procédures, faisaient valoir que l’application en cascade des réductions retenue par l’Autorité de la concurrence, au lieu du cumul des taux de réduction, serait contraire aux dispositions du point 61 du communiqué sanctions du 16 mai 2011 selon lesquelles « l’Autorité réduit ensuite le montant de la sanction pécuniaire pour tenir compte de l’exonération totale ou partielle accordée au titre de la clémence régie par le IV de l’article L. 464-2 du Code de commerce et de la réduction accordée au titre de la non contestation des griefs prévue par le III du même article ». Elles considéraient que l’application de cette disposition telle qu’elle résulte de la décision conduit à une inégalité de traitement au détriment des demandeurs de clémence et qu’elle nuit à l’attractivité de la procédure de clémence. Elles soutenaient en outre qu’une addition des pourcentages de réduction correspondrait à la solution retenue par la Commission en matière de transaction.
Les requérantes ont bénéficié sur ce point du soutien du ministre de l’Économie qui a observé que la méthode retenue par l’Autorité conduit à une forme d’inégalité de traitement entre les bénéficiaires de la procédure de non-contestation des griefs. En effet, selon lui, pour un même pourcentage de réduction obtenu au titre de la non-contestation des griefs par une entreprise bénéficiant de cette seule procédure et par une entreprise bénéficiant par ailleurs de la clémence, l’effet de réduction est plus faible dans le second cas puisque la réduction de l’amende au titre de la clémence diminue l’assiette à laquelle est appliqué le taux de réduction obtenu dans le cadre de la non-contestation des griefs. Il estimait que l’application « en cascade » plutôt que cumulative des réductions aboutit à ce que les entreprises décidant de coopérer le plus et avant les autres (clémence) soient moins bien traitées que celles qui n’ont pas fait ce choix.
L’argument est rejeté. Pour la cour d’appel il résulte des termes du point 6 du communiqué de procédure portant sur la procédure de non-contestation des griefs que le cumul porte sur les procédures, mais ne laisse nullement penser que l’Autorité procéderait à un cumul des taux7 (pt 498).
Elle ajoute que, lorsque, conformément au point 6 du communiqué de procédure, l’Autorité décide de mettre en œuvre les deux procédures conjointement, il se déduit des dispositions de celui-ci qu’elle doit d’abord appliquer au montant de base l’exonération accordée au titre de la clémence avant de faire application de la réduction accordée au titre de la non-contestation des griefs. Cette application en cascade des deux réductions n’aboutit pas à une inégalité de traitement au détriment des bénéficiaires de la procédure de clémence dès lors que l’exonération dont ceux-ci bénéficient est nécessairement supérieure à la réduction pouvant être accordée au titre de la non-contestation des griefs afin de ne pas nuire à l’attractivité de cette première procédure (pt 501).
Par ailleurs, selon la cour, en vertu du principe d’autonomie procédurale, il ne saurait sur ce point être reproché à l’Autorité de ne pas adopter la même façon de procéder que la Commission (pt 501)8.
VII – Contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles
Deux arrêts relevant du « private enforcement » retiendront l’attention. Le premier concerne une pratique de couplage dans le secteur des annonces nécrologiques (A) ; le second une entente anticoncurrentielle favorisant une filiale commune sur le marché des agences de voyage (B).
A – Pratique de couplage sur le marché de l’annonce nécrologique en ligne
Cette première affaire a donné lieu à une action autonome (« stand alone »), dont on sait qu’elle est susceptible de présenter l’avantage pour la victime d’un comportement anticoncurrentiel d’obtenir réparation sans attendre que l’Autorité de concurrence se prononce sur la pratique en cause, mais qui, en revanche, prive la victime de l’avantage probatoire résultant d’une condamnation prononcée par l’Autorité de la concurrence.
Au cas d’espèce, la cour confirme pour l’essentiel un jugement du 7 janvier 2014 par lequel le tribunal de commerce de Lyon, saisi par la société Aviscom, a jugé que le journal La Montagne exploitait une position dominante en se livrant à des ventes liées sur le marché de l’annonce nécrologique en ligne, pratique se traduisant, d’une part, par de la vente forcée, d’autre part, par l’éviction de la société Aviscom.
Pour parvenir à cette solution, la cour a retenu que le journal La Montagne a présenté « une offre unique couplée presse + internet ». Plus précisément, une annonce nécrologique dans le journal impliquait d’office, sans possibilité de la refuser, la parution payante et le service de condoléances sur le site internet www.dansnoscœurs.fr appartenant notamment à la société La Montagne.
La cour a également retenu que le marché pertinent était celui des annonces de décès par voie de papier (pour les départements du Puy-de-Dôme, du Cantal, de l’Allier, de la Creuse et de la Corrèze) et que le marché des annonces nécrologiques en ligne était un marché affecté comme étant complémentaire et connexe.
Pour elle, la pratique en cause a eu pour but de favoriser la société La Montagne. En effet, cette pratique interdisait de fait aux sociétés concurrentes de s’installer sur le marché des annonces nécrologiques en ligne puisque leur service faisait double emploi avec celui imposé par le journal La Montagne sur le site www.dansnoscœurs.fr et que les familles n’avaient alors aucun intérêt financier à souscrire à deux services internet qui remplissent le même office.
La cour a par ailleurs rejeté un argument par lequel les appelantes soutenaient que la vente couplée représentait un gain d’efficacité, au sens du droit de la concurrence, pour le consommateur de nature à écarter tout caractère abusif de leur position dominante. Elle retient en effet que ceux-ci se voyaient imposer systématiquement le paiement au demeurant dissimulé dans une offre non détaillée, d’une prestation de services qu’ils ne pouvaient refuser même s’ils ne la souhaitent pas.
Notons encore que, dans cette affaire, la victime reprochait également à la société La Montagne une entente illicite mais elle a été déboutée par le tribunal de commerce. Cette solution est également confirmée par la cour d’appel de Paris, celle-ci reprochant à l’intimée de ne pas avoir établi l’existence d’un accord de volontés.
S’agissant enfin de l’indemnisation, la cour juge que la perte de chance subie par la société Aviscom sera réparée par l’allocation d’une somme de 5 000 €9.
B – Entente favorisant une filiale commune sur le marché des agences de voyage
Cette deuxième affaire a donné lieu à une action de suivi (« follow on »), intervenant postérieurement à une décision de condamnation prononcée par l’Autorité de la concurrence.
On se souvient que, par décision n° 09-D-06 du 5 février 2009, l’Autorité de la concurrence a condamné un accord de partenariat entre le groupe SNCF et l’agence de voyage en ligne Expedia qui conférait un avantage à la filiale commune Voyages-sncf.com (VSC) au détriment des autres agences de voyage en ligne en permettant à la SNCF d’orienter les acheteurs de ses billets en ligne vers les prestations de VSC, et ainsi, de faire profiter cette dernière de la publicité, de l’efficacité commerciale et de la réputation de qualité de la SNCF. L’Autorité a jugé l’accord anticoncurrentiel dans la mesure où il avait pour objet de réserver un avantage déterminant à la filiale commune et ainsi de fausser la concurrence par les mérites.
Dans le cadre d’une procédure de non-contestation des griefs, la SNCF a pris des engagements visant à placer le site voyages-sncf.com dans les mêmes conditions de concurrence que les autres agences de voyage en ligne pour la distribution de produits non ferroviaires.
Cette décision de l’Autorité a été approuvée par un arrêt du 23 février 2010 de la cour d’appel de Paris qui est devenu définitif après le rejet du pourvoi par un arrêt du 16 avril 2013 de la Cour de cassation.
L’action indemnitaire a été introduite par le liquidateur d’une agence de voyage. Le tribunal de commerce de Paris y a fait droit en condamnant la SNCF à des dommages-intérêts d’un montant de 8,9 millions d’euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute de la SNCF. Son jugement est confirmé par la cour d’appel de Paris.
La procédure devant l’Autorité de la concurrence a offert un réel avantage probatoire à la victime notamment au stade de la démonstration de la faute civile. Certes, la cour rappelle que l’acceptation de la procédure de non-contestation des griefs devant l’Autorité de la concurrence ne constitue ni un aveu ni une reconnaissance de culpabilité. Par ailleurs, une condamnation par l’Autorité de la concurrence, qui constitue une décision administrative et ne lie pas le juge, n’établit pas nécessairement l’existence d’une faute civile. La cour relève cependant qu’il a été définitivement jugé que le partenariat conclu entre la SNCF et la société Expedia, créant l’Agence VSC, constituait une entente anticoncurrentielle prohibée par les dispositions des articles L. 420-1 du Code de commerce et 81 du traité CE devenu 101 du TFUE « comme ayant eu pour objet et pour effet » de favoriser leur filiale commune, l’Agence VSC, sur le marché des services d’agence de voyage fournis pour les voyages de loisir au détriment des concurrents.
Il a donc définitivement été jugé, conclut la cour, que la SNCF a commis une pratique anticoncurrentielle illicite ayant eu des effets restrictifs de concurrence sur le marché des services d’agence de voyage prestés pour les voyages de loisir, laquelle constitue nécessairement une faute de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
S’agissant du préjudice, la SNCF a fait valoir qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’entente et le préjudice invoqué par la victime dès lors que l’agence VSC et la victime n’étaient que très marginalement en concurrence. Elle considérait que la victime était avant tout un tour opérateur alors que l’agence VSC est une agence de voyage et que donc ces deux sociétés n’intervenaient pas, la plupart du temps, au même stade de la chaîne de distribution des produits touristiques.
S’appuyant une nouvelle fois sur la procédure « concurrence », la cour rejette l’argument en observant qu’il a été définitivement jugé que du fait du partenariat mis en place par la SNCF ayant permis d’orienter les acheteurs de billets de train en ligne vers les prestations d’agences de voyage de l’Agence VSC, les agences de voyage en ligne concurrentes de cet opérateur n’ont eu aucune possibilité durant l’entente d’accéder à un tel canal pour vendre leurs propres produits de sorte que contrairement à ce que soutenait la SNCF, il est établi que l’entente n’a pas eu seulement un objet anticoncurrentiel mais également des effets anticoncurrentiels, au détriment des concurrentes de l’Agence VSC.
La cour ajoute qu’il importe peu, au stade de la détermination de l’existence d’un préjudice personnel et certain en lien direct avec la pratique en cause, d’une part, que la victime et l’Agence VSC n’aient pas été concurrentes sur l’ensemble de leur activité et donc qu’elles n’aient été que « marginalement » en concurrence en matière de ventes de voyage à forfait, cet élément ne pouvant être éventuellement pris en considération que dans le cadre de l’évaluation du préjudice10.
VIII – Perte du bénéfice d’une exclusivité territoriale – rupture brutale des relations commerciales établies
Saisie par un concessionnaire qui se plaignait d’une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l’article L. 442-6-I 5°, la cour a confirmé le jugement par lequel le tribunal de commerce de Marseille a débouté le concessionnaire de sa demande d’indemnisation en estimant que le préavis était raisonnable et suffisant compte tenu de l’ancienneté de la relation ayant existé entre les parties.
Bien que le concédant ait respecté un préavis de deux ans, le concessionnaire a soutenu, devant la cour, que la résiliation dont le concédant avait pris l’initiative était brutale au motif qu’il a été privé des 18 derniers mois du préavis dès lors que la relation commerciale n’a pas été maintenue aux conditions antérieures en raison de la suppression de l’exclusivité territoriale prévue au contrat.
La cour a rejeté le moyen en observant que l’abandon de l’exclusivité conformément aux dispositions contractuelles ayant lié les parties constitue l’aménagement contractuel de l’exécution du préavis en cas de rupture du contrat et n’a pas pour effet de déroger aux dispositions impératives de l’article 442-6 I 5° du Code de commerce et n’est donc pas assimilable à une rupture brutale des relations commerciales11.
Notes de bas de pages
-
1.
CA Paris, 1er déc. 2016, n° 12/11639 ; par un arrêt du 15 déc. 2016, n° 2012/08968, la cour, sanctionnant aussi la présence du rapporteur et du rapporteur général au délibéré du Conseil de la concurrence dans l’affaire du béton prêt à l’emploi dans la région Provence -Alpes-côte d’Azur a également, après une série de quatre cassations, adopté une solution analogue en annulant en tant qu’elle concerne les requérantes la décision du Conseil de la concurrence n° 97-D-39 du 17 juin 1997.
-
2.
CA Paris, 19 oct. 2016, n° 14/07956.
-
3.
CA Paris, 7 déc. 2016, n° 16/15228.
-
4.
CA Paris, 6 oct. 2016, n° 15/06776.
-
5.
CA Paris, 27 oct. 2016, n° 15/01673.
-
6.
Communiqué de procédure du 10 févr. 2012, n° 49, spéc. pt 6 ; Arhel P., « Non-contestation des griefs et programmes de conformité », JCP E 2012, act. 131, p. 9
-
7.
Le point 6 du communiqué de procédure portant sur la procédure de non-contestation des griefs du 10 février 2012 précise que dans les affaires dans lesquelles les procédures de clémence et de non-contestation des griefs sont envisageables, il convient d’inciter les entreprises à s’orienter en premier lieu vers la clémence mais « cela est néanmoins sans préjudice de la possibilité d’accorder à une seule et même entreprise, à l’initiative du rapporteur général, une réduction de sanction au titre tant du III que du IV de l’article L. 464-2 du Code de commerce, lorsque l’Autorité estime que les gains procéduraux attendus d’un tel cumul sont suffisants ».
-
8.
CA Paris, 27 oct. 2016, n° 15/01673.
-
9.
CA Paris, 7 déc. 2016, n° 14/01036.
-
10.
CA Paris, 14 déc. 2016, n° 13/08975.
-
11.
CA Paris, 7 nov. 2016, n° 15/10249.