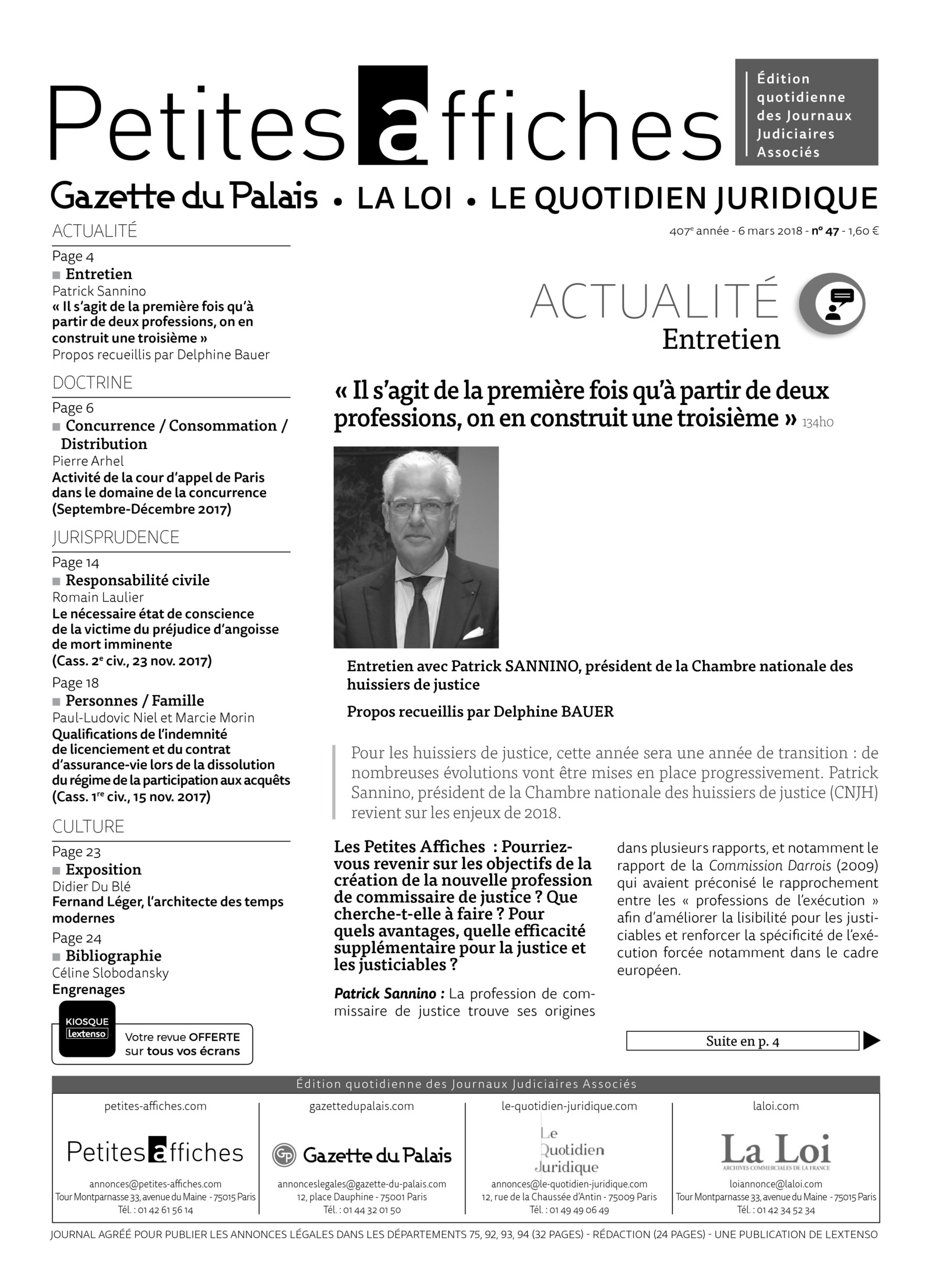Activité de la cour d’appel de Paris dans le domaine de la concurrence (Septembre-Décembre 2017)
Le présent article porte sur les arrêts rendus par la cour d’appel de Paris en droit de la concurrence, au sens du livre IV du Code de commerce, au cours de la période de septembre à décembre 2017. Les points suivants retiendront plus particulièrement l’attention : Protection du secret des correspondances avocat/client (I) ; Confirmation de la décision rendue dans l’affaire des commissions interbancaires (II) ; Confirmation de la décision rendue dans l’affaire des pratiques mises en œuvre par la société TDF sur le site de la tour Eiffel (III) ; Annulation partielle de la décision rendue dans l’affaire des pratiques de la société TDF dans le secteur de la diffusion de la télévision par voie hertzienne (IV) ; Notion de « partenaire commercial » (V) ; Déséquilibre significatif (affaire ITM) (VI).
I – Protection du secret des correspondances avocat/client
À l’origine de cette affaire, des opérations de visite et de saisie ont été réalisées, en 2013, dans diverses entreprises du secteur de la distribution de produits « blancs » et « bruns » puis, en 2014, dans les locaux de la société Whirlpool.
Saisi par Whirlpool, qui a contesté le déroulement de cette dernière opération, le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris adopte une conception élargie de la protection du secret des correspondances avocat/client en faisant droit à un moyen qui reprochait aux agents de l’Autorité de la concurrence d’avoir violé le secret professionnel : l’entreprise arguait que ces agents ont, en pleine connaissance de cause, violé ses droits de la défense dans le cadre de l’enquête en cours en ciblant, lisant et saisissant des documents couverts par le secret professionnel et concernant précisément sa défense dans le cadre de l’enquête.
Était visée par le recours la saisie de courriels de juristes de l’entreprise reprenant des informations communiquées par un cabinet d’avocats sur la défense de l’entreprise à la suite des opérations de 2013.
Même si ces courriels n’émanaient pas ou n’étaient pas adressés à un avocat, ils reprenaient une stratégie de défense mise en place par le cabinet d’avocats. Le délégué du premier président de la cour d’appel estime en conséquence que leur saisie a porté atteinte aux droits de la défense. Il annule en conséquence les courriels et interdit à l’Autorité d’en garder copie et d’en faire état de quelque manière que ce soit1.
II – Confirmation de la décision rendue dans l’affaire des commissions interbancaires
La cour d’appel de Paris se prononce à nouveau, après cassation, dans l’affaire des commissions interbancaires. On se souvient que le Conseil de la concurrence s’était saisi d’office de la situation concernant les tarifs et les conditions liées appliqués par les banques et les établissements financiers pour le traitement des chèques remis aux fins d’encaissement. Par décision du 20 septembre 2010, l’Autorité de la concurrence a jugé que les banques en cause avaient enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du Code de commerce et celles de l’article 101, § 1, du TFUE, et leur a infligé des sanctions pécuniaires. Les banques ont formé un recours contre cette décision et les associations UFC-Que choisir et ADUMPE sont intervenues volontairement à l’instance devant la cour d’appel.
Après avoir jugé que l’Autorité de la concurrence n’avait établi ni un objet ni des effets anticoncurrentiels et réformé en conséquence la décision attaquée en toutes ses dispositions, la cour d’appel a retenu qu’il suffisait de constater que, par suite de la réformation de la décision de l’Autorité de la concurrence découlant de la mise hors de cause des banques, les interventions des associations UFC-Que choisir et ADUMPE étaient sans objet.
Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, sans examiner les moyens des parties intervenantes, la cour d’appel, qui les a privées du droit d’être effectivement entendues, a violé les articles 6 paragraphe 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et 554 du Code de procédure civile2.
Saisie à nouveau dans une autre formation, la cour d’appel confirme pour l’essentiel la décision attaquée et approuve notamment la conclusion de l’Autorité sur l’existence d’une restriction par objet. Ce faisant, elle observe qu’il est connu et reconnu par l’expérience acquise et la science économique que les accords visant à maintenir les équilibres entre opérateurs en concurrence sur un marché sont particulièrement nocifs pour le jeu de la concurrence en ce qu’ils aboutissent à amoindrir le degré de concurrence entre eux et à figer le marché. De même, ajoute-t-elle, les comportements consistant pour les opérateurs d’un marché à se concerter et fixer ensemble un élément de leurs coûts sont particulièrement nocifs pour le jeu de la concurrence, car ils font obstacle à la libre fixation des prix qui doit prévaloir sur les marchés.
Or, en l’espèce, les banques en cause ont décidé d’introduire dans les charges des banques remettantes un élément artificiel de coût dont elles avaient fixé le montant en concertation, qui s’appliquait de façon systématique à chaque remise de chèque par toute banque remettante et avait pour vocation reconnue que les effets de la dématérialisation de l’encaissement ne pèsent pas sur les banques tirées et n’entraînent pas des déséquilibres financiers.
Les parties ont soutenu que la pratique en cause ne peut être considérée comme anticoncurrentielle par objet dès lors qu’aucune commission interbancaire identique n’avait, par le passé, été sanctionnée par les autorités européennes et nationales de concurrence et qu’aucune expérience ne permet d’affirmer la nocivité d’une telle pratique.
Pour rejeter l’argument, la cour d’appel s’appuie sur la jurisprudence du tribunal de l’Union qui, dans son arrêt du 8 septembre 20163, a relevé que la possibilité de se référer à la jurisprudence antérieure pour caractériser l’évidence du caractère nocif d’une pratique n’implique pas que celui-ci ait déjà été reconnu pour une pratique totalement identique. Ainsi, il importe peu qu’aucune pratique de commission interbancaire multilatérale n’ait encore été sanctionnée par une autorité de concurrence nationale ou par la Commission européenne et les juridictions européennes au titre des restrictions par objet, mais seulement au regard de leurs effets. Il suffit qu’il soit connu par l’expérience que le type de pratiques auquel se rattache le comportement poursuivi, est suffisamment nocif pour le libre jeu de la concurrence. Or tel est bien le cas d’une pratique consistant, comme en l’espèce, pour tous les opérateurs d’un secteur, à fixer en commun un élément artificiel de coût (pt 220).
De même, ajoute la cour, le constat selon lequel la Commission européenne n’a jusqu’à présent sanctionné que des commissions interbancaires accompagnées d’un accord de répercussion, ne permet pas de conclure qu’un tel accord serait la condition sans laquelle les commissions interbancaires ne peuvent pas être considérées comme constitutives d’une infraction par objet au droit de la concurrence. En effet, il ne ressort pas de la jurisprudence de l’Union qu’une commission interbancaire telle que celle de l’espèce aurait été jugée comme non constitutive d’une pratique anticoncurrentielle par objet, au motif qu’elle n’était pas assortie d’un accord de répercussion sur la clientèle (pt 221).
La décision de l’Autorité est en conséquence confirmée. Cependant, elle est réformée en ce qu’elle a majoré de 10 % le montant de la sanction infligée aux sociétés BNP Paribas, Crédit Agricole, La Banque postale, BPCE, venant aux droits de la société CE Participations et à la Confédération nationale du Crédit mutuel, la cour d’appel estimant que l’Autorité n’a pas établi que ces quatre banques ont joué un « rôle actif de conviction de leurs partenaires4.
III – Confirmation de la décision rendue dans l’affaire des pratiques mises en œuvre par TDF sur le site de la tour Eiffel
La cour d’appel de Paris confirme en tous points la décision rendue par l’Autorité de la concurrence dans l’affaire des pratiques mises en œuvre par Télédiffusion de France (TDF) sur le site de la tour Eiffel. Rappelons que cette décision avait condamné trois pratiques d’abus de position dominante qui ont fait l’objet respectivement de trois griefs notifiés à l’entreprise :
-
transmission tardive et incomplète au concurrent TowerCast des informations qui lui étaient indispensables pour répondre à l’appel d’offres de la ville de Paris pour le renouvellement de la convention domaniale du site de la tour Eiffel ;
-
fourniture tardive et incomplète des informations indispensables à TowerCast pour construire son offre de diffusion à destination des radios ;
-
imposition de prix inéquitable aux concurrents sous la forme de ciseau tarifaire entre le prix de détail sur le marché de gros aval des services de diffusion de programme radiophonique en mode FM depuis le site de la tour Eiffel et le prix de l’accès au marché de gros amont5.
S’agissant du grief n° 1, la cour répond d’abord à un argument de TDF qui reprochait à l’Autorité d’avoir rendu une décision de condamnation alors que les juridictions administratives, également saisies du litige opposant TDF à TowerCast, avaient conclu qu’aucun abus de position dominante n’avait entaché la régularité du renouvellement de la convention d’occupation domaniale du site de la tour Eiffel. Pour elle, « il appartenait aux juridictions administratives de déterminer si la Ville de Paris, autorité délégante, avait violé les règles de concession du domaine public, et non d’apprécier si la société TDF avait abusé de sa position dominante. À l’inverse, l’Autorité et, sur recours, la cour, doivent rechercher si la société TDF a commis un abus de position dominante. Or l’absence de faute de la part d’une autorité délégante ne suffit pas à exclure qu’un abus de position dominante ait été commis par l’un des candidats à l’occasion de l’appel d’offres, a fortiori lorsque, comme en l’espèce, est en question non pas le respect de l’obligation pesant sur l’autorité délégante d’assurer un égal traitement à tous les candidats, mais le respect, par un candidat en position dominante, de l’obligation de communiquer aux autres candidats des informations dont l’autorité délégante n’a elle-même pas connaissance » (pt 60).
Répondant ensuite aux arguments relatifs à la communication des informations, la cour conclut que « en n’ayant pas communiqué sans délai l’ensemble des informations indispensables à la société TowerCast pour construire l’offre la plus compétitive, la société TDF a amélioré sa position concurrentielle sur le marché de l’appel d’offres pour le renouvellement de la concession d’occupation domaniale. Ce faisant, elle a encore affaibli la structure de concurrence sur ce marché, sur lequel elle détenait une position dominante, et ce par des moyens autres que ceux qui relèvent d’une concurrence par les mérites » (pt 97).
En ce qui concerne le grief n° 2, la cour retient que les informations transmises par TDF à TowerCast étaient tardives, imprécises, voire inexactes (pt 275). Dès lors, TowerCast s’est trouvée dans l’impossibilité de construire une offre de diffusion, a fortiori concurrentielle (pt 276). Même à supposer qu’elle ait finalement reçu les informations suffisantes pour lui permettre d’élaborer une offre de diffusion à destination des éditeurs, la tardiveté de leur communication ne lui aurait pas permis de concourir à armes égales avec la société TDF, compte tenu du calendrier très contraint qui s’imposait aux éditeurs (pt 277).
S’agissant enfin du grief n° 3, la cour confirme la réalité de la pratique de ciseau tarifaire6.
IV – Annulation partielle de la décision rendue dans l’affaire des pratiques de la société TDF dans le secteur de la diffusion de la télévision par voie hertzienne
À l’origine de l’affaire de la diffusion de la télévision par voie hertzienne, l’Autorité de la concurrence, saisie par Itas Tim, le principal concurrent de la société TDF, avait retenu que TDF avait abusé de sa position dominante en mettant en œuvre les trois pratiques suivantes :
-
invocation de servitudes radioélectriques sans objet ou inexistantes pour s’opposer, par des avis négatifs, aux projets d’infrastructures de diffusion des concurrents (deuxième volet du grief n° 1) ;
-
mise en œuvre d’une communication trompeuse et de dénigrement auprès des collectivités locales, consistant à pointer le risque non avéré de perturbation technique et la nécessité de la consulter en tant que service de l’État (troisième volet du grief n° 1) ;
-
mise en œuvre d’une remise dite « de plaque géographique », liée au fait que les opérateurs de multiplex s’approvisionnent auprès de la société TDF pour une part importante, ou pour la totalité des sites de diffusion d’une zone géographique déterminée (grief n° 3).
Dans son arrêt du 21 décembre 2017, la cour d’appel de Paris annule partiellement la décision de l’Autorité, estimant non établie la pratique de dénigrement. En revanche, elle approuve l’analyse de l’Autorité s’agissant de l’instrumentalisation des servitudes et du système de remise.
A – Dénigrement des sociétés concurrentes
S’agissant de la pratique de dénigrement des sociétés concurrentes, qui avait fait l’objet du troisième volet du grief n° 1, la cour refuse d’approuver l’Autorité. Rappelons que celle-ci reprochait à la société TDF d’avoir, dans un courriel-type, adressé à la quasi-totalité des communes de la plaque Alsace, mentionné un risque spécifique de brouillage en cas d’implantation d’un pylône concurrent à proximité de ses installations. Ce faisant, selon l’Autorité, la société TDF a tenu un discours dénigrant de nature à induire en erreur les collectivités territoriales destinataires et à les inciter à refuser les projets d’infrastructures de diffusion de ses concurrents.
Pour la cour, l’Autorité a surinterprété le courriel-type.
D’abord, dès lors que le courriel-type invitait les maires à consulter la société TDF sur tout projet d’implantation d’un pylône concurrent, ceux-ci n’étaient pas incités à s’opposer à un tel projet avant d’avoir été préalablement éclairés par la société TDF (pt 137).
Ensuite, si la lecture du courriel-type indiquait aux maires destinataires que l’implantation d’un pylône concurrent entraînerait vraisemblablement des perturbations, rien, dans ce message, ne pouvait les amener à penser que ces perturbations seraient irréversibles, ni même graves (pt 138).
Par ailleurs, en invitant les maires à aviser la société TDF « afin d’anticiper toute perturbation », le courriel-type laissait entendre que des remèdes pouvaient être mis en œuvre, de sorte que, loin de laisser croire aux maires que la solution passait par une interdiction d’implantation d’un pylône concurrent, le courriel-type suggérait qu’une intervention de la société TDF sur ses propres installations permettrait d’éviter les perturbations (pt 139).
La cour constate encore que le courriel-type se borne à une présentation des conséquences de la colocalisation de deux pylônes, certes incomplète, et à ce titre trompeuse, mais neutre en ce qu’elle n’est pas orientée contre les sociétés concurrentes de la société TDF. En effet, il s’en déduit que le risque de perturbation résulte de toute implantation d’un nouveau pylône à côté d’un premier pylône, quels que soient les exploitants respectifs de l’un et de l’autre. Ce n’est donc en rien une critique de l’entreprise poursuivant le projet d’implantation d’un nouveau pylône, ou de ses produits ou services (pt 141).
Dans ces conditions, le caractère dénigrant du courriel-type n’est pas démontré (pt 142).
La cour ajoute que c’est davantage la possibilité que la société TDF s’est réservée, par le courriel-type, de pouvoir influencer la décision des collectivités territoriales sur les projets d’implantation concurrente à l’occasion de sa consultation par les maires, qui soulève des questions de compatibilité avec une concurrence loyale et non faussée. Mais l’Autorité n’a pas incriminé ce comportement en tant que tel, mais le seul caractère prétendument dénigrant du courriel-type (pt 143).
Dès lors, le troisième volet du grief n° 1, relatif à la mise en œuvre d’une politique de communication dénigrante auprès des collectivités locales, n’est pas établi (pt 144).
B – Instrumentalisation des servitudes
La cour estime que c’est en vain que les requérantes ont fait valoir qu’il n’était ni établi que les servitudes ont constitué une barrière à l’entrée susceptible d’entraver le développement de la concurrence sur le marché de la diffusion, ni démontré que les avis de la société TDF ont causé un retard dans le développement des infrastructures concurrentes (pt 110).
Il résulte en effet de l’instruction que plusieurs refus de maires de voir la société Itas Tim implanter un pylône radioélectrique ont été provoqués par l’opposition de la société TDF au projet, ce qui suffit à conclure que les avis de la société TDF ont eu un effet sur le développement de la concurrence par les infrastructures. Même si ces refus ont été finalement levés, après des démarches de la société Itas Tim, ils ont obligé cette société à mobiliser des ressources et du temps pour surmonter les oppositions initiales des maires et ont retardé le développement de ses infrastructures (pt 111).
C – Remise anticoncurrentielle
La cour confirme également la condamnation du système de remise de plaque géographique mis en place par la société TDF. Il s’agit d’une remise liée au nombre de sites de diffusion de la société TDF que chaque opérateur de multiplex sélectionne à l’intérieur de zones géographiques délimitées par TDF pour chaque appel d’offres. Plus précisément, une remise sur la part « émission » du prix de la prestation de diffusion proposée par la société TDF est accordée lorsqu’un opérateur de multiplex retient cette société pour un certain nombre de sites de l’appel d’offres sur un même sous-ensemble géographique appelé « plaque géographique ».
Pour la cour, l’Autorité a démontré à suffisance de droit le caractère anticoncurrentiel de la remise.
Certes, dès lors que le bénéfice de chaque remise de plaque n’était pas subordonné à la condition que l’opérateur de multiplex confie la totalité ou une partie importante de ses besoins de diffusion à la société TDF, le système de rabais mis en place par cette société ne pouvait être qualifié de rabais d’exclusivité (pt 212).
Dans ces conditions, l’Autorité ne pouvait présumer, comme elle l’a fait, que les remises de plaque étaient constitutives d’un abus de position dominante (pt 213).
La cour a donc recherché si, en instaurant le système de remise de plaque, la société TDF a abusé de sa position dominante.
Elle constate à cet égard que, appréciée au niveau de chaque plaque géographique, la remise de plaque réunit toutes les caractéristiques d’un rabais d’exclusivité au sens de la jurisprudence des juridictions de l’Union (pt 220).
Il est de jurisprudence constante des juridictions de l’Union que des rabais accordés pour des quantités individualisées correspondant à la totalité ou à la quasi-totalité de la demande ont le même effet que des clauses expresses d’exclusivité, en ce sens qu’ils amènent le client à s’approvisionner pour la totalité ou pour la quasi-totalité de ses besoins auprès de l’entreprise en position dominante (pt 221).
Or l’attribution à la société TDF, par un opérateur de multiplex, de la diffusion de ses programmes à partir d’au moins 70 % des sites de diffusion d’une plaque conditionne l’obtention du premier (et parfois unique) seuil de remise pour 59 % des plaques concernées par la pratique et l’obtention du seuil intermédiaire de remise pour 95 % des plaques présentant deux seuils de remise ; de même, l’attribution à la société TDF, par un opérateur de multiplex, de la diffusion de ses programmes à partir d’au moins 80 % des sites de diffusion d’une plaque conditionne l’obtention du seuil supérieur de remise pour 100 % des plaques présentant trois seuils de remise (pt 222).
C’est donc à juste titre que l’Autorité a constaté que la part des sites qu’un opérateur de multiplex doit confier à la société TDF pour obtenir les remises correspond la plupart du temps à une fraction considérable des sites de la plaque géographique considérée (pt 223).
Par ailleurs, outre qu’ils s’appliquent sur la totalité de la prestation de diffusion sur une plaque donnée, les taux de remise sont loin d’être négligeables, variant entre 3 % et 23 % (pt 232).
Au surplus, les contrats de prestation de services de diffusion passés par les opérateurs de multiplex avec l’opérateur de diffusion, notamment la société TDF, sont de longue durée, en général 5 ans, de sorte que la remise de plaque, accordée pour cette même durée, représente, à l’issue du contrat, des économies importantes pour l’opérateur de multiplex (pt 233).
Dans ces conditions, la remise de plaque proposée par la société TDF, en position dominante sur chaque plaque considérée et dont le bénéfice suppose que l’opérateur de multiplex confie la diffusion de ses programmes à la société TDF à partir d’au moins 70 % des sites de diffusion de cette plaque – représentant en même temps 70 % des besoins de diffusion de l’opérateur de multiplex – est une puissante incitation faite aux opérateurs de multiplex, qui s’adressent de toutes façons à la société TDF pour une part significative de leurs besoins de diffusion, de lui en confier au moins 70 % sur la majorité des 43 plaques géographiques concernées par la pratique (pt 234).
Partant, la remise de plaque a eu potentiellement un effet d’exclusion de la concurrence lors des appels d’offres pour la diffusion à partir des sites localisés sur ces plaques, puis pendant toute la durée des contrats de diffusion, généralement de 5 ans, conclus par la société TDF lorsqu’elle a remporté des appels d’offres (pt 235).
Finalement, la cour considère que, eu égard à ses caractéristiques, à ses taux, à ses seuils de déclenchement, à sa durée et à son étendue, le système de remise de plaque a été de nature à limiter l’intensité de la concurrence sur le marché (pt 242)7.
V – Notion de « partenaire commercial »
Un contentieux initié par le ministre chargé de l’Économie et visant notamment la société Cometik, offre l’occasion à la cour de préciser la notion de « partenaire commercial » au sens des articles L. 442-6, I, 1°, et L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce8.
L’activité de cette entreprise consiste à proposer à des professionnels la création de sites Internet dans le cadre d’un contrat d’une durée de 48 mois étant précisé que le client a la possibilité de signer un contrat d’abonnement de site internet et un contrat de licence d’exploitation de site internet. À l’issue d’une enquête diligentée par la DGCCRF, la société Cometik a été assignée par le ministre, notamment sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2°. Elle s’est défendue en soutenant que les relations qu’elle entretient avec ses clients ne sont pas des relations de partenariat commercial puisqu’elle leur loue un site et des services qu’ils rémunèrent dans le seul but de promouvoir sa propre activité ; les sociétés clientes ne poursuivent donc pas un objectif commun avec elle. Il s’agit donc, selon la société Cometik, de relations entre cocontractants.
Sensible à cet argument, la cour commence par énoncer que les pratiques visées aux articles L. 442-6, I, 1°, et L. 442-6, I, 2°, étant des délits civils qui peuvent être sanctionnés par des amendes civiles élevées, le principe d’interprétation stricte doit prévaloir.
Elle définit ensuite le partenaire commercial comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d’agent économique ou plus étroite de cocontractant.
Il en ressort que deux entités deviennent partenaires, soit par la signature d’un contrat de partenariat, soit parce que leur comportement traduit la volonté de développer des relations stables et établies dans le respect des règles relatives à la concurrence pour coopérer autour d’un projet commun. Le contrat de partenariat formalise, entre autres, la volonté des parties de construire une relation suivie. Cette notion implique un examen concret de la relation entre les parties et de l’objet du contrat.
Or en l’espèce, les contrats de mise à disposition de site internet conclus entre la société Cometik et ses clients sont des contrats de location.
Il s’agit, en premier lieu, d’opérations ponctuelles à objet et durée limités n’engendrant aucun courant d’affaires stable et continu entre les parties.
Par ailleurs, aucune réciprocité autour d’un projet commun ne réunit les cocontractants.
En définitive, si la société Cometik s’engage à louer un site qu’elle a installé et dont elle s’engage à effectuer la maintenance, la société contractante ne fait que s’acquitter de ses loyers, de sorte qu’aucune réciprocité ou accord autour d’un projet commun n’en ressort. La circonstance alléguée par le ministre selon laquelle les sites internet peuvent être qualifiés d’œuvres de collaboration, ne suffit pas en soi à caractériser la notion de partenariat, la collaboration du client se limitant en l’espèce à l’établissement du cahier des charges, en amont du contrat. De même, le fait que le fournisseur s’est engagé à fournir une prestation à exécution successive, à savoir la maintenance du site, que cette prestation soit accessoire ou essentielle, est indifférent à la caractérisation de la notion, puisqu’il s’agit encore d’une obligation à la charge du fournisseur.
Au final, la cour juge que le ministre ne peut, en l’espèce utilement invoquer l’application de l’article L. 442-6, I, 2°.
Notons encore que dès lors que l’assignation du ministre visait également une société de financement, s’est posée la question de l’application à cette entreprise de l’article L. 442-6. La cour observe à cet égard que les activités de l’entreprise ne relèvent pas du Code de commerce mais des dispositions spécifiques du Code monétaire et financier, la loi spéciale prévalant sur la loi générale. Celle-ci est donc mise hors de cause9.
VI – Déséquilibre significatif
La cour d’appel de Paris confirme le jugement du 6 février 2013 par lequel le tribunal de commerce d’Evry a rejeté les demandes du ministre chargé de l’Économie visant à condamner la société ITM Alimentaire International pour non-conformité de ses pratiques commerciales aux exigences de l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce dont on rappelle qu’il dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Étaient plus précisément visés les articles 210 et 411 de la convention d’affaires de 2009 signée par différentes entités du groupe ITM. L’analyse de la cour s’articule autour des deux éléments de la pratique restrictive visée à l’article L. 442-6, I, 2°, à savoir, en premier lieu la soumission ou la tentative de soumission et, en second lieu, l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif.
A – Soumission ou tentative de soumission
Sur le premier élément, la cour rappelle que si la structure d’ensemble du marché de la grande distribution peut constituer un indice de rapports de force déséquilibrés, se prêtant difficilement à des négociations véritables entre distributeurs et fournisseurs, cette seule considération ne peut suffire à démontrer l’élément de soumission ou de tentative de soumission d’une clause du contrat signé entre eux, même si ce contrat est un contrat-type. Cet indice doit être complété par d’autres indices.
Cependant, le ministre n’a pas apporté les éléments de preuve requis. La cour énonce à cet égard qu’il ne peut être inféré du seul contenu des clauses ou du contexte économique caractérisé par une forte asymétrie du rapport de force en faveur du distributeur la caractérisation de la soumission ou tentative de soumission exigée par le législateur. L’insertion de clauses « déséquilibrées » dans un contrat-type ne peut suffire en soi à démontrer cet élément, seule la preuve de l’absence de négociation effective pouvant l’établir, la soumission ne pouvant être déduite de la seule puissance de négociation du distributeur, in abstracto.
Dès lors que le ministre n’est pas parvenu à établir la soumission ou la tentative de soumission, la pratique de déséquilibre significatif n’est pas constituée, sans qu’il soit utile d’examiner la réalisation de la deuxième condition tenant à l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif. C’est donc de manière surabondante que cette deuxième condition est examinée par la cour.
B – Existence d’obligations créant un déséquilibre significatif
S’agissant de la clause de l’article 2, le ministre a soutenu qu’elle a créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, car il permet au distributeur de renégocier ou d’exclure les clauses des CGV fournisseur, sans aucune réciprocité prévoyant que les fournisseurs peuvent également renégocier les CGA du distributeur et sans justification puisqu’aucun élément objectif et nouveau ne permet de justifier une telle renégociation ou exclusion et crée le risque que le distributeur renégocie tout au long de l’année la convention d’affaires.
La cour refuse cependant de faire droit à cet argument. Pour elle, la clause litigieuse ne contient aucune obligation positive, mais renvoie à la faculté, pour les parties, d’exclure ou rediscuter des clauses des CGV des fournisseurs d’un commun accord ; elle renvoie donc à de possibles négociations futures. La cour n’approuve pas à cet égard l’assertion du ministre selon laquelle « le fournisseur se retrouve, par application de cette clause, débiteur d’une obligation incontestable de renégocier ou d’exclure ces conditions générales de vente qui, bien qu’intégrées à la convention d’affaires 2009, ne sont pas acceptées par le distributeur ». Le renvoi à un futur et hypothétique commun accord des parties ne constitue nullement une obligation imposée aux fournisseurs.
La cour se réfère ensuite à un avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales selon lequel « les cocontractants peuvent légalement décider, d’un commun accord, d’écarter pour partie les conditions du fournisseur, sous réserve de ne pas créer un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6 du Code de commerce ». Elle en conclut que ce procédé n’est pas en soi constitutif d’une obligation source de déséquilibre significatif, celui-ci devant s’apprécier lors de la négociation effective de clauses déséquilibrées.
La cour est en revanche sensible à l’argument du ministre relatif à l’article 4. Celui-ci faisait valoir que le paiement des factures et avoirs par le fournisseur ne saurait présumer de la réalisation effective des obligations et services par le distributeur : le ministre estimait que la clause renverse les obligations légales des parties et qu’en créant par contrat une présomption de réalisation de la prestation ou de l’obligation liée au paiement de la facture ou de la facture d’avoir, qui est une obligation dont le fournisseur ne peut s’affranchir, le groupement des Mousquetaires transfère indûment ses obligations légales sur les fournisseurs, ce qui caractérise un déséquilibre significatif entre les parties au détriment des fournisseurs.
La cour observe à cet égard que l’obligation de payer les factures du distributeur relatives à ses services pèse sur les fournisseurs qui ne peuvent s’en affranchir que dans le cadre d’une exception d’inexécution, si le distributeur n’a pas effectué les prestations convenues. Le paiement des factures ne saurait valoir a priori renonciation des fournisseurs à les contester, non seulement quant aux prestations effectuées mais aussi quant au caractère non proportionné de la rémunération. Le paiement des factures ne constitue en effet qu’un indice qui peut être invoqué par le distributeur, mais non une preuve en soi, de l’exécution de la prestation et du caractère non manifestement disproportionné, dont la charge de la preuve repose sur lui, en vertu de l’article L. 442-6, III, du Code de commerce qui dispose que « dans tous les cas il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l’industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation ». La loi prévoit donc qu’il appartient en l’occurrence au distributeur d’apporter la preuve de l’exécution de son obligation ou de la prestation de service qui lui incombe.
Or la clause en cause instaure une présomption de réalisation de la prestation et du caractère équilibré de la rémunération découlant du paiement des factures. À supposer même que cette présomption soit une « présomption simple », réfragable, elle conduit à renverser la charge de la preuve, dès lors qu’une fois payées, le distributeur n’aura plus à justifier de la réalité des prestations et de leur rémunération. En revanche, pèsera sur les fournisseurs la charge de renverser la présomption. Le fardeau de la preuve sera donc plus lourd qu’en droit commun, car il s’agira, non plus de contredire un simple indice, mais de renverser une présomption.
Cette clause accorde aux distributeurs un avantage excessif, contraire à la loi et contraint le fournisseur à contrôler, par ses propres moyens, l’effectivité des services rendus par les enseignes, alors que ce contrôle par un fournisseur est très complexe, compte tenu notamment de la multitude des points de ventes concernés, le distributeur pouvant de son côté de façon beaucoup plus aisée, conserver des preuves de l’effectivité de ses prestations afin de pouvoir les justifier par la suite.
Cette disposition crée donc un déséquilibre significatif dans la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur en ce qui concerne les moyens de preuve12.
Notes de bas de pages
-
1.
CA Paris, 8 nov. 2017, n° 14/13384.
-
2.
Cass. com., 14 avr. 2015, n° 12-15971.
-
3.
Trib. UE, 8 sept. 2016, n° T-471/13, Xellia Pharmaceuticals et Alpharma c/ Commission, pt 319 : Rec. 460.
-
4.
CA Paris, 21 déc. 2017, n° 15/17638.
-
5.
Aut. conc. n° 15-D-10, 11 juin 2015, pratiques mises en œuvre par TDF sur le site de la tour Eiffel ; Cholet S., « La tour Eiffel : une grande dame convoitée », RLC, 2015/45, n° 2849.
-
6.
CA Paris, 12 oct. 2017, n° 15/14038.
-
7.
CA Paris, 21 déc. 2017, n° 16/15499.
-
8.
C. com., art. L.442-6, I, 1° et 2° : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu (…) ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
-
9.
CA Paris, 27 sept. 2017, n° 16/00671.
-
10.
Convention d’affaires 2009, art. 2 : « Conformément aux dispositions légales, cette négociation a été menée sur la base des conditions générales de vente communiquées par le fournisseur, et établies unilatéralement par ce dernier. À ce titre, étant donné qu’elles constituent le socle de la négociation, elles sont annexées à la présente convention, sans pour autant valoir acceptation pure et simple de leur contenu. Les clauses ci-dessous énumérées de manière non exhaustive seront exclues ou rediscutées d’un commun accord au motif qu’elles peuvent être considérées comme déséquilibrées et/ou abusives ou ne relèvent pas de la négociation commerciale et/ou relèvent d’un autre document signé par les deux parties. Il s’agit notamment de clauses relatives : – (…) ; – aux conditions particulières pour la passation et/ou l’acceptation des commandes ; – à l’exclusion des réserves si ces dernières ne sont pas mentionnées sur les bons de livraisons ; – à des délais abusivement écourtés pour contester le bien-fondé ou le règlement d’une facture ; – (…) ; – à l’application des conditions générales de vente aux services rendus par le distributeur ; – aux conditions logistiques incompatibles avec l’organisation du « Groupement des Mousquetaires ; – (…) ; – à l’exonération ou la limitation de responsabilité du fournisseur ».
-
11.
Convention d’affaires 2009, art. 4 : « le paiement des factures et avoirs par le fournisseur présume de la réalisation effective des obligations et services et du caractère justifié et proportionné des rémunérations versées au titre de l’année écoulée ».
-
12.
CA Paris, 20 déc. 2017, n° 13/04879.