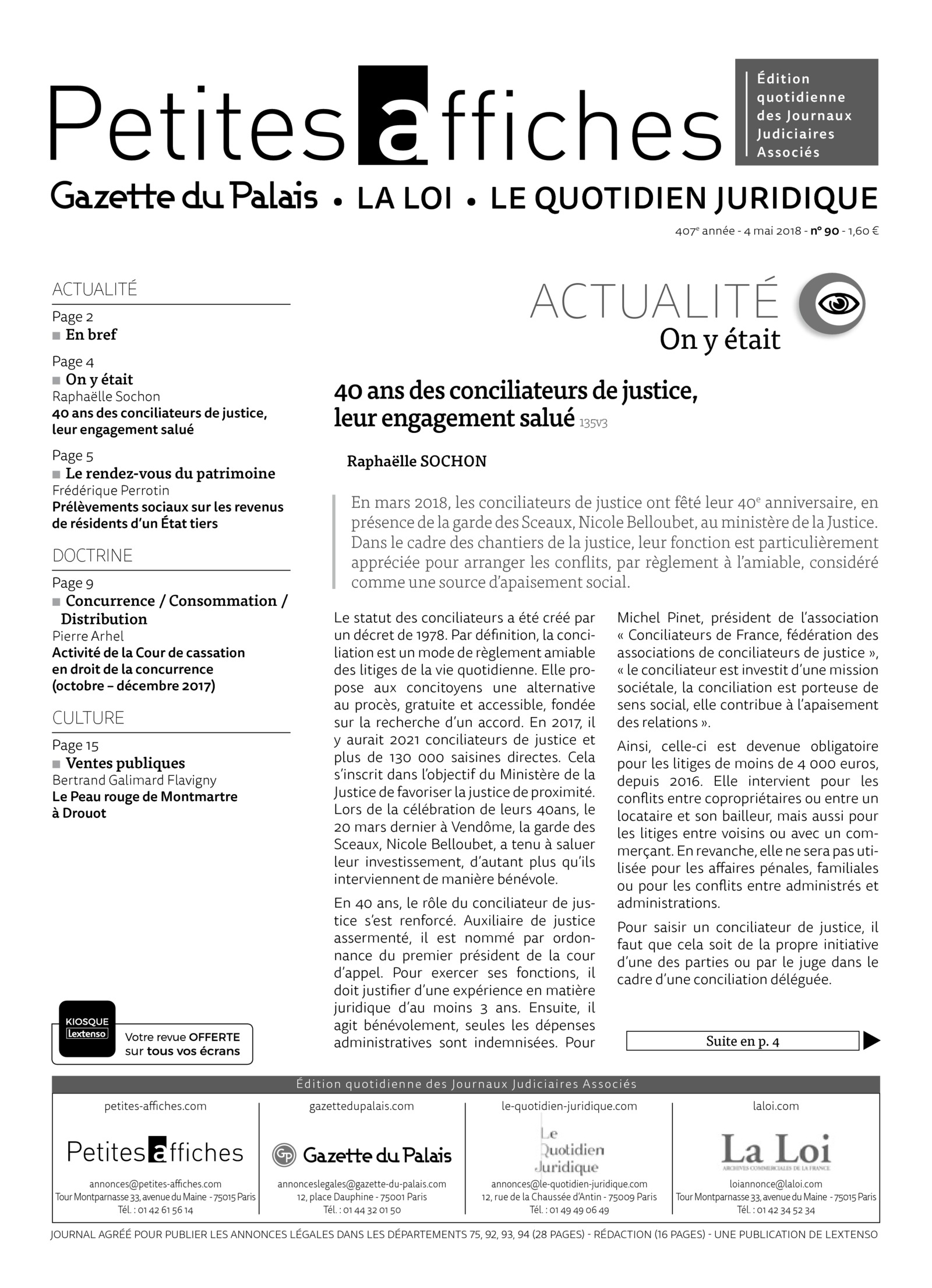Activité de la Cour de cassation en droit de la concurrence (octobre – décembre 2017)
La présente étude porte sur les arrêts rendus par la Cour de cassation en droit de la concurrence au sens du livre IV du Code de commerce. Plusieurs domaines sont théoriquement concernés. La Cour de cassation se prononce d’abord sur les arrêts que la cour d’appel de Paris rend lorsqu’elle est saisie d’un recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence ; elle est également saisie des pourvois en matière de « transparence », « pratiques restrictives de concurrence » et « autres pratiques prohibées », au sens du titre IV du livre IV du Code de commerce ; elle est aussi compétente en matière de visite et de saisies opérées sur le fondement de l’article L. 450-4 du Code de commerce ; enfin, elle se prononce sur les décisions rendues dans le cadre de litiges entre opérateurs économiques. L’étude porte sur la période d’octobre à décembre 2017. Les points suivants ont plus particulièrement retenu l’attention : confirmation de l’application de la présomption d’imputabilité à la société mère dans l’affaire du déménagement des militaires affectés en Martinique (I) ; rejet du pourvoi dans l’affaire de la vente événementielle en ligne (II) ; caractère « mono-produit » de l’entreprise (III) ; conformité au droit européen de l’interdiction de la revente à perte (IV) ; champ d’application des règles relatives aux pratiques restrictives de concurrence (V) ; justification de la rupture brutale de relations commerciales par la crise du secteur d’activité (VI).
I – Confirmation de l’application de la présomption d’imputabilité à la société mère dans l’affaire du déménagement des militaires affectés en Martinique
La chambre commerciale confirme l’analyse de la cour d’appel de Paris qui a estimé que la société Mobilitas, société mère de l’entreprise AGS Martinique, n’est pas parvenue, dans l’affaire du déménagement des militaires affectés en Martinique, à renverser la présomption selon laquelle dans le cas particulier où une société mère détient 100 % (ou presque 100 %) du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale.
La cour d’appel avait relevé que (i) le fait qu’une entreprise soit une holding non opérationnelle assurant une direction financière en coordonnant notamment les investissements financiers au sein du groupe ne suffit pas à exclure l’exercice d’une influence déterminante sur ses filiales ; (ii) la non-immixtion de la holding dans les activités de la filiale ne suffit pas à renverser cette présomption ; (iii) la diversité des activités, la configuration du groupe et l’éloignement géographique de la société mère sont sans portée ; (iv) le fait que la filiale dispose de sa propre direction locale et de ses propres moyens ne prouve pas qu’elle définit son comportement sur le marché de façon autonome ; (v) si le gérant de la filiale, par sa qualité de « gestionnaire de transport » dans le cadre d’une activité réglementée, est seul habilité à exercer certaines missions de gestion et de contrôle, il ne peut en être déduit que cette filiale est autonome ; (vi) cette dernière ne détenait pas de service juridique propre et recourait aux services de celui de la société holding, ce qui constitue un lien personnel entre les deux entités ; (vii) le fait que la filiale ait opté pour la non-contestation des griefs, contrairement à la société mère, ne permet pas de conclure à son autonomie.
Pour les hauts magistrats, en l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la société Mobilitas n’avait pas renversé la présomption1.
II – Rejet du pourvoi dans l’affaire de la vente événementielle en ligne
À l’origine de cette affaire, la société Brandalley a saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société Ventesprivees.com qu’elle jugeait contraires à l’article L. 420-2 du Code de commerce. Elle soutenait que cette société abusait de la position dominante qu’elle détenait sur le marché de la « vente événementielle privée sur internet » en imposant aux grandes marques qu’elle distribue une clause d’exclusivité leur interdisant de commercialiser leurs stocks d’invendus auprès d’autres sites internet concurrents.
Une notification de griefs a été adressée à la société Ventesprivees.com pour avoir, depuis 2005, « abusé de sa position dominante sur le marché français de la vente événementielle en ligne en contractant avec ses fournisseurs des clauses d’exclusivité et de non-concurrence leur interdisant, pour une durée injustifiée, de passer par un site de vente événementielle en ligne concurrent ».
Cependant, par décision n° 14-D-18 du 28 novembre 2014, l’Autorité a considéré, d’une part, que l’existence d’un marché de la vente événementielle en ligne n’était pas établie et, d’autre part, qu’il n’était plus concevable d’analyser la substituabilité du côté de la demande pour la période visée par le grief notifié. En conséquence, elle a décidé qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la procédure. Ce faisant, elle a refusé de renvoyer l’affaire à l’instruction afin de permettre aux services d’instruction de procéder à une nouvelle analyse de la substituabilité du côté de la demande.
La cour d’appel de Paris avait également retenu cette solution. Après avoir approuvé l’analyse de l’Autorité selon laquelle les éléments du dossier de l’instruction ne permettaient pas d’établir l’existence d’un marché de la vente événementielle en ligne, elle a relevé que l’Autorité a souligné que le secteur du déstockage de produits invendus avait connu une très forte évolution, marquée par l’essor des sites de e-commerce proposant une offre de déstockage, puisque plus d’une centaine de sociétés proposant des ventes événementielles de stocks d’invendus sur internet avaient été créées entre 2005 et 2011, qui intervenaient soit exclusivement en ligne soit par adossement à des entreprises spécialisées dans le déstockage physique. Elle a ajouté que, sur le plan qualitatif, l’Autorité a également souligné les importantes évolutions technologiques du secteur qui ont, elles aussi, affecté les comportements d’achat des consommateurs. Elle a retenu qu’en l’état de ces évolutions rapides et de leur impact sur les consommateurs, qui ont été soulignés dans la notification de griefs, il ne serait plus possible d’identifier et de porter une appréciation rétrospective sur des comportements passés, et aujourd’hui différents, des consommateurs et en a déduit que c’est à juste titre que l’Autorité a constaté que l’analyse de la substituabilité du côté de la demande, pour la période visée par le grief, indispensable à la détermination du marché pertinent, n’était plus concevable, dès la date de sa décision, dans la mesure où la perception contemporaine qu’ont les acteurs du marché sur les possibilités de substitution qui leur étaient offertes ou qu’ils considéraient comme telles, près d’une décennie plus tôt, ne pourrait être considérée comme suffisamment fiable2.
À son tour, la chambre commerciale approuve cette analyse. Elle estime en effet qu’ayant ainsi fait ressortir qu’un renvoi à l’instruction ne permettrait pas d’établir l’existence d’un marché pertinent de la vente événementielle en ligne, la cour d’appel a pu retenir que l’Autorité n’avait pas, au vu des circonstances de l’espèce, manqué à son obligation de rechercher si le secteur sur lequel il était allégué que la société Vente-privée.com occupait une position dominante constituait un marché pertinent et, sans méconnaître son office ni refuser d’apprécier le marché dans sa situation contemporaine des pratiques, approuver l’Autorité d’avoir considéré qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la procédure.
La haute juridiction fait également de l’article R. 463-7 du Code de commerce la même lecture que la cour d’appel : si ce texte permet à l’Autorité de décider de renvoyer une affaire à l’instruction lorsqu’elle estime celle-ci incomplète, il ne lui ouvre qu’une simple faculté qu’elle est libre d’exercer, au vu des éléments du dossier3.
III – Caractère « mono-produit » de l’entreprise
La chambre commerciale s’est prononcée sur la question des entreprises « mono-produits » au sens du paragraphe 48 du communiqué « sanctions » de l’Autorité de la concurrence du 16 mai 2011 qui prévoit que l’Autorité vérifie s’il y a lieu d’« adapter à la baisse » le montant des sanctions, au cas où il s’avèrerait que les entreprises en cause mèneraient l’essentiel de leur activité sur le secteur ou marché en relation avec l’infraction, c’est-à-dire si elles exerçaient une activité « mono-produit ».
L’occasion lui en a été donnée dans le cadre de l’affaire des pratiques mises en œuvre dans le secteur du papier peint consistant en des échanges d’informations sensibles intervenus entre des sociétés fournisseurs en situation de concurrence sur le marché des papiers peints français.
On se souvient que par une décision n° 14-D-20 du 22 décembre 2014, l’Autorité a établi que plusieurs sociétés avaient enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du Code de commerce et 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et leur a infligé des sanctions pécuniaires.
Conformément au point 48 de son communiqué « sanctions » du 16 mai 2011, l’Autorité s’est demandée s’il y avait lieu d’« adapter à la baisse » le montant des sanctions et a estimé que les sociétés l’Éditeur et Zambaiti devaient être considérées comme des entreprises « mono-produit » et elle leur a, en conséquence, accordé une réduction du montant de la sanction de 70 %.
En revanche, elle a refusé d’accorder ce bénéfice aux sociétés MCF, SCE, AS Création France et AS Création Tapeten, ainsi qu’aux sociétés Graham & Brown, en considérant que les comptes des groupes auxquels elles appartiennent ne permettent pas de conclure à une activité « mono-produit ».
Pour réformer cette décision, la cour d’appel de Paris a relevé qu’une activité « mono-produit », au sens du communiqué du 16 mai 2011, implique une comparaison sur des bases homogènes en ce qui concerne la détermination de la valeur des ventes, d’une part, et du chiffre d’affaires auquel cette valeur est rapportée, d’autre part. Elle en a déduit que, dès lors que l’Autorité a retenu le chiffre d’affaires consolidé du groupe auquel appartiennent ces sociétés, il y avait lieu de prendre en compte non pas la valeur des seules ventes qu’elles ont réalisées, mais la valeur des ventes réalisées par toutes les sociétés de ce groupe dans le secteur de la vente de papiers peints, incluant par conséquent, en ce qui concerne la situation des sociétés SCE et MCF, les ventes de la société AS Création France qui a pour seule activité la vente de papiers peints, et de la société allemande AS Création Tapeten dont la part du chiffre d’affaires réalisé sur ce secteur est supérieure à 90 %, et en ce qui concerne la situation de la société Graham & Brown France, les ventes de la société anglaise Graham & Brown Limited qui a pour seule activité la fabrication et la commercialisation de papiers peints. Elle a retenu, sur la base de ces éléments, que les sociétés en cause mènent l’essentiel de leur activité sur le secteur ou marché en relation avec l’infraction, à savoir la vente de papiers peints, et qu’il y avait lieu, en conséquence, d’adapter à la baisse le montant de la sanction prononcée dans une proportion identique à celle dont ont bénéficié, au même titre, les sociétés L’Éditeur et Zambaiti, soit à hauteur de 70 %.
Accueillant le deuxième moyen du pourvoi du président de l’Autorité de la concurrence, la chambre commerciale juge qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a intégré dans les termes de son analyse des valeurs de ventes sans lien avec l’infraction, a violé l’article L. 464-2 du Code de commerce et le communiqué du 16 mai 2011. En conséquence, elle casse et annule l’arrêt attaqué en ce que, réformant la décision de l’Autorité de la concurrence concernant le montant des sanctions pécuniaires infligées aux sociétés MCF investissements, Société de conception et d’éditions, Décoralis, AS Création France, AS Création Tapeten AG, Graham & Brown France et Graham & Brown Limited, il a fixé le montant de leurs condamnations. Elle remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
En revanche, la Cour de cassation refuse de faire droit au premier moyen du pourvoi qui faisait valoir que la réduction des amendes des entreprises au titre de leur activité « mono-produit » était contraire au droit de l’Union.
Selon ce premier moyen, lorsqu’elles mettent en œuvre le droit de la concurrence de l’Union européenne, les autorités de concurrence des États membres et leurs juridictions de contrôle sont tenues de respecter les principes généraux du droit de l’Union et les droits fondamentaux reconnus par la charte des droits de l’Union européenne, le cas échéant tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne ; or il résulte de l’arrêt Pilkington de la Cour de justice du 7 septembre 2016 que le « caractère moins diversifié » de l’activité de certaines entreprises sanctionnées « ne saurait en soit constituer un motif suffisant pour justifier » une réduction du montant de la sanction, car une telle réduction « reviendrait à avantager les entreprises les moins diversifiées, sur la base de critères qui sont sans pertinence au regard de la gravité et de la durée de l’infraction ». Le moyen ajoute que cette interprétation de la règle de droit s’intègre immédiatement dans l’ordre juridique, de sorte qu’il doit en être fait application dans les litiges en cours. Ainsi, conclut le moyen, en réduisant le montant de la sanction, d’une part, des sociétés MCF, SCE, AS Création France, AS Création Tapeten AG, outre de la société Décoralis tenue solidairement, d’autre part, des sociétés Graham & Brown France et Graham & Brown Limited, qui ont participé à une entente, aux motifs qu’elles menaient « l’essentiel de leur activité sur le secteur ou marché en relation avec l’infraction, à savoir la vente de papiers peints », la cour d’appel a violé les articles 101, paragraphe 1, du TFUE et 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels qu’interprétés par la Cour de justice, et les articles L. 464-2, I et 420-1 du Code de commerce.
La chambre commerciale rejette donc le moyen en rappelant qu’en application de l’article 5 du règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de la concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, devenus 101 et 102 du TFUE, les autorités de concurrence des États membres sont compétentes pour appliquer ces articles dans des cas individuels et adopter des décisions infligeant des sanctions pécuniaires ; qu’en droit national, la sanction infligée par l’Autorité doit être prononcée conformément aux dispositions de l’article L. 464-2 du Code de commerce, dans le respect du communiqué du 16 mai 2011, qui s’impose à elle, sauf à ce qu’elle explique, dans la motivation de sa décision, les circonstances particulières ou les raisons d’intérêt général la conduisant à s’en écarter. Elle énonce par ailleurs que, si la Cour de justice de l’Union européenne a exclu que la différence de pourcentage que représenterait l’amende dans le chiffre d’affaires total des entreprises concernées constitue un motif suffisant pour justifier que la Commission s’écarte de la méthode de calcul, ne prévoyant pas la prise en compte de cette situation, qu’elle s’est elle-même fixée (arrêt Pilkington), cette analyse ne s’oppose pas à ce que l’Autorité retienne ce facteur d’appréciation, prévu par son communiqué du 16 mai 20114.
IV – Conformité au droit européen de l’interdiction de la revente à perte
Rappelons que la Cour de justice a jugé que la directive n° 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale qui prévoit une interdiction générale d’offrir à la vente ou de vendre des biens à perte, pour autant que cette disposition poursuit des finalités tenant à la protection des consommateurs5.
La question de la pérennité de l’article L. 442-2 du Code de commerce, qui prévoit une interdiction générale d’offrir à la vente ou de vendre des biens à perte, s’est dès lors posée. Une intervention du législateur était attendue. Cependant, si la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a modifié plusieurs dispositions de ce texte, notamment celles relatives au seuil de revente à perte6, en revanche, elle n’a pas touché aux dispositions relatives au champ d’application de l’interdiction de la pratique.
S’agissant de la Cour de cassation, un litige dans le secteur de l’optique lui a donné l’occasion de se prononcer sur le sujet. Une centrale d’achat opérant dans ce secteur, qui s’est vue reprocher par un concurrent de revendre à perte, a été condamnée sur le fondement de l’article L. 442-2. Dans son pourvoi en cassation, elle s’est prévalue de la directive du 11 mai 2005, mais en vain : « Mais attendu qu’aux termes de l’article 3 de la directive n° 2005/29/CE du 11 mai 2005, celle-ci s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt et des écritures des parties que le litige porte sur des pratiques commerciales entre une centrale d’achat et des détaillants, soit des transactions entre professionnels ; qu’elles ne relèvent donc pas du champ d’application de la directive ; que le moyen, en ce qu’il invoque l’incompatibilité de la législation française avec une directive inapplicable en l’espèce, est inopérant7. »
On notera que cette solution, adoptée par la chambre criminelle, a été confirmée par la chambre commerciale8.
V – Champ d’application des règles relatives aux pratiques restrictives de concurrence
A – Exclusion des relations entre une coopérative et ses membres
La Cour de cassation exclut du champ d’application des articles L. 442-6, I, 2° et L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce9 les relations entre une société coopérative et ses membres.
Le litige est intervenu, dans le secteur des articles de sport dans la région de Toulouse, entre la société Groupe Intersport, coopérative d’achat en commun de commerçants détaillants et trois de ses membres, les sociétés Sport et Sesport.
La coopérative avait informé celles-ci de la décision du conseil d’administration de porter à 20 % le seuil de parts de marché ouvrant droit à une exclusivité d’implantation, puis d’agréer une nouvelle société dans la région.
Les sociétés Sport et Sesport ont réagi par une assignation reprochant notamment à la société Groupe Intersport de leur avoir causé un préjudice résultant d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en violation de l’article L. 442-6, I, 2° ainsi que d’un manquement à l’obligation légale d’accorder un préavis conforme aux dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°. Ces demandes ont été rejetées par la cour d’appel de Paris.
Le pourvoi en cassation n’a pas eu plus de succès, la Cour de cassation estimant, dans un arrêt du 18 octobre 2017, que les juges parisiens ont énoncé à bon droit que « les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° et 5° du Code de commerce sont étrangères aux rapports entretenus par les sociétés en cause, adhérentes d’une société coopérative de commerçants détaillants avec cette dernière »10.
S’agissant plus particulièrement de l’exclusion des relations entre une société coopérative et ses membres du champ d’application des règles relatives à la rupture brutale des relations commerciales, précisons que l’arrêt du 18 octobre 2017 confirme la position adoptée quelques mois plus tôt lorsque la chambre commerciale a jugé que les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° ne s’appliquent pas aux conditions dans lesquelles les liens unissant une société coopérative et un associé peuvent cesser, celles-ci étant régies par les statuts de cette dernière11.
B – Exclusion des relations entre un établissement de crédit et une entreprise
La Cour de cassation exclut également du champ d’application de l’article L. 442-6, I, 5° les relations entre un établissement de crédit et une entreprise.
À l’origine de cette affaire, le Crédit industriel et commercial a dénoncé l’ensemble des concours qu’il avait accordés à la société AMG, mettant celle-ci en demeure de lui régler, sous huitaine, diverses sommes au titre du solde débiteur de ses comptes courants. Celle-ci a assigné la banque en responsabilité pour rupture abusive et brutale de crédit mais a été déboutée de ses demandes par la cour d’appel de Paris.
Le pourvoi en cassation est également rejeté. Le deuxième moyen faisait valoir que constitue un comportement déloyal le fait pour une banque, après avoir substitué aux concours financiers octroyés à un client pour une durée indéterminée des concours financiers à durée déterminée, de cesser brutalement de renouveler ces concours financiers, sans en informer à l’avance son client qui, ayant bénéficié de concours à durée indéterminée pendant 12 ans, a légitimement pu croire en leur renouvellement.
Le moyen est rejeté dans les termes suivants : « Mais attendu que la décision d’un établissement de crédit de ne pas renouveler un concours revêt un caractère discrétionnaire, de sorte que le banquier n’est responsable du fait d’une telle décision de refus que s’il est tenu par un engagement ; que le renouvellement de concours bancaires à durée déterminée succédant à un concours à durée indéterminée, auquel il a été mis fin avec préavis, n’étant pas, à lui seul, de nature à caractériser l’existence d’une promesse de reconduction du crédit au-delà du terme, le moyen n’est pas fondé. »
Mais surtout, répondant au troisième moyen, la Cour écarte l’application des règles relatives à la rupture brutale des relations commerciales en énonçant que « les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d’une relation commerciale établie ne s’appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, opérations exclusivement régies par les dispositions du Code monétaire et financier »12.
VI – Justification de la rupture brutale de relations commerciales par la crise du secteur d’activité
La Cour de cassation refuse de sanctionner une rupture brutale de relations commerciales justifiée par la crise que traverse le secteur d’activité.
En l’espèce, un distributeur de chemises avait confié, à partir de l’année 2000, à un fournisseur, la maîtrise d’œuvre de chemises fabriquées au Bangladesh, moyennant le règlement de commissions calculées en fonction du volume des commandes. Reprochant au distributeur d’avoir diminué le volume de ses commandes à partir de l’année 2008, le fournisseur l’a assigné en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce.
Cette demande avait été rejetée par la cour d’appel de Paris qui, après avoir constaté que le distributeur n’avait pris aucun engagement de volume envers son partenaire, avait relevé que celui-ci avait souffert d’une baisse de chiffre d’affaires d’un peu plus de 15 % du fait de la situation conjoncturelle affectant le marché du textile, baisse qu’il n’a pu que répercuter sur ses commandes dans la mesure où, avaient précisé les juges parisiens, un donneur d’ordre ne peut être contraint de maintenir un niveau d’activité auprès de son sous-traitant lorsque le marché lui-même diminue. La cour d’appel avait également constaté que, dans le même temps, le distributeur avait proposé une aide financière au fournisseur pour faire face à la baisse de ses commissions, démontrant sa volonté de poursuivre leur relation commerciale. Elle avait ajouté que, nonobstant le fait que le distributeur avait momentanément cessé de passer des commandes au cours de l’année 2009, le fournisseur avait reçu des commissions au cours des 12 mois de l’année 2009. La cour d’appel avait conclu en retenant que la baisse des commandes du distributeur, inhérente à un marché en crise, n’engageait pas sa responsabilité.
La Cour de cassation approuve sans réserve cette solution13.
Notes de bas de pages
-
1.
Cass. com., 18 oct. 2017, n° 16-19120.
-
2.
CA Paris, 12 mai 2016, n° 15/00301.
-
3.
Cass. com., 6 déc. 2017, n° 16-18835.
-
4.
Cass. com., 8 nov. 2017, nos 16-17226 et 16-17330.
-
5.
CJUE, 7 mars 2013, n° C-343/12, Euronics Belgium CVBA c/ Kamera RLC 2013/36, n° 2343, obs. Grall.
-
6.
Arhel P., « Transparence tarifaire et pratiques restrictives », Rép. com. Dalloz, nov. 2017.
-
7.
Cass. com., 22 nov. 2017, n° 16-18028.
-
8.
Cass. com., 16 janv. 2018, n° 16-83457.
-
9.
C. com., art. L.442-6, I, 2° et 5° : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (…). »
-
10.
Cass. com., 18 oct. 2017, n° 16-18864 : Beaumont S. et Maugère C., « Pratiques restrictives de concurrence : nouvelles précisions de la Cour de cassation sur le champ d’application des articles L. 442-6, I, 2° et 5° du Code de commerce », RLC 2018/69, n° 3341.
-
11.
Cass. com., 8 févr. 2017, n° 15-23050.
-
12.
Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-16839 : Beaumont S. et Maugère C., art. préc.
-
13.
Cass. com., 8 nov. 2017, n° 16-15285.