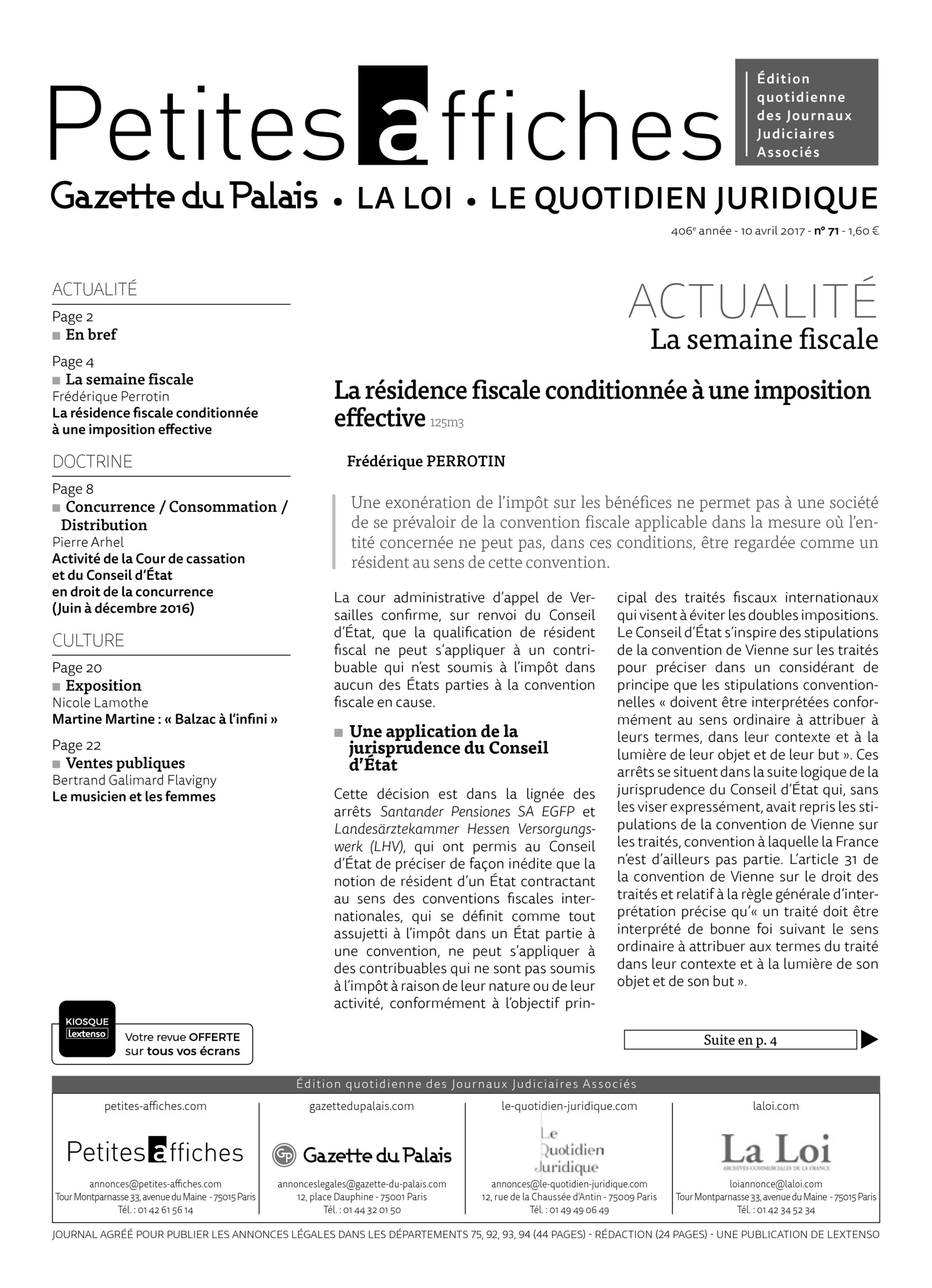Activité de la Cour de cassation et du Conseil d’État en droit de la concurrence (Juin à décembre 2016)
La présente étude porte sur les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d’État en droit de la concurrence au sens du livre IV du Code de commerce. Plusieurs domaines sont théoriquement concernés. La Cour de cassation se prononce d’abord sur les arrêts que la cour d’appel de Paris rend lorsqu’elle est saisie d’un recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence ; elle est également saisie des arrêts rendus par les cours d’appel en matière de « transparence », « pratiques restrictives de concurrence » et « autres pratiques prohibées », au sens du titre IV du livre IV du Code de commerce ; elle est aussi compétente en matière de visite et de saisies opérées sur le fondement de l’article L. 450-4 du Code de commerce ; enfin, elle se prononce sur les décisions rendues dans le cadre de litiges entre opérateurs économiques. Quant au Conseil d’État, il suffit, pour mesurer l’étendue de sa compétence, de rappeler que le droit de la concurrence fait partie intégrante du bloc de la légalité administrative. L’étude porte sur la période de juin à décembre 2016.
I – Contentieux des opérations de visite et de saisie
La chambre criminelle est revenue sur la question de la saisie de fichiers informatiques. Ainsi, dans une affaire classique de marchés publics, elle a rejeté le pourvoi contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en date du 10 février 2015 qui avait estimé que les enquêteurs n’avaient pas procédé à une saisie massive et indifférenciée des fichiers et documents informatiques dès lors qu’il ressort de l’inventaire des fichiers informatiques saisis, que ceux-ci, qui ont été sélectionnés à partir de mots-clés par le logiciel de recherche, sont au nombre de 227 sur 602 763 fichiers analysés, l’intitulé des fichiers inventoriés permettant par ailleurs à l’occupant des lieux de s’assurer, qu’ils présentaient des éléments entrant dans le champ de l’autorisation, ou présentaient un intérêt pour l’enquête, celui-ci ayant été mis en mesure, au moyen de la copie du DVD-R qui lui a été remise, de vérifier les documents qui à l’intérieur de ces fichiers seraient susceptibles d’en être extraits pour lui être restitués1.
La haute juridiction estime en effet que, « d’une part, les agents de l’Administration ont procédé à une saisie sélective de certains fichiers à partir de mots-clés dont ils n’avaient pas à rendre compte et sur lesquels le premier président n’était pas tenu de se fonder, et d’autre part, les représentants de l’occupant des lieux ont reçu, avant la saisie, un inventaire des fichiers saisis ainsi qu’une copie de ceux-ci et ont été mis en mesure d’en prendre connaissance, le premier président de la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions dont il était saisi et qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a justifié sa décision »2.
Une autre occasion de se prononcer sur la question de la saisie de fichiers informatiques a été donnée à la Cour de cassation par des pourvois formés contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles, en date du 22 janvier 2015, qui avait confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les rapporteurs des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et de saisie, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.
La haute juridiction énonce que le juge des libertés et de la détention « a pu souverainement admettre la copie intégrale des fichiers de messageries, sans individualisation de chaque message, et leur saisie dans leur globalité, dès lors qu’ils contenaient des éléments pour partie utiles à la preuve des agissements présumés ». Ce faisant, elle confirme à nouveau la validité de la saisie globale des fichiers informatiques.
Et la Cour de préciser qu’il appartenait à la requérante de justifier que le contenu des fichiers litigieux saisis dans la messagerie en cause « étaient sans lien avec l’enquête, la seule identification des courriels portant la mention “personnel” étant insuffisante à établir qu’ils ne contenaient que des données d’ordre privé et qu’ils ne pouvaient, en raison de leur objet, être saisis »3.
II – Protection du secret des affaires
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Orange qui reprochait à un arrêt du 5 février 2015 de la cour d’appel de Paris d’avoir confirmé le rejet par l’Autorité de la concurrence de sa demande de mesures conservatoires tendant à la suspension de la mise en œuvre d’un accord, entre SFR et Bouygues Télécom (Btel), portant sur la mutualisation de réseaux d’accès mobiles et prévoyant également la mise en place d’une itinérance 4G temporaire fournie par la société Btel à la société SFR.
La société Orange reprochait d’abord à la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande de mainlevée de la confidentialité de certaines pièces uniquement au regard de sa qualité de partie saisissante. Le moyen est rejeté. Ce faisant, la Cour approuve l’analyse de la cour d’appel selon laquelle le saisissant ne peut demander la levée de la confidentialité de pièces du dossier : « Mais attendu, en premier lieu, que le droit des parties de prendre connaissance des pièces remises à l’Autorité n’est pas un droit absolu et illimité et doit être mis en balance avec le droit des entreprises à la protection du secret de leurs affaires ; que le principe de la contradiction n’implique pas que la partie saisissante, qui n’a pas de droits de la défense à préserver dans le cadre de la procédure ouverte par l’Autorité sur sa saisine, laquelle en outre n’a pas pour objet la défense de ses intérêts privés, puisse obtenir la communication de documents couverts par le secret des affaires concernant la personne qu’elle a mise en cause, ni qu’elle puisse contester la décision de protection de secret des affaires prise à ce titre ; que s’étant justement référée à la qualité de partie saisissante de la société Orange, demanderesse de mesures conservatoires, qui n’était pas une partie mise en cause, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la société Orange n’était pas recevable à demander au rapporteur la levée de la confidentialité de certaines pièces en application de l’article R. 463-15, alinéa 2, du Code de commerce ».
La Cour de cassation approuve par ailleurs la cour d’appel d’avoir considéré que le collège de l’Autorité de la concurrence pouvait demander à la partie saisissante de quitter la salle lors de l’examen des pièces couvertes par le secret des affaires. Ce faisant la haute juridiction souligne que l’effet utile des décisions de secret des affaires rendues à l’occasion de la phase d’instruction du dossier doit être préservé durant les débats oraux qui se déroulent devant le collège de l’Autorité et que le principe de la contradiction n’impose pas davantage, à ce stade de la procédure, que la partie saisissante puisse assister aux débats au cours desquels des informations protégées seront évoquées.
Ajoutons enfin, pour ne plus y revenir, que la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir motivé le rejet des mesures conservatoires en retenant que les effets de la prestation litigieuse ne sont pas susceptibles de créer un dommage grave et immédiat dès lors que la prestation n’est pas irréversible et pourra être interrompue, à tout moment, sans créer de difficultés insurmontables au détriment de l’opérateur qui en bénéficie4.
III – Langue utilisée dans certaines pièces du dossier
La langue de procédure devant l’Autorité de la concurrence est le français. Cette règle qui résulte de l’article 2 de la Constitution, comme le rappelle l’article 26 du règlement intérieur de l’Autorité, a été soulevée dans l’affaire des farines alimentaires, sur le fondement de l’article 6, paragraphe 3, de la Conv. EDH qui dispose que « tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ». En vertu de ces principes, les entreprises allemandes mises en cause devant l’Autorité se sont vues adresser une notification des griefs en langue française, faisant état de façon détaillée des reproches que les services d’instruction formulaient contre elles. Il a néanmoins été soutenu devant la cour d’appel de Paris que la présence de certaines pièces en langue allemande dans le dossier méconnaissait les droits de la défense notamment en violant l’article 6-3.
Non satisfaites du rejet de leur moyen par les juges parisiens, les diverses entreprises ont soumis la question à la Cour de cassation. Étaient en premier lieu en cause des pièces issues de la demande de clémence, non traduites en français. La cour d’appel de Paris avait constaté qu’elles ne venaient pas au soutien des griefs retenus par les rapporteurs. Les juges du fond avaient également relevé, s’agissant des procès-verbaux d’audition de meuniers allemands et des pièces transmises par l’autorité de concurrence allemande, le Bundeskartellamt, rédigés en langue allemande, que ces documents, qui viennent au soutien des analyses avancées dans la notification des griefs, ont été entièrement traduits pour les uns et accompagnés de résumés en français pour les autres. Selon la Cour de cassation, de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’a pas refusé aux parties mises en cause devant l’Autorité le bénéfice de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dont elle a fait l’exacte application, a pu déduire qu’aucune atteinte aux droits de la défense, prise de la présence au dossier de certains documents en langue étrangère, n’était caractérisée.
Répondant à un moyen de la société VK Mühlen, la Cour de cassation relève par ailleurs qu’un délai supplémentaire de quinze jours avait été accordé aux entreprises pour répondre à la notification des griefs, en vue de leur permettre d’effectuer tous travaux de traduction de pièces jugés nécessaires et que ce délai avait ultérieurement été prolongé, les entreprises ayant ainsi bénéficié d’un délai de quatre mois après la notification des griefs. Elle relève par ailleurs que la société VK Mühlen a pu formuler des observations détaillées en réponse à cette notification et au rapport, sous le timbre d’un conseil l’ayant assistée dans leur rédaction. Enfin, représentée par un conseil lors de la séance, elle a fait part au collège de ses observations sur les griefs. Aucune atteinte aux droits de la défense de la société VK Mühlen n’était dès lors caractérisée.
Les hauts magistrats ajoutent qu’ayant constaté que les nouvelles pièces transmises par le Bundeskartellamt, portées à la connaissance des parties postérieurement à la notification des griefs, ne révélaient aucune nouvelle pratique et ne modifiaient ni le champ ni la portée des griefs notifiés et relevé que les parties avaient bénéficié d’un délai supplémentaire de deux mois pour présenter leurs observations à leur sujet et qu’elles avaient pu encore les commenter dans leurs observations après rapport, la cour d’appel a pu en déduire l’absence de toute atteinte aux droits de la défense des parties mises en cause5.
IV – Preuve d’une participation à une entente
On se souvient que dans l’affaire des farines, trois griefs d’entente ont été notifiés : le grief n° 1, portant sur le cartel franco-allemand, qui visait à limiter les importations entre les deux pays, et les griefs nos 2 et 3 portant sur deux ententes mises en œuvre au travers des sociétés communes France farine et Bach Mühle.
S’agissant du cartel franco-allemand, deux entreprises en cause ont critiqué le rejet par la cour d’appel de Paris de leurs arguments à propos de la preuve de leur participation à l’infraction complexe et continue.
La Cour de cassation confirme cependant l’analyse des juges du fond. Ceux-ci avaient d’abord rappelé que dans le cadre d’une infraction s’étendant sur plusieurs années, le fait que les manifestations de l’entente interviennent à des périodes différentes, pouvant être séparées par des laps de temps plus ou moins longs, demeure sans incidence sur l’existence de cette entente, pour autant que les différentes actions qui font partie de cette infraction poursuivent une seule finalité et s’inscrivent dans le cadre d’une infraction unique et continue. Ils avaient également rappelé qu’en l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement la durée d’une infraction, l’Autorité doit se fonder sur des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu’il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s’est poursuivie dans le temps de manière ininterrompue.
Pour la Cour de cassation, ayant constaté que l’Autorité avait rapporté la preuve de la tenue de douze réunions entre meuniers allemands et français, relatives à la conclusion et au fonctionnement de l’accord anticoncurrentiel, entre les mois de mai 2002 et de septembre 2004, et ayant procédé à une analyse globale des éléments qui lui étaient soumis, portant sur la constatation de pressions exercées sur une entreprise en octobre 2006 et juin 2007 et sur des documents saisis, datés de juin 2007 et juin 2008, la cour d’appel a pu retenir que la persistance de l’objectif commun anticoncurrentiel poursuivi par les meuniers français et allemands, après la dernière réunion collusoire, était établie et que l’entente, initiée le 14 mai 2002, avait duré, de manière continue, jusqu’au 17 juin 2008, peu important l’absence d’actes matériels l’établissant entre les mois de septembre 2004 et octobre 2006.
La Cour de cassation a par ailleurs apporté une précision intéressante concernant le défaut de distanciation publique d’une entreprise ayant participé à une réunion de nature anticoncurrentielle. Elle a en effet énoncé que « si la preuve d’une distanciation publique peut permettre de renverser la présomption du caractère illicite de la participation d’une entreprise à une réunion anticoncurrentielle, l’absence d’une telle distanciation ne peut, dans le cas d’une entente se poursuivant dans le temps et se caractérisant par une succession de réunions collusoires, être le seul élément retenu pour établir qu’une entreprise a continué de participer à l’infraction, lorsque cette entreprise a cessé, pendant une période significative, de participer à ces réunions ».
Dès lors, « en se fondant sur la seule absence de dénonciation publique des sociétés VK Mühlen et GMP à l’issue de la seule réunion du 24 septembre 2003 à laquelle elles avaient assisté, sans relever aucun élément factuel établissant la poursuite du comportement anticoncurrentiel de ces sociétés jusqu’au terme général de l’infraction et alors qu’il n’était pas contesté qu’elles n’avaient pas participé aux six réunions collusoires qui s’étaient tenues postérieurement à celle du 24 septembre 2003, la cour d’appel a privé sa décision de base légale »6.
V – Restriction de concurrence par objet
Dans l’affaire des farines alimentaires (v. supra), la cour d’appel de Paris avait estimé que l’Autorité de la concurrence n’avait pas établi que les entreprises sanctionnées ont noué autour des sociétés France farine et Bach Mühle une entente ayant un objet anticoncurrentiel. Pour les juges du fond, ces entreprises, qui n’avaient pas la capacité de proposer une offre crédible aux acheteurs, se sont trouvées placées dans la nécessité de présenter des offres groupées, quel que soit le lieu de livraison géographique, dans le cadre de structures de commercialisation commune, en soi licites au regard des règles du droit de la concurrence, afin de mettre en œuvre puis de poursuivre une coopération leur permettant de répondre, selon le cas, à la demande nationale et aux exigences des centrales d’achat de la grande distribution puis des entreprises du hard discount.
Selon la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les modalités d’organisation et de fonctionnement des sociétés Bach Mühle et France farine permettaient aux meuniers, actionnaires de ces sociétés, de pratiquer un prix unique pour la vente de farine en sachets à destination de la grande distribution et du hard discount et de se répartir les clients et volumes de livraison en fonction de zones géographiques pré-attribuées à chacun des meuniers, la cour d’appel, qui n’a pas vérifié si la création et le mode de fonctionnement de ces structures de commercialisation commune n’excédaient pas ce qui était strictement nécessaire à la pénétration et au maintien des entreprises sur ces marchés a privé sa décision de base légale.
Elle casse et annule donc l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée7.
VI – Violation d’une clause d’exclusivité territoriale
La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi par M. X, exploitant d’un garage proposant des services d’entretien et de réparation, ainsi que la vente au détail d’équipements automobiles, qui a conclu avec la société Point S France un « contrat de réseau Point S » comportant une clause d’exclusivité territoriale à son profit ; ayant constaté qu’un autre adhérent du réseau réalisait des opérations promotionnelles sur le parking d’un supermarché attenant à son local, il a estimé que la tête de réseau violait la clause d’exclusivité, mais sans convaincre les juges du fond.
Pour retenir l’absence de violation de la clause d’exclusivité la cour d’appel a rappelé qu’il résulte notamment de « l’article 81, paragraphe 3, du règlement CE du 31 juillet 2002 » que l’exclusivité territoriale accordée dans le cadre du réseau ne peut que restreindre le droit de faire des ventes actives sur le territoire exclusif et que les ventes passives, qui ont pour but de satisfaire des demandes non sollicitées émanant de clients individuels auxquels les prestations ou la livraison des biens sont offerts, sont permises ; elle a estimé qu’en l’espèce, l’activité litigieuse relève de ventes passives.
Pour la haute juridiction, en se déterminant ainsi, en application du droit communautaire, sans rechercher si les contrats de réseau étaient susceptibles d’affecter de façon sensible le commerce entre États membres, et s’ils avaient pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
La Cour de cassation se penche ensuite sur les notions de ventes actives et passives. La cour d’appel avait relevé que l’activité litigieuse, qui se déroulait à la demande d’un supermarché sur son parking, correspond à des prestations et des ventes passives qui répondent à des demandes émanant de clients, non pas du réseau, mais du supermarché et auxquels sont offertes ces prestations ponctuelles ; elle en avait déduit que ces ventes ne peuvent pas s’analyser comme des ventes actives de la part de l’entreprise adhérente tierce, faites en dehors de son exclusivité territoriale, et qu’il ne peut pas être reproché à la société Point S de ne pas avoir fait respecter les clauses contractuelles qui figurent dans les contrats de réseau qu’elle propose dont l’objectif ne peut pas mettre en place des obligations prohibant les ventes passives, qui seraient contraires aux règles communautaires.
Selon la chambre commerciale, en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les salariés de cette entreprise se rendaient sur le parking du supermarché situé dans la zone d’exclusivité de M. X pour proposer des prestations dans le cadre d’opérations promotionnelles, avec une camionnette affichant le logo Point S, ce dont il résulte que l’entreprise tierce prospectait une clientèle déterminée à l’intérieur du territoire concédé et procédait ainsi à des ventes actives, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
Notons encore que pour retenir l’absence de violation de la clause d’exclusivité du contrat de réseau au préjudice de M. X, la cour d’appel avait rappelé que la clause d’exclusivité dispose que « Point S France s’engage vis-à-vis de l’adhérent à ne pas accepter l’implantation, la création, ou la transformation d’un point de vente aux couleurs de Point S dans la zone d’exclusivité ». Elle avait relevé que la société Point S n’a aucun moyen d’empêcher les accords de fourniture de prestations de ses adhérents, sauf dans le cas où il s’agirait d’un établissement se livrant à la vente habituelle sous les couleurs de la société Point S, et avait constaté que les prestations concernant des pneumatiques, réalisées par l’entreprise tierce, membre du réseau Point S, étaient effectuées ponctuellement sur le parking du supermarché dans le cadre de l’accord conclu entre ces deux sociétés ; elle avait retenu que ces éléments ne caractérisent pas l’implantation et la mise en place d’un point de vente aux couleurs Point S, la présence d’une camionnette sur le parking du supermarché ne pouvant être qualifiée d’établissement ou de point de vente permanent.
La Cour de cassation ne partage pas cette analyse. En statuant ainsi, alors qu’il appartient au fournisseur de faire respecter l’exclusivité qu’il a concédée, la cour d’appel, qui a constaté que des employés de l’entreprise tierce participaient au montage de pneumatiques à l’aide d’une camionnette portant l’indication Point S dans la zone territoriale réservée à M. X, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations8.
VII – Pratiques d’éviction dans le secteur du fret ferroviaire
On se souvient que, par décision du 18 décembre 2012, l’Autorité de la concurrence a sanctionné la SNCF pour diverses pratiques d’éviction dans le secteur du fret ferroviaire qui ont consisté : (i) à utiliser, dans son propre intérêt commercial, des informations confidentielles stratégiques concernant ses concurrents dont elle disposait en tant que gestionnaire déléguée des infrastructures ; (ii) à empêcher ses concurrents d’accéder à des capacités ferroviaires indispensables à leur activité (cours de marchandises, sillons, wagons) ; (iii) à pratiquer auprès de certains clients des prix inférieurs à ses coûts de production pour ses prestations de transport par train massif.
La cour d’appel de Paris a, en grande partie, confirmé cette décision dans un arrêt rendu le 6 novembre 2014. Elle l’a néanmoins censurée en ce qui concerne, la pratique de prix d’éviction sur le marché du transport ferroviaire de marchandises par train massif. Pour réformer la décision de l’Autorité et dire qu’il n’est pas démontré que la SNCF a abusé de la position dominante qu’elle détient sur le marché du transport ferroviaire par train massif en mettant en œuvre des prix d’éviction, la cour d’appel a retenu que ni le dossier ni les explications présentées par l’Autorité ne permettent de réfuter les objections de la SNCF concernant le fait que la mise en œuvre du test de coûts permettant de déterminer si le comportement tarifaire était de nature à créer un effet d’éviction requiert indiscutablement de prendre en compte l’ensemble des coûts supportés et des prix pratiqués sur l’ensemble de son activité de transport de marchandises par train massif. La cour d’appel a ajouté que ni les éléments du dossier ni les explications de l’Autorité ne permettent davantage de contredire utilement les objections de la SNCF concernant le caractère nécessaire ou inévitable de la confusion des seuils de coût évitable moyen et de coût incrémental moyen à long terme.
Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que le recours en annulation ou en réformation de la décision de l’Autorité qui la saisissait lui imposait de vérifier elle-même la licéité de la pratique tarifaire mise en œuvre par la SNCF dans le cadre de son activité de train massif, voire de renvoyer l’affaire pour instruction complémentaire si elle estimait ne pas disposer des éléments lui permettant d’effectuer le test de coût approprié, la cour d’appel, qui a méconnu son office, a violé les articles 102 TFUE et L. 420-2 du Code de commerce, ensemble les articles L. 464-8 du Code de commerce, 561 et 562 du Code de procédure civile9.
VIII – Dénigrement
On se souvient que, par décision du 14 mai 2013, l’Autorité de la concurrence avait condamné la société Sanofi Aventis France, sur le fondement de l’interdiction des abus de position dominante, pour avoir diffusé à destination des professionnels de la santé un discours relatif aux différences entre son médicament phare, Plavix et ses génériques, par lequel elle leur a délivré des informations incomplètes et présentées, compte tenu de leur assemblage et du contexte particulièrement sensible dans lequel elles étaient données, d’une manière telle que ces informations revenaient intrinsèquement à discréditer les produits concurrents des siens, en mettant indûment en doute leur efficacité et leur sécurité au bénéfice de ses propres spécialités.
Cette décision avait été approuvée par la cour d’appel de Paris qui, dans un arrêt du 18 décembre 2014.
Saisie à son tour, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime d’abord que la cour d’appel a caractérisé une pratique de dénigrement. La cour d’appel a en effet constaté que l’entreprise, qui détenait une position dominante, avait mis en œuvre une stratégie de communication à destination des professionnels de santé, relative aux différences objectives entre le Plavix et ses génériques, concernant notamment le sel contenu dans ces médicaments, remettant ainsi en cause la bioéquivalence des génériques et les choix opérés par les autorités de santé.
La cour d’appel avait par ailleurs relevé que les différences entre les produits ont été liées de façon inappropriée et ambiguë, afin de laisser croire que la différence d’indication thérapeutique était liée à un obstacle médical, résultant de la différence de sels, alors qu’elle n’était due qu’à la protection juridique offerte par un brevet dont l’existence et la portée avaient été occultées lors de ces différentes communications.
Les juges du fond avaient ajouté que les argumentaires en cause recommandaient ou invitaient en outre les médecins à inscrire la mention « non-substituable » sur les ordonnances, et les pharmaciens à opérer la substitution avec l’auto-générique commercialisé par la requérante, en insistant sur les risques de mortalité élevés des patients atteints d’un syndrome coronarien aigu.
La cour d’appel avait également relevé qu’au regard des législations européenne et française, seule l’existence de « propriétés sensiblement différentes » au regard de la sécurité ou de l’efficacité peut justifier un discours attirant l’attention des professionnels de santé et que, par une lettre du 24 septembre 2009, l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, saisie par la société Sanofi-Aventis, a estimé, concernant les génériques du Plavix, que l’inhomogénéité des indications ne constituait pas un risque pour les patients et ne nécessitait pas d’insérer une mention spécifique dans le répertoire des groupes génériques.
La cour d’appel avait enfin souligné que cette agence a rappelé que les spécialités génériques avaient démontré leur bioéquivalence et un rapport efficacité/sécurité au moins similaire à la spécialité de référence.
Pour la Cour de cassation, en l’état de ces constatations et appréciations, fondées sur des indices précis et concordants, la cour d’appel, qui n’a pas méconnu le droit du laboratoire de communiquer sur le principe actif et les indications thérapeutiques de son produit mais en a rappelé les limites, a caractérisé une pratique de dénigrement.
S’agissant des effets de la pratique en cause, la Cour de cassation estime que les constatations et appréciations effectuées par la cour d’appel lui ont valablement permis de déduire, sans être tenue d’établir qu’un nombre significatif de professionnels de la santé s’était effectivement déterminé en fonction des informations communiquées par la société Sanofi-Aventis, que la pratique de dénigrement mise en œuvre pendant cinq mois contre des génériques concurrents du Plavix et de l’auto-générique, par une société en position dominante, avait eu pour effet de limiter l’entrée de ses concurrents sur le marché français du clopidogrel commercialisé en ville.
La cour d’appel avait relevé à cet égard que la société Sanofi-Aventis, qui a exploité le brevet de fabrication du Plavix en monopole pendant dix ans et appartient à un groupe important, a acquis de ce fait une réputation de référence, renforcée par un retour d’expérience qu’elle a fait valoir auprès des professionnels de santé à l’occasion de sa stratégie de communication. Après avoir constaté que les professionnels de santé avaient peu de connaissances en matière de pharmacologie, comme en matière de réglementation des spécialités génériques, et souligné leur aversion pour toute prise de risque, l’arrêt attaqué précisait que, dans un tel contexte, la diffusion d’une information négative, voire l’instillation d’un doute sur les qualités intrinsèques d’un médicament, peut le discréditer immédiatement auprès de ces professionnels. L’effet trompeur et dissuasif de la communication de la société Sanofi-Aventis résulte par ailleurs d’un faisceau d’indices précis et concordants, que l’arrêt attaqué énumère, établissant les craintes qu’elle a suscitées, qui se sont traduites par un grand nombre de mentions « non-substituable » apposées sur les ordonnances dans plusieurs régions, par une substitution prioritairement effectuée au moyen de l’auto-générique par les pharmaciens, et par la diffusion de circulaires d’information spécifiques au sein des groupements de pharmaciens pour répondre aux interrogations et vives inquiétudes d’un grand nombre d’entre eux10.
IX – Sanction des pratiques anticoncurrentielles
A – Affaire Sanofi-Aventis
L’arrêt de la cour d’appel dans l’affaire Sanofi-Aventis a été approuvé par la Cour de cassation non seulement en ce qu’il a caractérisé une pratique de dénigrement (v. supra) mais aussi en ce qu’il a confirmé l’analyse de l’Autorité de la concurrence au stade de la sanction.
Certes, la Cour de cassation rappelle que le communiqué de sanction du 16 mai 2011 de l’Autorité constitue une directive au sens administratif du terme, qui lui est opposable, sauf à ce qu’elle explique, dans la motivation de sa décision, les circonstances particulières ou les raisons d’intérêt général la conduisant à s’en écarter dans un cas donné. Elle observe par ailleurs que si la cour d’appel doit vérifier que la sanction a été prononcée conformément aux règles définies par la loi, elle ne peut se dispenser, lorsqu’elle en est requise, de s’assurer préalablement que l’Autorité a respecté le communiqué de sanction qu’elle a publié et qui s’impose à elle. C’est donc à tort que la cour d’appel a retenu qu’il lui revenait seulement d’apprécier si l’Autorité avait déterminé les sanctions pécuniaires infligées aux requérantes conformément aux dispositions de l’article L. 464-2 du Code de commerce. Toutefois, nonobstant l’erreur commise par la cour d’appel, la cassation de l’arrêt n’est pas encourue dès lors que ses motifs établissent que l’Autorité a respecté les termes de son communiqué, en précisant les raisons d’intérêt général et la situation particulière des entreprises en cause qui l’ont conduite à en aménager l’application.
S’agissant par ailleurs du coefficient multiplicateur qui doit être appliqué à la valeur des ventes en fonction de la durée des pratiques, la Cour de cassation approuve la cour d’appel en ce qu’elle a tenu compte des effets de la pratique, lorsque ceux-ci ont perduré dans le temps au-delà des faits en cause. Tel est le cas, estimait la cour d’appel, du dénigrement mis en œuvre pendant cinq mois, qui a fait naître une opinion défavorable, laquelle demeure attachée à l’entreprise ou au produit visé jusqu’à ce que l’expérience ou la diffusion d’une contre-opinion permette de l’inverser. Pour la Cour de cassation, ce faisant, la cour d’appel n’a pas méconnu le critère de proportionnalité prévu par l’article L. 464-2 du Code de commerce.
Enfin, les hauts magistrats estiment qu’après avoir relevé que la société Sanofi-Aventis dispose de ressources financières globales très importantes, qu’elle appartient à un groupe d’envergure et de réputation mondiale, et que l’appartenance à ce groupe a joué un rôle dans la mise en œuvre des pratiques, la cour d’appel a justifié la majoration appliquée au titre de la puissance économique de la société Sanofi-Aventis et du groupe auquel elle appartient11.
B – Affaire des farines alimentaires
Les entreprises mises en cause dans l’affaire du cartel franco-allemand de la farine (v. supra) ont reproché à la cour d’appel de Paris d’avoir retenu, pour le calcul de la sanction, la valeur des ventes réalisées à la fois en France et en Allemagne alors que, selon le moyen, l’Autorité de la concurrence n’est compétente que pour connaître de pratiques anticoncurrentielles qui affectent le territoire national.
Le moyen est rejeté, la Cour de cassation approuvant la cour d’appel de Paris d’avoir retenu qu’au regard des caractéristiques des pratiques poursuivies, visant à empêcher les meuniers allemands d’exporter de la farine en sachets vers la France et les meuniers français d’en exporter vers l’Allemagne, les seules ventes effectuées en France ne reflétaient pas de façon appropriée l’ampleur économique de l’infraction ou le poids relatif des entreprises impliquées.
Un moyen soulevé par la société Axiane à propos du plafond de la sanction pécuniaire pouvant être prononcée par l’Autorité de la concurrence retiendra également l’attention en ce qu’il a amené la Cour de cassation à préciser que ce plafond est calculé par référence au chiffre d’affaires de l’entreprise consolidante, peu important que cette dernière ait pris le contrôle de l’entreprise en cause après la cessation des pratiques.
La Cour commence par rappeler la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, par décision n° 2015-489 QPC du 14 octobre 2015, a déclaré conforme à la Constitution l’article L. 464-2, I, alinéa 4, du Code de commerce en ce qu’il prévoit que lorsque les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés de l’entreprise consolidante. Le Conseil constitutionnel a également précisé que cette disposition avait pour objet de prévenir des stratégies consistant à réduire, par des restructurations du capital des sociétés, le chiffre d’affaires des entreprises se livrant à des pratiques anticoncurrentielles afin de minorer le maximum de la sanction encourue. Il a également ajouté que cette disposition visait, en outre, à prendre en compte la taille et les capacités financières de l’entreprise visée dans l’appréciation du montant maximal de la sanction. Et le Conseil constitutionnel de conclure qu’eu égard à l’objectif ainsi poursuivi, l’article L. 464-2, I, alinéa 4, ne méconnaît pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines.
La Cour de cassation énonce ensuite qu’il résulte de l’article L. 464-2, I, alinéa 4, que « lorsque les comptes de l’entreprise sanctionnée ont été consolidés, le plafond de la sanction pécuniaire est déterminé par référence au chiffre d’affaires mondial hors taxe le plus élevé figurant dans les comptes de l’entreprise consolidante, réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre ». Selon elle, « ayant constaté que la société Groupe meunier Celbert, devenue la société Axiane, avait été rachetée par la société Épis-Centre, le 3 juillet 2008, c’est sans violer ces dispositions, dont elle a fait l’exacte application, ni prononcer une sanction disproportionnée, que la cour d’appel a approuvé l’Autorité d’avoir déterminé le maximum légal de la sanction encourue par la société Axiane par référence au chiffre d’affaires mondial consolidé hors taxe réalisé en 2009 par la société Épis-Centre, peu important que cette dernière société ait pris le contrôle de la société Axiane après la cessation des pratiques sanctionnées »12.
C – Affaire du fret ferroviaire
La décision rendue par l’Autorité de la concurrence dans l’affaire du fret ferroviaire a été réformée par la cour d’appel de Paris en ce qui concerne non seulement la pratique d’éviction, reprochée à la SNCF, sur le marché ferroviaire de marchandises par train massif (v. supra), mais aussi en ce qui concerne la sanction infligée à l’entreprise et plus particulièrement la prise ne compte de la réitération.
À cet égard, rappelons que l’Autorité de la concurrence peut, au titre des circonstances aggravantes, retenir la réitération lorsque, entre autres conditions, les nouvelles pratiques sont identiques ou similaires, par leur objet ou leur effet, à celles ayant donné lieu au précédent constat d’infraction.
Pour conclure que la SNCF se trouvait dans une situation de réitération justifiant, dans les circonstances de l’espèce, une majoration de 10 % de sa sanction, l’Autorité avait retenu, concernant l’existence d’un constat antérieur d’infraction que le Conseil de la concurrence a constaté, par une décision n° 09-D-06 du 5 février 2009 relative à des pratiques mises en œuvre par la SNCF et Expedia Inc. dans le secteur de la vente de voyages en ligne, que la SNCF avait commis plusieurs abus de position dominante.
La cour d’appel a censuré cette analyse dans un arrêt du 6 novembre 2014. Faisant une application restrictive de la réitération, elle a considéré que les pratiques d’abus de position dominante imputées et sanctionnées en l’espèce à la SNCF, qui ont consisté à publier, de manière tardive et incomplète, la liste de ses cours de marchandises dans le document de référence du réseau en protégeant sa position dominante sur le marché des services ferroviaires de marchandises par train massif, ne pouvaient être qualifiées d’identiques ou similaires, par leur objet ou leur effet, à celles ayant donné lieu au précédent constat d’infraction qui concernait la vente en ligne de titres de transport voyageurs et consistaient dans des pratiques discriminatoires visant à refuser l’accès des distributeurs de billets qui lui faisaient concurrence sur le marché, aux fonctionnalités techniques dont elle était propriétaire (billet imprimé, offres dernière minutes et iDTGV) afin, en substance, de favoriser son site internet marchand au détriment de ses concurrents, et ainsi d’évincer du marché des services de la distribution de billets de train, et à tout le moins du canal de distribution par internet, des concurrents aussi efficaces.
Cette approche n’est pas approuvée par la Cour de cassation qui précise que la qualification de réitération n’exige pas une identité quant à la pratique mise en œuvre ou quant au marché concerné.
Pour la haute juridiction, en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que les pratiques d’abus de position dominante imputées à la SNCF tendaient à restreindre l’accès des autres entreprises ferroviaires à ses cours de marchandises, dont elles avaient besoin pour se développer sur le marché du transport ferroviaire de marchandises par train massif, et à rehausser les barrières à l’entrée sur ce marché, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 464-2 du Code de commerce13.
X – Confirmation partielle d’une décision « concentration » dans le secteur de la distribution de GPL
Les juges du Palais-Royal ont partiellement confirmé une décision par laquelle l’Autorité de la concurrence a autorisé une opération de concentration dans le secteur de la distribution de gaz de pétrole liquéfié.
L’affaire remonte à 2014, date à laquelle la société UGI Bordeaux Holding (UGI), qui contrôlait déjà la société Antargaz, active dans le secteur de la distribution de gaz de pétrole liquéfié (GPL), a décidé d’acquérir la totalité du capital de la société Totalgaz, également active dans le même secteur.
Par une décision du 15 mai 2015, l’Autorité de la concurrence a autorisé cette opération de concentration sous réserve de l’exécution de plusieurs engagements pris par les parties à cette opération. Pour trois de ces engagements, l’Autorité avait accepté de prendre en compte deux « engagements alternatifs », c’est-à-dire des engagements appelés à se substituer aux engagements principaux dans l’hypothèse où ceux-ci se révéleraient insuffisamment certains. Elle avait occulté le contenu de ces deux « engagements alternatifs » dans sa décision.
Le Conseil d’État avait été saisi par deux concurrents des parties qui, en parallèle de leur demande d’annulation, avaient demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre la décision. Cette demande de suspension avait été rejetée par ordonnance du 9 juillet 2015 au motif que les sociétés requérantes n’étaient pas dans une situation d’urgence telle qu’elles ne puissent pas attendre que le Conseil d’État se prononce définitivement sur la légalité de la décision après une instruction complète.
Le Conseil d’État a ensuite rendu une première décision le 15 avril 2016, par laquelle il a invité l’Autorité à verser au débat contradictoire le contenu des deux « engagements alternatifs » qu’elle avait occultés. Celle-ci y a donné suite dans les délais requis.
Enfin, par décision rendue le 6 juillet 2016, le Conseil d’État s’est prononcé définitivement sur la légalité de la décision de l’Autorité.
Pour trois des marchés identifiés par l’Autorité (distribution de GPL combustible en moyen et gros vrac, distribution de GPL combustible conditionné en bouteilles, distribution de GPL utilisé comme carburant), le Conseil d’État a confirmé l’analyse concurrentielle de l’Autorité.
En revanche, pour le quatrième marché, celui de la distribution de GPL combustible en petit vrac, le Conseil d’État juge que l’Autorité a commis une erreur d’appréciation. En effet, si elle a examiné les effets sur le marché de la distribution en petit vrac de la faculté qu’aura l’entité issue de l’opération de concentration de s’extraire du réseau de contrats d’échange de volumes de GPL dans les onze marchés locaux dans lesquels sa position dominante a résulté du chevauchement d’activités entre des dépôts qui étaient auparavant contrôlés séparément par les sociétés UGI et Totalgaz, en revanche, elle n’a pas examiné les effets sur le marché de la distribution en petit vrac de la faculté qu’aura l’entité issue de l’opération de concentration de s’extraire de ce réseau de contrats d’échange dans les marchés locaux dans lesquels l’une ou l’autre des société UGI et Totalgaz disposait déjà d’une position dominante, mais était incitée à ne pas en abuser en raison de l’intérêt qu’elle avait à conclure des contrats d’échange dans d’autres zones du territoire. Or, dans ces marchés locaux, la société UGI aura également la faculté de refuser de conclure des contrats d’échange avec ses concurrentes et de les priver de l’accès à des capacités de stockage secondaire (pt 19).
Le Conseil d’État annule donc la décision de l’Autorité à cet égard. Celle-ci devra compléter son analyse concurrentielle sur ce point précis (pt 55).
Le Conseil d’État estime par ailleurs que les engagements ayant trait au point censuré de l’analyse concurrentielle ne suffisent pas à garantir le maintien d’une concurrence suffisante sur le marché concerné. Il annule donc également à cet égard la décision de l’Autorité. Celle-ci devra donc réexaminer s’il y a lieu, sur ce point précis, de compléter sa décision en la subordonnant à de nouveaux engagements ou en l’assortissant de prescriptions ou d’injonctions dans la mesure nécessaire au maintien d’une concurrence suffisante (pt 55)14.
XI – Rejet d’une demande de suspension d’une décision « concentration » dans le secteur de la collecte de grains
Le juge des référés du Conseil d’État a été saisi d’une demande visant, à titre principal, à ordonner la suspension de l’exécution de la décision n° 16-DCC-147 du 21 septembre 2016 par laquelle l’Autorité de la concurrence a autorisé la prise de contrôle exclusif par la société Axéréal participations de la société Agri-Négoce, sous réserve du respect d’engagements visant à remédier aux effets de cette opération sur le marché de la collecte de grains dans le département du Loir-et-Cher.
Il estime qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales dès lors que la prise de contrôle a été réalisée le 30 septembre 2016, postérieurement à l’introduction de la requête. En revanche, il statue sur les conclusions subsidiaires des sociétés requérantes tendant à la suspension de la décision contestée en tant qu’elle précise les engagements au respect desquels est subordonnée l’autorisation donnée par l’Autorité de la concurrence à l’opération litigieuse.
Pour démontrer l’urgence qu’il y avait à suspendre l’exécution de la décision contestée ainsi que le doute sérieux pesant sur la légalité de celle-ci, les sociétés requérantes soutenaient que les engagements souscrits par la société Axéréal participations ne sauraient maintenir une concurrence suffisante sur le marché de la collecte des grains dans le département du Loir-et-Cher, dès lors qu’ils font subsister une part de marché de la nouvelle entité supérieure à 65 % dans cinq zones de collecte locales, qu’aucun des silos proposés à la cession n’est relié à un embranchement ferroviaire en fonctionnement et exploitable, que trois silos parmi les six proposés à la cession ne sont pas viables et, enfin, que l’opération de concentration obligerait les agriculteurs à adhérer à une coopérative agricole du fait de la disparition, sur les zones en cause, du seul opérateur important proposant ses services sous la forme du négoce non coopératif.
Ces conclusions subsidiaires sont rejetées pour trois motifs.
En premier lieu, si la cession des silos laissait malgré tout subsister une part de marché supérieure à 65 % dans la zone de Talcy, la société Axéréal participations y dispose déjà d’une part de marché supérieure à 65 %. Par suite, dans la mesure où il ne saurait être fait grief aux engagements pris de ne pas accroître le degré de concurrence préexistant à l’opération de concentration, le moyen tiré de ce que ces engagements laisseraient subsister des parts de marché trop importantes pour la société Axéréal participations n’est, en l’état de l’instruction, de nature ni à caractériser l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, ni à faire naître un doute sérieux sur l’existence d’une erreur d’appréciation commise par l’Autorité de la concurrence.
En deuxième lieu, la détention d’un silo disposant d’un embranchement ferroviaire, si elle peut conférer un avantage concurrentiel sur le marché de la commercialisation des grains, n’est susceptible de procurer sur le marché de la collecte des grains, seul en cause dans la présente affaire, que des avantages très indirects et difficiles à mesurer. En outre, s’agissant de la vétusté des silos proposés à la cession qui les rendrait non viables, plusieurs concurrents ont manifesté leur intérêt pour le rachat de ces silos, ce qui constitue une circonstance déterminante pour apprécier le caractère suffisant des engagements au respect desquels l’autorisation de concentration est subordonnée.
En troisième lieu, la circonstance que l’opération de concentration litigieuse aura pour effet, dans les zones en cause, de priver les agriculteurs de la possibilité de continuer de vendre leurs grains dans le cadre du négoce non coopératif est sans incidence sur l’appréciation du caractère suffisant des engagements pris pour maintenir une concurrence suffisante sur le marché de la collecte des grains dans le département du Loir-et-Cher.
Par suite, le moyen soulevé par les requérantes n’est de nature ni à caractériser l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, ni à établir l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci15.
XII – Rejet de demandes d’annulation de deux décisions « concentration » dans le secteur des analyses de biologie médicale
Il n’appartenait pas à l’Autorité de la concurrence de prendre en compte, dans ses décisions en matière de concentration, les dispositions de l’article L. 6223-5 du Code de la santé publique. Tel est l’enseignement que l’on tirera de deux arrêts rendus, dans des termes analogues, par le Conseil d’État, saisi par l’Association des Entreprises de Biologie Médicale qui contestait la légalité de deux opérations de concentration sur le marché des analyses de biologie médicale spécialisées.
Selon la haute juridiction administrative, « d’une part, il n’appartenait pas à l’Autorité de la concurrence de prendre en compte, pour prendre sa décision du 13 juillet 2015, les dispositions de l’article L. 6223-5 du Code de la santé publique, qui n’ont pas d’autre objet que d’interdire la participation de certaines catégories d’opérateurs au capital social de sociétés exploitant des laboratoires de biologie médicale privés. D’autre part, l’autorisation délivrée par l’Autorité de la concurrence ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient l’AEBM, comme ayant nécessairement et par elle-même pour effet de conduire à une méconnaissance de l’article L. 6223-5 du Code de la santé publique. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’Autorité de la concurrence aurait commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l’article L. 6223-5 du Code de la santé publique doit être écarté »16.
XIII – Rupture brutale d’une relation commerciale établie
A – Rupture prévisible d’une relation commerciale établie
En rejetant le pourvoi contre un arrêt du 12 juin 2014 de la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation a jugé que la prévisibilité d’une rupture brutale établie au sens de l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce ne peut résulter que d’un préavis écrit.
L’occasion lui en a été donnée par un litige opposant la société Sniw, qui exerce une activité de centrale d’achats de produits alimentaires, à la société US import export (la société US), qui s’approvisionnait de longue date auprès de Sniw avant de cesser brutalement ses commandes. S’estimant victime de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, la société Sniw a assigné la société US en réparation de son préjudice.
La cour d’appel de Paris a fait droit à cette demande. En rejetant le pourvoi, la Cour de cassation écarte un moyen qui soutenait que la rupture de relations commerciales établies n’est pas brutale lorsqu’elle est prévisible. Pour la haute juridiction, « le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ; (…) ayant constaté que la société US avait cessé ses approvisionnements auprès de la société Sniw du jour au lendemain, sans lui adresser ni lettre de rupture, ni préavis écrit, la cour d’appel (…) a pu retenir la responsabilité de la société US »17.
B – Rupture brutale dans le secteur automobile
Le respect des délais de préavis fixés par le règlement automobile (CE) n° 1400/2002 du 31 juillet 2002 ne permet pas à un constructeur automobile de s’affranchir des prescriptions de l’article L. 442-6-I-5°, du Code de commerce relatif à la rupture brutale d’une relation commerciale établie. Tel est l’enseignement que l’on tirera de l’arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans le cadre d’un litige opposant la société BMW à la société Taurisson.
Celle-ci était concessionnaire de la société BMW (depuis 1964) en vertu, dans le dernier état de leurs relations, de deux contrats conclus le 1er octobre 2003, à durée déterminée, stipulant que chaque partie devrait, avec un préavis de six mois avant le terme, notifier à l’autre partie son intention de ne pas renouveler le contrat ; les contrats n’ayant pas été renouvelés à leur échéance, la société Taurisson a assigné la société BMW en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce.
Les juges du fond ont fait droit à l’action du concessionnaire mais le constructeur s’est pourvu en cassation. Celui-ci faisait grief à la cour d’appel de le condamner à payer à la société Taurisson la somme de 729 640 € au titre de la rupture de leurs relations commerciales portant sur la vente des véhicules neufs BMW et Mini, et celle de 215 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la baisse de l’activité après-vente alors, selon le pourvoi que doit être écarté comme incompatible avec le droit communautaire, la législation nationale qui impose ou permet d’exiger, dans le cas d’un contrat de concession automobile, un délai de préavis largement supérieur à ceux prévus par le règlement n° 1400/2002.
Ce moyen est rejeté. La Cour de cassation rappelle en premier lieu, qu’un règlement d’exemption n’établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu des clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à y adapter le contenu de leur contrat, mais se limite à établir des conditions qui, si elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à l’interdiction et par conséquent à la nullité de plein droit prévues par l’article 81 du Traité, devenu 101 du TFUE. Et d’ajouter que le règlement n° 1400/2002 précise expressément que la durée de préavis qu’il prévoit revêt un caractère minimal et le règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 prévoit, en son article 3.2, qu’il n’empêche pas les États membres d’adopter et de mettre en œuvre sur leur territoire des lois nationales plus strictes qui interdisent ou sanctionnent un comportement unilatéral d’une entreprise. Dès lors, le moyen, qui postule l’incompatibilité de la législation nationale sanctionnant la rupture brutale de relations commerciales établies en raison de la possibilité qu’elle offre d’exiger le respect d’un délai de préavis supérieur au minimum fixé par le droit de l’Union, manque en conséquence en droit.
La cassation est néanmoins prononcée dès lors que, pour condamner la société BMW à payer la somme de 215 000 € au titre de la baisse de l’activité après-vente, la cour d’appel a relevé que la perte de la vente des véhicules neufs induit nécessairement une diminution des recettes au titre de l’activité après-vente. Selon la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que seul le préjudice causé par le caractère brutal de la rupture doit être indemnisé et non celui résultant de la rupture elle-même, la cour d’appel a violé le l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce18.
XIV – Inopposabilité d’une clause compromissoire au ministre de l’Économie
La Cour de cassation s’est prononcée sur l’opposabilité d’une clause compromissoire au ministre de l’Économie qui entendait engager une action sur le fondement de l’article L. 442-6, III, du Code de commerce19.
À l’origine du litige le ministre de l’Économie a assigné la société Apple distribution international et la société Apple France (les sociétés Apple) devant la justice consulaire sur le fondement de l’article L. 442-6, III, pour faire prononcer la nullité de certaines clauses du contrat de distribution conclu avec la société Orange. Les sociétés Apple ont soulevé l’incompétence de la juridiction étatique sur le fondement de la clause compromissoire stipulée au contrat de distribution. Elles ont fait valoir que le juge saisi d’un litige relatif à un contrat comportant une clause d’arbitrage doit se déclarer incompétent, afin que l’arbitre statue, par priorité, sur sa compétence, sauf nullité manifeste ou inapplicabilité manifeste de la clause.
Cependant, après avoir rappelé que l’article L. 442-6, III, réserve au ministre chargé de l’Économie la faculté de saisir le juge pour faire cesser des pratiques illicites et prononcer des amendes civiles, la cour d’appel a énoncé que l’action ainsi attribuée au titre d’une mission de gardien de l’ordre public économique pour protéger le fonctionnement du marché et de la concurrence est une action autonome dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques au regard de sa nature et de son objet.
La Cour de cassation approuve cette analyse : « le ministre n’agissant ni comme partie au contrat ni sur le fondement de celui-ci, la cour d’appel a caractérisé l’inapplicabilité manifeste au litige de la convention d’arbitrage du contrat de distribution »20.
XV – Contrôle des aides d’État
L’arrêt rendu par le Conseil d’État le 27 octobre 2016 est venu rappeler les limites du rôle que peuvent jouer les juridictions nationales dans l’appréciation de la compatibilité d’une aide d’État avec le marché intérieur.
Le régime contesté résulte d’une convention conclue entre le Premier ministre et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) relative au programme d’investissements d’avenir.
Les autorités françaises ont, en décembre 2014, informé la Commission européenne de la mise en œuvre d’un régime d’aides exempté de notification relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation et à la protection de l’environnement dans le cadre du programme des « investissements d’avenir », dont ladite convention fait partie intégrante. Quant à la Commission européenne, elle a décidé de prolonger jusqu’au 31 décembre 2020 l’application du règlement du 17 juin 2016 qui exempte ce régime d’aides de l’obligation de notification.
À l’appui de sa requête, la société requérante soutenait que ledit régime méconnaissait les lignes directrices de la Commission du 27 juin 2014 concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie issues d’une communication de la Commission du 28 juin 2014. Le moyen est rejeté au motif que la société requérante ne saurait utilement invoquer un tel acte à l’encontre de la convention litigieuse sans remettre en cause l’appréciation portée par la Commission sur la compatibilité du régime d’aides d’État dont cette convention fait application. Or il n’appartient pas aux juridictions nationales d’apprécier la compatibilité d’un tel régime avec le marché intérieur21.
Notes de bas de pages
-
1.
CA Nîmes, 10 févr. 2015, n° 13/05645, accessible à Creda concurrence, 11 juill. 2016.
-
2.
Cass. crim., 29 juin 2016, n° 15-81890. Le même jour, la chambre criminelle a rejeté, dans la même affaire, le pourvoi n° 15-81889.
-
3.
Cass. crim., 23 nov. 2016, n° 15-81131.
-
4.
Cass. com., 4 oct. 2016, n° 15-14158.
-
5.
Cass. com., 8 nov. 2016, n° 14-28234 et s.
-
6.
Cass. com., 8 nov. 2016, n° 14-28234 et s.
-
7.
Cass. com., 8 nov. 2016, n° 14-28234 et s.
-
8.
Cass. com., 20 sept. 2016, n° 13-15935.
-
9.
Cass. com., 22 nov. 2016, nos 14-28224 et 14-28862.
-
10.
Cass. com., 18 oct. 2016, n° 15-10384.
-
11.
Cass. com., 18 oct. 2016, n° 15-10384.
-
12.
Cass. com., 8 nov. 2016, n° 14-28234 et s. ; Dumarçay M., « Des lignes de force au forçage des lignes, il n’y a qu’un pas… : retour sur la méthode de fixation du maximum légal de l’amende encourue au titre d’une pratique anticoncurrentielle », RLC 2017/57, n° 3107.
-
13.
Cass. com., 22 nov. 2016, nos 14-28224 et 14-28862.
-
14.
CE, 6 juill. 2016, nos390457 et 390774.
-
15.
CE, 17 oct. 2016, n° 403730.
-
16.
CE, 21 oct. 2016, n° 394117 ; CE, 21 oct. 2016, n° 395847.
-
17.
Cass. com., 6 sept. 2016, n° 14-25891.
-
18.
Cass. com., 5 juill. 2016, n° 15-17004.
-
19.
C. com., art. L. 442-6, III : « L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’Économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article. »
-
20.
Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-21811.
-
21.
CE, 27 oct. 2016, n° 387384.