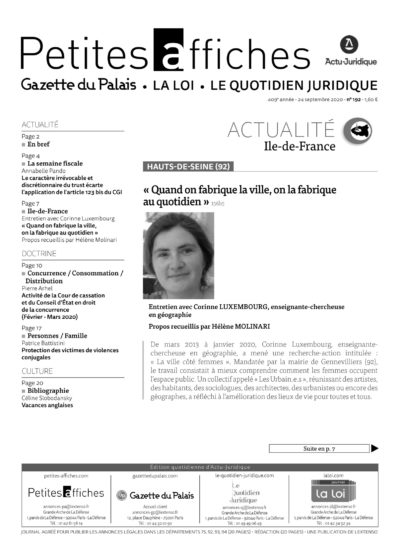Activité de la Cour de cassation et du Conseil d’État en droit de la concurrence (Février – Mars 2020)
La présente étude porte sur les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d’État en droit de la concurrence. Plusieurs domaines sont théoriquement concernés. La haute juridiction judiciaire se prononce d’abord sur les arrêts que la cour d’appel de Paris rend lorsqu’elle est saisie d’un recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence ; elle est également saisie des pourvois en matière de « transparence », « pratiques restrictives de concurrence » et « autres pratiques prohibées », au sens du titre IV du livre IV du Code de commerce ; elle est aussi compétente en matière de visite et de saisies opérées sur le fondement de l’article L. 450-4 du Code de commerce ; enfin, elle se prononce sur les décisions rendues dans le cadre de litiges entre opérateurs économiques.
Quant au Conseil d’État, il suffit, pour mesurer l’étendue de sa compétence, de rappeler que le droit de la concurrence fait partie intégrante du bloc de la légalité administrative.
L’étude porte sur la période de février à mars 2020. Les points suivants ont plus particulièrement retenu l’attention : 1) Précision du champ d’application des obligations relatives aux conditions générales de vente ; 2) Rappel du délai de prescription de l’action en nullité en matière de pratiques restrictives de concurrence ; 3) Validation de la pratique des scellés provisoires ; 4) Renvoi au Tribunal des conflits de l’affaire des mesures conservatoires prononcées à l’encontre de Google ; 5) Précision de la jurisprudence relative au défaut de notification d’une aide d’État ; 6) Annulation d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux dans une affaire de reversement d’aide d’État ; 7) Confirmation en tous points de l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans l’affaire des matériels de grande cuisine ; 8) Recevabilité des tiers à demander au juge d’engager la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs d’un cartel.
I – Précisions sur le champ d’application des obligations relatives aux conditions générales de vente
La Cour de cassation précise, par un arrêt du 5 février 2020, le champ d’application des obligations relatives aux pénalités de retard prévues à l’article L. 441-6 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 (remplacé par art. C. com., art. L. 441-1).
Cette affaire a pour origine l’assignation d’une association par un bailleur qui lui réclamait le paiement de pénalités de retard au titre de l’article L. 441-6.
Pour condamner l’association, la cour d’appel de Douai a retenu que l’article L. 441-6 lui est applicable, dès lors que seuls les consommateurs sont exclus de son champ d’application.
La Cour de cassation ne partage pas cette analyse. Elle rappelle d’abord qu’il résulte de l’article L. 441-6 « que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle, de telles conditions générales comprenant notamment les conditions de règlement, lesquelles doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».
Elle énonce par ailleurs qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de son activité, l’association n’avait pas la qualité de non-professionnel, exclusive de l’application des pénalités litigieuses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Elle casse et annule en conséquence, en toutes ses dispositions, l’arrêt attaqué et remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée1.

II – Rappel du délai de prescription de l’action en nullité en matière de pratiques restrictives de concurrence
Un fabricant de bijoux fantaisie, reprochant au groupe Auchan d’avoir facturé de fausses prestations de services de coopération commerciale, a assigné le distributeur en nullité de leurs accords commerciaux et en restitution des sommes versées à ce titre. Celui-ci lui a opposé la prescription de l’action, offrant ainsi à la chambre commerciale l’occasion de rappeler les règles applicables : « les actions en annulation des contrats de coopération commerciale, qui sont fondées sur la nullité d’ordre public de ceux-ci, sont soumises à la prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce qui, initialement décennale, est devenue quinquennale en application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile »2.
III – Validation de la pratique des scellés provisoires
Par un arrêt relevant du droit de la consommation mais transposable en droit de la concurrence, la chambre criminelle rejette le pourvoi formé par la société Renault contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles, en date du 25 janvier 2018, qui a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques prohibées par les articles L. 213-1 et suivants du Code de la consommation ; ces opérations s’inscrivaient dans le cadre d’une enquête demandée par le ministre de l’Économie, concernant des tromperies susceptibles d’être mises en œuvre dans le secteur de la fabrication automobile, plus précisément sur les contrôles d’émissions de polluants lors des tests d’homologation anti-pollution.
Les cinquième et sixième moyens retiendront l’attention.
Le cinquième moyen critiquait notamment la pratique consistant à ne pas procéder à l’inventaire des pièces immédiatement avant leur saisie, comme l’impose l’article L. 215-18 du Code de la consommation, et à lui substituer une mise sous scellés provisoires de multiples fichiers collectés par les enquêteurs. Cette pratique a pour effet, si ce n’est pour objet, d’augmenter considérablement la masse de données appréhendées par le service d’enquête et de rendre en conséquence très difficile, voire impossible, la vérification, tant par la personne visitée que par le juge, des pièces devant être distraites de la saisie et notamment des correspondances relevant de la protection de la correspondance avocat-client.
La chambre criminelle rejette le moyen en approuvant l’ordonnance attaquée d’avoir considéré que « la procédure des scellés provisoires mise en place protège précisément la confidentialité des correspondances avocat-client, puisqu’elle permet à l’entreprise de faire connaître aux enquêteurs les pièces qui, d’après elle, pourraient bénéficier de la protection liée à la confidentialité des correspondances avocat-client et qu’ainsi, ces documents peuvent être rapidement supprimés des fichiers de messagerie dans lesquels ils figurent » (pt 10).
La haute juridiction relève par ailleurs que « au stade de la mise sous scellé provisoire, la saisie n’est par hypothèse pas définitive, et qu’il n’existe que la copie mise sous scellé fermé provisoire en vue d’un examen contradictoire ultérieur, que les fichiers ont été inventoriés sur une liste exhaustive sous format numérique au moyen d’un CD annexé au procès-verbal de visite et saisies, qu’il a été indiqué à l’occupant des lieux qu’une date de rendez-vous lui serait fixée pour l’ouverture du CD provisoire et la suppression, le cas échéant, des documents protégés par le secret relevant de la protection avocat-client, puisque dans un deuxième temps, les enquêteurs, en présence d’un officier de police judiciaire et d’un représentant de la société Renault assisté de ses conseils, ont procédé à l’ouverture des scellés, les fichiers ayant fait l’objet de deux copies, l’une remise à l’entreprise, l’autre conservée par les enquêteurs, avant d’être placés sous scellé définitif (pt 12).
Elle ajoute qu’aller au-delà « consisterait à interdire à toute administration ou à toute autorité administrative indépendante de pratiquer toute forme de saisie » (pt 13).
La chambre criminelle rejette également le sixième moyen. Ce faisant, elle approuve le premier président d’avoir énoncé qu’un fichier de messagerie doit être regardé comme étant un fichier informatique indivisible qui peut être saisi dans son entier s’il est susceptible de contenir des éléments intéressant l’enquête, qu’il est difficilement envisageable, même si cela est techniquement possible, d’individualiser sur place au cours des opérations les seuls messages pertinents, en les analysant un à un, au risque de paralyser le fonctionnement de l’entreprise et de réduire l’efficacité de l’enquête, et qu’il est nécessaire de préserver l’intégrité et l’authenticité des éléments de preuve, ce que garantit davantage la saisie globale des messageries dans lesquelles a été constatée la présence de documents entrant dans le champ de l’autorisation, évitant ainsi de créer sur l’ordinateur des éléments qui n’existaient pas ou d’altérer des métadonnées des fichiers (pt 26).
Elle estime encore que le premier président a pu souverainement apprécier que le refus du juge des libertés et de la détention de se déplacer sur les lieux à l’occasion de l’ouverture des scellés provisoires, avait été justifié par ce magistrat, et n’avait pas été de nature à porter atteinte aux droits de la demanderesse (pt 33)3.
IV – Renvoi au Tribunal des conflits de l’affaire des mesures conservatoires prononcées à l’encontre de Google
On se souvient que la société Google a saisi la cour d’appel de Paris d’un recours contre la décision de mesures conservatoires prononcées à son encontre par l’Autorité de la concurrence. Plus précisément, elle a demandé à la juridiction parisienne d’annuler la décision du 31 janvier 2019 par laquelle l’Autorité a publié sur son site internet la version « non confidentielle » de sa décision n° 19-MC-01 du même jour et d’enjoindre à l’Autorité de remplacer la décision publiée par une version de la décision du 31 janvier 2019 ne comportant plus les éléments protégés par le secret des affaires selon la décision du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence.
La cour d’appel y a répondu en observant que la demande de Google, qui n’a pas pour objet l’annulation ou la réformation d’un chef de dispositif relatif aux conditions de publication de la décision attaquée, mais tend à voir constater la défaillance de l’Autorité dans la mise en œuvre d’une mesure de protection accordée par son rapporteur et à voir adresser une injonction à cette autorité administrative indépendante afin qu’elle procède à une nouvelle publication de la décision attaquée sur son site, après en avoir occulté certains passages, excède donc les limites de la saisine de la cour4.
Saisi à son tour, le Conseil d’État énonce que « dès lors que, pour se prononcer sur les modalités de publication de sa décision, l’Autorité doit tenir compte à la fois de la protection du secret des affaires et de l’intérêt public qui s’attache à la publication de la motivation de sa décision, y compris la publication d’informations susceptibles d’être protégées au titre du secret des affaires, cette décision distincte peut être regardée comme n’étant pas détachable de la décision par laquelle l’Autorité a prononcé les mesures conservatoires, laquelle ressortit, en vertu de l’article L. 464-7 du Code de commerce, à la compétence de la cour d’appel de Paris. Dans ces conditions, il apparaît que le litige est susceptible de relever de la compétence de la juridiction judiciaire ».
L’affaire est donc renvoyée au Tribunal des conflits pour décider sur la question de compétence5.
V – Précisions concernant la jurisprudence relative au défaut de notification d’une aide d’État
Le défaut de notification, à la Commission européenne, d’aides régionales en matière de transport mis en place par la région Île-de-France offre l’occasion au Conseil d’État de préciser sa jurisprudence.
Celui-ci énonce notamment que « la récupération des aides ne peut être prononcée qu’à titre de mesure de sauvegarde dans l’attente de la décision de la Commission sur la compatibilité du régime d’aides avec le marché intérieur ». En l’espèce, le Conseil d’État juge qu’en s’abstenant de préciser le caractère provisoire des restitutions, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit (cons. 5).
La haute juridiction précise par ailleurs la sanction de l’illégalité d’un défaut de notification en jugeant que lorsque la Commission a adopté une décision devenue définitive constatant la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur, la sanction de l’illégalité résultant d’un défaut de notification préalable implique, en l’absence de dispositions nationales imposant la récupération des aides dans cette hypothèse, que soit mis à la charge des bénéficiaires de l’aide le paiement d’intérêts, calculés conformément au règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004, que l’entreprise aurait acquittés si elle avait dû emprunter sur le marché le montant de l’aide entre la date à laquelle elle lui a été versée et celle de la décision de la Commission européenne au titre de la période d’illégalité (cons. 15)6.
VI – Annulation d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux dans une affaire de reversement d’aide d’État
À l’origine de cette affaire un négociant de vins de Bordeaux a reçu des aides de l’Union européenne dans le cadre d’un programme de promotion des vins sur les marchés tiers, en exécution d’une convention avec l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). À l’issue d’un contrôle qui a mis en évidence diverses irrégularités, FranceAgriMer a demandé le reversement des aides et infligé une sanction à l’entreprise.
Saisi d’un pourvoi formé par le négociant, le Conseil d’État reproche une double erreur de droit à l’arrêt attaqué.
La première erreur de droit porte sur le délai de prescription applicable. La haute juridiction estime que « en l’absence d’un texte spécial fixant, dans le respect du principe de proportionnalité, un délai de prescription plus long pour le reversement des aides accordées, dans le cadre de l’organisation commune du marché vitivinicole, en vue de la promotion de la vente des vins sur les marchés tiers, seul le délai de prescription de 4 années prévu au premier alinéa du 1 de l’article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 est applicable (cons. 3).
Par suite, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant que le délai de prescription de 5 années, prévu, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, par les dispositions à caractère général de l’article 2224 du Code civil, était applicable en lieu et place du délai de prescription de 4 années (cons. 4).
La seconde erreur de droit porte sur la sanction infligée à l’entreprise. Le Conseil d’État observe que les dispositions de l’article 5 bis de l’arrêté du 16 février 2009 prévoient l’application de sanctions déterminées selon une règle strictement arithmétique, exclusivement liée à la proportion du montant de l’aide dont le contrôle a révélé qu’il avait été indument perçu par rapport au montant de l’aide initialement retenu, sans que ne soit prise en considération, en dehors de la fourniture intentionnelle de données erronées dans la demande de paiement, la nature et la gravité des irrégularités qui ont été commises. Dès lors, « en jugeant que l’arrêté fixant ce régime ne méconnaît pas le principe de proportionnalité posé par l’article 98 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008, la cour a commis une erreur de droit (cons. 11) ».
L’arrêt attaqué est en conséquence annulé en tant qu’il s’est prononcé sur la sanction7.
VII – Confirmation en tous points de l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans l’affaire des matériels de grande cuisine
Au moment où la chambre commerciale confirme en tous points l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans l’affaire des matériels de grande cuisine, arrêt qui avait lui-même confirmé la décision de l’Autorité de la concurrence, il paraît utile de rappeler des étapes importantes de la procédure suivie devant l’Autorité.
Par une décision du 8 juin 2010, celle-ci s’est saisie d’office de pratiques prohibées par l’article L. 420-1 du Code de commerce et une première notification de grief a été adressée à plusieurs entreprises, dont la société le Groupement des Installateurs Français (le GIF), le 5 novembre 2015. Par décision du 14 avril 2016, le collège de l’Autorité a décidé de surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à l’instruction en ce qui concerne les pratiques reprochées au GIF, au motif que le dossier n’était pas en l’état d’être jugé pour cette entreprise. À la suite d’une erreur des services d’instruction, le rapport d’enquête de la DGCCRF n’a pas été joint à cette première notification de grief. Une seconde notification de grief, à laquelle, cette fois, le rapport de la DGCCRF était joint, a alors été adressée au GIF le 18 mai 2016. L’affaire a été de nouveau examinée par le collège de l’Autorité, lors de sa séance du 11 octobre 2016 et par la décision attaquée l’Autorité a sanctionné le GIF notamment en lui infligeant une sanction pécuniaire de 400 000 €.
Le pourvoi critique en premier lieu un détournement de procédure. Selon le premier moyen, le renvoi du dossier à l’instruction ordonné par le collège de l’Autorité sur le fondement de l’article R. 463-7 du Code de commerce8 a pour seul objet d’inviter les services de l’instruction à compléter une instruction jugée incomplète, en procédant, si nécessaire, à de nouvelles mesures d’investigation ; une telle procédure ne peut être détournée de sa finalité afin de permettre aux services de l’instruction de purger un vice de procédure consistant dans le fait, pour ceux-ci, d’avoir omis de communiquer à la partie poursuivie une pièce déterminante ayant motivé la saisine de l’Autorité.
Le critique est écartée : « Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève que le collège de l’Autorité a constaté qu’une pièce essentielle de la procédure constituée par un rapport d’enquête de la DGCCRF n’avait pas été communiquée au GIF, privant ce dernier de la possibilité de contester les constatations y figurant, y compris par la production d’éléments de preuve contraires ; qu’il retient que la communication de ce rapport, en ouvrant au GIF la possibilité d’en contester le contenu par la fourniture d’éléments de preuve nouveaux, était de nature à permettre de compléter l’instruction, peu important de savoir si le GIF se soit ou non saisi de cette possibilité et peu important que, de son côté, le rapporteur n’ait mené aucune mesure d’instruction supplémentaire dans le temps qui a séparé la décision de renvoi et la nouvelle notification des griefs ; qu’en l’état de ces appréciations dont elle a déduit que le versement d’une pièce essentielle au dossier, n’aurait-il eu pour objet que de permettre le respect du principe de la contradiction, entre dans le champ d’un complément nécessaire à l’instruction autorisant le collège de l’Autorité à faire usage des prérogatives qu’il tient de l’article R. 463-7 du Code de commerce, la cour d’appel a statué à bon droit ».
Est également rejeté un reproche de méconnaissance du principe d’égalité des armes et de l’article 6, § 1, de la Convention EDH : « Attendu (…) qu’ayant relevé que le GIF avait été en mesure de répondre par écrit à la seconde notification des griefs, c’est sans méconnaître le principe d’égalité des armes et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (…) que la cour d’appel a retenu que la circonstance que, en cas de renvoi à l’instruction, les rapporteurs avaient déjà connaissance de la réponse de l’entreprise à la première notification lorsqu’ils ont notifié le même grief pour la seconde fois, ne modifiait pas sa situation par rapport à ce qu’elle aurait été en l’absence de renvoi à l’instruction »9.
Les solutions retenues ici par la haute juridiction judiciaire n’ont pas été épargnées par la critique. Un auteur a observé à cet égard que : « À la lecture du présent arrêt, subsiste un désagréable sentiment d’impunité : les services d’instruction peuvent commettre des énormes erreurs de procédure – ne pas soumettre une pièce fondatrice de l’instruction au contradictoire alors qu’on s’en est visiblement allègrement servi pour nourrir la notification des griefs, utiliser des pièces qui n’ont pas été utilement soumises au contradictoire – sans qu’il n’en soit jamais tenu compte. Pour les services d’instruction, il y a toujours une session de rattrapage permettant de purger la procédure de ses vices… Dans ces conditions, à quoi bon chercher à améliorer le travail d’instruction, le collège sera toujours là pour rectifier le tir ou pour vous donner une seconde chance. Le seul souci, c’est que de seconde chance les entreprises de leur côté n’en ont pas. Lorsque les entreprises omettent de notifier une concentration, lorsqu’elles omettent de fournir une pièce, elles sont sanctionnées (…) sans qu’il y ait pour elle de session de rattrapage. Deux poids, deux mesures, là où l’exemplarité devrait être de mise »10.
VIII – Recevabilité des tiers à demander au juge d’engager la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs d’un cartel
On se souvient que par une décision n° 10-D-39 du 22 décembre 2010, l’Autorité de la concurrence a condamné diverses entreprises pour s’être entendues entre 1997 et 2006 sur la répartition et le prix de marchés de signalisation routière verticale.
Le Conseil d’État met un terme à cette affaire en rejetant le pourvoi de la société Lacroix Signalisation, condamnée au fond à indemniser les collectivités lésées. Ce faisant, il admet la recevabilité des demandes d’indemnisation des co-contractants, mais aussi des tiers. Il observe en effet que « lorsqu’une personne publique est victime, à l’occasion de la passation d’un marché public, de pratiques anticoncurrentielles, il lui est loisible de mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle non seulement de l’entreprise avec laquelle elle a contracté, mais aussi des entreprises dont l’implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché, et de demander au juge administratif leur condamnation solidaire »11.
Dans la même affaire, la haute juridiction administrative valide l’analyse de la cour administrative d’appel qui, pour évaluer l’ampleur du préjudice au titre du surcoût lié aux pratiques anticoncurrentielles, s’est fondé sur la comparaison entre les marchés passés pendant l’entente et une estimation des prix qui auraient dû être pratiqués sans cette entente, en prenant notamment en compte la chute des prix postérieure à son démantèlement ainsi que les facteurs exogènes susceptibles d’avoir eu une incidence sur celle-ci12.
Toujours dans la même affaire, le Conseil d’État énonce que « si une personne publique est, en principe, irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre, la faculté d’émettre un titre exécutoire dont elle dispose ne fait pas obstacle, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, à ce qu’elle saisisse le juge d’administratif d’une demande tendant à son recouvrement. L’action tendant à l’engagement de la responsabilité quasi délictuelle d’une société en raison d’agissements dolosifs susceptibles d’avoir conduit une personne publique à contracter avec elle à des conditions de prix désavantageuses, qui tend à la réparation d’un préjudice né du contrat lui-même et résultant de la différence éventuelle entre les termes du marché effectivement conclu et ceux auxquels il aurait dû l’être dans des conditions normales de concurrence, doit être regardée, pour l’application de ces principes, comme trouvant son origine dans le contrat »13.
Notes de bas de pages
-
1.
Cass. 1re civ., 5 févr. 2020, n° 18-18854.
-
2.
Cass. com., 4 mars 2020, n° 17-17148.
-
3.
Cass. crim., 4 mars 2020, n° 18-84071.
-
4.
CA Paris, 4 avr. 2019, n° 19/03274.
-
5.
CE, 4 mars 2019, n° 429279.
-
6.
CE, 18 mars 2020, n° 396651.
-
7.
CE, 18 mars 2020, n° 420244.
-
8.
C. com., art. R. 463-7 : « Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, l'Autorité de la concurrence peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction ».
-
9.
Cass. com., 18 mars 2020, n° 18-11998.
-
10.
Ronzano A., L’actu-concurrence 2020, n° 21.
-
11.
CE, 27 mars 2020, n° 421758.
-
12.
CE, 27 mars 2020, n° 420491.
-
13.
CE, 27 mars 2020, n° 421758 ; CE, 27 mars 2020, n° 420491.