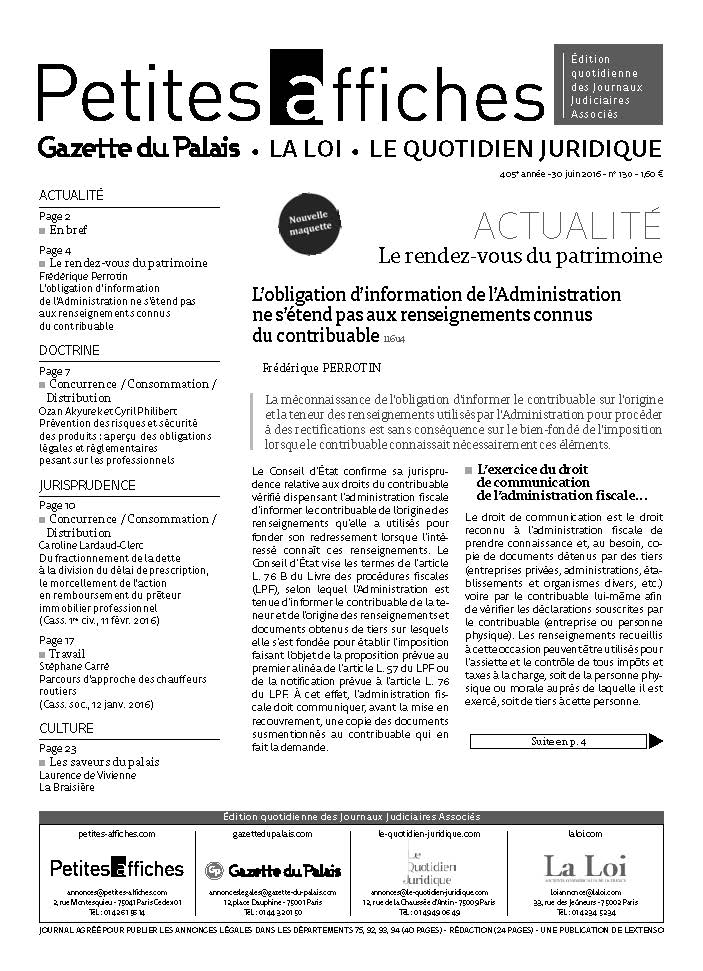Du fractionnement de la dette à la division du délai de prescription, le morcellement de l’action en remboursement du prêteur immobilier professionnel
Par une série de quatre arrêts rendus le 11 février 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation pose les règles applicables à la prescription fondée sur l’action en paiement de la banque à l’encontre du débiteur consommateur défaillant. Elle décide que la prescription de l’action en paiement des mensualités impayées se divise en fractions correspondant au fractionnement de la dette. Elle juge en outre que la prescription de l’action en paiement du capital restant dû commence à courir à la déchéance du terme demandée par le créancier.
Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, no 14-22938, PB
1. En prévoyant une prescription biennale pour toutes les actions engagées par les professionnels relativement aux biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, l’article L. 137-2 du Code de la consommation1 traduit parfaitement la rapidité avec laquelle doivent être traitées les difficultés de paiement du consommateur. La brièveté du délai lui permet d’éviter l’accumulation de majorations dues au retard de paiement en cas d’inaction de son créancier. Toutefois, l’absence de mention du point de départ de la prescription par le texte incite les créanciers professionnels soumis à cet article à défendre la recevabilité de leur action en tentant de repousser le début de la prescription.
C’est dans un tel contexte que le 11 février 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation rend quatre arrêts sur le thème commun de la prescription de l’action en remboursement contre le débiteur consommateur d’un prêt consenti par un établissement bancaire. À l’origine de l’intervention de la haute juridiction, se trouve une situation commune aux quatre affaires dans laquelle des emprunteurs ne remboursant pas leur prêt sont conséquemment actionnés par leurs banques créancières. Le caractère tardif de l’action des banques devient alors source de contentieux et conduit à l’intervention de la haute juridiction.
La soumission du litige à l’article L. 137-2 du Code de la consommation2 et la lecture des arrêts révèlent deux problématiques liées, regroupées par la première chambre civile. Elle répond ainsi par un principe unique et énonce à quatre reprises « qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ». Les quatre arrêts se complètent et deviennent indissociables ; ils permettent de prendre l’exacte mesure de la portée du principe énoncé.
Les deux premières décisions permettent à la Cour de cassation de faire application du fractionnement de la prescription de l’action en paiement des échéances passées non exécutées, puisque dans le premier arrêt3, elle rejette le pourvoi formé contre une décision de la cour d’appel de Chambéry, considérant que la prescription ne court pas à partir du premier incident de paiement, alors que la deuxième décision censure la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour avoir décidé le contraire4. Les deux arrêts suivants5 ont trait au paiement des futures échéances et imposent aux juges du fond de prendre en compte la date de la déchéance du terme pour apprécier la prescription de l’action en paiement du capital restant dû.
La pluralité d’arrêts rendus sur le même thème, le même jour, tous publiés et destinés à figurer dans le rapport annuel de la Cour de cassation, répétant une solution identique marque la volonté de la Cour de cassation de poser un principe généralement applicable. Elle le souligne davantage encore quand elle confère à l’article L. 137-2 du Code de la consommation, visa des arrêts commentés, une portée générale en repoussant l’argumentation fondée sur l’inapplicabilité de la prescription biennale au prêt de trésorerie6. La haute juridiction élargit donc encore le champ d’application de l’article visé, ce qui permet d’apprécier sans restriction les deux assertions opposées selon lesquelles la prescription applicable aux échéances impayées se divise en fonction du fractionnement de la dette (I), alors que celle applicable au capital restant dû est unitaire et dépend de la déchéance du terme demandée par le créancier (II).
I – Division de la prescription applicable aux échéances impayées
En décidant que l’inexécution du remboursement de chaque échéance est le point de départ du délai de prescription (A), la Cour de cassation divise certes la prescription, mais elle fractionne surtout la dette elle-même (B).
A – L’inexécution comme point de départ de la prescription des échéances impayées
2. Saisie de deux interprétations divergentes des juges du fond, la Cour de cassation devait trancher le point de savoir à quel moment commence à courir le délai de prescription de l’action en paiement à termes successifs.
Se ralliant à la position que la Cour de cassation avait tenue jusque-là, les juges aixois ont considéré que le point de départ de la prescription est fixé au jour de la première inexécution. Une telle idée a de quoi séduire. Il est vrai qu’une action en paiement peut être engagée dès la première inexécution, puisqu’il faut admettre que la prescription commence quand « le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée »7. La position de la cour d’appel d’Aix-en-Provence est justifiée par la chronologie dans laquelle s’inscrit l’action en justice et par l’unité de cette dernière. A contrario, si elle avait admis que le premier incident de paiement datant de plus de deux ans puisse bénéficier de la prescription de la dernière échéance non payée datant, elle, de moins de deux ans, elle aurait violé la lettre de l’article L. 137-2 du Code de la consommation et ainsi allongé artificiellement la durée de la prescription pour les échéances normalement prescrites.
3. Cependant, il s’avère que la décision d’appliquer la prescription à toutes les échéances de la dette, y compris à celles échues depuis moins de deux ans, est d’une particulière sévérité envers la banque. Si la lettre de l’article L. 137-2 impose d’éviter toute extension malheureuse de la prescription, elle n’impose néanmoins pas de la réduire indûment. La décision de la cour d’appel de Chambéry paraît donc plus mesurée et elle emporte la conviction de la Cour de cassation de revirer sa propre position, en considérant que l’action en paiement se prescrit à compter de la date de chaque échéance successive.
Ainsi, selon le raisonnement adopté par la première chambre civile, il faut fractionner le point de départ du délai et suivre la division de la dette pour déterminer quand commence la prescription. En définitive, l’inexécution fait naître l’action en paiement, ce qui implique que la prescription commence à courir quand l’échéance n’est pas respectée par le débiteur. Observons qu’une telle opération revient à appliquer distributivement le délai de prescription, ce qui permet d’éviter toute position radicale visant à déduire de la date d’une échéance donnée le sort d’une autre. Par ce procédé, la Cour de cassation rend parfaitement compte de la complexité de l’inexécution du contrat à exécution successive, appliquant à chaque échéance impayée son propre délai de deux ans pour agir en paiement. Elle offre une solution pragmatique permettant d’équilibrer les enjeux du débat, préservant à la fois l’intégrité de la prescription biennale8 et les intérêts antagonistes en présence9.
4. Une telle analyse du délai de prescription n’est pas nouvelle. Elle reprend une solution posée par la même chambre dans un arrêt inédit du 28 juin 2012 rendu au visa de l’article 2233 du Code civil10. En partant de la lettre de l’article selon laquelle la prescription ne court pas « à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé », la Cour de cassation en avait déduit la division du délai de prescription par l’identification de termes distincts applicables aux fractions de la dette. Toutefois, par une décision du 10 juillet 2014, publiée au Bulletin, la première chambre civile avait fait partir le délai de prescription du premier incident de paiement11. La réitération de la solution de 2012, cette fois-ci dans quatre arrêts publiés, traduit l’affirmation d’un nouveau positionnement assumé vis-à-vis de la prescription, mais également un renouvellement de sa position théorique sur la date de naissance de la dette.
B – La division de la dette par le droit de la prescription
5. La position défendue par la Cour de cassation dans ces arrêts remet en cause les conceptions traditionnellement applicables à la dette, à la prestation et à l’obligation. Selon une définition classique12, l’obligation est un lien de droit unissant le débiteur au créancier13 ; elle a une acception positive traduisant la créance et une face négative incarnée par la dette14. La dualité de façade marque en réalité l’unité de la relation entretenue entre les parties15 et il en résulte que la pluralité d’obligations désigne l’ensemble plus large appelé contrat. L’obligation est unitaire et appelle un traitement unitaire, expliquant certainement la décision censurée de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et plus généralement, l’ancienne position de la Cour de cassation.
Cependant, l’unité peine à convaincre en matière de contrat à exécution successive, car « dès qu’elles sont un peu élaborées, les situations juridiques ne naissent pas directement en leur état définitif »16. Le droit fondé sur le schéma simplifié du contrat instantané s’accommode effectivement mal de l’exécution qui s’installe dans le temps17. Ce dernier est facteur de perturbation, puisqu’il impose des aménagements du droit applicable à l’inexécution. Une telle dérogation est appliquée, par exemple, à l’occasion de la résolution qui, refusant la rétroactivité au contrat à exécution successive18, anéantit la convention pour l’avenir, en ne remettant pas en question ses effets passés19. À l’instar du délai de prescription des espèces étudiées, la résolution du contrat à exécution successive montre un fractionnement du droit applicable à l’obligation et donc, un fractionnement du lien de droit lui-même20.
6. Cette divergence dans l’application du droit ne traduit pas une incohérence du système juridique mais un double degré de lecture de l’obligation : une conception juridique unitaire21 d’une part, et une conception matérielle plurielle, d’autre part. C’est à cette seconde compréhension que les arrêts commentés se rattachent, puisque la Cour de cassation énonce que « la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ». Si l’emploi du terme « fractions » est contestable du fait de son absence de définition juridique22, le rapprochement que l’on peut en faire de la « prestation » marque la soumission du litige à une vision matérielle de l’obligation23.
En évoquant la division de la dette, la haute juridiction remet quelque peu en cause le principe qu’elle a affirmé avec constance et qui a été défendu en doctrine24, selon lequel « les obligations contractuelles prennent naissance, sauf convention contraire, au jour de la conclusion et non au jour de leur exécution »25. Or en divisant la dette pour lui appliquer des points de départ de prescription distincts, la première chambre civile admet qu’en matière d’exécution successive, certaines parties de la dette peuvent naître à d’autres moments que celui de la conclusion du contrat. Il n’y a alors plus d’obstacle à admettre que, à l’image de ce qu’elle accepte en procédures collectives26, la dette entière puisse naître à l’exécution du contrat, autorisant ainsi une « dissociation temporelle de l’obligation et de la créance »27. La Cour de cassation délaisserait donc une interprétation volontariste de la date de naissance de la créance, pour adopter une vision matérialiste de la problématique28, ce qui lui permet, in fine, d’assujettir la prescription de l’action en paiement du capital restant dû à un autre point de départ, unique cette fois-ci.
II – Unité de la prescription applicable au capital restant dû
Un raisonnement inverse à celui applicable aux échéances impayées est mis en œuvre pour le capital restant dû. Le délai de prescription redevient unitaire et a pour point de départ la déchéance du terme (A), dépendant exclusivement de la volonté du créancier professionnel (B).
A – La déchéance du terme comme point de départ de la prescription du capital restant dû
7. Les quatre arrêts étudiés ne sont que l’aboutissement d’une construction saccadée de la Cour de cassation à l’égard du délai de prescription applicable au crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur. Nous l’avons relevé, par un arrêt du 28 novembre 201229, la Cour de cassation a soumis pour la première fois ce contentieux aux dispositions de l’article L. 137-2 du Code de la consommation. Cette qualification se répercute directement sur les considérations mises en œuvre par la Cour dans nos arrêts. En soumettant le crédit immobilier à la prescription du droit de la consommation, la première chambre civile a certes remplacé le délai quinquennal par un délai biennal, mais elle a surtout changé le point de départ de la prescription. Il faut observer, en effet, qu’en dehors de l’hypothèse de la prescription de l’article L. 137-2, « la date d’exigibilité de la créance faisant courir le délai de la prescription quinquennal se situe à la date de la déchéance du terme »30. Le bât blesse donc doublement pour les professionnels du crédit immobilier, puisque la conjugaison de la décision du 28 novembre 2012 et de celle du 10 juillet 2014 a pour effet de raccourcir le délai de prescription d’une part, et de placer son point de départ à une date antérieure à celle précédemment retenue d’autre part31.
La solution des quatre arrêts étudiés marque un apaisement et une appréhension plus mesurée de ce contentieux. Par la réminiscence de la référence à la déchéance du terme comme point de départ de la prescription pour le capital restant dû, la Cour de cassation offre une solution qui a plus de relief et correspond davantage à la subtilité de la situation des parties.
8. Dans la quatrième espèce étudiée32, la haute juridiction affirme que la déchéance du terme est le point de départ de la prescription de l’action en paiement du capital restant dû. La solution doit être saluée, car elle est imposée par la conception de la créance qu’elle applique, montrant la cohérence de sa solution.
Le revirement de la Cour de cassation sur la déchéance du terme comme point de départ de la prescription peut surprendre ; il est toutefois inévitable. Alors que l’inexécution marque le point de départ de l’action visant les échéances passées, il ne peut en être ainsi pour le capital restant dû qui n’est pas inexécuté, puisqu’il n’était pas dû avant la déchéance du terme. En décidant de diviser l’application de la prescription, la première chambre civile n’avait d’autre choix que de prendre la déchéance du terme comme point de départ33.
9. En outre, il faut revenir à la nature même du contrat pour comprendre la distinction imposée par la première chambre civile et admettre que là encore, le choix de la haute juridiction a été dicté par des impératifs dépassant le cadre des considérations du droit de la consommation.
Le contrat à exécution successive met en place une succession d’échéances juridiquement qualifiées de termes, c’est-à-dire d’événements futurs certains. Or en tant que sanction du débiteur défaillant, la déchéance du terme a pour effet de faire perdre le bénéfice du caractère successif à l’exigibilité de la prestation34. Il en résulte que le débiteur se voit contraint de rembourser le capital restant dû en une fois. Naît alors une rupture matérielle entre les fractions de la dette passées qui ont connu des dates d’exigibilité suivant leurs échéances respectives, et les fractions futures, qui se trouvent soumises à une date unique.
En ôtant au capital restant dû ses termes successifs, la déchéance du terme unifie donc l’action en paiement ; il en résulte nécessairement l’unité du point de départ du délai de prescription.
N’en déplaise à ceux dénonçant un point de départ laissé à la libre disposition du créancier professionnel, la brièveté du délai de prescription oblige le créancier à agir rapidement ; il ne peut donc pas attendre le terme du contrat, ce qui impose au juge de constater la dualité du point de départ de la prescription du paiement des échéances du prêt selon qu’elles sont échues ou à échoir.
B – La demande de déchéance du terme par le créancier
10. Dans la troisième espèce soumise à la Cour de cassation le 11 février 201635, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait considéré que la déchéance du terme ne pouvait pas constituer le point de départ de la prescription dans la mesure où elle dépendait exclusivement de la libre appréciation du créancier professionnel. Critique classique adressée à la prise en compte de la déchéance du terme dans le contentieux étudié, sa décision faisait alors implicitement référence à la fonction répressive de la prescription visant à sanctionner l’introduction tardive de l’action par le créancier non diligent36. Il est vrai que, dans une telle conception, admettre un point de départ laissé à la libre disposition du créancier rend inopérante toute sanction à son égard.
Mais le changement de perception du délai de prescription par la Cour de cassation influence l’acception de la prescription elle-même. Comme le relève Dominique Legeais, de la sanction du créancier, la prescription devient une présomption de paiement quand elle a pour objet de limiter le passif du débiteur consommateur, en évitant de l’acculer à payer des majorations dues à son inexécution37. Tel est le cas pour les échéances passées. Or une telle considération disparaît quand il s’agit du capital restant dû, puisque cette majoration n’a pas eu lieu.
11. Cependant, ces deux fonctions de la prescription s’appliquent mal aux paiements à échoir, du fait de la cause de l’action en paiement des échéances futures. Ces dernières ne deviennent exigibles qu’en considération d’une sanction prononcée à l’encontre du débiteur – la déchéance du terme –, et il est donc naturel que l’emprunteur ne puisse bénéficier ni de l’une ni de l’autre des fonctions traditionnelles de la prescription de droit de la consommation38.
Il faut cependant admettre que la solution offerte par la première chambre civile rend, en pratique, quasiment imprescriptible toute action en paiement portant sur le capital restant dû. Puisque la déchéance du terme doit être demandée par le créancier, elle relève toujours de son action ; or relève également de son fait l’assignation en paiement qui interrompt la prescription39. La combinaison de ces deux prérogatives a pour conséquence la soumission totale de la prescription de l’action en paiement du capital restant dû à la volonté du créancier professionnel.
12. En définitive, la Cour de cassation nous offre une solution cohérente, reposant incontestablement sur une vision élaborée de la dette. On peut toutefois s’interroger sur la compatibilité de sa décision avec la théorie de l’action et l’exigence de concentration des moyens40. Le droit procédural impose qu’un litige opposant les mêmes parties sur un même objet et une même cause soit soumis à une action unique. À première vue, le paiement devrait être soumis à ce principe. Néanmoins, en décidant que des délais de prescription distincts sont applicables à chacune des échéances de la dette, il faut sans doute admettre qu’en se divisant, la dette crée des actions en paiement autonomes41. Si la solution transcrit donc parfaitement la complexité liée à l’inexécution d’un contrat à termes successifs, elle complexifie peut-être à outrance la théorie de l’action.
Notes de bas de pages
-
1.
C. consom., art. L. 137-2 : « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
-
2.
Rappelons que la soumission du contrat de prêt immobilier à la prescription biennale de l’article L. 137-2 est récente. Elle résulte d’une décision qualifiant le prêt de prestation de service : Cass. 1re civ., 28 nov. 2012, n° 11-26508 : D. 2012, p. 2885, obs. Avena-Robardet V. ; D. 2013, Pan., p. 945, obs. Aubry H., Poillot E. et Sauphanor-Brouillaud N. ; D. 2013, p. 1574, obs. Leborgne A. ; D. 2013, p. 2420, obs. Martin D.-R. et Synvet H. ; AJDI 2013, p. 215, obs. Cohet-Cordet F. ; RTD com. 2013, p. ; 126, obs. Legeais D. ; JCP E 2013. 1135, note Dupré M. ; JCP G 2013, 122, note Monacon-Duchêne G. ; Contrats, conc. consom 2013, n° 45, obs. Raymond G. ; Dr. et procéd. 2013, p. 8, obs. Bazin E.
-
3.
Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 14-22938.
-
4.
Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 14-28383.
-
5.
Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, nos 14-27143 et 14-29539.
-
6.
Voir le pourvoi incident de la banque dans la première affaire (Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 14-22938).
-
7.
Il s’agit là de la justification que donnait la Cour de cassation pour décider que la prescription courait à compter du premier incident de paiement. V. par ex. Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, n° 13-15511 : D. 2014, p. 1541 ; D. 2014, Pan, p. 588, obs. Aubry H., Poillot E. et Sauphanor-Brouillaud N. ; RTD com. 2014, p. 675, obs. Legeais D. ; JCP E 2014, 948, note Lasserre Capdeville J. ; JCP E 2014, 1441, note Legeais D. ; LEDC sept. 2014, n° 8, p. 3, obs. Bernheim-Desvaux S.
-
8.
Si l’intégrité de la prescription n’est pas mise en cause, une autre appréciation peut être faite quant à l’intégrité de l’action en paiement elle-même (v. infra n° 12).
-
9.
Comme le relèvent H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud, le strict respect de la prescription biennale est capital en droit de la consommation en ce qu’il permet au consommateur de bénéficier sans attendre d’une procédure de surendettement et de ne pas voir s’accumuler la majoration d’intérêts. Elle permet en outre à ses autres créanciers de faire valoir leur droit de gage général alors même qu’ils ne sont pas toujours pourvus des mêmes sûretés que les banques (v. pan., préc.).
-
10.
Cass. 1re civ., 28 juin 2012, n° 11-17744.
-
11.
Cass. 1re civ., 10 juill. 2014, n° 13-15511, préc. La solution a en outre été réaffirmée par d’autres arrêts postérieurs – V. par ex. Cass. 1re civ., 26 nov. 2014, n° 13-27447 : Contrats, conc. consom 2015, comm. 45 – Cass. 1re civ., 16 avr. 2015, n° 13-24024 – Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n° 14-17870.
-
12.
Sur l’évolution historique de la notion d’obligation, v. la thèse de doctorat de M. G. Forest. L’auteur conteste le rattachement de la notion de droit positif au droit romain (Forest G., Essai sur la notion d’obligation en droit privé, 2012, Dalloz, § 6 et 7).
-
13.
Delebecque P. et Pansier F.-J., Droit des obligations – Contrats et quasi-contrats (6e éd., LexisNexis/Litec, 2013), § 1.
-
14.
Dans cette définition, « la créance et la dette ne sont pas l’effet du lien de droit mais une certaine représentation de ce dernier : entre obligation, créance et dette, ce n’est pas le phénomène juridique objet de l’analyse qui change mais l’angle sous lequel il est contemplé » (Thomassin N., « La date de naissance des créances contractuelles » : RTD com. 2007, P. 655, spéc. § 7). V. aussi, Fabre-Magnan M., Droit des obligations. tome 1 : Contrat et engagement unilatéral, 3e éd., PUF, 2012, p. 1 ; Audit P.-E., La « naissance » des créances, Nouvelle Bibliothèque des Thèses, Dalloz, 2015.
-
15.
L’obligation est un lien de droit plus large que la créance ou que la dette, puisqu’elle incarne la relation des parties elles-mêmes. Le recours à la notion d’obligation permet de dépasser l’assimilation que l’on retrouve souvent entre la créance et la dette.
-
16.
Endréo G., « Fait générateur des créances et échanges économiques », RTD com. 1984, p. 223 ; Contra : Aynès L., « Rapport de synthèse », in La date de naissance des créances. Actes du colloque du CEDAG, 25 mars 2004 ; « la naissance d’une créance, comme celle d’un être humain ou d’une planète, est un événement unique, qui s’inscrit instantanément dans le temps, et s’impose à tous », LPA 9 nov. 2004, p. 61, spéc., § 4.
-
17.
Saleilles R. le relevait, « il y a contrats et contrats ; et nous sommes loin dans la réalité de cette unité de type contractuel que suppose le droit » (cité par Chénedé F., « Raymond Saleilles, Le contrat d’adhésion (partie 2) », RDC 2012, p. 1017, spéc., § 1).
-
18.
Contra : Cass. 3e civ., 30 avr. 2003, n° 01-14890 : Bull. civ. III, n° 87 ; JCP G 2003, I, 170, 15, obs. Constantin A. ; JCP G 2004, II, 10031, note Jamin C. ; JCP E 2004, 30, note Keita M. ; Defrénois 30 sept. 2003, n° 18, p. 1175, obs. Savaux É ; RTD civ. 2003, p. 501, obs. Mestre J. et Fages B. ; RDC 2004, p. 365, obs. Seube J.-B. ; LPA 8 déc. 2003, p. 6, obs. Pignarre G. Sur le thème, voir aussi la partie du rapport annuel de la Cour de cassation sur « le rôle du temps dans la qualification de la situation juridique » (rapp. 2014). Une analyse similaire s’applique à l’annulation du contrat, à la disparition de la cause en cours d’exécution, ou encore à la résiliation du contrat à exécution successive quand elle est conceptuellement distincte de la résolution.
-
19.
V. par ex. Cass. 3e civ., 28 janv. 1975, n° 73-13420 : Bull. civ. III, n° 33.
-
20.
V. cependant Genicon T., La résolution du contrat pour inexécution, 2007, LGDJ, § 818 : l’auteur critique la distinction faite entre le contrat à exécution instantanée et le contrat à exécution successive, montrant que le fractionnement que l’on applique classiquement au contrat est peu opératoire.
-
21.
Pour une vision unitaire de l’obligation dans le contrat à exécution successive, v. par ex. Torck S., « La naissance des créances en droit civil », LPA 9 nov. 2004, p. 25, § 1. Contra : M. P. Ancel analyse le contrat à exécution successive comme une génération cyclique d’obligations (Ancel P., « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTD civ. 1999, p. 771). V. aussi, Forest G., préc., § 542 et s.
-
22.
La préférence pour la « fraction » s’explique par l’objet auquel elle s’applique, à savoir la dette elle-même.
-
23.
La notion est en effet davantage connue des juristes, puisque dans ses Institutes, Gaius définissait déjà l’obligation comme un lien de droit astreignant à une prestation (cité par Delebecque P., Pansier F.-J., Droit des obligations – Contrat et quasi-contrat, 6e éd., LexisNexis/Litec, 2013, § 1).
-
24.
V. par ex. Putman E., La formation des créances (Thèse Aix-Marseille, 1987).
-
25.
Cass. 1re civ., 16 juill. 1986, n° 84-12990 : Bull. civ. I, n° 212 ; RTD civ. 1987, p. 748, obs. Mestre J.
-
26.
En procédures collectives, la Cour de cassation admet qu’un contrat conclu avant le jugement d’ouverture de la procédure puisse faire l’objet d’une créance postérieure au jugement. Pour une analyse sur ce point, v. par ex. Baron F., « La date de naissance des créances contractuelles à l’épreuve du droit des procédures collective », RTD com. 2001, p. 1.
-
27.
Thomassin N., « La date de naissance des créances contractuelles », RTD com. 2007, p. 655, spéc. § 3.
-
28.
Deux thèses s’opposent en effet en doctrine : la thèse volontariste selon laquelle la créance naît en une fois, dès la formation du contrat, et la thèse matérialiste en vertu de laquelle la créance naît au fur et à mesure de l’exécution.
-
29.
Cass. 1re civ., 28 nov. 2012, n° 11-26508, préc.
-
30.
Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-16950.
-
31.
L’arrêt de la première chambre civile du 10 juillet 2014 (préc.) censurait la cour d’appel de Nancy qui avait considéré que la prescription de l’article L. 137-2 du Code de la consommation commençait à courir à la déchéance du terme.
-
32.
Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 14-29539.
-
33.
La Cour de cassation considère désormais constamment que « le point de départ du délai à l’expiration duquel une action ne peut plus s’exercer se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance ». V. par ex. Cass. 1re civ., 9 déc. 1986, n° 85-11263 : Bull. civ. I, n° 293 – Cass. ass. plén., 6 juin 2003, n° 01-12453 : Bull. civ. ass. plén., n° 6. Le débat se reporte alors sur la notion d’exigibilité pour déterminer le point de départ de la prescription et il faut admettre que l’action en paiement ne peut être mise en œuvre avant l’inexécution pour les fractions échues ou la déchéance du terme pour le capital restant dû, si bien que le point de départ de la prescription ne peut leur être antérieur. V. aussi, Klein J., Le point de départ de la prescription, 2013, Economica, § 242 et s.
-
34.
La déchéance du terme est prévue à l’article L. 311-24 du Code de la consommation. Elle peut être demandée par le créancier dès la défaillance du débiteur quant à son obligation de remboursement.
-
35.
Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n° 14-27143.
-
36.
Sur ce point, voir par analogie la note de D. Legeais sous l’arrêt Cass. 1re civ., 10 juill ; 2014, préc. : JCP E 2014, 1441.
-
37.
Tel était l’objet de l’arrêt du 10 juillet 2014, préc., D. Legeais le relève, il faut toutefois se méfier de l’effet pervers de la brièveté de la prescription. Si le créancier sait qu’il a peu de temps pour agir, il sera sans doute moins enclin à se montrer clément vis-à-vis du débiteur. Ainsi, « la solution devient aussi un piège pour l’emprunteur. C’est que la solution condamne tout laxisme du créancier », RTD com. 2014, p. 675.
-
38.
Sur l’incidence de la déchéance du terme sur le point de départ de la prescription de l’action en paiement, v. Klein J., préc., § 243.
-
39.
CA Amiens, 14 nov. 2013, n° 13/03516 : n° Juris-data 2013-030265, cité par Legeais D. ; RTD com. 2014, p. 675.
-
40.
L’action est perçue de manière unitaire et de cette unité est née l’obligation de concentrer les moyens : Cass. ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10672, arrêt Cesareo : Bull. ass. plén., n° 8 ; D. 2006, p. 2135, note Weiller L. ; RDI 2006, p. 500, obs. Malinvaud P. ; RTD civ. 2006, p. 825, obs. Perrot R. ; JCP E 2006, I, 183, obs. Amrani-Mekki S., Gaz. Pal. 6 janv. 2007, n° 5, p. 22, note Gain M.-O. ; Dr. et procéd. 2006, p. 348, note Fricero N. La sanction est une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité liée à l’autorité de la chose jugée.
-
41.
V. Cass. 1re civ., 12 mai 2016, nos 15-16743 et 15-18595 (publication au Bulletin à venir), arrêt dans lequel la Cour de cassation considère que l’obligation de concentrer les moyens n’impose pas de concentrer les demandes portant sur les mêmes faits.