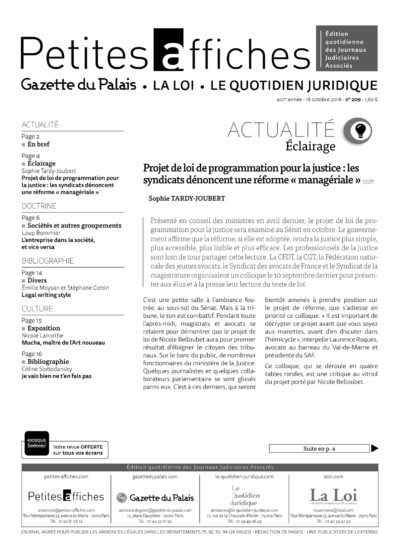L’entreprise dans la société, et vice versa
Pour réformer le capitalisme par le droit des sociétés, le gouvernement propose de modifier les articles 1833 et 1835 du Code civil, qui sont deux pierres d’angle de l’approche française de la technique sociétaire. Par suite, il serait vain de minimiser l’incidence juridique de la réécriture, même marginale, de ces articles, quand bien même il est encore difficile de mesurer précisément la portée d’une telle réforme…
Le projet de loi PACTE1, présenté en conseil des ministres le 18 juillet 2018, et désormais examiné par le Parlement, confirme sans surprise la volonté du gouvernement de modifier en profondeur le droit des sociétés, dans le prolongement du rapport Notat-Sénard publié le 9 mars 2018 et intitulé « L’entreprise, objet d’intérêt collectif ». En modifiant la rédaction de deux articles importants du Code civil qui avaient jusqu’alors survécu aux épreuves du temps, le gouvernement propose, selon l’exposé des motifs du projet de loi, de « repenser la place de l’entreprise dans la société », quoique d’un point de vue technique, il s’agisse plutôt de repenser la place de la société dans l’entreprise. De fait, l’article 61 du projet de loi a pour objet de consacrer la notion d’intérêt social à l’article 1833 du Code civil, en y associant une nécessaire prise en considération des « enjeux sociaux et environnementaux » qui entourent l’activité d’une entreprise. Entre autres dispositions, le projet de loi prévoit aussi la possibilité, à l’article 1835 du Code civil, de préciser de manière statutaire la « raison d’être de la société », notion qui paraît encore « évanescente »2 en tant qu’il s’agit, selon les auteurs du rapport précité, d’un « futur désirable pour le collectif ».
Il convient dès lors de s’interroger sur les impacts induits par la proposition de modification des articles 1833 et 1835 du Code civil. Et, si le gouvernement présente son projet de loi comme ambitieux, l’étude d’impacts jointe au projet qualifie néanmoins de « limitée » l’incidence juridique de l’article 61, en prenant soin de rappeler que cette évolution s’inscrit dans le prolongement de notions que les juristes ont déjà fait œuvre de clarifier. Alors que le projet de loi PACTE entend introduire dans le droit des sociétés une dose de « collectif » dans ce qui était jusqu’alors clairement l’apanage d’un droit vraiment privé, y a-t-il lieu de s’attendre à une évolution ou à une révolution en la matière ? La question est bien entendu ouverte, car la portée de cette collectivisation du droit des sociétés sera précisée à l’usage, les enjeux de l’article 61 du projet de loi PACTE étant en tout état de cause différents selon qu’il s’agit de redéfinir la notion d’intérêt social (I) ou de compléter l’objet social d’une société par une « raison d’être » (II).
I – L’intérêt social, d’une notion flexible à une notion floue
Au titre de l’article 61, le gouvernement entend d’abord légaliser la notion d’intérêt social, étant précisé que cette dernière supposera désormais de prendre « en considération des enjeux sociaux et environnementaux ». Compte tenu de la réception on ne peut plus circonspecte de cette ambition législative, le projet de loi s’avère ne pas être économe en justifications, soulevant toutefois plus de nouvelles interrogations qu’il ne rassérène, tant quant à la notion même d’intérêt social (A) que concernant les considérations collectives qui y sont attachées (B).
A – De la consécration de la notion d’intérêt social
L’article 61 du projet de loi entend d’abord légaliser la notion d’intérêt social dégagée par la jurisprudence. À titre liminaire, il convient de rappeler brièvement que la notion d’intérêt social a été accueillie par le juge dans un certain nombre de circonstances, s’imposant sans que sa légalisation n’ait été présentée comme un enjeu d’importance pour les praticiens3. S’il est difficile d’en dessiner les contours exhaustifs, on peut toutefois distinguer plusieurs acceptions à travers la mise en œuvre de cette notion4. Certaines solutions s’inscrivent dans une approche statutaire de l’intérêt social, en tant qu’il permet de contrôler des décisions d’instances5. Dans cette approche, tendraient alors à se rejoindre deux types d’analyses, pourtant opposés, du contrat de la société, en faisant droit à la fois aux analyses de l’école classique du contrat de société en tant que contrat conclu dans l’intérêt des associés, ainsi qu’aux analyses dites de l’école de Rennes, selon lesquelles la société ne saurait se réduire à un groupement d’associés. En effet, chacune de ces écoles fait montre d’un certain attachement aux prérogatives statutaires, à la seule assemblée générale pour les premières, mais aussi aux autres instances pour les secondes (conseils d’administration6, comité économique et social pour la consultation des salariés7, ou tout autre organe statutaire de l’entreprise8). Une autre approche tendrait plutôt à faire de l’intérêt social une orientation de gestion supplétive, qui s’imposerait au gérant ou au dirigeant en l’absence de directives précises données par les organes statutaires9.
Afin de ne pas perdre la flexibilité actuellement offerte par le caractère prétorien de la notion d’intérêt social, le projet de loi PACTE prévoit de la légaliser sans la définir. Cependant, si ce choix de principe doit être neutre, l’exposé des motifs délivre certains éléments orientant le sens de la démarche, et qui ne sauraient laisser indifférent. En effet, l’exposé des motifs précise d’abord qu’il s’agit d’une obligation de moyens, comme une étape désormais impérative dans le processus de décision. À ce titre, le dispositif vise plus spécifiquement les décisions de gestion. Comme le fait remarquer en ce sens le professeur Alain Couret, il s’agit de « mettre les dirigeants d’entreprise à l’abri de la part d’actionnaires mécontents au titre d’actes ne privilégiant pas leur propre intérêt »10. Il faut donc comprendre la légalisation de la notion d’intérêt social comme venant à la fois encadrer et protéger l’action du dirigeant dans l’exercice de ses fonctions.
Quoiqu’elle soit souvent rapprochée de la théorie fiscale de l’acte anormal de gestion, la notion d’intérêt social n’a jusqu’alors que peu servi à remettre en cause des décisions de gestion stricto censu11. La notion d’intérêt social s’applique davantage dans les litiges entre les parties au contrat de société, qu’il s’agisse des associés ou actionnaires, ou des autres parties prenantes dans le cadre du fonctionnement des instances12. Aussi, dès lors que la notion d’intérêt social se rapporterait désormais aux décisions de gestion (ce qui permettrait de renforcer l’analogie avec la théorie fiscale de l’acte anormal de gestion, qui ne s’applique pas aux décisions d’instance), faut-il s’attendre à ce que sa mise en œuvre soit plus contraignante pour ce qui concerne ces dernières ? Dans une telle perspective, les arbitrages relatifs à la gestion des réserves, qui font souvent l’objet de luttes de pouvoir entre les parties prenantes, tels que la gestion des actifs patrimoniaux ou les modalités d’activation de la trésorerie13, doivent-ils être considérés comme des décisions de gestion dès lors qu’ils ne sont pas afférents à l’activité de l’entreprise, car ne concourant pas directement à la réalisation du projet d’entreprise ? Pour rappel, en droit fiscal, la théorie de l’acte anormal de gestion exige que l’administration fiscale caractérise l’octroi d’un avantage à un tiers (et non pas seulement à un associé ou à des parties prenantes) et l’absence de contrepartie14. À suivre de près l’exposé des motifs du projet de loi, c’est donc un véritable repositionnement de la notion d’intérêt social qui serait alors suggéré.
La volonté du gouvernement de dissocier plus clairement l’intérêt de la société de celui de ses associés, en donnant davantage d’autonomie au dirigeant, a pour conséquence logique de ne faire porter sur les épaules de ce dernier, en sus d’une obligation de loyauté15, qu’une obligation de moyens. Ce faisant, consacrer la notion d’intérêt social en tant qu’obligation de moyens ne semble pas participer d’une consécration pure et simple de la notion dégagée par la jurisprudence. Typiquement, la notion d’intérêt social telle qu’elle est utilisée pour sanctionner ou non des cas d’abus de majorité16 ou de minorité17, ne s’analyse-t-elle pas plutôt comme une obligation de résultat ? En effet, dans une telle perspective, il s’agit bien de sanctionner une décision non conforme à l’intérêt social qui n’est autre qu’une obligation de ne pas faire18, quels que soient les motifs réels ou supposés de la décision. La consécration de la notion d’intérêt social en tant qu’obligation de moyens constitue-t-elle alors la prémisse d’une remise en cause des acquis jurisprudentiels s’inscrivant dans le cadre d’une approche de l’intérêt social comme obligation de résultat ?
Visant à protéger le dirigeant qui fait le choix d’une gestion soutenable de l’entreprise, c’est-à-dire privilégiant l’intérêt collectif à celui des seuls associés, la légalisation de la notion d’intérêt social met donc à charge dudit dirigeant une obligation de moyens. Au-delà du repositionnement de la notion, cette nouvelle obligation implique aussi de faire un point quant aux méthodes de gouvernance des sociétés. De fait, les processus de prise de décisions ne sont pas documentés de la même manière selon qu’ils ont trait à une décision de gestion ou à une décision d’instance. La décision de gestion est une décision à prendre en temps réel, sans que ne puisse être réellement exigée une quelconque documentation spécifique. Comment donc faire face à une telle obligation de moyens si ce n’est en documentant les principales décisions de gestion par des rapports d’expertise indépendante ? Par contraste, les décisions des organes font l’objet d’une documentation ad hoc, laquelle est généralement versée aux dossiers envoyés aux administrateurs ou qu’il leur est permis de demander dans le cadre de leur droit d’information19. Il appartiendra donc aux instances de préciser le niveau d’information et les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour documenter les décisions de gestion afin de sécuriser le gérant ou le directeur de société.
B – À la reconnaissance d’un intérêt collectif
Outre la légalisation de la notion, la principale difficulté résultant de l’article 61 du projet de loi PACTE tient surtout au fait que l’intérêt social devra désormais prendre « en considération des enjeux sociaux et environnementaux ». Une telle acception de l’intérêt social n’ayant jamais été dégagée en jurisprudence, il s’agit donc d’un élargissement de la notion plus que d’une légalisation à droit constant.
Alors que le risque d’une loi bavarde guette tout projet législatif, lorsque se mêlent les déclarations d’intention aux dispositifs, le gouvernement est souvent prompt à encadrer les prétentions des amendements parlementaires rédigés à grand recours de « notamment ». Or l’utilisation de l’article indéfini pluriel « des » dans le dispositif de l’article 61 est sans doute plus modeste, mais il est de la même veine. En effet, selon le gouvernement, le champ « des enjeux sociaux et environnementaux » doit être entendu comme « le plus large possible ». Il s’agit bien de faire de l’entreprise un levier du nouveau monde, laquelle doit être gouvernée non pas dans le seul intérêt de ses associés ou actionnaires, ni même dans l’intérêt des parties prenantes liées à l’entreprise en tant que groupe de contrats, mais dans l’intérêt de certaines « causes » d’intérêt général qui, si nobles soient-elles, n’en sont pas moins considérées in abstracto. Y a-t-il lieu de considérer qu’il s’agit ni plus ni moins d’une collectivisation de la notion de l’intérêt social ? La lecture littérale du dispositif laisse de fait penser que le dirigeant pourrait être tenu responsable de ne pas avoir visé tel ou tel risque dans sa décision… Encore faut-il distinguer les risques sociaux et environnementaux qui sont susceptibles de faire l’objet d’une anticipation raisonnable à la date de la décision, quoique sur ce point, les cabinets de conseil et associations militantes ne seront sans doute pas avares en imagination.
L’obligation de se conformer à l’intérêt social « en considération des enjeux sociaux et environnementaux » ne vient pas, de surcroît, se substituer aux obligations couramment en vigueur, mais instaure une nouvelle obligation à caractère général. En effet, les obligations relatives à la responsabilité sociale des entreprises ont jusqu’alors été définies de manière relativement précise, depuis la création de l’obligation de publier un rapport annuel de gestion concernant 19 rubriques sociales et environnementales20 jusqu’à sa transformation en obligation de publier une déclaration de performance extra-financière21, de même en va-t-il pour l’obligation faite à toute société employant plus de 500 personnes de publier un bilan carbone annuel issue de l’ordonnance 2015-1737 du 24 décembre 201522. Les précisions qui ont entouré la définition de ces obligations ont astreint les sociétés à un minimum de formalisme dont la portée apparaît désormais insuffisante puisque le gouvernement entend les compléter. Ainsi, les obligations RSE qui résultent du projet de loi PACTE sont non seulement plus générales, mais aussi plus prospectives, à l’inverse des obligations actuellement en vigueur. Pourrait-on alors imaginer la responsabilité des dirigeants d’EDF ou de Total mise en cause pour avoir décidé de maintenir leurs investissements dans des infrastructures pétrolières ou nucléaires alors que, selon la doxa, la cause de telles technologies serait entendue ?
Élargir la notion d’intérêt social sans en préciser la définition participe en sus d’un mouvement contradictoire de collectivisation de l’entreprise. Acter l’existence d’un intérêt social vise bien évidemment à renforcer l’autonomie de l’entreprise par rapport à ses parties prenantes, en particulier ses actionnaires. On comprend en effet aisément que l’intérêt de l’actionnaire se distingue de l’intérêt propre de l’entreprise au fur et à mesure que les associés fondateurs quittent la société. Pour rappel, la société n’existe que dès lors que ces derniers ont partagé au moment de la mise en société un projet « d’entreprise commune »23, projet que l’acquisition de participations dans la société ultérieurement à l’acte de création de la société ne requière pas24. Au cours de la vie de la société, les intérêts des actionnaires et ceux des dirigeants sont d’autant moins convergents que les titres de sociétés deviennent liquides et que le taux de rotation de l’actionnariat s’accroît25, au point que l’intérêt des actionnaires dans un éventuel boni devient purement théorique, la valorisation des titres d’une société reposant essentiellement sur la capacité de cette dernière à verser un certain niveau de dividendes sur un horizon de temps déterminé, et a fortiori inférieur à la durée de vie de la société fixée dans les statuts. Il faut donc comprendre la reconnaissance et l’élargissement de la notion d’intérêt social comme relevant d’une volonté de renforcer l’autonomie de l’entreprise, ou plutôt celle des sociétés par rapport à leurs parties prenantes, de sorte à les préserver de l’instrumentalisation de ces dernières. L’élargissement de la notion d’intérêt social aux considérations sociales et environnementales oblige à retenir des intérêts qui excèdent les intérêts individuels de chacune de parties prenantes dans le sens d’une collectivisation de la société. Toutefois, on ne saurait occulter le fait que ce mouvement visant à renforcer l’autonomie des sociétés vient par ailleurs percuter une autre tendance de la RSE qui viserait à mieux appréhender l’activité des groupes à travers la reconnaissance d’une responsabilité solidaire des sociétés-mères à l’endroit de leurs filiales26, en ligne avec le principe directeur n° 26 des Nations unies relatif aux entreprises et aux droits de l’Homme27. La reconnaissance de l’intérêt social participe en ce sens davantage à un mouvement de collectivisation de la société qu’à un mouvement de collectivisation de l’entreprise.
À renforcer l’autonomisation de la société dans l’entreprise, le projet de loi ne risque-t-il pas d’avoir une incidence juridique on ne peut moins « limitée » ? L’élargissement de la notion d’intérêt social au-delà des préoccupations communes des parties prenantes renouvelle davantage la société que l’entreprise, dès lors qu’elle permet d’évaluer une décision de gestion sur la base d’intérêts extérieurs à ceux de ses parties prenantes28. Certes un tel risque apparaît de prime abord limité dans la mesure où la formulation proposée fait ressortir une hiérarchisation entre une obligation de résultat (les décisions de gestion doivent être conformes à l’intérêt social) et une obligation de moyens (l’intérêt social devant être défini en considération des enjeux sociaux et environnementaux). L’absence de prise en considération de tout ou partie des enjeux sociaux ou environnementaux demeure cependant susceptible de constituer une faute du dirigeant résultant de la violation des dispositions législatives (peut-on alors redouter des analyses a posteriori des enjeux sociaux et environnementaux à prendre en compte ?). Dans le même sens, les décisions de gestion du dirigeant pourraient être davantage contestées en opportunité dans l’hypothèse d’une erreur manifeste d’appréciation des enjeux sociaux et environnementaux compte tenu des diligences désormais nécessaires (cas des fautes de gestion dites « par commission »)29. L’article 1833 du Code civil qui jusqu’alors se rapportait aux conditions de création de sociétés (objet licite, intérêt commun des associés), est donc en passe de devenir un article central pour ce qui concerne la régulation de leur gestion.
Enfin, les nouvelles obligations de RSE sont attachées à l’intérêt social, et plus particulièrement aux sociétés dotées d’une personnalité morale. Il s’agit d’un élargissement considérable du champ des obligations sociales et environnementales pesant sur les entreprises. De manière générale, seules étaient concernées par les obligations RSE les sociétés comptant plus de 500 salariés. Désormais toute société devra se livrer aux études d’impacts des risques sociaux et environnementaux entourant les décisions de gestion du dirigeant. Seules échappent au dispositif les entreprises individuelles qui, du fait de leur forme, sont par hypothèse dépourvues de tout intérêt social. Il est aussi à supposer que les sociétés de fait et les sociétés en participation soient aussi dispensées de ces obligations de moyens dès lors que, faute de personnalité morale, elles ne sont pas dotées d’un intérêt social propre30. La structuration des groupes, ou la coopération entre entreprises devra nécessairement prendre en compte ce nouveau cadre de responsabilité. Dans ce mouvement de collectivisation de la société, l’interposition d’une personnalité morale perd de son intérêt comme instrument d’organisation juridique de l’entreprise, tout simplement parce que la société ne peut plus être instrumentalisée par ses parties prenantes. Paradoxalement, les sociétés dépourvues de personnalité morale pourraient dès lors apparaître comme les vestiges d’une approche de la société comme instrument d’organisation juridique de l’entreprise.
II – Objet social et raison d’être de la société, une cause perdue
L’article 61 du projet de loi PACTE propose par ailleurs de modifier l’article 1835 du Code civil en vue de permettre aux associés de préciser par voie statutaire la « raison d’être » de leur projet d’entreprise. Cette approche relativement inédite interroge tant le contrat de société, tant dans son objet qui serait alors complété (A) que dans ce qui était sa cause au sens de l’ancien article 1131 du Code civil (B).
A – Objet, objet social et raison d’être
Donner aux associés la possibilité de redonner de la cohérence à l’objet social de la société en précisant la « raison d’être » de leur projet d’entreprise par voie statutaire, c’est certes donner à l’entreprise la possibilité de se réapproprier sa responsabilité économique, mais c’est aussi modifier la portée juridique du contrat de société, en particulier celle de son objet.
En matière de droit des sociétés, le législateur s’était jusqu’alors montré relativement économe, requérant du contrat de société qu’il ait un objet licite31 et que ce dernier soit précisé par les statuts de la société32. Le Code civil n’a jamais clairement distingué l’objet du contrat comme condition de validité de la société d’une part, de l’objet social en tant que projet d’entreprise que les associés se proposent de poursuivre d’autre part. Cette distinction s’est pourtant imposée sous l’empire de l’ancien article 1108 du Code civil qui disposait que « quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention », laquelle devait notamment avoir « un objet certain qui forme la matière de l’engagement »33. Pour ce qui concerne le contrat de société plus spécifiquement, l’article 1382 a alors permis de désigner l’apport comme objet du contrat en tant que les associés s’obligent à « affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie ». Parallèlement, les articles 1833 et 1835 du Code civil renvoient à une tout autre approche de l’objet du contrat, lequel est envisagé au-delà de l’acte de formation du contrat : l’objet renvoie en ce sens au projet d’entreprise qu’entendent poursuivre les associés, à la nature des activités qu’ils assignent à la société en formation, c’est-à-dire à l’objet social34. Par suite, les éléments apportés sont sujets à un principe d’affectation, lequel est désigné, pour les sociétés qui sont dotées d’une personnalité morale35, comme « principe de spécialité »36 ou comme capacité juridique limitée37. Il s’ensuit que les statuts d’une société ne sont réguliers que si l’objet social n’est pas « trop vague »38. En pratique, nonobstant certaines formes de société sujettes à une réglementation spécifique39, la désignation de l’objet social dans les statuts a conduit à multiplier les mentions d’activités pour lesquelles la société est constituée.
Alors que d’aucuns n’envisageaient de revenir sur la nécessité de formuler de manière suffisamment précise l’objet social de l’entreprise, l’article 61 du projet de loi PACTE prévoit de pouvoir compléter cet objet social par une « raison d’être » propre à l’entreprise, laquelle s’entendrait de manière générale, selon les termes du projet loi citant le rapport Notat-Sénard, « comme l’expression de ce qui est indispensable pour remplir l’objet social », telle « une devise pour un État ». Toutefois, à la différence de l’objet social, préciser la raison d’être de l’entreprise dans les statuts ne serait pas une cause de nullité du contrat de société, car cette spécification demeurerait optionnelle, et, plus largement, aucun effet juridique précis n’y serait d’ailleurs attaché… en théorie. Ce faisant, dès lors que la raison d’être serait précisée par les statuts, elle générerait de fait une responsabilité statutaire, en engageant notamment la responsabilité du dirigeant à l’égard des associés. Tout manquement à la raison d’être de la société constituerait en effet un manquement, susceptible de caractériser une faute des organes de gestion. Et, là où la légalisation de la notion d’intérêt social viserait à protéger le dirigeant des requêtes de ses actionnaires, la notion de raison d’être pourrait en revanche s’avérer être un motif de révocation.
Au-delà de l’incidence de la notion de raison d’être sur les relations entre actionnaires et dirigeants, la question peut aussi se poser de savoir si la spécification de la raison d’être d’une société pourrait faire l’objet d’un contrôle comparable à celui de l’objet social qu’elle viendrait compléter. Si les notions d’objet social et de raison d’être doivent être distinguées dans la mesure où la première entend qualifier la nature des activités induites par le projet d’entreprise, alors que la seconde définit plutôt l’objectif général du projet d’entreprise, il ne peut être exclu, compte tenu du caractère statutaire et complémentaire, de les rapprocher, voire de les assimiler. En effet, ce rapprochement résulte d’abord des ambitions du rapport Notat-Sénard, selon lequel « l’objet social mentionné dans les statuts étant devenu un inventaire d’activités potentielles, souvent beaucoup plus large que les activités réelles, la raison d’être est une recherche de cohérence ». Y a-t-il dès lors lieu d’analyser la raison d’être comme une nouvelle clause parapluie à stipuler de manière subsidiaire dès lors que la liste des items spécifiant l’objet social deviendrait un inventaire à la Prévert ? La raison d’être pourrait-elle même s’entendre comme la possibilité de définir un objet social générique en sus des activités se rapportant spécifiquement au projet d’entreprise ? En effet, malgré les précautions prises par l’exposé des motifs du projet de loi pour définir la raison d’être de la société, l’absence de définition légale ne permet pas d’exclure de tels rapprochements entre la raison d’être et l’objet social d’une société. Il a ainsi été relevé que « la raison d’être de la société est la réalisation de son objet »40, ou encore que « la détermination de l’objet [de la société], expression de la raison d’être de la société, revêt une grande importance, car elle conditionne la régularité des opérations que la société va effectuer »41. Partant, considérer la raison d’être comme le complément statutaire de l’objet social ouvrirait une brèche dans le principe de spécialité applicable aux personnes morales dans la mesure où une telle raison d’être serait, par hypothèse, générique. On peut enfin imaginer la requalification de la raison d’être suffisamment précise en objet social, et vice versa, ce qui pourrait soulever d’importants enjeux statutaires (règles de quorum et de majorité).
Comprendre la raison d’être comme le prolongement de l’objet social supposerait par ailleurs de réévaluer certaines solutions jusqu’alors établies. De fait, si l’article 1833 du Code civil fait toujours obligation à la société d’avoir un objet licite, la clause statutaire spécifiant la raison d’être de la société, laquelle serait de surcroît une déclaration de bonnes intentions, pourrait alors venir compléter la description de l’objet social et couvrir des activités illicites (exercice irrégulier de certaines activités, activités contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs) dès lors que le juge est tenu de ne procéder qu’à un contrôle formel de la licéité de l’objet social d’une société42. Le cas échéant, la spécification d’une raison d’être comme complément de l’objet social viendrait réduire les risques de nullité pesant sur le contrat de société. Dans le même sens, pour ce qui concerne les actes de la société, la spécification d’une raison d’être statutaire pourrait aussi faire passer pour réguliers des actes de gestion jusqu’alors inopposables à la société en l’absence de toute modification statutaire43. Il y a enfin tout lieu de penser que la spécification d’une raison d’être puisse permettre de recourir avec plus de souplesse à la théorie de l’accessoire pour permettre à une société civile de passer des actes commerciaux en évitant d’acter la création d’une société commerciale de fait44. Cette interprétation extensive des effets de la réforme apparaît d’autant plus plausible que la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 16 février 2016 retient une conception plutôt libérale de la capacité des personnes morales45.
En l’absence de définition législative, il appartiendra alors au juge de préciser la notion de raison d’être, précisément parce que le rapport Notat-Sénard favorise son rapprochement avec la notion d’objet. De fait, selon le rapport, « la notion de raison d’être constitue le retour de l’objet social au premier sens du terme, celui des débuts de la société anonyme, quand cet objet était d’intérêt public et examiné par le Conseil d’État ». Il renvoie ainsi aux origines de la société anonyme, issue du Code de commerce de 1807, lequel disposait que « la société par action est anonyme, elle n’est connue que par une qualification relative à son objet » et que sa constitution était soumise à agrément. Ce « merveilleux instrument du capitalisme » entendait offrir un double intérêt : distinguer le patrimoine personnel des associés de celui de la société d’une part, et par là même, permettre de confier la direction de telle société à des prête-noms d’autre part. L’effacement des véritables propriétaires de l’affaire avait alors deux corollaires : l’impossibilité de désigner la société en mentionnant le nom de ses actionnaires, le crédit attaché à la société résultant du capital libéré pour son agrément, et la limitation de la responsabilité financière des actionnaires à hauteur de leur apport emportant atténuation de l’affectio societatis. L’agrément de la société anonyme, requis jusqu’à la loi du 24 juillet 1867, était en ce sens censé garantir « le crédit général » et préserver la « tranquillité publique »46. En spécifiant la raison d’être de la société, on entendrait inscrire sa gestion dans une perspective à long terme, à l’abri des pratiques compromettant la confiance dans le capitalisme. Cette préoccupation apparaît être une constante des réflexions entourant les sociétés par actions. Pour autant, le projet de loi PACTE interroge dans la mesure où il prévoit de faire aussi application de la raison d’être aux sociétés de personnes, dont le crédit repose jusqu’alors sur l’engagement personnel de leurs associés, et où l’affectio societatis demeure un élément prépondérant par rapport à l’objet social.
Si le rapport Notat-Sénard est intitulé « L’entreprise, objet d’intérêt collectif », on peut donc se demander quel est le terme le plus important de ce titre, « objet » ou « intérêt collectif » ? L’originalité du rapport est sans doute à rechercher dans la juxtaposition de deux termes qui renvoient, sur le plan juridique, à deux réalités fort différentes. En ce sens, la raison d’être y est non seulement définie comme un « objet », mais aussi comme un affectio societatis élargi à l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise, dont les salariés. Or, si une telle approche était de nature à générer un supplément de confusion, elle serait aussi l’occasion de mettre à jour certaines contradictions qui sous-tendent la démarche du projet de loi PACTE. Spécifier la raison d’être, c’est répondre à un enjeu de confiance dans la société en tant qu’instrument juridique. Cependant, élargir l’affection societatis c’est le diluer, là où la confiance semble plutôt requérir de la transparence quant à l’identité des réels décideurs (c’est d’ailleurs l’objet de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 transposant la directive 2015/849 du 20 mai 2015 obligeant les sociétés à déclarer les noms de leurs bénéficiaires effectifs47). En se référant au modèle de la société anonyme originelle, on ne saurait concevoir de renforcer l’objet social sans atténuer l’affectio societatis et réciproquement, l’agrément de la société visant précisément à donner des gages aux parties prenantes là où l’affectio societatis est atténué. Ainsi, on voit réellement l’intérêt ni de spécifier une raison d’être dans une société de personnes ni de solliciter un affectio societatis de l’ensemble des parties prenantes, lesquelles sont davantage en quête d’interlocuteurs crédibles (notamment lorsqu’une chaîne de management placerait artificiellement une entité en situation de défaillance) qu’en situation de devoir concourir à accroître le crédit de sociétés tierces.
B – Raison d’être, succédané d’une cause perdue ?
En réalité, si la notion de raison d’être paraît si difficile à saisir, c’est qu’elle renvoie implicitement à une notion désormais disparue, à savoir la notion de cause. En effet, la cause était une condition requise aux fins de validité d’une convention sous l’empire de l’ancien article 1108 du Code civil. La raison d’être ne renvoie certes pas à ce qu’il convenait d’appeler une « cause objective » à caractériser, pour ce qui concerne le contrat de société, dans l’objet de l’obligation des coassociés, c’est-à-dire dans leur apport. En revanche, la notion de raison d’être porte davantage la trace de la « cause subjective » en tant que mobile des parties au contrat de société, voire au groupe de contrats que constitue l’entreprise. Il s’agit non pas de la cause directe et immédiate, mais du mobile ayant déterminé l’engagement des associés ou actionnaires. La raison d’être est en ce sens la cause de l’objet social de l’entreprise, un objectif commun à l’ensemble des organes de la société. Or, si la cause objective a été retenue de façon marginale en droit des sociétés – car le contrat est synallagmatique, la notion de cause subjective a en revanche été assez largement admise, notamment pour vérifier la licéité des objectifs présidant à la création d’une société. C’est bien une cause subjective qui est mise en œuvre lorsqu’il s’agit de vérifier que la création d’une société ne vise pas à contourner des dispositions légales impératives, ou à faire obstacle aux droits de tiers, ou tout simplement dans une perspective de fraude48. Ainsi, dès lors que, selon les termes mêmes du rapport Notat-Sénard, la raison d’être constitue « un compromis neutre et créatif entre les aspirations des différentes parties », elle s’inscrit donc dans le prolongement de la feue cause subjective.
Alors que la notion de cause a été supprimée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de nombreux articles ont déjà fait ressortir que la notion de cause subjective était demeurée à travers la notion de but49. Le projet de loi PACTE semble aussi vouloir faire réapparaître un succédané à la notion de cause subjective en droit des sociétés, comme si le droit des sociétés n’avait pas pu faire son deuil de la réforme du droit des obligations. Cependant, on ne saurait voir dans la notion de raison d’être une simple légalisation, sous une autre appellation, de la notion de cause. De fait, là où la notion de cause subjective aurait conduit à rechercher dans le contrat de société la cause commune aux associés, la notion de raison d’être renvoie plutôt à une cause collective à partager au-delà du simple cercle des associés, c’est-à-dire avec l’ensemble des parties prenantes. Elle ne saurait donc s’analyser comme un élément déterminant de l’engagement dans les liens du contrat de société dès lors qu’elle tend aussi à engager des tiers à ce contrat, à savoir les parties prenantes (prestataires, salariés, etc.)50. De même, la notion de raison d’être ne saurait pas non plus se réduire à la notion de but, au sens du nouvel article 1162, dès lors qu’il prévoit d’en apprécier la portée, que « ce dernier ait été connu ou non de toutes les parties ». Or, spécifier statutairement la raison d’être vise précisément à porter cette dernière à la connaissance de tous, obligeant les associés à s’interroger sur l’effet relatif d’une telle modification des statuts de la société51.
Quelles que soient les traces de la notion de cause dans celle de raison d’être, les effets juridiques résultant de la spécification statutaire de cette dernière ne sauraient être négligés. De fait, alors que le nouvel article 1186 du Code civil dispose que « l’obligation que la disparition d’un élément essentiel du contrat entraîne sa caducité », que deviendrait le contrat de société avec l’apparition d’un élément essentiel (la raison d’être) ou la disparition d’un de ces éléments (toilettage de l’objet social) ? Qui plus est, à considérer l’entreprise comme un groupe de contrats, la spécification ou la modification de la raison d’être d’une entreprise pourraient-elles être considérées comme un motif suffisant de nature à remettre en cause les contrats (prestataires, salariés, etc.) pour lesquels la raison d’être affichée de l’entreprise deviendrait un élément prépondérant, offrant ainsi l’occasion d’exercer une sorte d’objection de conscience au titre du nouvel article 1186, alinéa 2, du Code civil ? L’été 2018 a ainsi fourni un exemple de difficultés liées à l’exécution de contrats entre des entreprises attachées à des raisons d’être apparemment incompatibles (annulation d’une commande de boissons passées auprès de la société Barnum par la société organisatrice des Gay games). On peut en ce sens envisager que certaines entreprises prennent très vite position en matière de raison d’être, s’interdisant de travailler avec des sociétés dont les raisons d’être seront jugées incompatibles, voire avec des sociétés n’ayant pas de raison d’être. La raison d’être aura alors ses raisons que la raison économique ne pourra pas connaître.
Notes de bas de pages
-
1.
Projet de loi composant, avec certaines dispositions du projet de loi de finances pour 2019, le « Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises ».
-
2.
Dondero B., « La raison d’être des entreprises (rapport Notat-Senard) », https://brunodondero.com/2018/03/10/la-raison-detre-des-entreprises-rapport-notat-senard/
-
3.
Couret A., « Faut-il réécrire les articles 1832 et 1833 du Code civil ? », Recueil Dalloz 2017, p. 222.
-
4.
Pirovano A., « La “boussole” de la société. Intérêt commun, intérêt social, intérêt de l’entreprise ? », Recueil Dalloz 1997, p. 189.
-
5.
Pour la régularité d’un octroi de garanti : Cass. 1re civ., 19 mai 1987, n° 84-14855 ; pour la régularité de la nomination d’un administrateur provisoire : Cass. com., 17 oct. 1989, n° 87-19369.
-
6.
Mathez H., « Sociétés cotées : redonner sa place au conseil d’administration », BJS juill. 2018, n° 118t5, p. 389.
-
7.
C. trav., art. L. 2311-1 et s., issus de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
-
8.
Gallois-Cochet D. et Laroche M., « Projet PACTE, quel impact ? », Gaz. Pal. 3 avr. 2018, n° 319y5, p. 42.
-
9.
C. civ., art. 1848, pour les gérants de sociétés civiles ; C. com., art. L. 221-4, pour le gérant d’une SARL.
-
10.
Couret A., « Faut-il réécrire les articles 1832 et 1833 du Code civil ? », Recueil Dalloz 2017, p. 222.
-
11.
Cass. com., 21 sept. 2004, n° 02-17559, concernant les choix d’investissement ; Cass. com., 10 févr. 2015, n° 14-11760 ; Cass. com., 2 nov. 2016, n° 16-10363 ; Cass. 3e civ., 27 avr. 2017, n° 16-12388, concernant l’octroi de cautionnement – Cass. com., 5 avr. 2018, n° 16-23365, SAS RM System France, concernant le choix d’un prestataire douteux : Messaï-Bahri S., « Petit florilège de fautes de gestion du dirigeant », BJS juill. 2018, n° 118s6, p. 402.
-
12.
Mousseron P. et Chatain-Autajon L., « Comment régir les conventions suscitant un conflit d’intérêt », in Droit des sociétés, 2e éd., Précis Joly, p. 225.
-
13.
Cass. crim., 28 sept. 2016, n° 15-87232, concernant l’octroi d’un prêt rémunéré dans l’intérêt de l’actionnaire majoritaire : Moulin J.-M., « Pas d’abus de majorité dans une convention de trésorerie », Gaz. Pal. 28 oct. 2016, n° 278t0, p. 79.
-
14.
Cozian M., Deboissy F. et Chadefaux M., Précis de fiscalité des entreprises, 40e éd., 2016, LexisNexis, nos 276 et s. ; Gutmann D., Droit fiscal des affaires, 8e éd., 2017, LGDJ, Domat Droit privé, n° 630 ; Dondero B., « Le droit des sociétés est partout », Gaz. Pal. 2 févr. 2016, n° 256u6, p. 51.
-
15.
Dondero B., « Affaire Europcar : la loyauté du dirigeant est due à la société, mais aussi à l’actionnaire », Gaz. Pal. 6 sept. 2016, n° 272y2, p. 74 ; Favario T., « Faute de gestion de l’article L. 651-2 du Code de commerce : une double illustration », BJE juill. 2015, n° 112h9, p. 249 ; Poracchia D., « Contrat de management et obligation de loyauté des dirigeants », BJS févr. 2015, n° 113a4, p. 61.
-
16.
Cass. com., 18 avr. 1961 ; Cass. com., 22 avr. 1976 ; Cass. com., 11 janv. 2017, n° 14-27052, Sté Clinique de la Ciotat et Sté de gestion Sainte-Marguerite c/Sté Centre d’hémodialyse de Provence Aubagne et Clinique de Casamance : Moulin J.-M., « Quand l’accordéon jour un air d’abus de majorité », Gaz. Pal. 20 juin 2017, n° 297s8, p. 77 ; Sylvestre S., « Quand la fraude corrompt le coup d’accordéon », BJS juin 2017, n° 116k2, p. 379.
-
17.
Cass. com., 9 mars 1993, n° 91-14685 ; Cass. com., 5 mai 1998, n° 96-15383.
-
18.
C. com., art. L. 241-3, 4° et 5° et C. com., art. L. 242-6, 3° et 4°.
-
19.
C. com., art. L. 225-35, al. 3 in fine.
-
20.
Initialement applicable aux sociétés cotées aux termes de la loi NRE du 15 mai 2001, puis élargie aux sociétés de plus de 500 salariés et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros par la loi dite Grenelle II du 12 juillet 2010.
-
21.
C. com., art. L. 225-102-1, issu de l’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017, et dont le III prévoit que cette déclaration comprend déjà un « notamment ».
-
22.
C. envir., art. L. 229-25, issu de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle II.
-
23.
C. civ., art. 1832.
-
24.
Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-22296.
-
25.
La durée de détention moyenne des actions cotées à la Bourse de New-York, hors trading à haute fréquence, atteindrait 11 mois, selon P.-Y. Gomez (« L’actionnariat en hypertension », Le Monde mars 2016), cité dans le rapport Notat-Sénard.
-
26.
C. com., art. L. 225-102-4, issu de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017.
-
27.
Concernant la responsabilité pénale de la société-mère : Cass. crim., 25 sept. 2012, n° 10-82938, Sté Total.
-
28.
Hamelin J.-F., « Gérer la société en prenant en compte les intérêts des tiers… ou le flou artistique », LEDC févr. 2018, n° 111f2, p. 1.
-
29.
Cass. com., 5 juill. 2017, n° 15-22936, concernant la révocation d’un dirigeant pour des erreurs d’appréciation ayant conduit à des décisions inadaptées, voire contradictoires.
-
30.
Lenhof J.-B., « La notion d’intérêt social à l’épreuve de l’absence de personnalité morale des sociétés gérant des pools bancaires », LPA 29 oct. 2001, p. 7.
-
31.
C. civ., art. 1833.
-
32.
C. civ., art. 1835.
-
33.
Depuis la réforme de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le nouvel article 1128 requiert des conventions qu’elles aient un « contenu licite et certain ».
-
34.
Sur la distinction entre objet et objet social, v. Massart T., « Contrat de société », in Répertoire de droit des sociétés, Dalloz, n° 30 ; Dondero B., Droit des sociétés, 4e éd., Dalloz, nos 86 et 87.
-
35.
C. civ., art. 1145, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
-
36.
Concernant le principe de spécialité des personnes morales, v. Massart T., « Contrat de société », in Répertoire de droit des sociétés, Dalloz, n° 14.
-
37.
Le Cannu P. et Dondero B., Droit des sociétés, 6e éd., 2014, Lextenso, nos 247 et s.
-
38.
Merle P., Sociétés commerciales, 17e éd., 2014, Précis, Dalloz, n° 73.
-
39.
Par exemple : SCEA, SICOMI, ESH, etc.
-
40.
Merle P., Sociétés commerciales, 17e éd., 2014, Précis, Dalloz, n° 74.
-
41.
Besnard Goudet R., « Objet social : Notion et influence sur la condition juridique de la société », Encyclopédie du JurisClasseur : Sociétés (Traité), 2018, LexisNexis, fasc. 9-10.
-
42.
CJUE, 13 nov. 1990, n° C-106/89, Marleasing ; CA Paris, 3e ch., 21 sept. 2001, n° 99/02244, Escudié c/SA 3001 Informatic ; Cass. com., 11 juill. 2006, n° 04-16759, Fread c/Doni.
-
43.
Cass. com., 12 janv. 1988, n° 85-12666, SA Edition Rohart c/Dessaint ; CA Paris, 14e ch., 10 nov. 2000, n° 00/14167, Goujon Chesnel c/SNC Chesnel ; Cass. com., 18 oct. 1994, n° 92-21485, Sté Al Malak c/Sté Farb France ; Cass. com., 26 janv. 2012, n° 11-11467 ; Cass. com., 14 févr. 2018, n° 16-16013, SAS Deceuninck.
-
44.
CA Rouen, 22 nov. 1995, n° 93/04425.
-
45.
Saintourens B., « Les aspects de droit des sociétés de la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats », BJS juin 2018, n° 118r9, p. 373.
-
46.
Rapport du Conseil d’État sur le projet de Code de commerce de 1867 ; sur le rôle de l’objet dans les anciennes sociétés anonymes, v. aussi Didier P. et Didier Ph., Les Sociétés commerciales, 2011, Economica, Corpus de droit privé, n° 133.
-
47.
C. mon. fin., art. L. 561-2-2.
-
48.
Dondero B., Droit des sociétés, 4e éd., Dalloz, nos 88 et 166.
-
49.
Mestre J., Velardocchio D. et Mestre-Chami A.-S., Le Lamy Sociétés Commercial, févr. 2018, n° 584, « Objet et cause du contrat – But du contrat » ; Netter E., « Contrat de société et nullité de société », Études Joly Sociétés, févr. 2017, nos 126 et s. ; v. aussi Andreu L. et Thomassin N., Cours de droit des obligations, 2017-2018, LexisNexis, nos 472 et 473.
-
50.
Sur l’effet relatif du contrat de société, le manquement à des obligations statutaires favorables aux tiers est susceptible de constituer une faute. V. en ce sens Corbert-Picard V., « Pouvoirs des dirigeants : l’effet des statuts et des pactes extra-statutaires vis-à-vis des tiers », Option Droit & Affaires, 8 juin 2016.
-
51.
Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13255 ; Cass. soc., 15 févr. 2012, n° 10-27685.