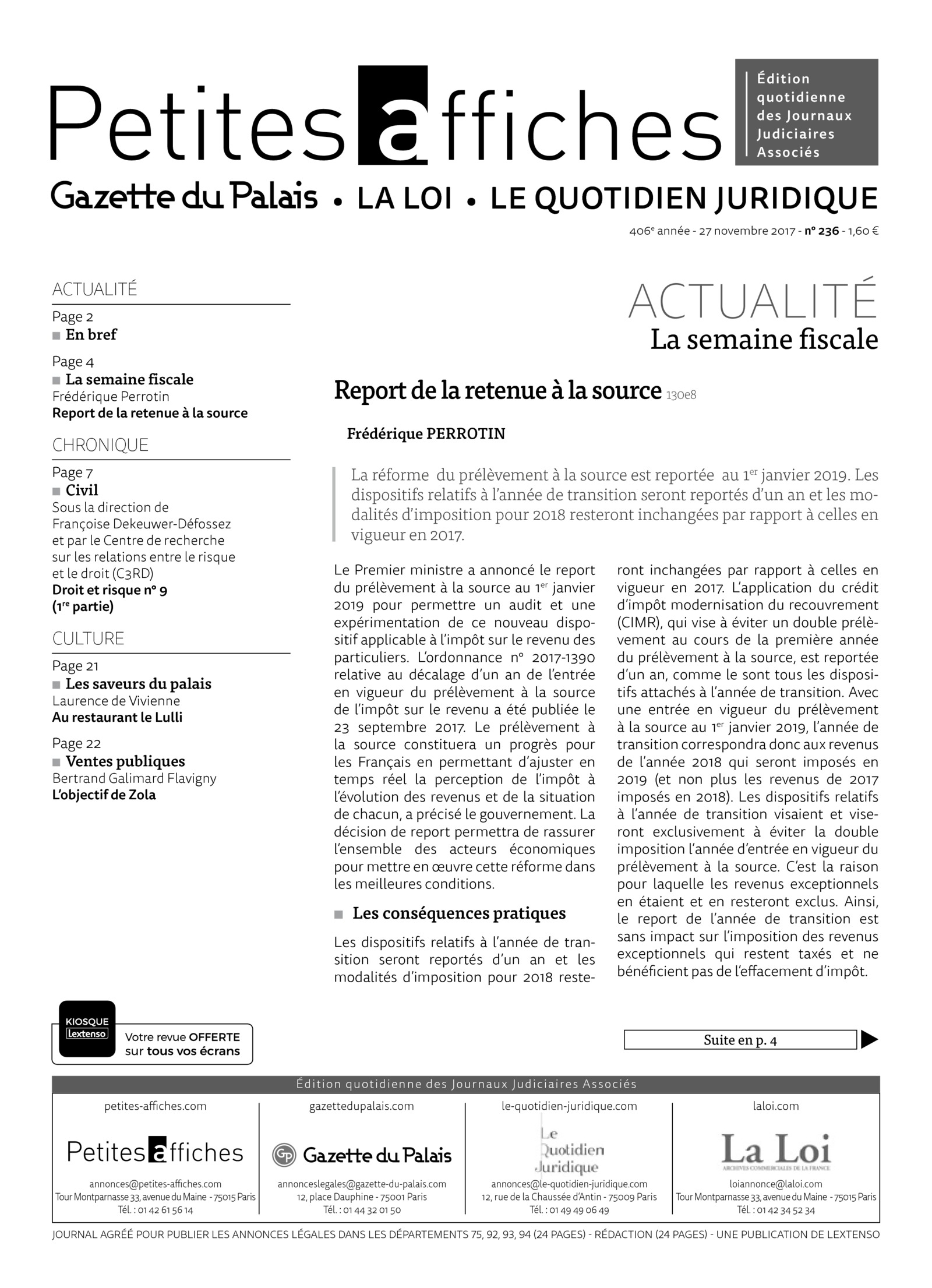Droit et risque n° 9 (1re partie)
Cette neuvième chronique des tumultueux rapports entre Risque et Droit s’ouvre, comme toujours sur une illustration de ce que le Droit lui-même peut être créateur de risques, mais la question posée est inédite : est-il concevable que le refus d’application du droit européen par une juridiction ouvre le droit à une indemnisation de l’État au titre de la faute lourde ? Que la Cour de cassation dans sa formation la plus haute réponde positivement sur le principe ouvre de nouvelles et inédites perspectives quant à l’indemnisation éventuelle de l’insécurité juridique (Cass. ass. plén., 18 nov. 2016). La même question sera peut-être posée dans un proche avenir à propos de la multiplicité des risques causés par des textes hâtivement rédigés ou animés d’a priori idéologiques biaisés. Ainsi, les risques que font courir tant aux époux qu’aux tiers le nouveau divorce contractuel (art. 50, loi du 18 nov. 2016 de modernisation de la justice), ou même la dégradation des statuts du doctorant comme de son directeur de thèse (arrêté du 25 mai 2016) engendreront probablement des dommages, dont il n’est pas inenvisageable que réparation soit demandée au législateur.
Quant à la gestion des risques de toute sorte par le droit, elle fait désormais la part belle aux dispositions dites de « prévention » dont on sait qu’elles sont particulièrement délicates, tant la prévision des risques est aléatoire et tant les mesures prises pour y parvenir peuvent s’avérer soit illusoires, soit attentatrices aux libertés. Ces deux cas de figure sont illustrés à merveille par le « droit à la déconnexion », louable tentative de préserver la vie privée du salarié, mais si peu compatible avec un monde désormais connecté en permanence (C. trav., art. L. 2242-8, 7°, issu de la loi du 8 août 2016), et par une décision de la cour de Versailles décidant de couper tout lien entre un bébé de 2 ans et son père, en raison de la radicalisation islamique de ce dernier (CA Versailles, 20 avr. 2017) dont la conformité au « droit à la vie familiale » du père comme de l’enfant semble problématique.
La réparation des risques réalisés est assurément un domaine mieux balisé, même si la jurisprudence montre la persistance de questions inédites ou de solutions critiquables. Ainsi la reconnaissance, en droit médical, du préjudice « d’impréparation » a nécessité une mise au point précise de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 25 janv. 2015, n° 15-27898), tandis que la survivance d’obligations de sécurité « de moyens » en matière de responsabilité contractuelle (Cass. 1re civ, 25 janv. 2017, n° 16-11953) suscite de légitimes critiques dont il faudra tenir compte lors de la prochaine réforme de la responsabilité civile. Reste enfin la question des conséquences de pratiques managériales pathogènes émanant d’un salarié : au casse-tête de l’employeur qui doit sanctionner et réparer les conséquences d’agissements d’un subordonné la jurisprudence récente apporte des réponses en responsabilisant davantage les salariés de l’encadrement.
F.D.D
I – Les risques du droit
A – L’insécurité juridique
La responsabilité de l’État du fait de la violation manifeste du droit par une décision de justice. Progrès et relativité
Cass. ass. plén., 18 novembre 2016, n° 15-21438. « La responsabilité de l’État, pour des dommages causés aux particuliers du fait d’une violation du droit de l’Union européenne, par une décision d’une juridiction nationale de l’ordre judiciaire statuant en dernier ressort, n’est susceptible d’être engagée que si, par cette décision, ladite juridiction a méconnu de manière manifeste le droit applicable, ou si cette violation intervient malgré l’existence d’une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l’Union européenne ». C’est en ces termes que s’est prononcée, en assemblée plénière, la Cour de cassation dans un arrêt remarqué du 18 novembre 20161. Un tel attendu de principe mérite attention, non seulement parce qu’il concerne la répression de conflits de normes (ou de leur interprétation) et l’encadrement d’un risque généré par l’application du droit, mais aussi parce qu’il situe l’office du juge dans le traitement d’une violation du droit dont il est à l’origine. Tout ceci plante le large décor de la question de droit en cause, celle consistant à déterminer la violation, par une juridiction, d’un principe du droit supérieur (exclusivement communautaire en l’état), dans des conditions susceptibles d’engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
En l’espèce, une coopérative agricole avait procédé à l’importation de pois protéagineux en France et indiqué, lors de leur entrée sur le territoire, que ces graines qui provenaient des Pays-Bas et de Grande-Bretagne n’étaient pas destinées à l’ensemencement. Grâce à cette déclaration, cette coopérative agricole avait perçu des aides communautaires. Comme ces pois provenaient en partie de Hongrie et avaient été en réalité utilisés pour l’ensemencement, la direction générale des douanes avait intenté une action pour déclaration d’origine inexacte et fausse déclaration à l’importation, ce qui avait abouti à une condamnation.
Cette solution fut contestée jusqu’en cassation. Le demandeur reprocha à l’arrêt de ne pas avoir écarté l’article 110 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 en raison du principe de l’application rétroactive de la peine plus légère. Pour comprendre, si l’article 111 de cette même loi prévoit que le Code des douanes ne s’appliquera plus à l’entrée des marchandises communautaires, il précise également que les nouvelles dispositions ne font pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 1993, sur le fondement des dispositions législatives antérieures.
Précisément, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi aux motifs que les dispositions de cette loi ne faisaient pas obstacle à la poursuite des infractions douanières commises avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures. Pour elle, la modification apportée par cette loi n’avait eu en l’espèce des incidences que sur les modalités de contrôle du respect des conditions de l’octroi de l’aide aux pois protéagineux et de leur origine et non sur l’existence de l’infraction ou la gravité des sanctions. En somme, l’application du principe de rétroactivité in mitius est écartée.
Par la suite, le demandeur a saisi le comité des droits de l’Homme des Nations unies. 3 ans après la solution de la Cour de cassation, celui-ci a constaté que l’article 110 de la loi de 1992 violait le principe de rétroactivité de la peine plus légère, énoncé par l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civil et politique2. L’affaire pris alors une autre tournure puisque le demandeur a assigné l’agent judiciaire de l’État, en réparation de la faute lourde du fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sur ce point, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 mai 2015, a retenu une violation manifeste du droit communautaire et de l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constitutive d’une faute lourde au sens de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire. Solution inédite à notre connaissance : une cour d’appel juge, d’une manière dépourvue de toute équivoque, que la Cour de cassation, en l’espèce sa chambre criminelle, a commis une violation du droit communautaire.
Les termes de l’arrêt, formulés sans ménagement, sont tout aussi remarquables : la Cour de cassation aurait « délibérément fait le choix de ne pas appliquer le principe communautaire, en recourant à une motivation dont elle n’ignorait pas qu’elle n’était ni pertinente ni adaptée ; qu’il en résulte que cette violation manifeste de la règle de droit communautaire qui avait pour objet de conférer des droits aux particuliers par la Cour de cassation a causé un préjudice ». On ne mesure peut-être pas assez l’incidence d’une telle position, pas seulement symbolique, sur l’équilibre hiérarchique de l’ordre juridictionnel et la mission d’unification du droit traditionnellement dévolu à la Cour de cassation, aujourd’hui responsable du droit jurisprudentiel qu’elle énoncerait mal, sans que les juges qui en relèvent n’hésitent à le lui faire reproche aussi directement. Tout ceci est-il bien sain ? Est-ce un progrès pour la sécurité juridique ? Le droit à réparation du dommage généré par la mauvaise application du droit en sort-il grandi ?
En droit pur, il faut rappeler que la mise en œuvre de cette responsabilité repose sur des fondements solides. Elle s’appuie sur l’arrêt Köbler rendu le 30 septembre 2003 par la Cour de justice de l’Union européenne3. Cet arrêt a posé le principe selon lequel la responsabilité de l’État peut certes être engagée du fait d’une décision juridictionnelle statuant en dernier ressort qui violerait le droit communautaire, mais à la condition que cette violation soit manifeste, compte tenu du degré de clarté et de précision de la règle violée, du caractère délibéré de la violation, et du caractère excusable ou non de l’erreur de droit commise. Le Conseil d’État a déjà entériné ce principe depuis plusieurs années4. Il a même jugé récemment que les tribunaux administratifs et, en appel, les cours administratives d’appel, sont bien compétents pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l’État à raison de la faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par le Conseil d’État5.
La solution de la cour d’appel de Paris repose sur deux paramètres. D’une part, la Cour de cassation connaissait la décision de la CJUE du 3 mai 2005 relative au principe de la rétroactivité de la peine plus légère, ainsi que l’article 15 du Pacte international, et n’ignorait pas que ses arrêts antérieurs n’étaient pas dans la ligne de cette jurisprudence et étaient critiqués par une partie de la doctrine. D’autre part, la chambre criminelle a considéré que la loi du 17 juillet 1992 n’avait ni supprimé l’infraction ni eu d’effet sur les peines, de telle sorte que le principe de rétroactivité in mitius n’avait pas à s’appliquer. Si bien que la Cour de cassation avait délibérément fait le choix de ne pas appliquer le principe communautaire et le Pacte international, alors que, si l’élément matériel de l’infraction pouvait avoir subsisté, l’élément légal avait été supprimé par l’article 111 de cette loi.
On fera observer que c’est tout à la fois l’existence de jurisprudence antérieure, l’avis de l’avocat général, le contenu du rapport du conseiller rapporteur déposé à la Cour de cassation qui sont pris en compte en vue d’identifier la violation manifeste du droit de nature à actionner la responsabilité. Formidable mise au radar de la confection du droit jurisprudentiel… par le juge.
L’assemblée plénière a cassé sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel de Paris, sous couvert de l’attendu de principe précité. Elle ne définit pas différemment le principe même et les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État ; ce qui, au passage, entérine clairement dans l’ordre judiciaire le principe de cette responsabilité. Elle souligne qu’aucun texte ou principe général du droit de l’Union européenne, ni aucune jurisprudence bien établie de la CJUE n’indique que le principe de l’application rétroactive de la peine plus légère fait obstacle à ce que soient poursuivies et sanctionnées les fausses déclarations en douane ayant pour but ou pour effet d’obtenir un avantage quelconque attaché à des importations intracommunautaires commises antérieurement à la mise en place du marché unique. L’application de l’article 110 de la loi du 17 juillet 1992 ne contrevenait donc pas, d’après elle, au droit de l’Union.
Bien sûr, il est facile de souligner que ne pas reconnaître ici la responsabilité de l’État, c’est pour la Cour de cassation écarter sa propre responsabilité, ou plus exactement celle d’une de ses chambres qui – Ô crime suprême – aurait pris une décision qui pourrait apparaître comme n’ayant pas fait une application absolue d’un principe du droit de l’Union européenne. À l’inverse, on ne quitte pas l’interrogation fondamentale d’un tel montage : un juge « suprême » peut-il sciemment violer le droit ? L’admettre remet en cause, en cascade, une série de considérations structurantes, et la prudence invite à mesurer le « progrès » que cela est censé constituer et le modèle à l’œuvre dans une telle mécanique un peu folle.
À ce stade, et en première intention, la solution de l’assemblée plénière repose sur une affirmation qu’elle énonce en dernier mot (si cela existe encore) dans le cadre de l’action en responsabilité : le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que le législateur déroge expressément au principe de rétroactivité in mitius. Discutable évidemment, faute de renvoi préjudiciel qui aurait permis de le poser authentiquement. Sensible aussi, compte tenu de la valeur cardinale de la rétroactivité in mitius. Appréciation relative, en tout état de cause, car elle dépend du contexte dans lequel l’interprétation a été retenue à l’époque dans la solution litigieuse6.
Là est le moteur du raisonnement. La responsabilité du fait de la violation manifeste du droit doit s’apprécier, comme le rappelle le rapport attaché à l’arrêt rapporté, en fonction du principe violé. Elle doit être mise en perspective avec son champ d’application, son régime et ses limites. Ce qui suppose, qu’on le veuille ou non, que ledit principe repose sur une jurisprudence suffisamment établie. Or le principe de rétroactivité in mitius connaît des ambiguïtés, bien connues mais non toutes résolues, qui tiennent à ses fondements et aux spécificités de son application en matière de sanctions économiques7. Et, le cas échéant, à la pluralité des sources et des juges qui s’en saisissent.
Point de « violation manifeste » en l’absence d’un principe suffisamment précis au sens et pour le compte d’un engagement de responsabilité juridictionnelle, telle est en somme l’analyse retenue par l’Assemblée plénière.
La CJUE a admis elle-même, un mois avant l’arrêt rapporté8, que le principe de la rétroactivité in mitius n’est pas un principe absolu dont l’application est automatique. L’application de ce principe est subordonnée à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi. Elle suppose, pour reprendre l’analyse de Marie-Christine Sordino, « l’existence d’une succession de lois dans le temps et repose sur la constatation que le législateur a changé d’avis, soit sur la qualification pénale des faits, soit sur la peine à appliquer »9.
Cela rejoint la position du Conseil constitutionnel, dont on ne saurait tenir rigueur à la Cour de cassation d’être attentive. Sur le fondement de l’article 8 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, celui-ci considère notamment que le principe de rétroactivité in mitius peut être écarté lorsque la répression antérieure plus sévère est « inhérente aux règles auxquelles la loi nouvelle s’est substituée »10. Autre moyen d’affirmer qu’il est des cas objectifs dans lesquels la nécessité commande d’aménager la survie de la loi ancienne plus sévère.
Le relativisme de l’interprétation du principe en cause, et en l’espèce la circonstance que le texte nouveau n’est pas porteur d’une modification de l’avis du législateur sur la qualification ou sur la peine, devait conduire à la solution retenue par l’Assemblée plénière sur le terrain de la responsabilité.
Le cas rapporté en témoigne : l’application de la jurisprudence Köbler, d’un maniement très délicat, est elle-même source d’incertitudes indépassables, pour partie inhérentes à la subsidiarité juridictionnelle et à la répartition de l’office des juges internes. De fait, il est difficile d’extraire cette action de toute dimension afflictive, la « violation manifeste » étant sans doute parasitée par la charge symbolique que représente la « faute lourde » énoncée à l’article L. 141-1, alinéa 1er, du Code de l’organisation judiciaire.
Dans la quête d’une répression des actions juridictionnelles inconséquentes, faut-il aller jusqu’à sanctionner l’obligation de renvoi préjudiciel à la Cour de justice, en ouvrant la responsabilité de l’État du seul fait de la violation de cette obligation de renvoi ou d’un défaut de diligence, responsabilité jusqu’alors susceptible d’être engagée en cas de violation du fond du droit11 ? Pas sûr que ce biais répressif soit tenable ni opportun, ni conforme au prétendu « dialogue des juges » qu’on agite pourtant pour la fonder. Avatar de l’affaire rapportée, 5 jours après son prononcé, la chambre criminelle a fait preuve de son discernement en posant une question préjudicielle sur l’interprétation du principe de rétroactivité in mitius dans le domaine commercial12, en vue sans doute de faire ajuster la position de la Cour de justice.
Pour le reste, la complexité inhérente à l’application du droit, de surcroît dans nos systèmes enchevêtrés, rend plus ou moins aléatoire la mise en œuvre du principe de responsabilité du fait de sa violation prétendument manifeste. L’incertitude du droit ne manque jamais de ressources, tandis que la défaillance jurisprudentielle est une théorie en construction. Il est louable mais un peu naïf d’envisager l’action en responsabilité de l’État du fait de la violation manifeste du droit par l’autorité juridictionnelle comme un levier pour contenir l’une, sans en passer par l’autre.
On ne maîtrisera pas le risque juridique en accablant toujours plus le juge. Ni en laissant planer de façon non mesurée un autre risque, utilement reconnu et intelligiblement contenu, celui d’une responsabilité de l’État du fait de sa pratique judiciaire contraire au droit de l’Union européenne. Pour autant, ainsi qu’on a déjà pu le souligner dans la présente chronique13, on ne peut négliger la force symbolique et les vertus pédagogiques de la responsabilité lorsque, comme on peut le souhaiter, elles ont le mérite de signifier que l’insécurité du droit à un coût et que, sous leurs diverses formes, les actions normatives déraisonnables, déjà économiquement sanctionnées dans un contexte de « law shopping », ne bénéficient plus d’une impunité.
M.D.
B – Les autres risques du droit
Le renouveau des conditions d’accès au doctorat : le risque d’affaiblissement de la fonction de directeur de recherche
L’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat14 précise le cadre et les conditions de la formation doctorale et confirme la définition du « doctorant » jusqu’alors retenue, en durcissant son statut et les conditions d’obtention du diplôme visé. Le doctorant est ainsi un étudiant préparant un doctorat : il se définit donc par le diplôme préparé. Cette définition est absente du Code de l’éducation, l’article L. 612-715 définissant en effet la formation doctorale et non l’individu concerné par cette formation en rappelant que « [le] troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux »16. Le doctorat est alors une formation à la recherche par la recherche, organisée dans le cadre d’écoles doctorales, ce que l’arrêté du 25 mai 2016 reprend dès son article 1 : « La formation est une formation à et par la recherche et une expérience professionnelle de recherche ». La formation doctorale s’articule donc autour d’un triptyque : formation à la recherche, formation par la recherche, expérience professionnelle de recherche. Partant, il est essentiel d’encadrer cette formation dont la définition laisse apparaître les limites intrinsèques.
Partant, l’arrêté fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat vient rappeler les obligations respectives des différentes parties – écoles doctorales, directeurs de recherche et doctorants – en renforçant l’encadrement du doctorant ainsi que son statut. L’arrêté rappelle que les écoles doctorales organisent la formation des doctorants et les préparent à leur activité professionnelle à l’issue de la formation doctorale. Elles fixent les conditions de suivi et d’encadrement dans une charte du doctorat signée par le doctorant et le directeur de thèse lors de la première inscription. Il précise en outre que le directeur de thèse est responsable et contrôle les travaux du doctorant jusqu’à la soutenance où il siège au sein du jury sans la qualité de membre et sans prendre part à la délibération. Enfin, l’inscription administrative en doctorat serait conditionnée à l’existence de moyens de subsistance, ce qui, tout en s’imposant comme une sécurité, ne s’accompagne pas d’une reconnaissance effective de l’expérience professionnelle de recherche, cette dernière étant répartie en expérience de la recherche et expérience professionnelle.
Il apparaît ainsi que l’arrêté fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat du 25 mai 2016 tend à durcir les conditions d’accès au statut de doctorant et à affaiblir la relation doctorant-directeur en imposant une rupture du lien établi au moment de la soutenance, tout en renforçant le rôle des écoles doctorales.
I. Le durcissement du statut de doctorant
La question de la reconnaissance du statut de doctorant est une question centrale, sujette à controverse : celle d’un statut unique, transdisciplinaire pose la question de sa pertinence en raison de la diversité des cas et des domaines de recherche, diversité au regard de laquelle la structure de l’école doctorale – en tant que collège des équipes de recherche – demeure le cadre de référence qui, tout en prenant en charge une partie de la formation, propose un encadrement scientifique au doctorant : « les écoles doctorales organisent la formation des docteurs et les préparent à leur insertion professionnelle »17.
L’arrêté fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat18 fait évoluer le statut des doctorants. Cette évolution se traduit par un encadrement renforcé des obligations respectives des protagonistes et témoigne parallèlement d’un durcissement de ce statut : les conditions proposées viennent contredire l’esprit de novation et de liberté de la recherche, en soumettant les doctorants à des conditions renouvelées, par exemple en matière de financement.
Ainsi, l’inscription administrative en doctorat serait conditionnée à l’existence d’un financement, ce qui provoque l’inquiétude des doctorants19 et des directeurs des écoles doctorales délivrant le doctorat en droit, dont la Conférence nationale « s’oppose fermement au principe selon lequel l’inscription en doctorat soit subordonnée au financement des candidats »20. Pourtant, la question du financement des études doctorales mérite d’être posée car, par-delà la question de la survie économique, se pose celle de la reconnaissance du temps doctoral en emploi qualifiant : autrement dit, sans salaire, pas de travail21 et en conséquence pas d’emploi qualifiant, c’est-à-dire pas de reconnaissance des années travaillées non payées pour le calcul des trimestres de retraite notamment.
Or en l’état actuel du droit, les années doctorales ne sont pas prises en compte dans le calcul des annuités de la retraite alors même qu’elles sont qualifiées d’expérience professionnelle. Autrement dit, il s’agit d’une expérience professionnelle qui mérite d’être reconnue en tant que telle par les recruteurs, publics ou privés, ainsi que pour l’accès aux concours, mais pas au regard du calcul de la retraite : le doctorant fait des études supérieures longues, arrive en conséquence tardivement sur le marché du travail et ne peut pas faire reconnaître son expérience dans sa carrière. Ces aspects mériteraient quelque évolution afin d’entrer en cohérence. Une ouverture semble à cet égard proposée par la loi du 22 juillet 2013 – article 82 – modifiant le Code de la recherche, en particulier l’article L. 411-4, in fine, en ce qu’elle vise à faire reconnaître l’expérience professionnelle de recherche du doctorat dans les conventions collectives avant le 1er janvier 2016. Toutefois, cette reconnaissance n’est pas encore avérée car elle est soumise à « une commission formée de délégués des parties signataires à la convention ou à l’accord convoquée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la Recherche, du ministre chargé de l’Industrie et du ministre chargé du Travail, en vue de permettre la discussion des conditions de la reconnaissance, dans le cadre de la convention ou de l’accord, du titre de docteur, avant le 1er janvier 2016 »22. De plus, l’État est un des employeurs de docteurs les plus importants : il verrait gonfler sa dette sociale significativement, ce qui représente un frein qui ne saurait être négligé.
La recherche d’une sécurisation du statut du doctorant conduit ainsi à un durcissement des conditions d’accès audit statut et à la recherche : l’ambiguïté de la formulation « formation à la recherche par la recherche » se prolonge dans le statut accordé au doctorant qui se forme professionnellement tout en ne tirant pas les bénéfices de son statut de professionnel. Cette difficulté est directement liée au statut accordé à la recherche elle-même, envisagée dans une double dimension, à la fois élément de formation et véritable profession et se prolonge dans la nouvelle relation imposée entre le doctorant et son directeur de recherche par l’arrêté du 25 mai 2016.
II. L’affaiblissement de la relation doctorant-directeur
La rationalisation du statut du doctorant ne doit donc pas faire oublier que l’engagement doctoral vise un travail particulier de « formation à la recherche par la recherche »23, formulation obscure de laquelle il faut seulement comprendre que pour devenir chercheur, il faut chercher. Cette expression regroupe à la fois l’objectif de formation du parcours doctoral – formation à la recherche – et l’objectif final dudit parcours : la production d’une thèse nouvelle ou apportant un éclairage nouveau sur un sujet connu. Partant, si l’initiation à la recherche s’effectue en master, la traduction dans un travail de recherche est rarement une réalité, ce qui signifie que le doctorant, lors de sa première inscription n’est pas encore un chercheur mais qu’il va apprendre à le devenir pour mener à bien son engagement doctoral. Dans cette optique, l’école doctorale de rattachement ainsi que le directeur de thèse sont deux interlocuteurs primordiaux : d’une part l’école doctorale est chargée d’organiser la formation du doctorant24 et d’autre part, le directeur de thèse est responsable et contrôle les travaux du doctorant25. L’expérience et l’expertise du directeur de recherche permettront au doctorant de faire aboutir ses travaux de recherche tant sur le fond que sur la forme : si le directeur ne peut être tenu pour responsable des propos du doctorant, il cautionne le travail lorsqu’il propose de présenter la thèse en soutenance26, laquelle apparaît comme le moment ultime de l’accomplissement de la recherche, celui où les résultats sont présentés publiquement afin d’être jugés par un jury de spécialistes.
À cet égard, l’arrêté sur la formation doctorale introduit une disposition qui porte atteinte à la relation de confiance établie entre le doctorant et son directeur. La soutenance est inscrite comme le moment de la rupture : le doctorant devient docteur sans son directeur, le texte disposant que « Le ou les directeurs de thèse siègent au sein du jury sans la qualité de membre. Ils ne prennent pas part à la délibération »27. A contrario jusqu’alors, « Le directeur de thèse, s’il participe au jury, ne peut être choisi ni comme rapporteur de soutenance, ni comme président du jury »28. Autrement dit, le directeur se verrait privé de la qualité de membre du jury et serait, en conséquence, exclu de la discussion relative aux résultats du travail de recherche qu’il a suivis et encadrés tout au long du parcours doctoral29. Cette situation est paradoxale au regard de l’engagement pris de contrôler et soutenir le doctorant. Il n’est pas interdit de voir ici une tentative de transformation de la relation doctorant-directeur, visant à la dépersonnaliser et à la « rationaliser », dans la suite de la réforme LMD30.
À l’issue de la soutenance, le doctorant est donc seul, avec son travail : son directeur ne sera pas en mesure de le soutenir ou d’apporter quelque éclairage lors de la délibération qui se fera hors sa présence : la relation est consommée et le doctorant deviendra docteur sans son directeur.
La formation et l’obtention du diplôme sont distinguées et la soutenance apparaît alors comme l’ultime sésame permettant d’acquérir le grade de docteur. Le directeur de recherche est renvoyé au rôle de spectateur et son influence réduite à la direction de recherche. Cet encadrement de la fonction de directeur se prolonge encore dans la mise en place d’un comité de suivi individuel de la formation composé d’au moins trois personnes sans lien avec la formation du doctorant, chargé de veiller au bon déroulement du cursus et de prévenir toute forme de conflit, de discrimination ou de harcèlement31. Toutefois, le texte ne prévoit ni les modalités financières de mise en place de tels comités ni les modalités pratiques, il revient à chaque école doctorale de le faire. Enfin, la question de la formation du directeur de recherche ne correspond à aucune réalité : qui pourrait être en mesure de l’assurer ? Les directeurs de recherche doivent être habilités à diriger des recherches pour encadrer un travail doctoral, ce qui vérifie a priori leur capacité et leurs compétences. Il semble difficile de demander à un/des collègue(s) d’évaluer le travail de direction effectué, et encore moins à un comité ad hoc composé de non spécialistes.
Ainsi, alors que la rationalisation du statut de doctorant recherchée par l’arrêté du 25 mai 2016 se présente comme un garde-fou aux excès des uns et des autres, elle ne prend pas en compte la spécificité de la discipline juridique et des sciences humaines et sociales dans leur ensemble : l’encadrement de la durée des études doctorales et en particulier le caractère exceptionnel des dérogations32 ne tient pas compte des contraintes de la discipline. Ces éléments, qui se veulent contributifs d’un meilleur encadrement pourraient, avoir l’effet contraire de celui recherché : l’hyper-rationalisation est contradictoire avec l’esprit de la recherche et ne garantit pas, pour le moment, une reconnaissance institutionnelle effective du statut de doctorant.
La question de la valorisation des travaux doctoraux a été placée au cœur des débats relatifs à la préparation de la loi du 22 juillet 2013 portant sur l’enseignement supérieur et la recherche33. Toutefois, les résultats apparaissent à certains égards décevants et l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat n’apporte pas davantage d’information relativement au futur docteur. Au terme de l’article L. 412-1 du Code de l’éducation modifié par l’article 78 de la loi du 22 juillet 2013 précité, « La formation à la recherche et par la recherche intéresse, outre les travailleurs scientifiques, la société tout entière. Elle ouvre à ceux qui en bénéficient la possibilité d’exercer une activité dans la recherche comme dans l’enseignement, les administrations et les entreprises. (…) Les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d’emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique sont adaptés (…) afin d’assurer la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu’elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat ». Dans l’ensemble, dans la fonction publique, des adaptations sont apportées aux différentes procédures de recrutement afin de reconnaître et de valoriser l’expérience du parcours doctoral34 du docteur, l’obtention du titre étant une condition sine qua non.
S. D.-M.
Divorce sans juge : les risques à l’égard des époux
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle35 a ôté le prononcé du divorce par consentement mutuel de la compétence du juge aux affaires familiales, en instaurant une procédure de divorce extrajudiciaire que les époux sont, en principe, désormais tenus d’emprunter lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et sur ses effets. Ils doivent alors, chacun assistés par un avocat, constater leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée36, signée par les époux et leurs avocats ensemble, en trois exemplaires37. La convention de divorce par consentement mutuel doit contenir certaines mentions prescrites à peine de nullité38 et doit être déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles39. Ce dépôt confère à la convention date certaine et lui donne force exécutoire40. Par exception, les époux demeurent tenus d’emprunter la voie judiciaire traditionnelle lorsque l’un de leurs enfants mineurs, capable de discernement, a été informé de son droit à être entendu par le juge et a manifesté son souhait d’être auditionné41. Le législateur a en outre précisé que la voie du divorce extrajudiciaire était fermée aux époux dont l’un d’eux est placé sous un régime de protection juridique42, ce qui n’est guère surprenant dès lors qu’en pareille hypothèse les époux ne pouvaient davantage recourir au divorce par consentement mutuel judiciaire43. Dans la lignée de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce44 qui avait, dans le but de pacifier les relations entre époux, aménagé une passerelle entre divorces contentieux et le divorce par consentement mutuel45, la loi du 18 novembre 2016 a donné aux époux engagés dans une procédure de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute la possibilité d’opter pour un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats46, sauf demande de l’enfant mineur capable de discernement d’être entendu par le juge47.
L’amendement déposé par le gouvernement dans le cadre des travaux préparatoires à la loi du 18 novembre 2016 et qui a conduit à la réforme du divorce par consentement mutuel48 fait apparaître que la déjudiciarisation de ce divorce devait répondre aux « critiques récurrentes (…) qui portent sur la complexité [des] procédures, leur durée ainsi que leur coût ». Il s’agissait donc de simplifier la procédure de divorce, de la rendre moins longue et de diminuer son coût, mais également de désencombrer les cabinets des juges aux affaires familiales, lesquels « pourront se consacrer aux divorces contentieux ou conflictuels »49. Le gain escompté s’agissant de la charge de travail des juges aux affaires familiales s’est révélé, avant même l’entrée en vigueur de la réforme le 1er janvier 2017, très peu en adéquation avec les réalités vécues par les juridictions. En effet, dans la mesure où l’extrême majorité des conventions de divorce par consentement mutuel soumises par les époux à l’approbation du juge aux affaires familiales était homologuée50, ces magistrats consacraient assez peu de temps, en moyenne une journée par mois, aux divorces par consentement mutuel, ce qui était plutôt négligeable dans leur charge de travail globale51. L’intérêt de la réforme à cet égard est donc minime, d’autant plus au regard du risque d’augmentation du nombre d’instances destinées à modifier les clauses de la convention de divorce initiale52. Quant à l’objectif tenant à la diminution du coût du divorce, il n’a guère plus de chance d’être atteint, aussi bien pour le service public de la justice que pour les époux. Pour le premier, la faiblesse de l’impact de la réforme sur l’activité des juges aux affaires familiales ne permettra de réaliser aucune économie. De surcroît, tandis que les époux pouvaient auparavant faire le choix d’un avocat commun lorsqu’ils divorçaient par consentement mutuel53, ils sont tenus, dans le cadre du nouveau droit commun du divorce par consentement mutuel, d’être tous deux assistés de leur propre avocat54. Cela risque d’entraîner une augmentation considérable des demandes d’aide juridictionnelle, la loi du 18 novembre 201655 ayant modifié la loi du 9 juillet 1991 relative à l’aide juridique56 et précisé que l’aide juridictionnelle peut être accordée aux époux dans le cadre du divorce conventionnel, coût que devra supporter le service public de la justice. Quant aux époux, alors que « le coût de ce divorce se [voulait] maîtrisé »57, ils devront, s’ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle eu égard à leurs ressources, supporter la charge de rémunérer deux avocats, là où ils choisissaient majoritairement, par le passé, de se partager la rémunération d’un seul avocat58, étant observé que certains cabinets ne se sont pas privés d’augmenter les honoraires qu’ils demandent à chaque client dans le cadre du nouveau divorce par consentement mutuel, pour faire face au fait qu’ils n’ont plus qu’un client au lieu de deux auparavant. L’ambition de rendre le divorce moins onéreux est donc elle aussi illusoire.
Seul l’objectif de célérité de la procédure semble rempli. Tandis que la procédure de divorce par consentement mutuel devant le juge pouvait durer quelques mois59, il est désormais théoriquement envisageable d’obtenir un divorce par consentement mutuel en moins d’un mois, au vu des délais imposés par la loi du 18 novembre 2016 et par son décret d’application du 28 décembre 201760. D’abord, une fois la convention de divorce rédigée par les avocats respectifs des époux et envoyée à leurs clients par lettre recommandée avec accusé de réception, les époux ne peuvent la signer qu’à l’expiration d’un délai de réflexion ne pouvant être inférieur à 15 jours61. Puis la convention de divorce et ses annexes sont transmises au notaire par l’avocat le plus diligent dans un délai maximal de 7 jours à compter de la signature de la convention62. Enfin, le notaire doit déposer la convention de divorce au rang de ses minutes dans un délai maximal de 15 jours suivant la réception63.
Cela étant, il n’est pas certain qu’une telle célérité de la procédure de divorce soit systématiquement la solution la plus favorable aux époux. En effet, désireux de parvenir rapidement à la dissolution de leur mariage, les époux pourraient opter pour le nouveau divorce par consentement mutuel extrajudiciaire au risque parfois de prévoir des modalités de leur rupture peu respectueuses des intérêts de l’un d’entre eux au moins. De ce point de vue, la réforme du divorce par consentement mutuel se révèle être un possible piège dont les époux seraient finalement les victimes (I). Mais il n’est pas exclu, à l’inverse, que les époux aient des raisons de ne pas vouloir emprunter la voie d’un divorce extrajudiciaire. Or puisque le divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats constitue désormais le droit commun du divorce par consentement mutuel, les époux qui souhaiteraient que leur divorce soit prononcé par un juge pourraient être tentés de détourner de leur objectif les dispositions légales, afin de pouvoir saisir le juge aux affaires familiales. Vue sous cet angle, la réforme du divorce par consentement mutuel crée également, de la part des époux, un risque d’instrumentalisation de la possibilité de recourir au juge (II).
I. Les risques de la réforme du divorce par consentement mutuel créés à l’encontre des époux
La déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel a été présentée par ses partisans comme bénéfique, à de multiples égards, aux époux qui souhaitent divorcer. Pourtant, le recours au divorce conventionnel peut, dans certaines situations, s’avérer néfaste aux intérêts de l’un des époux, voire aux intérêts de chacun d’entre eux.
Tout d’abord, la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel a pour effet de priver la convention de divorce de tout contrôle judiciaire quant au respect des intérêts de chaque époux. Il en résulte une possibilité que les époux mettent en œuvre une convention de divorce contraire aux intérêts de l’un d’entre eux. Il peut en effet arriver que, par lassitude d’une situation devenue insupportable ou encore parce qu’il fait l’objet de pressions de la part de son conjoint, l’un des époux accepte de signer une convention déséquilibrée s’agissant du règlement des effets du divorce, tant sur les plans patrimoniaux qu’extrapatrimoniaux64. La convention pourrait par exemple exclure le versement d’une prestation compensatoire à l’époux qui remplissait pourtant les conditions pour en bénéficier. Elle pourrait également renfermer un déséquilibre s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs, en prévoyant par exemple l’exercice par l’un des parents d’un droit de visite et d’hébergement restreint alors que les circonstances ne le justifient pas. Le plus vulnérable des époux, en particulier sur le plan socio-économique, est davantage exposé au risque que soit conclue une convention de divorce contraire à ses intérêts. En outre, il a été très justement souligné, dans le cadre de la discussion du projet de loi par l’Assemblée nationale, que le divorce par consentement mutuel peut s’avérer extrêmement néfaste aux intérêts de l’époux qui serait dans une situation d’emprise ou qui serait victime de violences conjugales65. Dans le même sens, il a été souligné que les femmes victimes de violences conjugales pouvaient fréquemment accepter un divorce par consentement mutuel désavantageux, guidées par le souci de s’extraire au plus vite de leur situation66. Plusieurs associations de défense des femmes victimes de violences conjugales ont d’ailleurs manifesté leur vive inquiétude quant à la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel67. Préalablement à l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, la convention réglant les effets du divorce par consentement mutuel était nécessairement soumise à l’approbation du juge aux affaires familiales68. Ce dernier n’homologuait la convention et ne prononçait le divorce que s’il avait acquis la conviction que la volonté de chacun des époux était réelle et que leur consentement au divorce était libre et éclairé69. À défaut, ou encore s’il constatait que la convention préservait insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux, le juge refusait d’homologuer la convention70. Nous avons déjà expliqué dans ces colonnes en quoi, dans le cadre du nouveau divorce par consentement mutuel, étaient susceptibles d’être conclues des conventions insuffisamment respectueuses des intérêts des enfants mineurs du couple71, mais l’absence de contrôle désormais porté par le juge sur la convention de divorce est tout aussi problématique au regard des intérêts de l’un des époux. Bien qu’auparavant, lorsque le divorce par consentement mutuel devait être prononcé par le juge aux affaires familiales, la convention de divorce était homologuée par le magistrat dans l’extrême majorité des situations72, le fait qu’elle soit soumise au contrôle du juge apparaissait comme un garde-fou. Conscients que, faute d’homologation de leur convention, le juge ne prononcerait pas le divorce et ajournerait sa décision jusqu’à la présentation d’une nouvelle convention73, les époux devaient s’efforcer de parvenir à des accords équilibrés et respectueux des intérêts de chacun. En outre, l’audition des époux par le juge aux affaires familiales permettait un échange à l’audience et le magistrat pouvait, avec l’accord des parties, faire supprimer ou modifier certaines clauses de la convention qui lui paraissaient contraires à l’intérêt de l’un des époux74, ce qui garantissait la mise en œuvre ultérieure d’une convention de divorce préservant les intérêts des deux époux. Désormais, en l’absence d’intervention du juge aux affaires familiales, le risque que l’un des époux accepte de signer une convention de divorce non conforme à ses intérêts est multiplié. Pour réduire ce risque, la loi du 18 novembre 2016 a prévu que chacun des époux doit être assisté de son propre avocat, ce qui devait être un gage d’équilibre, d’équité et de protection de chaque époux75. Pourtant, les avocats ne pouvant désormais plus mettre en garde leurs clients quant au risque de refus d’homologation par le juge d’une convention de divorce insuffisamment respectueuse des intérêts de l’un d’entre eux, leur marge de manœuvre se trouve nécessairement réduite face à une convention de divorce déséquilibrée. Il est donc naïf d’imaginer qu’ils disposent des moyens de contraindre leurs clients à adopter des accords plus conformes aux intérêts de chacun d’entre eux. Le rôle du notaire ayant été circonscrit au contrôle du respect des exigences formelles76, il ne sera pas davantage en mesure de s’opposer au dépôt au rang de ses minutes d’une convention de divorce attentatoire aux intérêts de l’un des époux. Quoiqu’une circulaire du 26 janvier 201777 ait invité le notaire à alerter les avocats des époux lorsqu’il constate que la convention de divorce est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, par exemple parce qu’elle comprend une clause de non-remariage ou porte atteinte aux droits résultant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il semble que les professionnels du droit aient une marge de manœuvre très limitée si les époux s’obstinaient à vouloir appliquer une convention de divorce déséquilibrée.
Mais il est possible également que l’accord établi entre les époux s’avère finalement peu conforme aux intérêts de chacun des époux. En effet, avant la réforme du divorce par consentement mutuel, il n’était pas rare que les accords intervenus lors du prononcé du divorce soient ensuite remis en cause lors d’instances modificatives78. Le divorce par consentement mutuel, qui présente l’attrait, par rapport aux autres cas de divorce, d’être plus prompt et moins onéreux, comporte aussi le risque d’aboutir à des ententes insuffisamment discutées et réfléchies. Ce risque est d’autant plus accru dans le cadre de nouveau divorce par consentement mutuel extrajudiciaire puisqu’il paraît plus accessible et peut être obtenu plus rapidement que sous l’empire des dispositions antérieures. Ainsi, soucieux de divorcer rapidement parce que l’un des époux souhaite refaire sa vie avec un nouveau compagnon ou encore pour mettre un terme à une vie conjugale devenue insupportable, les époux pourraient parvenir à des accords sur la prestation compensatoire, sur la liquidation du régime matrimonial ou sur la résidence des enfants, qui ne leur donnent pas entière satisfaction. Le risque est alors que surviennent ensuite des points de désaccord et que les relations des ex-époux se raidissent, au point d’appeler un arbitrage judiciaire au terme d’une instance modificative qui peut être particulièrement conflictuelle. Ainsi, la réforme du divorce par consentement mutuel risque d’augmenter le contentieux postérieur au divorce. Il apparaît donc que « le fait de soulager le juge du gracieux a priori [l’accable] du contentieux en imposant son intervention a posteriori »79, ce qui est loin de contribuer au désengorgement des tribunaux. Mais surtout, dans la mesure où une convention de divorce adoptée sans pleine adhésion des époux porte les germes de conflits à venir, la réforme est particulièrement nuisible aux intérêts des époux, partant à ceux de leurs enfants, et à la paix des familles.
La réforme du divorce par consentement mutuel se révèle ainsi porteuse de risques qui menacent les intérêts des époux, aussi bien au moment de leur divorce que dans la période postérieure au divorce, durant laquelle une convention bancale pourrait être appliquée et ne pas satisfaire les intéressés. Cela étant, il se peut également que les époux souhaitant divorcer parviennent à des accords parfaitement équilibrés, mais ne souhaitent pas pour autant emprunter la voie du nouveau divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, au point de chercher à contourner le dispositif aménagé par la loi du 18 novembre 2016.
II. Les risques de la réforme du divorce par consentement mutuel créés par les époux
Tandis que certains parlementaires avaient suggéré que les époux qui souhaitent divorcer par consentement mutuel aient le choix d’opter pour le divorce extrajudiciaire ou pour le divorce traditionnel prononcé par le juge aux affaires familiales80, la loi du 18 novembre 2016 n’a guère laissé d’alternative aux époux, lesquels sont tenus d’emprunter la voie du divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire lorsqu’ils sont d’accord sur la dissolution de leur union et sur ses effets. Ce nouveau droit commun du divorce par consentement mutuel n’a pas reçu la faveur de tous les avocats ni de tous les époux, qui ont parfois estimé préférable d’obtenir un divorce prononcé par le juge aux affaires familiales. D’ailleurs, certaines juridictions font état d’une augmentation considérable du nombre de demandes de divorce par consentement mutuel leur ayant été adressées entre la promulgation de la loi du 18 novembre 2016 et son entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, étant précisé que les dispositions faisant du divorce extrajudiciaire le nouveau droit commun du divorce par consentement mutuel n’étaient pas applicables aux procédures de divorce en cours lorsque la requête en divorce avait été déposée au greffe avant le 1er janvier 201781. Un juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a ainsi constaté que sa juridiction avait été saisie de 340 requêtes en divorce par consentement mutuel pour le seul mois de décembre 2016, alors qu’elle était d’ordinaire saisie d’une centaine de demandes par mois82, ce qui démontre le manque d’enthousiasme de certains avocats pour le divorce nouvelle mouture. Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats est la seule option à disposition des époux qui souhaitent divorcer en s’entendant sur la rupture du mariage et sur ses effets, mais la ferveur pour ce nouveau divorce extrajudiciaire demeure modérée. En effet, les époux peuvent estimer qu’il est préférable que leur divorce soit prononcé judiciairement, parfois conseillés en ce sens par leurs avocats, dont la responsabilité professionnelle a moins de risque d’être engagée lorsque le divorce est prononcé par le juge. Par conséquent, les époux pourraient chercher à contourner le droit commun du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, ce de deux façons.
Les époux pourraient d’abord feindre un désaccord quant aux conséquences de la dissolution de leur union, de sorte qu’ils puissent recourir à un divorce contentieux, dont le prononcé implique nécessairement l’intervention du juge. Un juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a ainsi observé une augmentation significative du nombre de requêtes conjointes en divorce accepté depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 201683. Ce type de divorce peut être demandé par les époux ou l’un d’eux lorsqu’ils s’entendent sur le principe de la rupture du mariage mais non sur ses effets, et demandent au juge de prononcer le divorce et de statuer sur ses conséquences84. De fait, les époux font mine de rencontrer des désaccords sur des points relativement mineurs, par exemple sur quelques dizaines d’euros concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, que le débiteur de la pension alimentaire est en réalité prêt à payer et auxquels le débiteur est prêt à renoncer. De cette façon, les époux peuvent obtenir du juge aux affaires familiales qu’il prononce leur divorce en réglant les conséquences de leur désunion sur lesquelles ils affichent un désaccord. Ce procédé peut être mis en œuvre lorsque les époux souhaitent que leur divorce soit prononcé par une décision de justice, laquelle présente un double avantage. D’une part, tandis que l’acte sous signature privée contresigné par avocats est susceptible d’être remis en cause par la voie de l’annulation en l’absence de certaines mentions prescrites à peine de nullité85 ou par application du droit commun des contrats86, voire par celle d’une procédure de faux87, le prononcé du divorce ne peut être attaqué que par la voie de l’appel, lequel est enfermé dans un délai nettement plus court, à savoir un mois en matière contentieuse88. D’autre part, le prononcé du divorce par décision de justice présente de meilleures garanties que les mesures prises pourront être mises en œuvre dans les autres États de l’Union européenne. Comme l’ont souligné les auteurs d’une plainte déposée auprès de la commission européenne en avril dernier89, l’acte sous signature privée contresigné par avocats, par lequel les époux peuvent divorcer en France, pourrait ne pas répondre à la définition des « décisions » dont le règlement Bruxelles II bis du 27 novembre 200390 pose les conditions de circulation dans l’Union Européenne. Ce sont en particulier les dispositions de la convention de divorce relatives à la pension alimentaire et à la prestation compensatoire qui paraissent sources de difficulté. En effet, l’article 509-3 du Code de procédure civile, modifié par la loi du 18 novembre 2016, prévoit que le notaire ayant reçu la convention de divorce au rang de ses minutes peut être requis aux fins de certification du titre exécutoire en vue de sa reconnaissance et de son exécution à l’étranger en application de l’article 39 du règlement Bruxelles II bis. Or ce texte ne vise pas les obligations alimentaires, lesquelles relèvent d’un autre règlement du 18 décembre 200891. Ainsi, les dispositions des conventions de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire ne peuvent pas être exécutées à l’étranger, ce qui rendra les procédures de recouvrement d’aliments complexes et incertaines, d’où la volonté de certains couples de recourir artificiellement à un divorce contentieux, qui procure la garantie de la circulation du jugement de divorce dans l’Union européenne.
Les époux qui recourraient à un divorce contentieux déguisé subiraient néanmoins la charge de rémunérer deux avocats, l’assistance de chaque époux par un avocat étant obligatoire dans le cadre du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage92. Désireux de faire l’économie des honoraires liés à l’intervention de deux conseils, les époux pourraient recourir à une manœuvre bien plus redoutable, qui leur permettrait de judiciariser leur divorce par consentement mutuel, tout en étant assistés par un seul avocat, commun. Le législateur a en effet prévu une exception au droit commun du divorce par consentement mutuel, lorsque l’enfant mineur des époux, capable de discernement, a manifesté son souhait d’être entendu par le juge93. Dans ce cas, les époux doivent adresser une requête au magistrat, par laquelle ils soumettent à son approbation la convention réglant les conséquences de leur divorce94. En pareille hypothèse, les époux conservent, comme avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, la possibilité d’être assistés par un avocat commun95, ce qui représente une économie substantielle par rapport au divorce extrajudiciaire, qui suppose que chaque époux soit assisté de son propre avocat. Puisque la seule manifestation de volonté du mineur d’être entendu par le juge a pour effet de judiciariser la procédure et de permettre le recours à un seul avocat pour assister les époux, ces derniers pourraient chercher à orienter la volonté de leur progéniture. Il est possible en effet que les époux manipulent leur enfant afin de le déterminer à solliciter son audition, au moyen du formulaire qui lui aura été adressé96. Les époux pourraient par exemple culpabiliser l’enfant, en lui faisant part des difficultés financières qu’ils pourraient rencontrer si, faute de demande d’audition de sa part, ils devaient divorcer par acte sous signature privée contresigné par deux avocats, qu’il leur faudrait rémunérer. Ainsi, au risque d’instrumentalisation de l’enfant par ses parents en vue de le réduire au silence, qu’il a déjà été possible de mettre en évidence97, s’ajoute le risque également important que les époux instrumentalisent l’enfant pour qu’il sollicite une audition qu’il ne désire pas. Les parents pourraient être tentés de procéder de la sorte alors même que le mineur n’est pas encore capable du discernement requis pour être entendu, car la suite de la procédure à l’égard des époux est identique, que le juge estime ou non l’enfant capable de discernement.
Dans l’affirmative, il procède à l’audition de l’enfant puis convoque les époux à une audience ultérieure98, au terme de laquelle il prononce le divorce dès lors que la volonté des époux de divorcer est réelle, que leur consentement est libre et éclairé et que la convention de divorce préserve les intérêts de l’enfant et de chaque époux99, mais la suite de la procédure est inchangée. Le défaut d’audition du mineur qui a demandé à être entendu par le juge est en effet sans incidence sur le fait que la procédure soit devenue judiciaire par son initiative, ce qui permet aux époux de conserver la possibilité de recourir aux services d’un avocat commun. Dès lors, les époux pourraient être tentés de pousser leur enfant à demander son audition, alors même qu’ils le savent trop jeune pour être entendu par le juge et qu’ils ont conscience que ce dernier refusera de l’entendre en raison de son absence de discernement, dans le seul dessein de judiciariser leur divorce et de pouvoir être assistés d’un avocat unique. En de telles circonstances, ce n’est plus l’intérêt des époux qui est menacé mais, par leur fait, l’intérêt supérieur de l’enfant qui se trouve sacrifié sous le poids d’une réforme qui ne semble profitable à personne.
B.M.
(À suivre)
II – La gestion du risque par le droit
A – Anticipation du risque
B – Les conséquences des risques réalisés
Notes de bas de pages
-
1.
Cass. ass. plén., 18 nov. 2016, n° 15-21438, v. égal. le rapport du conseiller M. Echappé, l’avis du procureur général M. Marin et son avis complémentaire.
-
2.
Comité des droits de l’Homme, 21 oct. 2010, n° 1760/2008, X c/ France.
-
3.
CJCE, 30 sept. 2003, n° C-224/01, Kobler – v. récemment CJUE, 28 juill. 2016, n° C-168/15.
-
4.
CE, 18 juin 2008, n° 295831, Gestas.
-
5.
CE, 21 sept. 2016, n° 394360.
-
6.
Au cas particulier, l’arrêt de la chambre criminelle contesté a été rendu le 19 septembre 2007 (Cass. crim., 19 sept. 2007, n° 06-85899), à une époque où le principe de rétroactivité in mitius était énoncé de manière large (CJCE, 3 mai 2005, n° C-387/02, Berlusconi).
-
7.
V. Sordino M.-C., « Principe de rétroactivité in mitius en droit pénal : nouveaux développements », AJ pénal, 2017, p. 125.
-
8.
CJUE, 6 oct. 2016, n° C-218/15, Gianpaolo Paoletti : « l’article 6 TUE et l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens que l’adhésion d’un État à l’Union ne fait pas obstacle à ce qu’un autre État membre puisse infliger une sanction pénale à des personnes ayant commis, avant cette adhésion, le délit d’assistance à l’immigration illégale en faveur de ressortissants du premier État ».
-
9.
Op. cit.
-
10.
Cons. const., 3 déc. 2010, n° 2010-74 QPC.
-
11.
CJUE, 12 nov. 2009, n° C-154/08, Commission c/ France.
-
12.
Cass. crim., 23 nov. 2016, n° 15-82333.
-
13.
Disant M., « La responsabilité de l’État du fait de l’interprétation jurisprudentielle de la loi. Imprécision de la loi vs. Interprétation jurisprudentielle inattendue », LPA 30 oct. 2015, p. 5 et s.
-
14.
L’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, JORF 122, 27 mai 2016.
-
15.
C. éduc., art. L. 612-7, modifié par L. n° 2013-660, 22 juill. 2013, art. 35 et 38, www.legifrance.fr.
-
16.
Ibid. in limine.
-
17.
Article 2 de l’arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, version consolidée au 28 mai 2015, www.legifrance.fr.
-
18.
Le document de travail est accessible à l’adresse www.letudiant.fr.
-
19.
V. les nombreuses réactions, notamment de la Conférence des jeunes chercheurs, sur www.letudiant.fr ou encore de l’Association nationale des Docteurs, www.andes.asso.fr.
-
20.
Document de la Conférence nationale des directeurs des écoles doctorales en droit, réunie en marge du colloque organisé par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à Paris les 13 et 14 avril 2015, non publié. La Conférence des Doyens de droit et de science politique ainsi que le Conseil national du Droit s’en émeuvent également.
-
21.
Il faut aussi préciser ce qui tient aux représentations sociales : la formation n’est pas un travail parce qu’elle n’est pas payée, c’est une question générale de culture et représentation du travail.
-
22.
C. rech., art. L. 411-4 modifié par art. 82 de L. n° 2013-660, 22 juill. 2013, www.legifrance.fr. À notre connaissance, la commission n’a pas été réunie avant le 1er janvier 2016.
-
23.
C. éduc., art. L. 612-7, op. cit.
-
24.
Article 2 de l’arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, op. cit. L’article 4 va dans le même sens. L’article 16 précise en outre que « Au cours de leur parcours de formation doctorale, les doctorants suivent des formations d’accompagnement et participent à des enseignements, séminaires, missions ou stages organisés dans le cadre de l’école doctorale ».
-
25.
Article 17 de l’arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, op. cit.
-
26.
Article 18 de l’arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, op. cit.
-
27.
Article 18 de l’arrêté fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, op. cit.
-
28.
Article 19 de l’arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, op. cit.
-
29.
La Commission permanente du Conseil national des universités – CP-CNU – souligne les dangers d’une telle proposition, dans un communiqué du bureau du 27 mai 2015, « Quelques dangers du projet d’arrêté relatif au diplôme national de doctorat », www.cpcnu.fr.
-
30.
Il serait même possible d’aller plus loin : entre les différents contrôles en amont, les contrôles en cours (comité de suivi) et cette disposition l’excluant du suffrage de la soutenance, le directeur de thèse est littéralement mis sous tutelle.
-
31.
Article 13, ibid.
-
32.
Article 14 alinéas 1 et 3 de l’arrêté fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat en préparation, préc. : « La préparation du doctorat s’effectue en 3 ans maximum. (…) Des dérogations, dans la limite de 2 années supplémentaires, peuvent être exceptionnellement accordées par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’école doctorale et après avis du directeur de thèse, du comité de suivi individuel du doctorant et du conseil de l’école doctorale, sur demande motivée du candidat ». La réunion de l’ensemble de ces autorisations rend l’obtention d’une dérogation pour le moins hypothétique.
-
33.
L. n° 2013-660, 22 juill. 2013, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche : JORF 169, 23 juill. 2013, p. 12235.
-
34.
Toutefois, à l’issue des travaux de la Commission mixte paritaire réunie après une lecture de chacune des chambres en raison de l’engagement de la procédure accélérée par le gouvernement, on peut noter que le titre de docteur ne peut suffire pour accéder au deuxième concours de l’ENA, contrairement à la proposition faite par l’Assemblée nationale. Cette reconnaissance aurait fait du doctorat un équivalent de 4 années d’activité dans le service public de la recherche, ce que le gouvernement a refusé de valider au Sénat en faisant voter un amendement.
-
35.
L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 50, de modernisation de la justice du XXIe siècle : JO n° 0269, 19 nov. 2016.
-
36.
C. civ., art. 229-1, al. 1er.
-
37.
CPC, art. 1145.
-
38.
C. civ., art. 229-3 et CPC, art. 1144-1 et s.
-
39.
C. civ., art. 229-1, al. 2.
-
40.
C. civ., art. 229-1, al. 3.
-
41.
C. civ., art. 229-2, 1° et C. civ., art. 230.
-
42.
C. civ., art. 229-2, 2°.
-
43.
L’article 249-4 du Code civil affirme en effet que « lorsque l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection (…), aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée ».
-
44.
L. n° 2004-439, 26 mai 2004, art. 7, relative au divorce : JO n° 122, 27 mai 2004.
-
45.
C. civ., art. 247 anc.
-
46.
C. civ., art. 247, 1°.
-
47.
C. civ., art 247, 2° ; dans ce cas, le texte prévoit que les époux peuvent demander au juge de constater leur accord, en lui présentant une convention réglant les conséquences de leur divorce, de sorte que celui-ci soit prononcé par consentement mutuel.
-
48.
Amendement n° CL186 au projet de loi n° 3204 relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, présenté le 30 avril 2016 par le gouvernement, adopté.
-
49.
V. not. le dossier « Justice 21 : Questions – réponses sur la réforme du divorce par consentement mutuel » diffusé en nov. 2016 par le ministère de la Justice.
-
50.
99,9 % selon le garde des Sceaux : dossier de présentation « Justice 21 : Réforme de modernisation de la justice du XXIe siècle » diffusé en nov. 2016 par le ministère de la Justice.
-
51.
V. en ce sens Tasca C. et Mercier M., « Rapport d’information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale sur la justice familiale », n° 404, 26 févr. 2014, p. 37-38.
-
52.
V. infra.
-
53.
C. civ., art. 250, al. 1er.
-
54.
C. civ., art. 229-1, al. 1er.
-
55.
C. civ., art. 50.
-
56.
L. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 10, relative à l’aide juridique : JO n° 162, 13 juill. 1991.
-
57.
Exposé sommaire de l’amendement n° CL186 au projet de loi n° 3204, préc.
-
58.
Environ 80 % des couples divorçant par consentement mutuel faisaient le choix de recourir à un avocat commun : Détraigne Y., « Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale sur le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle », 21 sept. 2016, p. 86.
-
59.
Le garde des Sceaux a affirmé en 2016 que la procédure de divorce par consentement mutuel durait en moyenne 7 mois : Dossier de présentation « Justice 21 : Réforme de modernisation de la justice du XXIe siècle », préc. L’Annuaire statistique de la justice fait, pour sa part, état d’une durée moyenne de 2,7 mois pour l’année 2010 : Annuaire statistique de la justice, 2011-2012, La Documentation française, p. 73.
-
60.
D. n° 2016-1907, 28 déc. 2016 relatif au divorce prévu à l’article 229-1 du Code civil et à diverses dispositions en matière successorale : JO n° 0302, 29 déc. 2016.
-
61.
C. civ., art. 229-4, al. 1er.
-
62.
CPC, art. 1146, al. 1er.
-
63.
C. civ., art. 1146, al. 3.
-
64.
Comme le relevait un député lors de la discussion du texte à l’Assemblée nationale : V. le compte rendu de la première séance du 12 juill. 2016, intervention de Gosselin P.
-
65.
V. le compte rendu de la deuxième séance du 17 mai 2016, intervention de Coronado S.
-
66.
V. le compte rendu de la deuxième séance du 19 mai 2016, intervention de Coutelle C. Plusieurs parlementaires ont d’ailleurs proposé, lors des travaux parlementaires, d’exclure le recours au divorce par consentement mutuel sans juge dans les situations de violences conjugales : v. not. l’amendement n° COM-35 à l’article 17 ter du projet de loi, présenté le 19 sept. 2016 par Benbassa E. et a, rejeté.
-
67.
V. par ex. le communiqué diffusé le 26 octobre 2016 par la Fédération nationale solidarité femmes : « Non à une simplification de la justice qui pénalise femmes et enfants ».
-
68.
C. civ., anc. art. 230.
-
69.
C. civ., art. 232, al. 1er.
-
70.
C. civ., art. 232, al. 2.
-
71.
Mallevaey B., « L’intérêt de l’enfant et la réforme du divorce par consentement mutuel », LPA 29 juin 2017, n° 127p1, p. 6.
-
72.
V. supra.
-
73.
CPC, art. 1100.
-
74.
C. civ., art. 1099, al. 2.
-
75.
V. au sein des discussions du texte par l’Assemblée nationale, le compte rendu de la deuxième séance du 17 mai 2016, intervention de Urvoas J.-J., garde des Sceaux.
-
76.
C. civ., art. 229-1, al. 3.
-
77.
Circ. CIV/02/17 du 26 janv. 2017 de présentation des dispositions en matière de divorce par consentement mutuel et de succession issues de la loi n° 2016-1547 du 18 nov. 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n° 2016-1907 du 28 déc. 2016 relatif au divorce prévu à l’article 229-1 du Code civil et à diverses dispositions en matière successorale.
-
78.
Delmas-Goyon P., « Le juge du XXIe siècle – Un citoyen acteur, une équipe de justice », rapport à la garde des Sceaux, ministre de la Justice, déc. 2013. p. 70
-
79.
Serra G., « De la question du divorce sans faute et sans juge », in Mélanges en l’honneur de la professeure Françoise Dekeuwer-Défossez, Liber amicorum, 2012, Montchrestien, Lextenso, p. 357.
-
80.
V. not. l’amendement n° COM-78 à l’article 17 ter du projet de loi, présenté le 19 sept. 2016 par Détraigne Y.
-
81.
Art. 114, V, de la loi du 18 nov. 2016.
-
82.
Entretien réalisé à Bordeaux le 5 juillet 2017.
-
83.
Entretien téléphonique réalisé le 16 juin 2017. Cet état de fait montre derechef le caractère illusoire de l’objectif de la réforme lié au désencombrement des tribunaux.
-
84.
C. civ., art. 233 et 234.
-
85.
C. civ., art. 229-3.
-
86.
Comme l’a signalé la circulaire du 26 janv. 2017 préc., le caractère conventionnel du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats rend applicable à la convention le droit commun des contrats.
-
87.
L’article 1374, alinéa 2, du Code civil précise en effet que la procédure de faux prévue par le Code de procédure civile est applicable aux actes sous signature privée contresignés par avocats.
-
88.
CPC, art. 1114 et 538.
-
89.
Plainte auprès de la commission européenne pour violation par la France du droit de l’Union européenne – Violation par la France du droit de l’Union européenne suite à la réforme du divorce entrée en vigueur le 1er janvier 2017, déposée en avril 2007 par Nourissat C., Boiche A, Eskenazi D., Meier-Bourdeau A. et Thuan dit Dieudonné G.
-
90.
Règl. (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 nov. 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 : JOUE n° L338, 23 déc. 2003.
-
91.
Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 déc. 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires : JOUE n° L7, 10 janv. 2009.
-
92.
C. civ., art. 253.
-
93.
C. civ., art. 229-2, 1°.
-
94.
C. civ., art. 230.
-
95.
C. civ., art. 250, al. 1er.
-
96.
Le décret du 28 déc. 2016 a prévu à l’article 1144 du Code de procédure civile que le mineur est informé de son droit de se faire entendre par le juge au moyen d’un formulaire, dont la forme a été précisée par un arrêté du garde des Sceaux du 28 déc. 2016 fixant le modèle de l’information délivrée aux enfants mineurs capables de discernement dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire : JO n° 0302, 29 déc. 2016.
-
97.
Mallevaey B., « L’intérêt de l’enfant et la réforme du divorce par consentement mutuel », art. préc.
-
98.
CPC, art. 1092, al. 2.
-
99.
C. civ., art. 232 ; CPC, art. 1099.