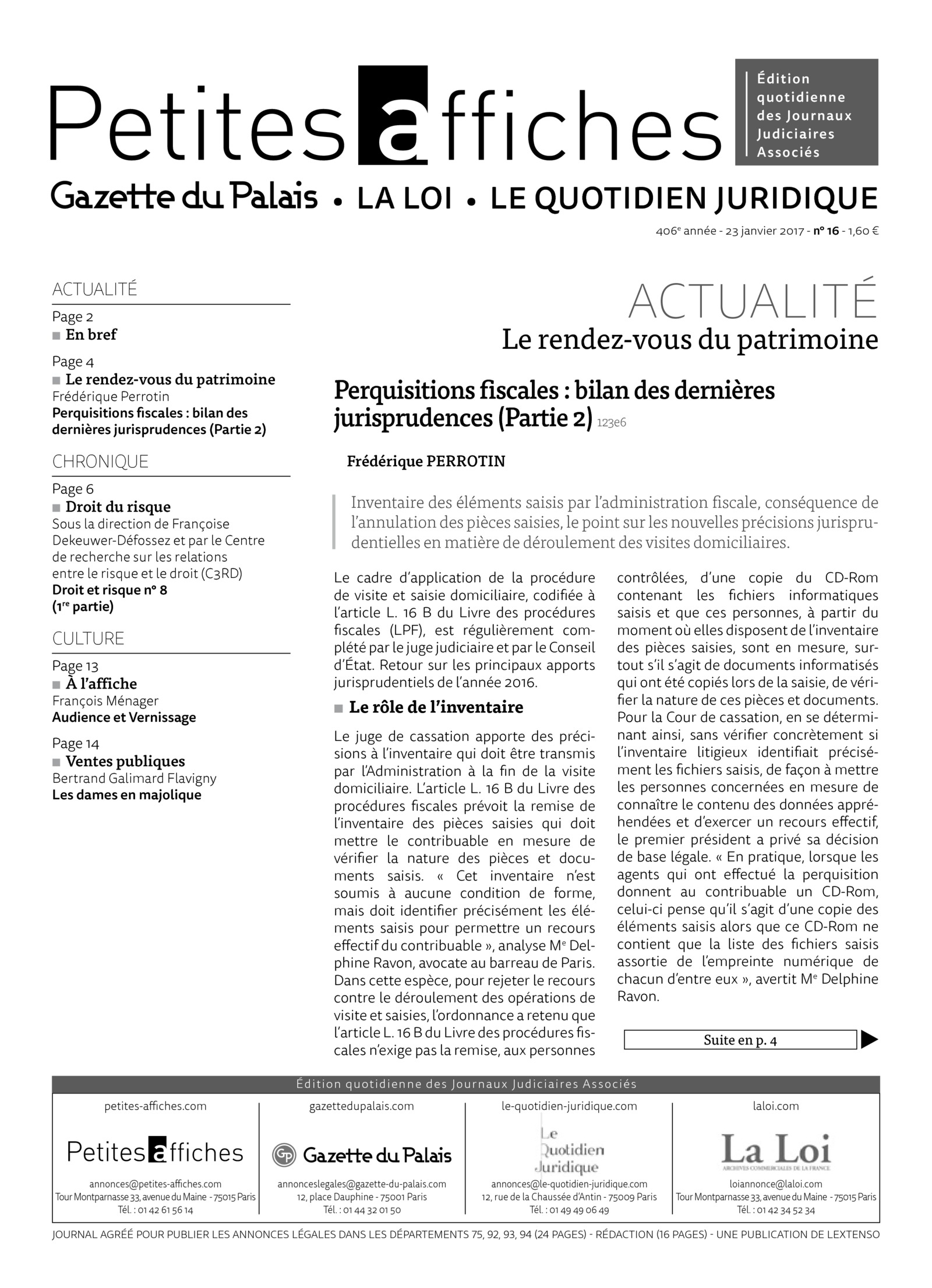Droit et risque n° 8 (1re partie)
Cass. com., 1er déc. 2016, no 14-20688
CEDH, 22 mars 2016, no 646/10, M. G.
L. n° 2016-297, 14 mars 2016 : relative à la protection de l’enfant
Avant-propos
Cette huitième chronique des tumultueuses rencontre du risque et du droit s’ouvre, comme chaque année, par l’observation des multiples occurrences dans lesquelles c’est le droit lui-même qui est source de risques et notamment d’insécurité ou de discrimination.
Les lois de validation sont particulièrement intéressantes à cet égard, et leur examen par le Conseil constitutionnel, qui repose sur une analyse des risques supposés être corrigés par la loi, en termes de proportionnalité et de supportabilité est particulièrement instructif1.
Mais il existe bien d’autres exemples de textes destinés à améliorer la sécurité juridique, dont la mise en œuvre révèle qu’elles créent de nouvelles difficultés : il en va ainsi de la loi sur la protection de l’enfance, qui renforce la sécurité juridique et fiscale des enfants adoptés simplement lorsque leur parent décède pendant la minorité, mais crée de ce fait une discrimination entre les enfants adoptés simplement selon que leurs parents décèdent avant ou après leur majorité2, ou encore de l’article L. 622-17 du Code de commerce, censé sécuriser l’exploitation des entreprises pendant la procédure collective, dont l’interprétation ouvre à de nombreuses incertitudes3
La réintroduction de l’inceste dans le Code pénal par l’effet de la loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfant est un autre exemple de texte engendrant plus d’incertitudes que d’amélioration. Le parti pris de « nommer » l’inceste sans en aggraver la répression, et sans préciser les éléments constitutifs de l’infraction aboutit à un texte qui n’apporte en définitive aucun progrès en matière de répression, et, bien au contraire, souligne la perfectibilité des notions auxquelles il renvoie et l’incohérence de plus en plus profonde du régime répressif des infractions sexuelles.
La gestion des risques par le droit montre les difficultés considérables auxquelles confrontent les nouveaux types de risques envisagés par le droit. La volonté affichée par la Cour européenne des droits de l’Homme d’imposer aux États la prévention des violences conjugales4 se heurte à des impossibilités de fait, tandis que la réparation du préjudice écologique, acceptée par la Cour de cassation dans l’attente de la loi annoncée sur ce sujet, ne manque pas d’engendrer nombre de difficultés, notamment au regard des personnes susceptibles de la solliciter, et du chiffrage du dommage écologique5.
I – Les risques du droit
A – L’insécurité juridique
La constitutionnalité au prisme du risque (À propos du contentieux constitutionnel des validations législatives)
Le Conseil constitutionnel se prêterait-il à une analyse des risques ? Rendues à quelques jours d’intervalle, sur des sujets sensibles tant politiquement que techniquement, deux récentes décisions du Conseil constitutionnel en témoignent dans le contentieux constitutionnel des validations législatives, domaine dans lequel la prise en compte de l’analyse des risques est liée à l’objet même de la loi.
D’une part, dans la décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016 relative, une nouvelle fois, à la question des droits à pension des rapatriés, le Conseil constitutionnel était saisi du paragraphe II de l’article 52 de la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Il a censuré cette validation rétroactive des décisions de refus opposées par l’Administration aux demandes d’allocations et de rentes formées par les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives relevant du statut civil de droit commun.
D’autre part, dans la décision n° 2015-525 QPC du 2 mars 2016 concernant la taxe foncière, le Conseil constitutionnel était saisi du paragraphe III de l’article 32 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Ces dispositions procédaient à une validation destinée à limiter les conséquences d’une décision du Conseil d’État du 5 février 2014 qui, pour l’application de la méthode d’évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux prévue au 2° de l’article 1498 du Code général des impôts, a jugé qu’un local-type qui a été entièrement restructuré ou détruit ne peut plus servir de terme de comparaison pour évaluer la valeur locative d’un bien soumis à la taxe foncière.
Les dispositions contestées excluaient ainsi la possibilité pour les contribuables de se prévaloir du motif d’irrégularité tiré de ce que le terme de comparaison utilisé, directement ou indirectement, pour fonder l’évaluation de la valeur locative d’un local commercial ou d’un local à usage d’habitation ou professionnel autre que commercial a été détruit ou a changé de consistance, d’affectation ou de caractéristiques physiques, en vue d’une remise en cause de l’évaluation de la valeur locative des immeubles concernés, y compris pour les impositions postérieures au 1er janvier 2015, dès lors que cette évaluation a été réalisée avant le 1er janvier 2015. Là encore, une décision de non-conformité a été rendue.
Les deux censures sont fondées sur l’article 16 de la Déclaration de 1789. On le sait, c’est sur cette base que reposent le contrôle des lois de validation et plus largement le traitement constitutionnel aujourd’hui plus étroit des lois civiles rétroactives. Selon une jurisprudence bien établie, plusieurs fois réaffirmée en QPC, cinq conditions sont requises pour que leur conformité à la Constitution soit reconnue. Quatre d’entre elles ne posaient aucune difficulté dans les deux espèces rapportées : la validation respectait les décisions de justice ayant force de chose jugée (faute de quoi, c’est le principe de la séparation des pouvoirs qui serait méconnu) et le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; l’acte validé ne méconnaissait aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle (dans le cas contraire, le but d’intérêt général visé par la validation doit lui-même être de valeur constitutionnelle) ; la portée de la validation était strictement définie.
C’est le critère tenant à la finalité justificative de la validation qui, comme souvent, était en débat. Depuis sa décision n° 2013-366 QPC du 14 février 20146, le Conseil constitutionnel exige que la validation « soit justifiée par un motif impérieux d’intérêt général », là où la poursuite d’un « but d’intérêt général suffisant » était antérieurement requis. Il a ainsi été mis fin en grande pompe à une dissonance avec la terminologie retenue par la jurisprudence de la CEDH. C’est non seulement son pouvoir de contrôle sur le législateur que renforce le Conseil, mais aussi sa maîtrise du contrôle de la validité de la loi.
Faisant application de ce critère, les deux décisions rapportées permettent d’apprécier « sur pièces » la portée de cette modification et de vérifier que le Conseil constitutionnel intensifie son contrôle en la matière, sans être nécessairement dans le sillage du contrôle conventionnel comme on pourrait vouloir systématiquement l’y ranger. En termes de régulation interne des systèmes, l’enjeu juridique se déplace discrètement mais sûrement sur la qualité de dépositaire de l’interprétation authentique de « l’impérieux ». En termes de contenu du contrôle, qui nous retiendra dans les lignes qui suivent, le rapprochement de ces deux décisions met en lumière les paramètres et modalités d’appréciation du juge constitutionnel dans un contentieux qui prend le risque pour objet.
Qu’en est-il exactement dans nos deux affaires ?
Dans la décision n° 2015-522 QPC, le Conseil a relevé, tout d’abord, que le droit des intéressés à bénéficier d’une allocation de reconnaissance avait été ouvert pendant plus de trente-quatre mois. Ensuite, les dispositions contestées avaient pour effet d’entraîner l’extinction totale de ce droit, y compris pour les personnes ayant engagé une procédure administrative ou contentieuse en ce sens à la date de leur entrée en vigueur. Enfin, l’existence d’un enjeu financier n’était pas démontrée. Le Conseil constitutionnel en a déduit que la volonté du législateur de rétablir un dispositif d’indemnisation, bien que correspondant pour partie à son intention initiale, ne constituait pas en l’espèce un motif impérieux d’intérêt général.
Dans la décision n° 2015-525 QPC, le Conseil a jugé, d’une part, qu’il n’était pas établi que, du fait de la décision du Conseil d’État du 5 février 2014, le nombre de contestations de la fixation des valeurs locatives s’accroisse dans des conditions de nature à perturber l’activité de l’administration fiscale et de la juridiction administrative. Il a jugé, d’autre part, que compte tenu de l’incertitude pesant sur l’issue d’une contestation de la valeur locative d’un local fondée sur le caractère inapproprié du terme de comparaison utilisé par l’Administration quant au montant de la cotisation d’impôt fixée finalement, l’existence d’un risque financier pour l’État et les collectivités territoriales n’était pas établie. Le Conseil en a déduit qu’aucun motif impérieux d’intérêt général ne justifiait l’atteinte portée par les dispositions contestées aux droits des contribuables.
À regarder de plus près, le risque devient plus nettement un élément du langage du juge constitutionnel au service d’une appréciation fine du critère justificatif (I), et au moyen d’outils orientés vers l’appréciation des risques par le juge (II).
I. L’appréciation en termes de risque
L’appréciation en termes de risque se déploie dans un double temps de raisonnement.
D’une part, le Conseil constitutionnel intègre implicitement, dans l’analyse « motif impérieux d’intérêt général », la protection de la sécurité juridique et celle des situations légalement acquises.
Dans la décision n° 2015-522 QPC, il relève que les dispositions litigieuses « sont restées en vigueur plus de trente-quatre mois », ce qui revient à déceler implicitement, dans de telles conditions, une attente légitime de la requérante au maintien de son droit à recevoir une allocation. Il vaut de corriger sans tarder les effets pervers des censures prononcées par le Conseil constitutionnel ! Tel est l’enseignement pour le législateur, lequel « ne saurait se tirer d’affaire par la grâce d’une validation législative »7.
Dans l’affaire n° 2015-525 QPC, c’est l’intelligibilité de la loi fiscale qui était implicitement mise en cause, faute de révision des valeurs locatives engagée par le législateur. On est en droit de penser que la loi de validation en question faisait, en fait, supporter aux contribuables le résultat des carences de l’administration fiscale dans l’exécution de sa mission de mise à jour des évaluations foncières prévues par le Code général des impôts.
D’autre part, le Conseil inclut les considérations économiques et financières dans son contrôle de l’impérieux motif d’intérêt général.
Dans la décision n° 2015-522 QPC, il considère que « l’existence d’un enjeu financier important pour les finances publiques lié à ces dispositions n’est pas démontrée ». L’intégration du prisme financier dans le contrôle de la justification des validations législatives est un débat connu qui trouve désormais une reconnaissance explicite8. En l’espèce, cela revient pour le Conseil à évaluer les conséquences d’une de ses propres décisions, celle du 4 février 2016 en l’occurrence9, laquelle avait invalidé la distinction basée sur la nationalité et permis que davantage de personnes puissent demander le bénéfice de l’allocation. Un « coût » pour le budget de l’État évalué jusqu’à 270 millions d’euros. Que le législateur a tenté de prévenir en réduisant le nombre de personnes potentiellement bénéficiaires de l’allocation. Le Conseil ne livre aucun seuil ni aucune modalité de calcul, pas plus qu’il ne donne accès aux modalités d’une telle expertise, mais il s’éloigne manifestement de l’analyse économique développée lors des travaux préparatoires.
Dans l’affaire n° 2015-525 QPC, le législateur entendait faire obstacle aux effets économiques de l’arrêt précité du Conseil d’État10, lequel avait remis en cause la méthode d’évaluation de l’assiette de la taxe foncière. L’équilibre du dispositif des évaluations de valeurs locatives, déjà obsolète, s’en est trouvé perturbé, au point de conduire le législateur à aligner rétroactivement les règles en cause par une manœuvre validante.
Le Conseil évalue les arguments retenus par le Gouvernement – « éviter le développement d’un contentieux de masse », prévenir un « risque financier pour l’État et les collectivités territoriales » – pour s’en écarter car non établis. Ce n’est pas la réalité factuelle du risque qui est remise en cause, c’est, d’une part, la détermination précise des conséquences (de toutes natures) invoquées et, d’autre part, la qualification constitutionnelle du risque dans la grille jurisprudentielle relative aux validations et autres mesures rétroactives. Un contrôle de l’existence pour l’un, une appréciation du degré de risque encouru pour l’autre.
Ce dernier élément est le plus remarquable. Il appelle quelques observations quant à ses modalités.
II. Les modalités d’appréciation des risques
Le Conseil constitutionnel ne se limite pas à retranscrire sur parole l’intention du législateur, moins encore à prendre le chiffrage communiqué pour argent comptant. Il progresse vers une analyse autonome de la réalité et d’une certaine façon de la proportionnalité des risques invoqués, voire d’une évaluation de leur acceptabilité. Le contrôle gagne en dynamisme et en finesse, pour rechercher avec précision les éventuels effets d’aubaine de la validation comme pour prendre en considération les « filets de sécurité » existants en droit positif, le tout en fonction des vertus curatives ou analgésiques de la validation législative et des risques générés par le maintien du statu quo que la validation était sensée corriger.
Ainsi, dans l’affaire n° 2015-525 QPC, le Conseil constitutionnel estime qu’« il n’est pas établi que (…) le nombre de contestations de la fixation des valeurs locatives s’accroisse dans des conditions de nature à perturber l’activité de l’administration fiscale et de la juridiction administrative ». Le risque de perturbation du service public est ainsi écarté en l’espèce, sans manquer pourtant de sérieux compte tenu des charges administratives en jeu11. Il faut reconnaître qu’un tel risque est, par nature, difficilement évaluable. Sait-on seulement évaluer le risque contentieux avec suffisamment de précision pour être invocable, lorsqu’il est de « masse », dans le contentieux constitutionnel renforcé ? Il semble qu’en l’espèce les observations tirées de la pratique administrative, qui témoignent des difficultés d’engager avec succès les contestations en question12, ont pu jouer un rôle d’indicateur dans le raisonnement retenu par le Conseil constitutionnel.
Surtout, au terme d’un considérant très détaillé qui rappelle qu’une irrégularité ne conduit pas à la décharge de l’impôt, et dans la mesure où « l’issue d’une contestation de la valeur locative (…) est incertaine quant au montant de la cotisation d’impôt fixée finalement », le Conseil conclut que « l’existence d’un risque financier pour l’État et les collectivités territoriales n’est pas établie ». Ce qui revient à dire non seulement qu’une validation législative ne peut avoir pour seul objet de faciliter l’office de l’administration fiscale, mais surtout qu’il n’existe aucun risque d’absence de taxation compte tenu de la jurisprudence administrative constante selon laquelle le juge ne peut jamais prononcer la décharge d’une taxe foncière à laquelle un contribuable est assujetti. Le risque budgétaire se trouve ainsi écarté, tant du point de vue des dégrèvements potentiels qu’au regard des éventuelles réclamations d’indemnités de la part des collectivités territoriales affectataires. Comme cela a pu être relevé, « les chances pour le contribuable d’obtenir, au prix d’une procédure semée d’obstacles, la minoration de sa cotisation de taxe foncière sont réduites et toujours incertaines »13.
On pourra voir dans ces décisions la « conséquence d’une analyse économique concrète et réaliste »14. Toutefois, on aurait tort de considérer que ce type d’analyse serait inéluctablement de nature à concrétiser le contrôle de constitutionnalité. Le cadre d’intervention du Conseil constitutionnel demeure inscrit dans un contentieux objectif et abstrait, sans que celui-ci n’ait jamais été dénué d’une prise en compte des réalités factuelles et autres éléments de contexte environnant les dispositions législatives examinées. Un tel cadre n’empêche pas de déployer une évaluation objectivée des risques, en tant que paramètre d’appréciation de l’impérieux motif d’intérêt général, dans la limite du rôle grandissant que le juge constitutionnel peut être tenté d’exercer dans l’appréciation de l’intérêt général. Il n’empêche nullement, on le voit, un contrôle approfondi et réaliste de la constitutionnalité de la loi.
Cette projection du juge constitutionnel dans la gestion des risques n’est sans doute pas étrangère à l’élévation du degré de contrôle des lois de validation. Les risques invoqués dans l’affaire n° 2015-525 QPC liés à l’effondrement d’un système d’évaluation en matière fiscale, auraient sans doute été jugés suffisants en l’état antérieur de la jurisprudence. Ce n’est plus le cas au regard du critère de l’impériosité. Le resserrement du contrôle des validations sur le terrain constitutionnel, et sans doute à terme la protection générale de la sécurité juridique, est aujourd’hui bien engagé, au point de donner le change au contrôle de conventionnalité.
Mathieu Disant
La sécurisation du lien de parenté par la reconnaissance fiscale de l’enfant mineur adopté simple
La loi n° 2016-297 du 14 mars 201615 relative à la protection de l’enfant16 sécurise le lien de parenté établi entre l’adoptant et l’adopté simple en assurant la reconnaissance fiscale de ce lien. L’article 36 de la loi modifie et complète le dispositif fiscal complexe existant en matière de succession dans le cadre de l’adoption simple17. Jusqu’alors, le Code général des impôts prévoyait en son article 786 que « [pour] la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple »18, sauf circonstances dérogatoires expressément prévues aux alinéas suivants. La solution retenue était donc celle de la disparition pure et simple du lien de parenté, sauf à pouvoir en prouver19 l’existence.
Cet article 786 CGI trouve sa justification dans « l’histoire » de l’adoption simple20, laquelle initialement réservée aux majeurs (Code civil de 1804) n’a été étendue aux enfants mineurs que par la loi du 19 juin 192321. Rapidement, les dispositions fiscales relatives aux droits en matière de succession ont été transformées en textes anti-abus, des majeurs ayant par ailleurs choisi de s’adopter réciproquement dans le seul but d’échapper à une partie de l’impôt dû. Le paradoxe de la protection de l’enfant par l’adoption et de la fraude fiscale était né : l’ouverture de l’adoption simple aux mineurs en 1926 avait pour objectif de les protéger, mais la question des droits de l’enfant ne se posant pas alors en ces termes, le même traitement fiscal est imposé aux adultes et aux enfants mineurs : ainsi « de peur que l’adoption simple ne soit utilisée que pour des raisons purement fiscales, le législateur a neutralisé les effets [fiscaux] du lien de parenté créé par l’adoption »22.
La justification de la lutte contre la fraude fiscale dans le cas de l’adoption simple d’un mineur semble difficile à apporter, surtout en cas de décès de l’adoptant pendant la minorité de l’adopté, ainsi, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 mars 2016, l’article 786 du CGI – prévoyant sept hypothèses dans lesquelles le lien de parenté résultant de l’adoption simple n’est pas ignoré – dispose que les « adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus » seront soumis à la perception des droits de mutation à titre gratuit. Il appartenait donc au mineur d’apporter tous les éléments de preuve exigés par l’administration fiscale.
Désormais, au terme de l’article 36 de la loi du 14 mars 2016, les nouveaux 3° et 3° bis précisent que l’article 786 CGI in limine n’est pas applicable aux transmissions faites en faveur « 3° D’adoptés mineurs au moment du décès de l’adoptant ; 3° bis D’adoptés majeurs au moment du décès de l’adoptant qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale ». L’enfant mineur adopté simple est reconnu fiscalement comme un enfant en cas de décès de l’adoptant pendant sa minorité et dispose des mêmes droits que l’enfant biologique ou adopté plein : les transmissions à titre gratuit sont désormais imposées comme les transmissions en ligne directe, et non plus à 60 % comme le sont les tiers à la succession. Sa sécurité fiscale est assurée : la charge de la preuve de la réalité des soins et secours permettant d’établir fiscalement le lien de parenté ne pèse plus sur ses épaules (ni sur celles de son tuteur23).
Toutefois, l’article 36 introduit une distinction nette entre cette situation et celle de l’adopté simple majeur lors du décès de l’adoptant : dans ce second cas, l’adopté devra apporter la preuve du lien de parenté en démontrant qu’il a reçu de l’adoptant des secours et des soins non ininterrompus au titre d’une prise en charge continue et principale, soit pendant cinq ans alors qu’il était mineur, soit pendant dix ans au moins pendant sa minorité et sa majorité. La première hypothèse pose la question de l’égalité entre le mineur adopté simple dont le parent adoptant décède la veille de sa majorité (lequel verra son statut aligné sur les conditions et tarifs applicables en ligne directe, le 3° de l’article 786 du CGI s’appliquant) et le mineur adopté simple dont le parent décède le lendemain de sa majorité, qui lui devra apporter la preuve des soins et secours ininterrompus pendant cinq ans au cours de sa minorité. Une telle situation présente un risque d’inégalité de traitement entre des enfants d’une même famille – voire d’exclusion du bénéfice des dispositions de l’article 786-3° du CGI, situation ubuesque au regard de l’objectif poursuivi par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, centrée sur l’intérêt supérieur de l’enfant. La rencontre de deux catégories d’intérêts explique cette situation, sans toutefois pouvoir la justifier : l’intérêt supérieur de l’enfant et l’intérêt fiscal.
Ainsi, si la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant24 sécurise le lien de parenté en cas de décès de l’adoptant pendant la minorité de l’adopté en faisant primer l’intérêt supérieur de l’enfant, au contraire, elle ne parvient pas à éliminer tout risque d’inégalité fiscale entre les enfants adoptés simples : ce résultat est largement le produit du processus législatif aboutissant à l’adoption de la loi.
La priorité est désormais accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant qui prévaut sur le risque théorique d’abus qui pourrait résulter d’une adoption simple voulue seulement pour éviter le paiement d’une partie des droits de succession normalement versés25. En ce sens, l’article 36 de la loi est une disposition de justice fiscale : elle redonne du sens à la filiation établie par l’adoption simple et la rapproche de l’adoption plénière et sécurise le lien de parenté de l’enfant adopté simple avec l’adoptant. Toutefois, bien que la distinction entre enfant mineur et majeur soit compréhensible en tant qu’elle vise la protection du mineur supposé plus faible, elle demeure source potentielle d’inégalité entre des enfants dont le sort est scellé par la date du décès du parent adoptant. Il est intéressant de voir et de comprendre comment, lors des débats parlementaires ces risques ont été traités : la question de la constitutionnalité de la disposition n’a pas été soulevée mais elle a plané sur les débats et conduit à l’adoption d’un texte qui n’a pas été réfléchi dans sa globalité ; cette question n’a pas résisté à l’intérêt supérieur de l’enfant ni à la recherche d’égalité entre les enfants. La quête de la protection de l’enfant mineur adopté simple a surpassé tous les écueils, au risque de conduire à d’autres inégalités – sauf l’interprétation qui serait donnée aux dispositions concernées.
L’ensemble des débats s’est organisé autour de l’intérêt supérieur de l’enfant, sur la base de la proposition de loi déposée par les sénatrices Michèle Meunier et Muguette Dini déposée au Sénat le 11 septembre 201426 ainsi que le précise le texte : « Cette proposition de loi vient (…) compléter la loi précitée et rappeler que, dans tous les cas, l’intérêt de l’enfant doit être la préoccupation centrale du dispositif de protection de l’enfance »27. Ce faisant, l’intérêt supérieur de l’enfant s’est imposé face au risque théorique d’abus fiscal ayant justifié les dispositions fiscales énoncées et a permis de mettre fin à une discrimination entre mineurs adoptés simples et mineurs adoptés pleins.
La loi du 14 mars 2016 s’est efforcée de prendre en compte la situation des enfants adoptés simples dans sa globalité, allant jusqu’à mettre fin à une injustice pour l’avenir tout en donnant la possibilité de considérer le cas des enfants déjà concernés par l’article 786 du CGI. La question de l’intérêt supérieur de l’enfant et celle de sa défense sont étroitement liées au consensus trans-politique qui s’est dégagé lors des débats, preuve de l’importance de ces questions. L’arbitrage s’est fait en faveur de l’intérêt supérieur de l’enfant, dans un élan quasi unanime des députés et des sénateurs : la nécessité de protéger les enfants adoptés simples ayant perdu un parent adoptant pendant leur minorité s’est imposée. La discussion a en réalité porté davantage sur le cas des enfants mineurs adoptés simples qui ont perdu un parent adoptant pendant leur minorité et qui ont commencé à payer – voire ont payé – des droits de succession comme tiers : la procédure législative montre que, face aux doutes émis par le Gouvernement, les parlementaires sont parvenus à se mettre d’accord pour protéger tous les enfants adoptés simples qui perdent un parent adoptant pendant leur minorité28. Ainsi, grâce à l’article 36-II de la loi du 14 mars 2016, désormais, « Pour les droits de succession dont le fait générateur est antérieur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par dérogation à l’article L. 247 du Livre des procédures fiscales, l’Administration procède, à la demande du contribuable, à la remise des droits restés impayés, pour la partie qui excède les droits qui auraient été dus si le I du présent article avait été en vigueur à la date du fait générateur ». Cette mesure transitoire est d’application directe ; sa formulation semble sans équivoque, puisque l’Administration « procède », et non « peut procéder » à la remise des droits restés impayés à la demande du contribuable. Si la transcription n’est pas encore effective, il est vraisemblable que l’administration fiscale procèdera aux remises demandées par les contribuables concernés29. Le risque de refus est faible voire inexistant, sa potentialité semble ne pas pouvoir survivre à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Alors qu’un très large consensus s’est dégagé autour de l’article 36-I, les débats relatifs au II du même article ont été plus importants et orientés par les risques de rétroactivité et d’inconstitutionnalité du dispositif (II). Ce cheminement législatif laisse perdurer un risque de discrimination « au jour près » entre l’enfant adopté simple qui perd son parent adoptif la veille de sa majorité et celui qui le perd le lendemain : le curseur est déplacé et la différence de traitement n’est plus justifiée par le statut de l’enfant (adopté simple) mais par sa majorité.
Pourtant, l’effort de sécurisation conduit à renforcer la distinction entre mineur et majeur adoptés simples en cas de décès de l’adoptant, au détriment de l’enfant mineur, en raison d’une procédure tournée vers la recherche d’un consensus sur la proposition plus que vers la recherche d’une solution globale : les débats ont été orientés par les risques de rétroactivité et d’inconstitutionnalité du dispositif et en conséquence limités par ces derniers ; ils n’ont pas portés sur la pertinence de la protection de l’enfant mineur. Aucun débat ne fait état d’une réflexion sur la distinction entre mineurs et majeurs adoptés simples : la défense et la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant a été la priorité. L’adoption de l’article 36-I a remporté les suffrages alors que l’article 36-II a peiné à s’imposer dans sa rédaction actuelle ; le risque d’inconstitutionnalité du dispositif a plané sur la procédure et les amendements déposés à l’article 16 de la loi – devenu article 36 – montrent la volonté d’éviter tout risque d’inconstitutionnalité fondée sur le principe d’égalité devant l’impôt et la rétroactivité de la loi fiscale30 : pour autant, l’inconstitutionnalité n’a pas été invoquée.
L’article 36-I a d’ores et déjà été codifié et l’article 786 du CGI modifié, ce qui implique que les adoptés mineurs au moment du décès de l’adoptant31 ainsi que les adoptés majeurs au moment du décès pouvant apporter la preuve des secours et soins ininterrompus32, ne verront plus le lien de parenté résultant de l’adoption simple annihilé par le décès de leur parent, et n’auront plus à payer 60 % de droits. Ceci constitue une réelle avancée redonnant du sens à la filiation établie par l’adoption simple et rapprochant cette dernière de l’adoption plénière : le lien établi par l’adoption n’est plus nié par la soumission à des droits de succession équivalents aux droits auxquels sont soumis les tiers. Pour autant, la loi n’est pas parvenue à régler la situation des adoptés simples dans sa totalité : le curseur du risque à été déplacé du statut d’adopté simple pour se fixer sur la majorité de l’enfant en raison d’un processus législatif biaisé par une proposition de départ centrée sur l’intérêt supérieur de l’enfant toute à la fois régulatrice et génératrice de risque d’inégalité.
Sarah Durelle-Marc
B – Les autres risques du droit
II – La gestion du risque par le droit
A – Anticipation du risque
B – Les conséquences des risques réalisés
(À suivre)
Notes de bas de pages
-
1.
Cons. const., 19 févr. 2016, n° 2015-522 QPC et Cons. const., 2 mars 2016, n° 2015-525 QPC
-
2.
L. n° 2016-297, 14 mars 2016, modifiant CGI, art. 786.
-
3.
Cass. com., 1er déc. 2015, n° 14-20688.
-
4.
CEDH, 22 mars 2016, n° 646/10, M. G. c/ Turquie.
-
5.
Cass. crim., 22 mars 2016, n° 13-87650.
-
6.
V. not. notre commentaire dans la précédente chronique.
-
7.
Piazzon T., N3C 2016, n° 52, p. 109.
-
8.
Il faut souligner que le motif financier est de nature à se rattacher à des impératifs constitutionnels (non pris en compte au niveau européen), tels « l’équilibre financier de la sécurité sociale » ou le « principe de continuité des services publics ».
-
9.
Cons. const., 4 févr. 2011, n° 2010-93 QPC.
-
10.
CE, 5 févr. 2014, n° 367995.
-
11.
V. Maitrot de la Motte A., « Vers l’irrégularité de toutes les valeurs locatives évaluées par comparaison ? », Dr. fisc. 2016, n° 25, comm. 384.
-
12.
Not. Thiry J., Dr. fisc. 2016, n° 11, act. 148.
-
13.
Thiry J., Dr. fisc. 2016, op. cit.
-
14.
Salles S., Gaz. Pal. 5 juill. 2016, n° 268d8, p. 22 ; v. égal. Fouquet O., Dr. fisc. 2016, n° 11, act. 147.
-
15.
L. n° 2016-297, 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant : JO n° 63, 15 mars 2016. Ibid., art. 1 : « L’article L. 112-3 du Code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : “Art. L. 112-3. La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. […]” », nous soulignons.
-
16.
L. n° 2016-297, 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant : JO n° 63, 15 mars 2016. Elle est composée de quarante-neuf articles et vient compléter la L. n° 2007-293, 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance (JO n° 55, 6 mars 2007).
-
17.
La complexité du dispositif est largement liée à la survivance du lien biologique parallèlement au lien de parenté créé par l’adoption.
-
18.
Sur cette disposition, v. en particulier Douet F., Précis de droit fiscal de la famille, 15e éd., 2016, LexisNexis, nos 2410 et s. et n° 2911.
-
19.
Sur ce point, l’administration fiscale avait déjà intégré la jurisprudence de la Cour de cassation invalidant la doctrine administrative qui exigeait que l’adopté rapporte la preuve d’une prise en charge exclusive, Cass. com., 6 mai 2014, n° 12-21835 : Bull. civ. IV, n° 78 : la notion de secours et de soins ininterrompus prévue par l’art. 786, al. 2, 3°, du Code général des impôts, concernant les droits de mutation à titre gratuit applicables aux transmissions faites en faveur d’adoptés simples, n’impose pas une prise en charge exclusive de l’adopté simple par l’adoptant, mais seulement une prise en charge continue et principale. V. not., Fruleux F., « Adoption simple : une réforme fiscale maladroite », La semaine juridique notariale et immobilière, 27 mai 2016, n° 21, 1176.
-
20.
Sur cet aspect, v. not. Mignot J.-F., « L’adoption simple en France : le renouveau d’une institution ancienne (1804-2007) », Revue française de sociologie, n° 56-3, 2015, p. 525 à 560.
-
21.
L. 19 juin 1923, relative à l’adoption des orphelins de guerre : JO, 20 juin 1923, p. 5794.
-
22.
« Fiscalité de l’adoption simple : la QPC ne sera pas transmise », Dalloz, Forum Famille, 09 mars 2012, www.dalloz.fr. Sur la question, v. not. Sauvage F., « Adoptions simples et successions complexes » et Douet F., « Les principales conséquences fiscales de l’adoption », in AJ fam. 2008, dossier « Adoption simple ».
-
23.
Les auditions effectuées par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale semblent montrer que dans de nombreuses occasions, les tuteurs eux-mêmes peinent à regrouper les éléments de preuve, voire n’ont pas eu conscience de la nécessité de conserver tout élément matériel pouvant contribuer à établir le lien de parenté au sens du droit fiscal : v. www.assemblee-nationale.fr.
-
24.
Ibid.
-
25.
Sur cette question, v. not. Fruleux F., « Adoption simple : une réforme fiscale maladroite », art. préc., et Durelle-Marc S., « L’enfant adopté simple : une situation fiscalement précaire en cas de décès de l’adoptant pendant la minorité de l’enfant », JDJ n° 344, avril 2015, p. 17.
-
26.
Cette proposition s’inscrit dans le prolongement de la mission confiée aux deux sénatrices par la commission des affaires sociales du Sénat visant à étudier la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et à formuler des propositions d’amélioration du dispositif en place le cas échéant.
-
27.
Texte n° 799 (2013-2014), proposition de loi relative à la protection de l’enfant de Mmes Meunier M., Dini M. et plusieurs de leurs collègues, déposée au Sénat le 11 sept. 2014 : www.senat.fr.
-
28.
Sur cette question, v. not. Durelle-Marc S., « L’enfant mineur adopté simple reconnu fiscalement comme un enfant », JDJ n° 353, mars 2016, p. 54-56.
-
29.
Aucune information n’est à ce jour accessible auprès des services de l’administration fiscale : le BOFiP n’est pas encore actualisé et n’a pas encore précisé les modalités d’interprétation des nouvelles exceptions posées à CGI, art. 786. Pour une interprétation du texte antérieur, v. http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6839-PGP.html, qui précise les modalités de la preuve des secours et soins non interrompus de l’adoptant.
-
30.
L’argument du Gouvernement selon lequel seule une loi de finances peut modifier une disposition fiscale n’a pas résisté, la jurisprudence du Conseil constitutionnel étant claire à cet égard : « Considérant que les dispositions fiscales ne sont pas au nombre de celles qui sont réservées à la compétence exclusive des lois de finances et qu’elles peuvent figurer aussi bien dans un texte de loi présentant ce caractère que dans un texte législatif qui en est dépourvu ; qu’il y a lieu à cet égard de distinguer selon que les dispositions en cause affectent ou non l’exécution du budget de l’exercice en cours » (Cons. const., 24 juill. 1991, n° 91-298 : JO, 26 juill. 1991, p. 9920).
-
31.
Cas n° 3 de CGI, art. 786.
-
32.
Cas n° 3°bis de CGI, art. 786 : « D’adoptés majeurs au moment du décès de l’adoptant qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale ».