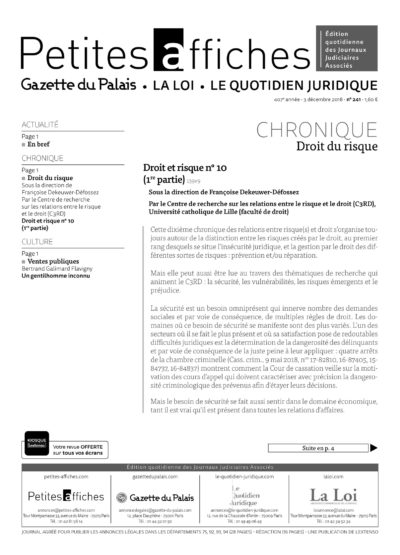Droit et risque n° 10 (1re partie)
Cette dixième chronique des relations entre risque(s) et droit s’organise toujours autour de la distinction entre les risques créés par le droit, au premier rang desquels se situe l’insécurité juridique, et la gestion par le droit des différentes sortes de risques : prévention et/ou réparation.
Mais elle peut aussi être lue au travers des thématiques de recherche qui animent le C3RD : la sécurité, les vulnérabilités, les risques émergents et le préjudice.
La sécurité est un besoin omniprésent qui innerve nombre des demandes sociales et par voie de conséquence, de multiples règles de droit. Les domaines où ce besoin de sécurité se manifeste sont des plus variés. L’un des secteurs où il se fait le plus présent et où sa satisfaction pose de redoutables difficultés juridiques est la détermination de la dangerosité des délinquants et par voie de conséquence de la juste peine à leur appliquer : quatre arrêts de la chambre criminelle (Cass. crim., 9 mai 2018, nos 17-82810, 16-87405, 15-84737, 16-84837) montrent comment la Cour de cassation veille sur la motivation des cours d’appel qui doivent caractériser avec précision la dangerosité criminologique des prévenus afin d’étayer leurs décisions.
Mais le besoin de sécurité se fait aussi sentir dans le domaine économique, tant il est vrai qu’il est présent dans toutes les relations d’affaires. Ainsi, la question de la validité des cautionnements et plus précisément, des critères de l’évaluation de la « disproportion » entre la dette cautionnée et les ressources de la caution (Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-26182) met en jeu l’intensité du risque couru tant par le créancier que par la caution.
C’est encore la recherche de la sécurité, juridique cette fois, qui anime les règlements européens du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés qui vont entrer en vigueur le 29 janvier 2019.
Un dernier exemple d’insécurité juridique résulte du régime des reconnaissances de complaisance, sources de risques pour l’enfant et sa famille, mais aussi à l’origine d’un très ennuyeux risque d’inconventionnalité du droit français de la filiation (CA Riom, 16 janv. 2018, n° 17/00694).
La protection que le droit offre face aux vulnérabilités est un autre aspect du traitement juridique des risques. Dans cette chronique, l’attention est attirée sur les risques que « l’uberisation du lien social » fait courir au public particulièrement fragile des services sociaux, qui est ainsi détourné des administrations censées les protéger. Une autre contribution s’attache aux missions du médecin du travail, modifiées dans un sens inquiétant par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Les risques émergents sont aussi divers que variés. Dans la chronique de cette année, c’est l’irruption du numérique dans les entreprises et plus précisément l’adoption du programme Watson dans le secteur bancaire qui suscite les craintes des salariés et une demande d’expertise, rejetée avec l’aval de la Cour de cassation (Cass. soc., 12 avr. 2018, n° 16-27866). À raison ? Ou à tort ?
Enfin, la réparation des préjudices résultant de la réalisation des risques fait encore et toujours l’objet d’un contentieux nourri et de réflexions théoriques radicales. Peut-on obtenir réparation du préjudice subi par un parieur sportif lorsqu’un joueur a commis des fautes de jeu inexcusables entraînant l’insuccès de son équipe ? (Cass. 2e civ, 14 juin 2018, n° 17-20046). Le fait de naître sans père est-il constitutif d’un préjudice moral indemnisable (Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-26687) ; et enfin, que penser de la proposition de créer une amende civile amenant à dépasser la réparation intégrale du préjudice (article 1266-1 du Code civil tel qu’issu du projet de loi du 13 mars 2017) ?
F.D.-D.
I – Les risques du droit
A – L’insécurité juridique
Risques d’insécurité juridique et conflits de juridictions (l’entrée en application, le 29 janvier 2019, des règlements du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés)
L’évolution du droit international privé se caractérise par un phénomène de communautarisation de ses sources. Deux règlements (UE) nos 2016/1103 et 2016/1104 en date du 24 juin 20161, appelés à entrer en application le 29 janvier 2019, l’un relatif aux régimes matrimoniaux2 et l’autre concernant les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, s’ancrent dans cette tendance en mettant en place une coopération renforcée entre 18 États membres. À défaut d’unanimité entre les États européens, le Conseil a en effet adopté, le 9 juin 2016, la décision (UE) n° 2016/954 autorisant cette procédure3. Ces deux règlements présentent pour intérêt de traiter à la fois de la compétence juridictionnelle, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions. Ils sont fondés sur le même esprit et reposent sur une structure générale « quasi-identique »4.
Le droit international privé français comprend déjà des règles de conflit de lois dans les matières visées par ces règlements. D’une part, la convention de La Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur le 1er septembre 1992, traite de la loi applicable aux régimes matrimoniaux. Au préalable, il était loisible aux époux mariés avant cette date de désigner le droit gouvernant leur régime ; à défaut la loi de leur premier domicile conjugal était alors mise en œuvre5. D’autre part, l’article 515-7-1 du Code civil détermine la loi régissant les partenariats enregistrés. En revanche, il n’existait pas de règles dans les conflits de juridictions traitant spécifiquement de ces questions. Les règlements du 24 juin 2016 proposent donc des solutions novatrices. Ils permettent en effet de fonder la compétence juridictionnelle dans les litiges relatifs aux régimes matrimoniaux, ainsi que dans ceux concernant les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.
Les règles de conflit de juridictions forgées par ces règlements sont structurées de manière similaire. Les articles 4 et 5 centralisent le contentieux. À défaut, l’article 6 prévoit l’application d’une règle de conflit hiérarchisée fondée sur l’application successive de différents critères de rattachement. Dans les hypothèses visées par cette disposition, les parties peuvent également procéder à une élection de for aux conditions fixées à l’article 7. Les solutions adoptées par ces deux règlements doivent pour l’essentiel être approuvées dans la mesure où elles contribuent à limiter les risques d’insécurité juridique dans les conflits de juridictions. D’une part, elles unifient la compétence juridictionnelle (I), et d’autre part, elles centralisent les procédures juridictionnelles (II).
I. L’unification de la compétence juridictionnelle
Les règlements du 24 juin 2016 unifient les règles de compétence juridictionnelle entre les États membres à la procédure de coopération renforcée. Avant le 29 janvier 2019, date d’entrée en application de ces règlements, le droit européen ne déterminait pas les juridictions compétentes pour régler les litiges portant sur les régimes matrimoniaux ou les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. D’une part, aucun règlement communautaire ne traitait spécifiquement de ces questions. D’autre part, le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 les exclut expressément ; affirmant à l’article 1, § 2 a, que sont évincés de son champ d’application matériel : « les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage ».
En l’absence d’instrument international, chaque État fixe donc ses propres règles de compétence juridictionnelle. À cet égard, le droit international privé français se fonde sur l’application des règles ordinaires de compétence internationale qui procèdent à une extension dans l’ordre international des règles de compétence territoriale interne6. Si cette méthode ne permet pas de déterminer la compétence des tribunaux français, il convient alors de mettre en œuvre les privilèges de juridiction. Les articles 14 et 15 du Code civil, fondés sur la nationalité française du demandeur ou du défendeur, sont alors applicables en raison de leur caractère subsidiaire7. Enfin, le déni de justice constitue l’ultime méthode permettant de fonder la compétence des juridictions françaises.
L’absence d’unification des règles de compétence juridictionnelle engendre d’importants risques d’insécurité juridique. D’une part, elle provoque des conflits de procédures. Deux juridictions d’États différents peuvent en effet être saisies d’une même affaire. Cette hypothèse de litispendance est alors traitée en se fondant sur les règles issues du droit commun8. Ainsi, le juge français saisi en second lieu peut-il se dessaisir s’il estime que la décision étrangère à venir satisfait aux conditions du contrôle de régularité internationale. Le traitement de cette exception de procédure suscite cependant des réserves en raison des risques d’insécurité juridique qu’il provoque. En premier lieu, les règles applicables sont difficiles à mettre en œuvre car elles relèvent d’une démarche qui s’avère en réalité prospective. Le juge français doit en effet soumettre aux conditions du contrôle de régularité internationale une décision qui n’a pas encore été rendue. En second lieu, il n’est pas obligé de se dessaisir même si les conditions de la litispendance sont caractérisées. De fait, il s’agit pour lui d’une simple faculté et non d’une obligation. D’autre part, deux juridictions d’États différents peuvent, au sujet d’une même affaire, rendre des décisions contradictoires qui nuisent alors gravement à la sécurité juridique.
Les règlements du 24 juin 2016, sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, limitent donc ces risques d’insécurité juridique en unifiant les règles de compétence juridictionnelle entre les États membres à la procédure de coopération renforcée. Certes, ces textes ne suppriment pas toutes les hypothèses de litispendance. Toutefois, ils prévoient des règles spécifiques, régissant cette exception de procédure, qui restreignent les risques d’insécurité juridique. L’article 17, § 3, affirme en effet que lorsque les conditions de la litispendance sont caractérisées, la juridiction européenne saisie en second lieu a l’obligation de se dessaisir. Il est cependant permis de regretter que ces règlements ne traitent pas les hypothèses de litispendance extra-communautaire, à l’instar de la solution adoptée à l’article 33 du règlement du 12 décembre 2012.
L’unification de la compétence juridictionnelle entre les États membres à la procédure de coopération renforcée doit être approuvée car elle limite les risques d’insécurité juridique. Elle évite les conflits de procédures, ainsi que les décisions contradictoires. La centralisation des procédures juridictionnelles contribue également à restreindre les risques d’insécurité juridique.
II. La centralisation des procédures juridictionnelles
Les règlements du 24 juin 2016 prévoient des règles de compétence juridictionnelle destinées à concentrer le contentieux devant une juridiction européenne. D’une part, l’article 4 envisage cette hypothèse en cas de décès de l’un des partenaires ou de l’un des époux. D’autre part, l’article 5 évoque cette éventualité en cas de dissolution ou d’annulation du partenariat enregistré, ainsi que dans les affaires de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage. L’esprit de ces dispositions est que les juridictions d’un État membre à la coopération renforcée qui ont compétence pour statuer sur la rupture du mariage ou du partenariat, quelle qu’en soit la cause (annulation, dissolution ou décès), sont également compétentes pour se prononcer sur le régime matrimonial ou les effets patrimoniaux du partenariat en relation avec l’affaire traitée. Ces textes évitent ainsi que deux juridictions d’États membres différents soient saisies de litiges présentant des liens entre eux. En théorie, l’esprit de ces règles de compétence doit être approuvé car, en centralisant le contentieux, elles permettent de restreindre les risques d’insécurité juridique. D’une part, elles évitent les hypothèses de connexité. D’autre part, elles permettent d’échapper à d’éventuels jugements contradictoires. Toutefois, en pratique, les articles 4 et 5 suscitent des appréciations contrastées.
En vertu de l’article 4, la juridiction d’un État membre qui est compétente pour traiter de la succession de l’un des époux ou de l’un des partenaires, sur le fondement du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, l’est également pour régler les questions relatives au régime matrimonial ou aux effets patrimoniaux du partenariat en lien avec ladite succession. Cet article a un rôle déterminant car les dispositions suivantes ne peuvent être mises en œuvre que s’il ne permet pas de fonder la compétence juridictionnelle. Ainsi, l’article 6, fondé sur une règle de conflit hiérarchisée, et l’article 7, qui autorise l’élection de for, sont-ils inapplicables si le contentieux peut être centralisé par application de l’article 4. Cette disposition doit être approuvée car elle permet de concentrer les procédures devant une juridiction européenne. Elle contribue ainsi à limiter les risques d’insécurité juridique.
L’article 5 suscite en revanche une appréciation plus nuancée car il accorde une place importante à la volonté des époux et à celle des partenaires. Mariel Révillard et Cyril Nourissat estiment d’ailleurs qu’il est « assez complexe »9. D’une part, en vertu de l’article 5, § 1, du règlement (UE) n° 2016/1103 du 24 juin 2016, la juridiction d’un État membre qui est compétente pour se prononcer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage, sur le fondement du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, l’est également pour traiter du contentieux relatif au régime matrimonial en lien avec ladite demande. Toutefois, l’article 5, § 2, prévoit différentes hypothèses pour lesquelles l’accord des époux est nécessaire10. D’autre part, en vertu de l’article 5, § 1, du règlement (UE) n° 2016/1104 du 24 juin 2016, le tribunal d’un État membre qui est compétent pour se prononcer sur l’annulation ou la dissolution du partenariat l’est aussi pour régler le contentieux relatif à ses effets patrimoniaux à la condition cependant que les partenaires en conviennent ainsi. En l’espèce, il incombe donc aux règles de compétence juridictionnelle de chaque État membre de déterminer les tribunaux compétents pour se prononcer sur l’annulation ou la dissolution du partenariat, car cette question n’est soumise à aucun instrument international. D’une part, le règlement 12 décembre 2012 l’exclut de son champ d’application matériel ; affirmant à l’article 1, § 2. a, que sont évincés « les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage ». D’autre part, le règlement du 27 novembre 2003 ne s’applique, selon l’article 1, § 1. a, qu’« au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux ».
La concentration du contentieux, sur le fondement de l’article 5, relève donc parfois de la volonté des époux ou des partenaires. Dans certaines hypothèses définies à l’article 5, § 2, les époux doivent en effet donner leur accord. Le considérant 34 les justifie en invoquant le fondement de la compétence pour statuer sur le divorce, la séparation de corps ou l’annulation du mariage, qui repose sur des critères de compétence spécifiques. Il s’agit en effet de chefs de compétence ayant un caractère dérogatoire. En revanche, la centralisation du contentieux est soumise dans tous les cas à l’accord des partenaires. Cette solution se justifie vraisemblablement en raison de l’absence de règle européenne applicable en la matière. Subordonner la concentration des procédures juridictionnelles à l’accord des époux ou des partenaires peut susciter des réserves, car cette condition risque d’aller à l’encontre du but recherché. Il faut en effet que ces derniers réussissent à s’entendre sur ce point alors que précisément un désaccord les oppose. Par ailleurs, des doutes ont également été émis quant à l’effectivité des articles 4 et 5, car leur application suppose qu’une juridiction européenne ait été préalablement saisie11.
Les règlements du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés contribuent donc à restreindre les risques d’insécurité juridique dans les conflits de juridictions. Ils unifient la compétence juridictionnelle et centralisent dans certaines hypothèses les procédures devant une juridiction européenne. Il est donc à souhaiter, pour des raisons de sécurité juridique, qu’à terme, d’autres États européens s’associeront à la procédure de coopération renforcée qui a ainsi été initiée…
C. B.
Risques psycho-sociaux et responsabilité déontologique du médecin du travail
Les réformes successives opérées depuis la loi du 20 juillet 2011 ont bouleversé l’organisation et le fonctionnement des services de santé au travail et bousculé les pratiques professionnelles des médecins du travail. Elles n’ont toutefois pas démenti la place essentielle qu’occupent leurs écrits dont l’impact juridique direct ou indirect tant sur les employeurs que sur les salariés est loin d’être négligeable. Les conditions dans lesquelles ces écrits sont susceptibles d’être remis en cause ou engagent la responsabilité du médecin du travail constituent donc un objet d’intérêt majeur pour le juriste. C’est également un sujet de préoccupation pour le conseil national de l’ordre des médecins qui, dans sa mission de gardien de la déontologie médicale et de défense de la profession, s’invite dorénavant régulièrement dans le débat.
L’ordre des médecins peut tout d’abord intervenir pour garantir aux médecins du travail le bon exercice de leur fonction. C’est ainsi que le 19 décembre dernier, le président du conseil national de l’ordre des médecins adressait au Premier ministre une lettre12 lui faisant part de ses vives préoccupations à la suite de la modification de la procédure de contestation devant le juge prud’homal des avis, propositions, conclusions écrites ou indications du médecin du travail13 opérée par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 201714. Il estimait en effet qu’elle était susceptible de porter atteinte au secret médical et de fragiliser la relation de confiance entre le médecin du travail et le salarié/patient.
Mais l’ordre des médecins est également chargé de veiller au respect par les médecins du travail de la conformité de leur pratique professionnelle aux règles déontologiques. À cette fin, les juridictions ordinales peuvent, en cas de manquement du médecin, infliger une sanction disciplinaire allant de l’avertissement à la radiation15. Par nature, ces actions disciplinaires sont génératrices de tensions entre l’ordre et les médecins du travail. Mais c’est spécialement dans les hypothèses où l’action contre le médecin était initiée par une entreprise que les critiques se sont faites les plus vives à l’encontre de l’ordre16. En témoigne la forte émotion, relayée par les médias, qu’a suscitée récemment la condamnation d’un médecin du travail (le docteur Djemil) à une sanction d’une sévérité jusqu’alors inégalée de 6 mois d’interdiction d’exercer (dont 3 mois avec sursis) à la suite d’une plainte de deux employeurs concernant des écrits qui se référaient à des comportements de harcèlement sexuel17. Sans compter un arrêt du Conseil d’État du 6 juin 201818 qui ne sera certainement pas de nature à apaiser les esprits. Y est en effet rejeté le pourvoi du docteur Huez, par ailleurs vice-président délégué de l’a-SMT19, qui tendait à l’annulation de la sanction d’avertissement infligée en première instance à raison d’un certificat jugé tendancieux.
Ces décisions s’inscrivent en réalité dans un mouvement plus large de saisine des juridictions ordinales à la suite de plaintes d’entreprises. Les médecins du travail ne sont en effet pas les seuls concernés : ont été par ce biais déférés devant la juridiction ordinale des médecins généralistes, des psychiatres, voire des cardiologues à qui il était reproché notamment des écrits tendancieux ou de complaisance. Il est toutefois délicat de mesurer l’ampleur du phénomène faute de données disponibles20 sur le nombre de plaintes émanant précisément d’entreprises21 et de pouvoir les croiser avec les spécialités mises en cause22, ainsi que leur objet23. Et il est permis de regretter avec d’autres24 l’absence de diffusion de la jurisprudence des chambres disciplinaires de première instance. Ce n’est qu’au niveau de l’appel qu’une tentative de recensement peut être opérée grâce à la publication des décisions de la chambre disciplinaire nationale. Le nombre d’affaires initiées par des entreprises et concernant des écrits d’un médecin du travail y est de l’ordre d’une dizaine. Mais en l’absence de données plus précises, il n’est pas significatif du nombre de médecins réellement mis en cause par des entreprises, les plaintes initiales ayant pu trouver un règlement au stade de la conciliation dorénavant obligatoire et l’appel n’étant pas nécessairement formé. Il y aurait dans un recensement et une identification plus précis des plaintes et de leur devenir, un travail de recherche sans doute assez conséquent mais indispensable à une analyse pleine et objective de la situation. À défaut, les conditions présidant à un débat serein ne sont pas réunies et celui-ci s’inscrit d’ailleurs à présent dans une défiance regrettable : à l’égard tout d’abord de l’ordre suspecté de connivence avec les employeurs, à l’égard ensuite des entreprises, suspectées d’une utilisation massive d’une voie ordinale rapide, moins contraignante et plus productive que les voies judiciaires à des fins d’intimidation des médecins, et à l’égard enfin des médecins du travail eux-mêmes dont l’image n’a guère besoin d’être davantage altérée par des doutes sur leur moralité et leur professionnalisme.
L’examen de la jurisprudence ordinale disponible peut toutefois être riche d’enseignements. Elle témoigne en effet de ce que les risques psycho-sociaux constituent un sujet particulièrement sensible. Il suffit de constater que les décisions initiées par la plainte d’une entreprise et tenant aux écrits du médecin du travail, se rapportent toutes à des risques psycho-sociaux. Ce n’est sans doute pas un hasard : dans ce contexte particulier, la règle déontologique est largement débattue. Posée pour tout médecin, elle s’est trouvée bousculée par l’exercice, par le médecin du travail, de ses missions. La jurisprudence ordinale l’a donc adaptée (I). Mais est-ce bien suffisant ? Il se pourrait en effet que cette jurisprudence se révèle inadéquate en matière de risques psycho-sociaux (II).
I. L’adaptation de la règle déontologique à l’exercice par le médecin du travail de son art
Le médecin du travail n’est pas un médecin comme les autres. Les conditions particulières dans lesquelles il exerce sa mission ne pouvaient être plus longtemps occultées (A). Il en est résulté une adaptation mesurée de la règle déontologique (B).
A. La spécificité des missions du médecin du travail
Les écrits contestés devant le juge ordinal peuvent être de natures diverses. Il faut dire que c’est potentiellement « tout écrit, (…) qu’il établirait en sa qualité de médecin et où il décrirait l’état de santé de son patient », quand bien même il ne prendrait pas la forme d’un certificat ou d’un rapport, qui est susceptible d’engager la responsabilité d’un médecin25. Dans les affaires impliquant des médecins du travail, on retrouve aussi bien des avis d’inaptitude26 ou des courriers adressés au médecin traitant27 que des certificats médicaux28. Plus récemment, dans l’affaire concernant le docteur Djemil, ce sont même les études de poste que celle-ci avait entendu réaliser qui ont été condamnées29. Procédant par assimilation, le juge ordinal soumet en effet aux mêmes obligations déontologiques que les certificats, des documents qui n’étaient pas nécessairement qualifiés comme tels, et donne ainsi le plus large champ d’application à l’interdiction des certificats de complaisance et des rapports tendancieux.
Apparaît rapidement la difficulté de déterminer ce qui rend l’écrit condamnable : l’article R. 4127-28 du Code de la santé ne définit pas le certificat de complaisance ni le rapport tendancieux et l’article R. 4127-76 du Code de la santé publique, en énonçant que l’écrit doit être établi « conformément aux constatations médicales que le médecin est en mesure de faire » laisse une sensible marge d’appréciation. On comprend bien que rentre dans la catégorie des certificats de complaisance, l’attestation délivrée sous la seule pression du salarié notamment sous la menace de se suicider30 ou l’avis d’inaptitude délivré sans étude de poste ni des conditions de travail préalable31. Mais au-delà ? Dans un rapport de 2006, complété en 2012 des commentaires du Code de déontologie, le CNOM a précisé l’interprétation qu’il convenait de donner des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du Code de la santé publique. En ressort une directive ferme : « ce que le médecin atteste dans un certificat doit correspondre, avec une scrupuleuse exactitude aux faits qu’il a constatés lui-même »32. De ce principe, sont tirées trois grandes conséquences :
-
le médecin ne pouvant procéder qu’à des constats, il lui est interdit d’attester d’une relation causale entre les difficultés professionnelles et l’état de santé présenté par le patient et d’attribuer la responsabilité des troubles de santé, physique ou psychique constatés au conflit notamment professionnel dont le patient lui a fait part ;
-
les dires du patient ne peuvent être rapportés qu’au conditionnel ou entre guillemets33 sous la réserve d’accusations du patient contre un tiers notamment l’employeur, qui ne peuvent pas du tout à figurer dans le certificat même sous forme de « dires » ;
-
l’objectivité qui doit présider à la rédaction du certificat interdit au médecin d’affirmer ce qui n’est que probable et comporter des omissions dénaturant les faits.
Il ressort de ces directives que tout médecin devrait se cantonner à une stricte description objective de l’état de santé (mentale et/ou physique) du patient. Il ne saurait être de son rôle que d’attribuer une cause professionnelle à l’état de santé constaté, quand bien même celle-ci serait probable. Mais précisément, le législateur a confié une mission spécifique au médecin du travail : éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant (…) leur état de santé. Il lui appartient d’œuvrer afin que le travail des salariés n’altère pas leur santé et le suivi individuel de leur état de santé en est une des modalités. Détacher l’état de santé du salarié/patient de son travail apparaît alors comme un non-sens. Interroger et déterminer les liens qui peuvent lier l’état de santé du salarié/patient à son travail relève de la mission même du médecin du travail et de sa compétence. Comment dès lors justifier de ce qu’il ne puisse pas en attester34 ? Une évolution de la jurisprudence était dès lors inéluctable. Elle ne pouvait qu’aller vers la reconnaissance de la faculté pour le médecin du travail d’établir dans ses écrits un lien entre la santé du salarié et son travail. Elle ne l’a toutefois fait que sous conditions.
B. Les conditions jurisprudentielles de l’établissement d’un lien santé/travail
La chambre disciplinaire nationale a en réalité assez rapidement pu prendre en considération la mission préventive du médecin du travail pour dénier une violation de l’article R. 4127-28 du Code de la santé publique35. Puis, par un rapport spécialement consacré aux écrits du médecin du travail, publié en juin 2015, le conseil national de l’ordre des médecins a officialisé sa position en affirmant que « sa formation et ses missions permettent au médecin du travail d’établir un lien entre la santé du salarié, son activité professionnelle et son environnement professionnel ». Fin du débat ? Certainement pas car le propos est complété afin d’assurer la compatibilité de la spécificité des missions du médecin du travail aux exigences du Code de déontologie. L’approche au fond n’est pas modifiée, la règle est simplement adaptée afin de tenir compte de ce qui fait, pour l’ordre, la singularité de l’activité du médecin du travail par rapport aux autres médecins, à savoir sa connaissance effective du poste et du milieu de travail. Mais la ligne directrice reste identique : il ne peut être attesté que de ce que le médecin du travail a personnellement constaté. Il ne peut s’agir que de constatations médicales après examen de la personne du salarié, et l’« imputabilité » (lien santé-travail) doit « renvoyer à des risques et des organisations de travail identifiés ». Les « dires » du salarié, quant à eux, ne doivent toujours être rapportés qu’avec la plus grande prudence et en usant des guillemets. Cette position de l’ordre apparaît somme toute raisonnable et logique si l’on veut bien se rappeler que le médecin du travail n’est pas un juge et qu’il n’a pas à prendre parti sur une éventuelle responsabilité de l’employeur. Elle vient d’ailleurs de recevoir la consécration du Conseil d’État dans un arrêt du 6 juin 201836. Y est en effet énoncé que le fait qu’un certificat prenne parti sur le lien entre l’état de santé du salarié et ses conditions de vie et de travail dans l’entreprise n’est pas en soi de nature à méconnaître les articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du Code de la santé publique. Le rôle assigné par le législateur au médecin du travail s’y oppose effectivement. Mais ensuite, le Conseil d’État, après avoir rappelé le droit du médecin du travail d’accéder aux lieux de travail, précise qu’il ne saurait établir un tel certificat qu’en considération de constats personnellement opérés par lui, tant sur la personne du salarié, que sur son milieu de travail. La « faveur » accordée au médecin du travail et à lui seul37, ne semble alors résulter que de la faculté qui lui est accordée, pour exercer ses missions, de pénétrer dans l’entreprise. Dans ces conditions, il n’est pas tout à fait certain qu’elle soit pertinente en matière de risques psycho-sociaux.
II. L’adéquation de la jurisprudence aux risques psycho-sociaux
Le conseil national de l’ordre des médecins lui-même a pu souligner la difficulté et la complexité d’établir le lien entre l’état de santé du salarié et des causes professionnelles dans les cas de risques psycho-sociaux38. C’est donc sans grande surprise que la pertinence de la jurisprudence est débattue (A), débat dont il convient de bien de mesurer les enjeux (B).
A. Les termes du débat
En premier lieu, il est permis de relever qu’à s’en tenir aux constats que le médecin aura personnellement pu faire, même en les élargissant au milieu de travail, laisse de côté un certain nombre de situations de souffrance d’origine professionnelle dont le médecin ne peut, par voie de conséquence, attester sous peine de sanction. D’abord parce qu’il est fort peu probable qu’il soit à un moment le témoin direct d’actes de maltraitance à l’égard d’un salarié/patient. Sont donc exclues les situations de harcèlement moral39 ou sexuel voire de comportement managérial pathogène. Ensuite, parce que l’état de souffrance s’installe souvent progressivement dans le temps. Établir son origine professionnelle suppose de remonter le temps et d’identifier les éléments du travail qui ont participé à le générer. Faudrait-il que le médecin du travail ait été chaque fois présent pour les constater ? À défaut les signes objectifs du passé (alertes collectives déclenchées par des prédécesseurs ; éléments du dossier médical du salarié/patient qui lui auraient été transmis) seraient-ils à même de suppléer le défaut de constatations personnelles ? Ou est-ce à dire plus simplement que le médecin du travail dans ces situations serait tout simplement impuissant à établir ce lien, ce qui expliquerait qu’il ne puisse en attester ? Voilà une conclusion que combat fermement un certain nombre de médecins du travail qui ont pu développer depuis plusieurs années une clinique médicale particulière, la clinique médicale du travail40. « Il s’agit d’une consultation médicale où l’approche compréhensive permet d’accéder, grâce au récit du vécu subjectif du travail, aux dynamiques de mobilisation du sujet dans sa confrontation à l’organisation du travail (…) et aux risques du travail »41. Elle repose sur « l’écoute compréhensive » du salarié permettant au médecin d’identifier les difficultés et au salarié de comprendre ce à quoi il est confronté. Cette « construction commune » est « conceptualisée, par rapport à ce que le médecin a observé de la situation des autres travailleurs, de l’état des collectifs, de l’organisation du travail dans l’entreprise » jusqu’à l’établissement d’un diagnostic étiologique « permettant de relier les atteintes à la santé au repérage des situations pathogènes »42. Dans cette démarche, le « vécu » du salarié (et non pas ses « dires ») est essentiel dans l’instruction du lien santé-travail. On mesure alors l’écart qui sépare cette approche de la conception adoptée par les juridictions ordinales. La différence d’analyse des deux affaires au cœur de la polémique actuelle, celles concernant les docteurs Huez et Djemil, selon que l’on adopte l’une ou l’autre des « méthodes » (faits personnellement constatés/clinique médicale du travail) est à cet égard tout à fait édifiante43. On pourrait toutefois avoir le sentiment qu’il ne s’agit là que d’une simple querelle d’experts. On aurait cependant tort d’en négliger les enjeux.
B. Les enjeux du débat
Les enjeux sont bien évidemment importants pour le médecin du travail exposé à une sanction disciplinaire à raison de ses écrits. Mais ils le sont également pour le salarié/patient et ce, à un double titre. Sur le plan humain tout d’abord, et pour l’amélioration de son état de santé, il semble important qu’il puisse bénéficier de la pleine reconnaissance par le médecin du travail de ce que son travail est à l’origine de sa souffrance, chaque fois que c’est effectivement le cas. Or selon la « méthode » appliquée, la faculté pour le médecin du travail de le faire ne sera pas la même. Sur le plan juridique ensuite, le choix de la « méthode » en conditionnant le contenu du certificat, influe nécessairement sur sa force probatoire. Le juge ne regardera évidemment pas du même œil le certificat dans lequel le médecin du travail aura dû se cantonner à rapporter les dires du salarié que celui dans lequel il aura pu pleinement attester de la cause professionnelle (lorsqu’elle existe). Il en ira de même en cas de demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie : selon la « méthode » appliquée, le contenu et donc l’avis du médecin du travail, n’aura pas la même portée. Mais les enjeux se situent également au-delà de la sphère des différents protagonistes : c’est en effet la faculté même pour un tiers à la relation patient-médecin de contester la conformité de l’écrit du médecin à la règle déontologique dans les conditions actuellement définies par le Code de la santé publique qui pourrait être remise en cause.
Cette faculté trouve sa source dans loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé qui a profondément réformé les instances des ordres des professions médicales, en distinguant clairement les attributions administratives des attributions disciplinaires. Elle a également instauré la procédure de conciliation obligatoire entre les parties, la procédure disciplinaire s’engageant uniquement mais nécessairement44 en cas d’échec de celle-ci, et a renforcé le droit des plaignants, en leur reconnaissant le statut de partie à l’instance. Ceux-ci ont dès lors été autorisés à formuler eux-mêmes leur plainte, sans plus devoir s’en remettre pour ce faire au conseil départemental de l’ordre et se sont vu ouvrir la voie de l’appel de la décision disciplinaire prise au niveau régional qui leur était jusque-là fermée. Cette dernière évolution s’est clairement initialement inscrite « dans la perspective d’accroître les droits des malades »45, témoignant de ce que la qualité de plaignant renvoyait alors au patient46. Un décret d’application du 25 mars 2007 est venu ainsi préciser que l’action contre un médecin ne pouvait être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre « agissant de leur propre initiative à la suite de plaintes formées par les patients (…) ». Quelques jours plus tard toutefois, un nouveau décret du 13 avril 2007 insérait l’adverbe « notamment » avant le terme de « patients » et changeait alors considérablement la donne47. Les entreprises mais également tout tiers à la relation médecin/patient48 justifiant d’un intérêt à agir49 se sont ainsi vu reconnaître la qualité de partie à l’instance et non plus de simple témoin. Or cette qualité leur donne dorénavant accès à l’ensemble des éléments de la procédure. Les opposants à leur action y ont trouvé un argument majeur en invoquant la nécessaire protection du secret médical dû au patient. Selon eux, les médecins du travail mis en cause par la plainte d’une entreprise sont confrontés à un dilemme dès le stade de la conciliation : soit violer le secret médical pour se défendre, soit ne pas se défendre pour protéger le secret médical50. L’égalité des armes dans le procès en serait nécessairement rompue. La procédure telle qu’elle existe aujourd’hui mettrait donc à mal le secret médical et le droit de se défendre.
À la suite de multiples tentatives tendant à obtenir la suppression de l’adverbe « notamment »51, le Conseil d’État a été amené à se prononcer52. Sa réponse est sans appel : il énonce en effet que « l’adverbe “notamment” n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer au médecin poursuivi de méconnaître le secret médical pour assurer sa défense ou de limiter son droit de se défendre ; que les requérants ne sauraient, par suite, utilement soutenir que la décision de refus d’abrogation qu’ils attaquent porte atteinte à la protection du secret médical ou au droit des médecins à un procès équitable ». Il a pu être reproché au Conseil d’État à la suite de cette décision de s’être contenté d’affirmer sans démontrer53. Mais en réalité, la solution adoptée était en parfaite harmonie avec la position des juridictions ordinales. Et elle se comprend pleinement à la lumière de son arrêt du 6 juin 2018 qui n’admet que le médecin du travail ne puisse établir un certificat qu’en considération des constats personnellement opérés par lui sur la personne du salarié et sur son milieu de travail. En effet, en suivant ce raisonnement, le débat en conciliation et devant le juge ordinal se concentre sur une seule question : les éléments figurant sur le « certificat »54 constituent-ils des constats que le médecin du travail était personnellement en mesure de faire sur l’état de santé du salarié/patient ou sur son milieu de travail ? La question de fond est objective : si ces éléments ne découlent pas de constats personnels, le médecin du travail a manqué à ses obligations déontologiques. Il s’agit là d’une recherche par examen des faits et qui ne nécessite pas en théorie que le médecin du travail dévoile d’autres aspects relevant du secret médical que ceux que le salarié/patient aura lui-même préalablement invoqués à l’encontre de l’employeur car il ne s’agit pas de discuter au fond du lien établi par le médecin du travail entre la souffrance du salarié/patient et son travail mais seulement d’examiner si le lien dont il fait état dans son écrit résulte de constats personnels. Le débat est ainsi totalement circonscrit à la conformité du comportement du médecin du travail à l’exigence déontologique de constats personnels. Le bien-fondé de ses conclusions n’entre pas en ligne de compte55 et il n’a donc pas à en justifier. Dans ces conditions, les chances qu’aboutisse le recours qui vient d’être formé56 devant la Cour européenne des droits de l’Homme sur le fondement d’une violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme57 semblent compromises. En revanche, les arguments invoqués seraient sans conteste pertinents si le juge ordinal dépassait l’exigence de constats personnels pour autoriser le médecin du travail à faire état de ses conclusions sur le lien santé/travail acquises grâce à la clinique médicale du travail, dès lors que celui-ci a été sérieusement mené. Là se trouve le nœud de la difficulté : une évolution de l’interprétation de la règle déontologique, permettant de prendre en compte la clinique médicale du travail et ainsi un plus large panel de situations pathogènes, amènerait à vérifier le sérieux avec lequel le médecin du travail aura investi le lien santé/travail dont il aura pu faire état dans son écrit. Mais pour ce faire, serait mis à mal le droit du salarié/patient au secret médical58. Une telle évolution ne peut se concevoir que conjuguée à un aménagement de la procédure disciplinaire afin que soit protégé le secret médical. Ce que le gouvernement ne semble guère pour l’heure disposé à faire.
V. L. B.-D.
B – Les autres risques du droit
II – La gestion du risque par le droit
A – Anticipation du risque
B – Les conséquences des risques réalisés
(À suivre)
Notes de bas de pages
-
1.
Nourissat C. et Révillard M., « Règlements européens du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés », Defrénois 15 sept. 2016, n° 124g4, p. 878 ; Barrière-Brousse I., « Le patrimoine des couples internationaux dans l’espace judiciaire européen. Les règlements européens du 24 juin 2016 relatifs aux régimes matrimoniaux et aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés », JDI 2017, doctr. 6 ; Gallant E., « Le nouveau droit international privé européen des régimes patrimoniaux des couples », Europe 2017, étude 3.
-
2.
Péroz H., « Le nouveau règlement sur les régimes matrimoniaux », JCP N 2016, n° 29, 1241 ; Perreau-Saussine L., « Le nouveau règlement sur les régimes matrimoniaux », JCP G 2016, n° 42, doctr. 1116 ; Godechot-Patris S., « Commentaire du règlement du 24 juin 2016 relatif aux régimes matrimoniaux : le changement dans la continuité », D. 2016, p. 2292.
-
3.
Péroz H., « Régimes patrimoniaux des couples internationaux : coopération renforcée en Europe », JCP N 2016, n° 25, act. 755.
-
4.
Nourissat C. et Révillard M., « Règlements européens du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés », Defrénois15 sept. 2016, n° 124g4, p. 878.
-
5.
Cass. req., 4 juin 1935 : Ancel B. et Lequette Y., Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 5e éd., 2006, Dalloz, p. 128, n° 15.
-
6.
Cass. 1re civ., 19 oct. 1959 : D. 1960, p. 37, note Holleaux G. ; Rev. crit. DIP 1960, p. 215, note Y. L. – Cass. 1re civ. 30 oct. 1962 : Ancel B. et Lequette Y., Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 5e éd., 2006, Dalloz, p. 319, n° 37 ; Rev. crit. DIP 1963, p. 387, note Francescakis P. ; D. 1963, p. 109, note Holleaux G.
-
7.
Cass. 1re civ., 19 nov. 1985 ; Ancel B. et Lequette Y., Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 5e éd., 2006, Dalloz, p. 638, n° 71 ; Rev. crit. DIP 1986, p. 712, note Lequette Y. ; JDI 1986, p. 719, note Huet A. ; D. 1986, p. 268, obs. Audit B. ; JCP G 1987, II 20810, note Courbe P.
-
8.
Cass. 1re civ., 25 nov. 1974 : Ancel B. et Lequette Y., Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 5e éd., 2006, Dalloz, p. 504, n° 54 ; Rev. crit. DIP 1975, p. 491, note Holleaux D. ; JDI 1975, p. 108, note Ponsard A.
-
9.
Nourissat C. et Révillard M., « Règlements européens du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés », Defrénois 15 sept. 2016, n° 124g4, p. 878.
-
10.
L’accord des époux est nécessaire lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage :
-
11.
a/ est la juridiction d’un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a :, cinquième tiret, du règl. (UE) n° 2201/2003.
-
12.
b/ est la juridiction d’un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins 6 mois immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a/ sixième tiret du règlement (CE) n° 2201/2003.
-
13.
c/ est saisie en vertu de l’article 5 du règl. (CE) n° 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce, ou
-
14.
d / est saisie en vertu de l’article 7 du règl. (CE) n° 2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
-
15.
Barrière-Brousse I., « Le patrimoine des couples internationaux dans l’espace judiciaire européen. Les règlements européens du 24 juin 2016 relatifs aux régimes matrimoniaux et aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés », JDI 2017, doctr. 6, n°31.
-
16.
Lettre du 19 décembre 2017, disponible sur le site www.snpst.org.
-
17.
C. trav., art. L. 4624-7 (à nouveau modifié par l’ord. du 20 déc. 2017, puis par la loi de ratification du 29 mars 2018).
-
18.
Ordonnance intervenue afin de lever les ambiguïtés et incertitudes de la réforme réalisée par la loi Travail l’année précédente.
-
19.
CSP, art. L. 4124-6.
-
20.
Not. par le syndicat national des professionnels de la santé au travail (SNPTS), l’association santé et médecine du travail (a-SMT) ou encore le syndicat de la médecine générale (SMG). La polémique est ancienne : déjà en 2006, Alain Carré regrettait que les plaintes des employeurs soient jugées recevables : Carré A., « Plainte des employeurs contre les médecins du travail pour une déontologie des juridictions de l’Ordre des médecins », Les Cahiers S.M.T 2006, n° 21, p. 67.
-
21.
La chambre disciplinaire nationale a confirmé le 4 mai 2018 cette condamnation. Sa décision n’étant pas publiée au jour où ces lignes sont écrites, c’est avec la plus grande prudence que seront évoquées ses conclusions. En revanche, la décision de première instance est disponible et permet une appréhension des faits (CNOM, ch. disc. 1re instance Île de France, 18 janv. 2016, n° 9699, www.a-smt.org).
-
22.
CE, 6 juin 2018, n° 405453.
-
23.
L’a-SMT œuvre de longue date en faveur de la suppression de la faculté pour les employeurs d’initier des actions disciplinaires.
-
24.
En 2013, l’ordre des médecins énonçait que « les plaintes d’employeurs sont rarissimes » en réponse aux reproches faits à son encontre d’être instrumentalisé par les employeurs (communiqué du 16 mai 2013). Interpellée sur la question en 2015, la ministre de la Santé indiquait qu’elle avait saisi le conseil de l’ordre aux fins d’établir la proportion de recours émanant d’employeurs (Touraine M., « Projet de loi de modernisation de notre système de santé », DP Sénat, 16 sept. 2015). Les rapports d’activité de la juridiction ordinale témoignent d’un effort en ce sens depuis 2014, mais ils ne sont pas suffisamment précis pour en tirer des conclusions.
-
25.
Les rapports d’activité de la juridiction ordinale visent les plaignants par catégorie dont celle de « personne morale ».
-
26.
Seul le rapport d’activité de la juridiction ordinale pour 2015 fait état pour la première fois (et semble-t-il la dernière) de 21 médecins du travail poursuivis devant les CDPI. On reste toutefois pour ces cas dans l’ignorance de l’auteur des plaintes et de leur objet. L’a-SMT a de son côté tenté de procéder à une évaluation. Mais les résultats sont obtenus par extrapolation à partir d’affaires portées à sa connaissance (Huez D., « Évaluation du 4 avril 2017 », www.a-smt.org).
-
27.
Les rapports d’activité de la juridiction ordinale recensent les sanctions à différents manquements déontologiques en classant ceux-ci par catégories parmi lesquelles les « certificats dont certificat de complaisance/rapport tendancieux » et la « médecine du travail » sans plus de précision.
-
28.
Mémeteau G. et Girer M., Cours de droit médical, 5e éd., 2016, LEH Edition, p. 163.
-
29.
CNOM, ch. disc., 4 févr. 2016, n° 12338.
-
30.
CNOM, ch. disc., 28 nov. 2014, n° 11968 (inaptitude à tous les postes de cette entreprise « à la suite de violences internes à l’entreprise » suivie d’une lettre indiquant au dirigeant que ses « méthodes de travail semblent être la cause de mal-être profond au travail, avec risque de suicide ») ; CE, 10 févr. 2016, n° 384299 – CNOM, ch. disc., 7 juill. 2014, n° 11823 (avis d’inaptitude sous pression du salarié, à partir de ses seuls dires sans étude de poste ni échange avec l’employeur).
-
31.
CNOM, ch. disc., 7 juin. 2011, n° 10143 bis (courrier précisant que le travail est dangereux pour la salariée, faisant état d’une guerre intestine au sein de l’entreprise et considérant que le dirigeant est « tout puissant et a, à mon avis, une structure perverse »).
-
32.
CE, 6 juin 2018, n° 405453 ; CNOM, ch. disc., 8 juin 2016, n° 12218 (certificat se référant notamment à un « vécu de maltraitance professionnelle ») et à un « enchaînement de pratiques “maltraitantes de son entreprise” » ; CNOM, ch. disc., 26 sept. 2016, n° 12660 (certificat de six pages reprenant l’historique de la carrière de la salariée et les relations conflictuelles vécues par elle et faisant notamment mention d’épisodes de maltraitance professionnelle et de maltraitance managériale et organisationnelle) ; CNOM, ch. disc., 26 juin 2014, n° 11843 (attestation de la détérioration de l’état de santé et de graves pathologies « en raison des risques psycho-sociaux » et du « contexte d’environnement relationnel extrêmement délétère ») ; CNOM, ch. disc., 5 févr. 2007, n° 9509 (certificat reprenant de manière exhaustive les dires de la patiente mais dans lequel le médecin du travail conseillait à la salariée de tenir le coup car, pour lui, le processus de licenciement était en cours en lui précisant que si elle n’y arrivait pas, il la mettrait inapte au poste de travail).
-
33.
CNOM, ch. disc. 1re instance Île-de-France, 18 janv. 2016, n° 9699.
-
34.
CE, 10 févr. 2016, n° 384299 ; CNOM, 7 juill. 2014, n° 11823 (même affaire).
-
35.
CNOM, ch. disc., 28 nov. 2014, n° 11968 ; CE, 10 févr. 2016, n° 384299 ; CNOM, ch. disc., 7 juill. 2014, n° 11823 (même affaire).
-
36.
Boissin H. et Rougemont D., « Les certificats médicaux, Règles générales d’établissement », Rapp. CNOM oct. 2006.
-
37.
Afin de distinguer ce qui est allégué par le patient et ce qui est constaté par le médecin.
-
38.
« Que le médecin du travail puisse ainsi relier (au niveau collectif comme individuel) la souffrance du salarié à ses conditions de travail (…), c’est chose entendue et indiscutable (…). Le lien d’imputation est ainsi un fait “certifiable” » : Adam P., « Médecins du travail : le temps du silence ? », Dr. soc. 2015, p. 541.
-
39.
CNOM, ch. disc., 7 juin. 2011, n° 10143 bis ; CNOM, ch. disc., 26 juin 2014, n° 11843.
-
40.
CE, 6 juin 2018, n° 405453.
-
41.
N’en bénéficient pas les médecins généralistes et les psychiatres qui sont eux aussi confrontés à des plaintes d’entreprises pour leurs écrits en matière de risques psycho-sociaux.
-
42.
Rapp. CNOM, Les écrits du médecin du travail et la déontologie médicale, juin 2015.
-
43.
En ce sens, CNOM, ch. disc., 31 mars 2015, n° 12068.
-
44.
V. not. pour une première appréhension de cette pratique : Loubet-Deveaux A. et Bardot F., « Une nouvelle pratique : la clinique médicale du travail », Travailler 2003/2, n° 10) ; Carré A., Sandret N. et Martinez H., Concepts de la clinique médicale du travail : les mots clés, 14 juin 2013, Les Actes du colloque E-Pairs Association SMT, www.E-Pairs.org ; Davezies P., Repères pour une clinique médicale du travail, 31 mai 2006, 29e congrès national de médecine et santé au travail, www.a-smt.org.
-
45.
Carré A., Sandret N. et Martinez H., Concepts de la clinique médicale du travail : les mots clés, 14 juin 2013, Les Actes du colloque E-Pairs Association SMT, www.E-Pairs.org.
-
46.
Carré A., Sandret N. et Martinez H., Concepts de la clinique médicale du travail : les mots clés, 14 juin 2013, Les Actes du colloque E-Pairs Association SMT, www.E-Pairs.org.
-
47.
Carré A., La décision de l’instance disciplinaire condamnant le Dr. Djemil : incompétence médicale ou parti-pris idéologique ?, mai 2018, www.a-smt.org ; Huez D., Témoignage et analyse d’un médecin poursuivi, Les cahiers SMT 2015, n° 29, p. 58.
-
48.
CSP, art. L. 4123-2 : « Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, (…) mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de 3 mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. (…) En cas de carence du conseil départemental, l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d’un mois.
-
49.
Guigou E., Projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé n° 3258, Exposé des motifs, 5 sept. 2001.
-
50.
Au cours des débats parlementaires, a également été visé « l’usager du service de santé » (Evin C., Charles B. et Denis J.-J., Rapp. AN n° 3263, vol. 1, 18 sept. 2001).
-
51.
CSP, art. R. 4126-1.
-
52.
On songe dans notre cas à un salarié dont le comportement pathogène aura été évoqué dans un écrit du médecin du travail.
-
53.
Encore qu’une autre interprétation de l’article R. 4126-1 du Code de la santé publique eut été possible (v. Adam P., « Médecins du travail : le temps du silence ? », Dr. soc. 2015, p. 541), le Conseil d’État reconnaît que cette disposition permet aux entreprises d’introduire une plainte. Il admet en effet que cette faculté est ouverte à « toute personne, lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques » : CE, 11 oct. 2017, n° 403576 : JCP S 2018, n° 4, 1038, note Frouin C. Cette condition de l’intérêt à agir est aisément remplie dans notre hypothèse où le certificat litigieux, en attribuant une cause professionnelle à l’état de santé du salarié, met en cause une entreprise et/ou un autre salarié.
-
54.
Et dès lors de se retrouver automatiquement en chambre disciplinaire (CSP, art. L. 4123-2).
-
55.
En sus des pétitions au soutien de médecins poursuivis ou courrier adressé au président du conseil national de l’ordre (lettre ouverte du 23 octobre 2015, www.a-smt.org), la ministre de la Santé a été directement interpellée sur la question, par voie de lettres ouvertes (lettre du 19 mars 2015, www.a-smt.org ; lettre du 26 janvier 2016, www.a-smt.org) ou d’amendement lors du projet de loi Santé (DP Sénat, sc., 16 sept. 2015) ainsi que le Premier ministre (requête préalable du 13 mai 2016 tendant à l’abrogation partielle de l’article R. 4126-1 du Code de la santé publique, www.a-smt.org). À la suite du refus implicite de ce dernier, l’association SMT, le syndicat national des médecins du travail des mines et des industries électriques et gazières (SMTIEG-CGT), le syndicat UGICT-CGT, l’association ASD PRO, l’union syndicale solidaires et le syndicat de la médecine générale ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Premier ministre (requête pour excès de pouvoir du 14 septembre 2016, a-smt.org).
-
56.
CE, 11 oct. 2017, n° 403576.
-
57.
Communiqué de l’association SMT www.a-smt.org.
-
58.
Dans sa conception large. Le salarié/patient ayant lui-même invoqué ces éléments à l’encontre de l’employeur, ce dernier en aura eu connaissance sans violation du secret médical.
-
59.
Aussi est-il indifférent qu’une décision du juge prud’homal ou du juge pénal vienne ensuite confirmer les conclusions du médecin du travail. Tout au plus cela vaudra-t-il au médecin du travail un peu d’indulgence de la part du juge ordinal dans le prononcé de la sanction (CNOM, ch. disc., 31 mars 2015, n° 12068).
-
60.
Requête du 11 avril 2018, dont des extraits sont disponibles sur www.a-smt.org.
-
61.
Les requérants (l’association SMT, le SMG et le SMTIEG – CGT) invoquent une rupture de l’égalité des armes du fait de l’impossibilité pour le médecin de se défendre sans violer le secret médical ainsi que la violation du droit au respect de la vie privée (des malades) que l’État français ne peut réparer qu’en amendant les dispositions des articles R. 4126-1 et L. 4123-2 du Code de la santé publique.
-
62.
V. l’exemple significatif donné dans la requête devant la CEDH.