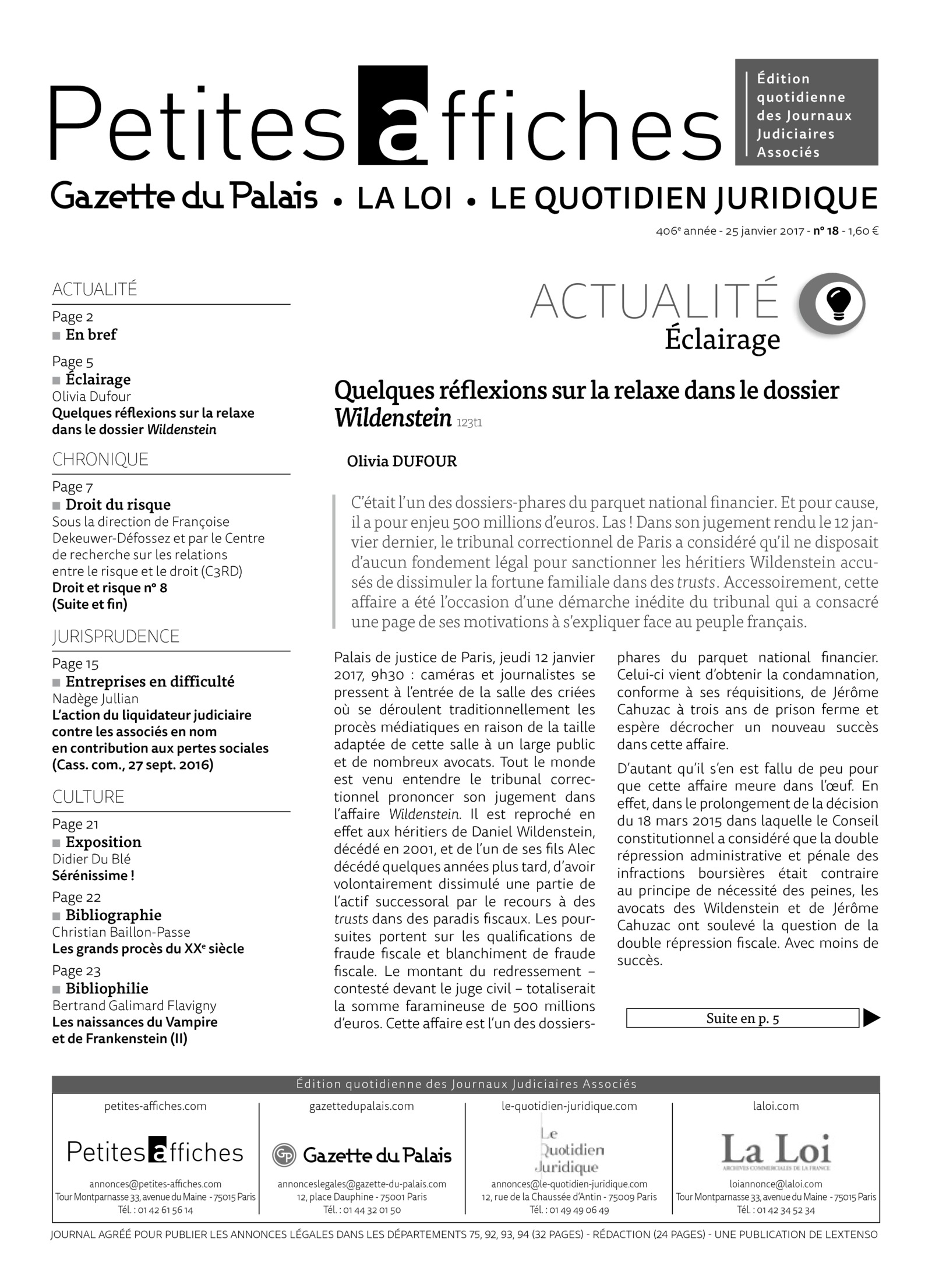Droit et risque n° 8 (Suite et fin)
Cass. com., 1er déc. 2016, no 14-20688
CEDH, 22 mars 2016, no 646/10, M. G.
L. n° 2016-297, 14 mars 2016 : relative à la protection de l’enfant
I – Les risques du droit
A – L’insécurité juridique
B – Les autres risques du droit
II – La gestion du risque par le droit
A – Anticipation du risque
Risques de violences conjugales et obligation de protection de l’État
CEDH, 22 mars 2016, n° 646/10, M. G. c/ Turquie. Déjà condamnée dans l’affaire n° 33401/02 Opuz c/ Turquie le 9 juin 2009, la Turquie était derechef poursuivie par une femme estimant ne pas avoir été suffisamment protégée contre les violences graves que son époux lui a fait subir pendant de nombreuses années. Malgré la réforme législative réalisée par la Turquie suite à sa précédente condamnation, la République de Turquie est de nouveau considérée comme n’ayant pas assumé ses obligations et devra indemniser la plaignante pour son préjudice moral, à hauteur de 19 500 euros.
L’intérêt de cet arrêt pour le juriste français réside, à l’évidence, dans la possibilité de comparer le droit applicable en Turquie et celui de la France, mais aussi plus largement de réfléchir sur les voies et moyens qu’un État peut effectivement utiliser afin de prévenir les violences familiales.
Mme M. G., mariée depuis 1997, affirme avoir subi des violences conjugales dès le début de l’union. Elle saisit le procureur de la République le 18 juillet 2006 d’une plainte pour viol, violences volontaires, torture, privation de liberté et toute une série d’autres violences physiques et morales. Un rapport de l’institut médico-légal, et un autre du service de psychiatrie sont dressés dans les jours qui suivent, et attestent les graves séquelles psychiques et physiques de Mme M. G. Le mari est convoqué par la police en décembre, mais il nie toute violence. Cependant, au vu d’un rapport d’expertise de janvier 2007, l’instruction se poursuit. Elle n’aboutira qu’en février 2012, date à laquelle le mari est inculpé pour une partie des délits qui lui sont reprochés. Au jour où la Cour de Strasbourg statue, c’est-à-dire en mars 2016, l’affaire n’a toujours pas été jugée…
Parallèlement, Mme M. G. saisit le juge aux affaires familiales d’une demande de divorce, laquelle aboutit à un divorce aux torts partagés en décembre 2007. Le tribunal note que la requérante a de son côté vécu avec un autre homme pendant quelques mois et qu’elle a participé à une émission télévisée dans laquelle elle exposait les violences subies depuis le début de son mariage, en sorte que « les deux parties sont également responsables de l’échec du mariage ». Le juge des affaires familiales rend également en 2006 une première ordonnance de protection interdisant au mari d’approcher ou de déranger sa femme pendant une durée de six mois. En 2012, le juge aux affaires familiales rendra une nouvelle ordonnance de protection, Mme M. G. affirmant que son mari continue de la menacer. Elle sera suivie d’une itérative ordonnance de protection en 2013, puis encore en 2014. Toutefois, en 2014, la durée des mesures fut limitée à deux mois.
Pendant tout ce temps, les enfants du couple ont été placés dans des institutions, Mme M. G. étant dans l’incapacité de s’en occuper. Elle a été hébergée par un foyer pour femmes battues, puis est restée en liens avec le centre de prévention. Elle a vécu d’aides sociales, qu’elle refusait d’accepter lorsqu’elle était avertie qu’elles seraient récupérées sur son ex-mari.
La condamnation de l’État turc par la Cour de Strasbourg est fondée sur deux séries de motifs, qui appellent des commentaires différents.
La première série de griefs résulte du retard des poursuites pénales, la mobilisation du dispositif pénal ayant été clairement défectueuse, et la condamnation de ce chef est parfaitement compréhensible (I) ; en revanche, la manière dont la Cour censure le fonctionnement des mesures civiles de protection suscite l’interrogation (II).
I. Les risques d’impunité pénale : une passivité révélatrice de discrimination
Ce qui est reproché à la Turquie dans l’arrêt commenté est en continuité directe avec la jurisprudence Opuz1 : la Turquie, certes, incrimine législativement les violences conjugales, mais de manière relativement formelle, car les poursuites sont extrêmement molles et n’aboutissent donc pas à des condamnations effectives et suffisantes. En l’espèce, la Cour relève qu’il a fallu cinq mois après le dépôt de plainte pour que le mari fasse l’objet d’un mandat d’amener et d’une audition, et cinq ans et demi avant le déclenchement des poursuites, lesquelles n’ont pas encore abouti à une condamnation au jour de l’arrêt. L’absence de sanction pendant plus de six ans ne peut qu’ancrer le mari violent, ainsi que tous les hommes dans la même situation, dans un sentiment d’impunité et de toute-puissance favorable à la réitération des violences et des menaces. Aussi bien, la Cour relève que cette inaction a contribué à ce que la requérante ait « dû vivre une situation propre à lui inspirer des sentiments de peur, de vulnérabilité et d’insécurité » (§ 105).
Comme le relève la Cour de Strasbourg, « le simple passage du temps est de nature à nuire à l’enquête mais aussi à compromettre définitivement ses chances d’aboutissement2. Elle souligne en outre que l’écoulement du temps érode inévitablement la quantité et la qualité des preuves disponibles et que, en outre, l’apparence d’un manque de diligence jette le doute sur la bonne foi avec lesquelles les investigations sont menées et fait perdurer l’épreuve que traversent les plaignants »3.
Le fait que la Turquie ait déjà été condamnée par la Cour de Strasbourg dans plusieurs affaires similaires achève de convaincre les juges européens de l’existence d’une « passivité généralisée et discriminatoire » concernant les violences conjugales, créant un climat propice à cette violence (§ 6) : les faibles risques de poursuite et de condamnation encourus par les conjoints violents ne peuvent que les conforter dans une attitude violente quasiment assurée de l’impunité. Il s’agit là de l’application d’une jurisprudence constante de la Cour de Strasbourg4.
Cette critique ne saurait être étendue à un pays tel que la France, dans lequel les violences conjugales sont effectivement poursuivies, et même depuis plus longtemps qu’on ne le prétend souvent5.
L’aspect innovant de la décision est la mobilisation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 7 avril 2011, dite Convention d’Istanbul, que la Turquie a signée et ratifiée le 14 mars 2012. Le Préambule de cette convention la situe explicitement dans le sillage de la Convention européenne des droits de l’Homme et de l’importante jurisprudence rendue par la Cour de Strasbourg en cette matière, ce qui explique sa mobilisation comme source de droit pertinent par cette dernière. Au vu de l’importance et de la précision des obligations mises à la charge des États parties par cette Convention, le fait que la Cour de Strasbourg en assure l’effectivité obligera les États à une diligence accrue, s’ils veulent éviter des condamnations répétitives, à l’instar de la Turquie. Une éventuelle adhésion de l’Union européenne à la Convention d’Istanbul ne pourrait que renforcer cette impérativité6.
L’intégration de la Convention d’Istanbul dans le corpus des règles dont la Cour de Strasbourg assure l’efficacité n’est pas sans susciter quelques interrogations. Alors que la question de savoir s’il s’agit de violences « conjugales », ou « de genre » divise sociologues et psychologues (le fait qu’elles puissent exister dans des couples de même sexe ne contribuant pas à éclaircir le débat), la Convention d’Istanbul et à sa suite la Cour de Strasbourg les considèrent de manière univoque comme une discrimination dirigée contre les femmes (§ 115 et 116), optique que l’on peut estimer réductrice et parfois erronée.
Dans l’affaire M. G. c/ Turquie, la Cour de Strasbourg a relevé que la Convention d’Istanbul impose aux États parties de prendre toutes les mesures pour que les enquêtes et procédures judiciaires soient traitées sans retard injustifié (art. 49 de la Convention).
Les reproches faits à la Turquie de ce chef sont si évidemment fondés que l’État turc ne s’est pas défendu et s’en est remis à l’appréciation de la Cour (§ 74). Comme il était prévisible, la Cour a condamné l’État turc. Il n’est pas exclu qu’une autre condamnation soit encore encourue, dans la mesure où la Cour a rejeté les demandes fondées sur l’article 6 de la Convention, relevant que le procès pénal n’étant pas encore terminé, l’épuisement des voies de recours n’était pas constitué (§ 120). Mais si l’issue du procès pénal conforte l’impression d’impunité, un autre recours devant la Cour de Strasbourg n’est pas inimaginable.
Si un retard de la sanction pénale confinant à l’oubli est clairement contraire à l’obligation de l’État de protéger les femmes contre les violences conjugales, le dispositif pénal n’est évidemment pas suffisant à lui seul pour constituer une protection efficace. L’examen des mesures civiles suscite cependant nombre d’interrogations.
II. Les ordonnances de protection civiles : une prévention impossible ?
Après une première ordonnance de protection délivrée le 31 août 2006, le divorce de Mme G. fut prononcé en 2007, mais elle continua à se sentir menacée par son ex-conjoint. Prise en charge dans un refuge, elle y subit des soins médicaux et psychologiques pendant deux ans et demi. Trop affectée pour trouver un emploi, elle ne subsista qu’avec des aides publiques, qu’elle refusa lorsqu’elle apprit qu’elles seraient recouvrées sur son ex-mari, redoutant ses violences.
À cette époque, il lui était impossible d’obtenir une nouvelle ordonnance de protection, la loi ne visant pas le cas des femmes divorcées. Une loi du 20 mars 2012, n° 6284, ayant étendu le champ d’application des ordonnances de protection aux épouses divorcées, Mme G. saisit le tribunal de la famille d’une demande d’ordonnance de protection, qui lui fut accordée le 9 novembre 2012. L’ex-mari se vit donc interdire pendant six mois d’approcher de Mme G., de communiquer avec elle, et il lui fut imposé de remettre les armes qu’il pouvait détenir. Deux nouvelles ordonnances de protection furent prises, en octobre 2013 pour six mois, puis en juin 2014 pour deux mois seulement. À chaque fois, Mme G. déclarait que l’ordonnance de protection étant échue, elle se sentait de nouveau menacée.
La condamnation de la Turquie du chef des mesures civiles prises par le juge aux affaires familiales est fondée sur l’article 14 combiné à l’article 3, en raison de l’impossibilité, entre 2007 et 2012 de prendre une ordonnance de protection en faveur d’une femme divorcée. Un semblable reproche ne saurait être fait à la législation française, puisque l’article 515-9 du Code civil permet de prendre une ordonnance de protection à l’encontre d’un ancien conjoint, ancien partenaire lié par un pacs ou ancien concubin. De fait la fin légale de l’union ne marque pas toujours, tant s’en faut, la cessation des violences et menaces. Pourtant, la prise d’une ordonnance de protection à l’encontre d’une personne qui n’est plus juridiquement liée à l’auteur des menaces pose un certain nombre de problèmes spécifiques.
Historiquement l’ancêtre de l’ordonnance de protection est l’ordonnance qui peut être prise dès le dépôt d’une requête en divorce lorsque des mesures urgentes et provisoires paraissent nécessaires. En France, depuis la loi du 18 avril 1886, le juge peut autoriser l’épouse à résider séparément de son mari pendant la durée de l’instance en divorce, et ceci sur la foi des affirmations unilatérales de la demanderesse et sans débat contradictoire. En effet, le devoir de communauté de vie s’oppose à ce que les épouses maltraitées puissent s’enfuir du domicile familial. Il fallait donc leur permettre de se soustraire à ce devoir.
Dans le cas des femmes qui ne sont pas ou plus mariées, la situation est juridiquement différente : n’étant liées par aucun devoir juridique, rien ne leur interdit en théorie de partir et de se mettre à l’abri des menaces de l’ex-conjoint ou concubin. Le sens et la portée de l’ordonnance de protection sont alors différents et se rapprochent d’ailleurs plus d’une mesure pénale, puisqu’il s’agit de mesures de restriction de droits et de libertés destinées à prévenir la commission de violences qui constitueraient un délit.
La Cour de Strasbourg a considéré que la législation turque antérieure à 2012 était discriminatoire, alors qu’elle était en réalité fondée sur une vision civiliste de la situation de l’épouse. De ce fait, elle a condamné la conception ancienne de l’ordonnance de protection comme autorisation de se dérober aux devoirs du mariage, et a imposé une vision moderne de protection physique de toute femme (ou homme, pourquoi pas ?) potentiellement victime de violences. C’est aussi l’optique de la Convention d’Istanbul qui évoque les ordonnances de protection en continuité de la politique pénale.
Il ne faut cependant pas ignorer les difficultés juridiques résultant du changement de paradigme fondant l’ordonnance de protection. L’une des plus aigües est celle de la durée des mesures. Dans la loi française du 9 juillet 2010, l’ordonnance de protection avait une durée maximale de quatre mois, sauf dans le cas où elle concernait une femme mariée : à condition que la procédure de divorce soit initiée pendant ce délai, l’ordonnance pouvait voir ses effets prolongés jusqu’au prononcé du divorce. Pour remédier au désavantage des femmes non mariées, à l’égard desquelles cette faculté de prolongation n’existait pas7, la loi du 4 août 2014 a permis de prolonger l’efficacité de l’ordonnance de protection, désormais fixée à six mois, jusqu’à la fin d’un éventuel litige relatif à l’autorité parentale (à quoi on peut raisonnablement assimiler les litiges relatifs à l’obligation alimentaire) si la victime et l’auteur des violences ne sont pas ou plus mariés. La réforme fut présentée comme alignant la situation des victimes mariées et non mariées, mais il s’agit là d’une présentation fallacieuse car il existe des séparations violentes de couples qui n’ont aucun enfant mineur, pour lesquelles aucune possibilité de prolongation des mesures n’est prévue.
Le débat relatif à la durée des mesures de protection et à leur éventuelle prolongation doit cependant être relativisé, car, si la loi ne permet pas la prolongation d’une ordonnance arrivée à son terme, il est toujours possible, si la menace persiste, d’obtenir une nouvelle ordonnance de protection. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé dans l’affaire M. G. c/ Turquie. Reste que l’on ne peut les renouveler indéfiniment, et le fait que la dernière ordonnance de protection de Mme G. n’ait été prise que pour deux mois montre bien les réticences du JAF devant ces renouvellements itératifs.
L’arrêt M. G. c/ Turquie interpelle donc l’observateur quant à la durée possible des mesures de protection. L’on ne peut oublier qu’il s’agit de dispositions qui peuvent être gravement attentatoires aux libertés de celui qu’elles visent, et le respect de ces droits impose de limiter ces restrictions à ce qui est nécessaire. L’arrêt commenté montre que cette durée peut être très longue : de 2007 à 2014, c’est pendant sept années que l’ex-mari a été mis sous contrôle judiciaire par de successives ordonnances de protection ! Il est, certes « difficile de mettre en balance, d’articuler le principe de présomption d’innocence et celui de protection des victimes dans cette sphère sensible »8.
On relativisera l’atteinte aux libertés de l’ex-mari en faisant remarquer qu’en l’espèce, les mesures n’étaient que faiblement attentatoires, puisqu’elles consistaient en l’interdiction de toute violence, menace ou harcèlement, incriminées de toute façon par le Code pénal, assorties de l’interdiction de prendre contact avec son ex-épouse, d’approcher de son domicile et de détenir une arme. Ces restrictions limitées et assez légères demeuraient tout à fait tolérables, même pendant plusieurs années.
Cependant, pendant toute cette période, on ne relève aucun fait de violence physique de la part de l’ex-mari de Mme G. Quant aux menaces, leur réalité n’est pas réellement étayée par l’exposé des faits de l’arrêt. La Cour de Strasbourg a considéré qu’elles étaient établies par les ordonnances de protection (§ 105)… ce qui est un curieux renversement de la preuve ! Rien non plus, ne permet d’affirmer que la situation de Mme G. ait été plus mauvaise pendant le temps où elle ne bénéficiait d’aucune ordonnance de protection (2007-2012) que par la suite lorsqu’elle en a obtenu (2012-2014), ce qui jette un doute sur la pertinence de la condamnation de l’État turc de ce chef.
Si l’existence des menaces n’est pas vraiment attestée, il est cependant certain que Mme G. vivait dans la terreur. Et ce qui est reproché à l’État turc par la Cour de Strasbourg n’est pas d’avoir mal protégé Mme G. puisque, rappelons-le, aucun fait de violence n’est survenu après la plainte pénale et le prononcé du divorce, mais de ne pas avoir fait en sorte qu’elle ne se sente plus menacée (§ 104, 105, 106). Ce faisant, l’arrêt se situe clairement dans le sillage de la jurisprudence antérieure de la Cour, qui englobe dans le respect de la vie privée la protection de l’intégrité psychologique, notamment des plus vulnérables9. Mais il ajoute à la Convention d’Istanbul, qui impose aux États de protéger les femmes contre les menaces et les violences, mais non pas de leur garantir une vie exempte de crainte.
Mais est-ce que cette « obligation positive » est réaliste en toute hypothèse ? En raison d’une menace dont, rappelons-le, aucune violence postérieure à 2006 n’attestait matériellement la plausibilité, Mme G. est allée jusqu’à reprocher à l’État turc le fait que les JAF ne puissent être saisis qu’aux heures ouvrables (§ 108) ! La Cour de Strasbourg n’a pas répondu à ce grief et n’a pas imposé aux États d’organiser des « permanences femmes battues » à la charge des JAF. Mais cette requête irréaliste montre bien qu’il existe des limites à ce qu’un État peut organiser pour protéger les femmes de violences conjugales éventuelles.
Dans la mesure où le sentiment d’effroi et de crainte résulte non pas de la réalité d’une menace, mais de la représentation de cette menace par la subjectivité d’une personne, il n’est pas réaliste d’exiger que l’État parvienne, en toute hypothèse, à éradiquer toute crainte de la part d’une femme qui a été violentée dans le passé. Telle pourrait être, à rebours de ce que souhaitait la Cour de Strasbourg, la leçon de l’arrêt M. G. c/ Turquie.
Françoise Dekeuwer-Défossez
B – Les conséquences des risques réalisés
Dans le sillage de l’Erika : le préjudice écologique saisi par le droit commun de la responsabilité civile
Pas davantage l’émergence contemporaine de la notion de préjudice écologique que les décisions de justice relative à sa reconnaissance et à sa réparation ne pourront désavouer Théodore Monod lorsque celui-ci affirmait que « Parler de l’homme dans la nature revient presque aujourd’hui à parler de l’homme contre la nature ». Aussi pessimiste cette conception soit-elle, le droit n’est désormais que trop familier des atteintes portées à l’environnement, en témoigne notamment la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux10.
À l’échelle nationale, le naufrage de l’Erika le 12 décembre 1999 a longtemps cristallisé l’attention du juriste et son traitement par les juridictions judiciaires a permis à la jurisprudence de développer de nouveaux concepts, en reconnaissant notamment la particularité du préjudice écologique. L’arrêt rendu le 22 mars 2016 par la chambre criminelle de la Cour de cassation s’inscrit dans le triste sillage de l’affaire de l’Erika, tout en affinant et en enrichissant considérablement ses solutions.
En l’espèce, une rupture de tuyauterie de la raffinerie de Donges, exploitée par la société Total Raffinage Marketing, a provoqué le déversement de fuel dans l’estuaire de la Loire. L’importante pollution occasionnée a touché de nombreuses communes. En première instance, la société Total a été reconnue coupable par un tribunal correctionnel de rejet en mer ou eau salée de substances nuisibles pour le maintien ou la consommation de la faune ou de la flore et de déversement de substances entraînant des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la faune ou à la flore. Sur l’action civile, le tribunal a condamné la société Total à indemniser le préjudice matériel et moral de nombreuses collectivités territoriales et association agréées de protection de l’environnement, en ce compris la Ligue de protection des oiseaux (LPO). Les premiers juges ont en revanche déclaré la LPO irrecevable dans sa demande en réparation du préjudice écologique.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 27 septembre 201311 a, quant à elle, jugé recevable la demande de la LPO, mais ne l’en a pas moins déboutée sur le fond. D’une part, les juges du fond ont relevé que la LPO avait chiffré le préjudice sur la base d’une estimation du nombre d’oiseaux détruits, quand bien même cette destruction n’était pas prouvée. D’autre part, la cour d’appel a noté que l’association avait évalué son préjudice sur la base de son propre budget annuel destiné à la gestion de la baie de l’Aiguillon. La LPO aurait ainsi sollicité la réparation de ce qui s’apparentait à un préjudice économique, confondant de ce fait son préjudice personnel et le préjudice écologique dont elle réclamait la réparation.
Invitée de nouveau à se saisir de la délicate question de la définition du préjudice écologique, de son évaluation et de sa réparation subséquente, et aux termes d’un arrêt richement motivé, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 mars 2016, casse l’arrêt de la cour d’appel de Rennes au quintuple visa des articles L. 142-2, L. 161-1 et L. 162-9 du Code de l’environnement, 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil.
Reprenant de prime abord une définition jurisprudentielle du préjudice écologique désormais stabilisée, la Cour de cassation énonce que celui-ci « consiste en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction ». La Cour d’ajouter « que la remise en état prévue par l’article L. 162-9 du Code de l’environnement n’exclut pas une indemnisation de droit commun que peuvent solliciter, notamment, les associations habilitées, visées par l’article L. 142-2 du même code ».
Une fois la définition du préjudice écologique et la titularité du droit d’agir en justice évoquées, il ne restait plus à la Cour de cassation que de conclure en abordant l’évaluation et la réparation pécuniaire du préjudice écologique. L’indispensable office des juridictions du fond sur ce point est rappelé par la Cour de cassation, celles-ci devant « réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe et d’en rechercher l’étendue ». Par voie de conséquence, la cour d’appel aurait dû « chiffrer, en recourant, si nécessaire, à une expertise, le préjudice écologique dont elle avait reconnu l’existence ».
À l’évidence, le classique côtoie le nouveau dans cet arrêt riche d’enseignements.
En effet, si la Cour de cassation reprend à l’identique la définition du préjudice écologique issue de la jurisprudence Erika12, l’arrêt ne se cantonne pas à ce simple rappel mais affine considérablement la notion en en précisant les modalités d’évaluation et de réparation. La survenance du risque écologique est ainsi l’occasion pour la Cour de cassation de confronter le régime classique de la responsabilité civile à l’originalité du préjudice écologique. Dans cet exercice, force est de constater que le droit commun de la responsabilité civile rapporte la preuve de ses facultés d’adaptation pour concevoir et appréhender une forme contemporaine de préjudice (I), qu’il appartient aux juges du fond d’évaluer et de réparer (II).
I. La réception du préjudice écologique par le droit de la responsabilité civile : retour sur une nécessaire adaptation du droit commun
Communément défini comme toute « atteinte portée à l’intégrité et/ou à la qualité de l’environnement naturel »13, la saga judiciaire du naufrage de l’Erika14 a été l’occasion pour la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans une décision du 25 septembre 2012, de proposer sa propre définition du préjudice écologique conçu comme « l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement », formulation reprise à l’identique l’arrêt du 22 mars 2016. Ce faisant, c’est plus spécifiquement le préjudice écologique qualifié de « pur » par la doctrine qui a été évoqué en l’espèce, à savoir le préjudice causé aux éléments naturels en tant que tels, indépendamment de ses répercussions sur l’être humain, par opposition au préjudice écologique « dérivé », autrement dit l’atteinte à la personne ou aux biens. « Cette distinction est établie en fonction d’une logique séquentielle : la pollution est le fait causal des préjudices écologiques purs et dérivés, les éléments naturels jouent le rôle de vecteur du fait dommageable »15.
Pourtant, l’on aurait pu penser que le droit de la responsabilité civile était profondément inadapté à appréhender le préjudice écologique ainsi défini. En effet, le droit de la responsabilité civile est classiquement présenté comme celui de la réparation. Dirigé vers cette finalité, ce droit oblige la personne fautive, ou présumée telle, à réparer les conséquences de son acte, le préjudice causé à autrui. Cette conception, d’origine doctrinale16, a rapidement reçu les faveurs de la Cour de cassation selon laquelle, dès 195417, « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu ». Il s’agit en ce sens « de faire croire que le paradis perdu sera retrouvé »18 au moyen d’une fiction juridique tendant à effacer le dommage d’ores et déjà réalisé et subi par la victime. Cette réparation intégrale doit être appropriée, sans qu’il ne puisse, en principe, en résulter « ni perte, ni profit »19 pour la victime.
De ce qui précède, il résulte que la mise en œuvre de la responsabilité civile suppose l’existence, et la preuve, d’un préjudice subi par une victime personnalisée et la présence d’un sujet du droit à réparation. À défaut, le droit de la responsabilité civile échouerait dans la finalité qui est sienne, faute pour lui de seulement pouvoir être mis en œuvre.
Or, l’environnement étant dépourvu de personnalité juridique, le préjudice écologique présente cet écueil, du point de vue des conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile, qu’il « ne porte atteinte à aucun intérêt individuel ». Il s’agit d’un « préjudice sans autre victime que la nature »20. De là à conclure que la responsabilité civile était inadaptée à se saisir du préjudice écologique, il n’y avait qu’un pas que, sous l’impulsion de la doctrine21, la Cour de cassation s’est bien gardée de franchir dans les arrêts du 25 septembre 2012 et du 22 mars 2016. C’est en effet l’objectivisation du préjudice écologique, la conception d’un préjudice qui surpasse les classifications traditionnelles pour se détacher de son nécessaire caractère personnel, qui a permis à la jurisprudence de faire fi de cette difficulté. Que l’on parle, comme l’ont fait les juges du fond dans la décision du 30 mars 2010, d’une atteinte « à l’intégrité du patrimoine naturel » ou aux « actifs environnementaux non marchands », c’est toujours cette même idée d’un préjudice privé de son aspect subjectif et personnel qui recueille les faveurs de la jurisprudence et qui, substantiellement, permet au droit de la responsabilité civile d’appréhender le préjudice écologique, fût-il conçu de façon purement objective. C’est à cette condition sine qua non que, pour reprendre les termes de la décision du 22 mars 2016, « la remise en état prévue par l’article L. 162-9 du Code de l’environnement » demeure compatible avec « une indemnisation de droit commun ». La jurisprudence a ainsi su faire œuvre créatrice en dépersonnalisant la notion de préjudice subi aux fins d’indemnisation. Si cette finalité a pu être atteinte, c’est parce que le droit commun de la responsabilité civile a revêtu, en amont et pour la cause, les caractères d’un droit malléable, souple, et c’est probablement aussi parce qu’une infraction avait été préalablement commise. L’infraction préalable deviendrait ainsi une condition à l’action civile, fondée sur le droit commun, en réparation du préjudice écologique22.
Naturellement, là où la jurisprudence a pu s’affranchir des concepts les plus académiques en objectivant le préjudice subi, elle n’aurait su le faire en allant jusqu’à supprimer la nécessité d’un sujet du droit à réparation. Si l’on indemnise le préjudice écologique, encore faut-il en effet que cette indemnisation profite à un bénéficiaire. Sur ce point, l’arrêt du 22 mars 2016 reprend une solution déjà connue qui consiste à faire des associations de protection de l’environnement agrées les prétendants au droit à réparation en leur qualité de parties civiles. De la sorte, la cassation de l’arrêt de la cour d’appel s’avérait prévisible dans la mesure où, pour débouter la LPO de sa demande en réparation du préjudice écologique subi, les juges du fond avaient retenu que l’association avait confondu « son préjudice personnel et le préjudice écologique, ses frais de fonctionnement n’ayant pas de lien direct avec les dommages causés à l’environnement ».
Cependant, si le principe même de l’indemnisation du préjudice écologique et du droit d’action des associations en la matière semble chose acquise en l’espèce, il subsiste la problématique de l’évaluation de ce préjudice et de ses modalités de réparation. Quid de l’évaluation du préjudice écologique pur ? Quid du rôle du juge en la matière ? L’arrêt du 22 mars 2016 va plus loin sur ce point que la jurisprudence Erika et lève le voile sur l’indispensable rôle du juge en la matière.
II. La délicate question de l’évaluation du préjudice écologique
Si le droit commun de la responsabilité a su faire preuve d’adaptation afin de recevoir le préjudice écologique en son principe et sa définition, la question de son évaluation et de son indemnisation demeure posée afin d’examiner si ce droit est définitivement apte à connaître de cette problématique.
Or cette interrogation se pose avec d’autant plus d’acuité à l’heure actuelle que le préjudice écologique s’apprête à faire une entrée remarquée au sein du Code civil. En effet, le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 24 mars 2015 et au Sénat le 26 janvier 2016. Le texte a ensuite été examiné en commission du développement durable de l’Assemblée nationale du 1er au 9 mars derniers avant d’être adopté en deuxième lecture le 17 mars 201623. En dernier lieu, le 25 mai 2016, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion n’étant pas parvenue à un accord, il a été convenu que le projet soit à nouveau débattu devant chacune des deux chambres. Depuis, la loi a été définitivement adoptée le 20 juillet 2016, jugée partiellement conforme par le Conseil constitutionnel le 4 août 2016 et promulguée le 9 août 2016 (JO n° 223, 24 sept. 2016).
C’est dire que l’arrêt du 22 mars 2016 s’inscrit dans une actualité brulante, car il ne s’agit de rien de moins pour le texte nouveau que d’insérer un article 1386-19-1 dans le Code civil, selon lequel : « Indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun, est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique résultant d’une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».
S’agissant des modalités de réparation du préjudice écologique, le projet de loi marque sa préférence pour une réparation en nature, les alinéas 1 et 2 du nouvel article 1386-20 du Code civil disposant à cet effet que : « La réparation du préjudice mentionné à l’article 1386-19-2 s’effectue par priorité en nature. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser au demandeur des dommages et intérêts qui sont affectés, prioritairement, à des fins de réparation de l’environnement et, subsidiairement, à des fins de protection de l’environnement. Si le demandeur n’est pas en mesure d’affecter les dommages et intérêts à des fins de réparation ou de protection de l’environnement, les dommages et intérêts sont versés, aux fins définies à la première phrase du présent alinéa, à l’État ou à toute personne qu’il a désignée ».
À lire le dispositif projeté, il n’est guère certain que les écueils à envisager la réparation du préjudice écologique sous l’angle de l’indemnisation pécuniaire, fût-elle subsidiaire par rapport à la réparation en nature, soient efficacement levés. La doctrine s’est à cet égard faite l’écho de la difficulté à distinguer le préjudice moral des associations agréées du préjudice écologique lui-même. « C’est que le préjudice causé à l’environnement se distingue mal de l’atteinte à l’objet social des associations, qui n’est autre que la protection de l’environnement, et de l’atteinte aux intérêts des collectivités de personnes représentées par les associations et les collectivités territoriales »24.
Si la confusion se comprend aisément, l’arrêt indique qu’il revient pourtant aux juges du fond de « chiffrer, en recourant, si nécessaire, à une expertise, le préjudice écologique dont elle avait reconnu l’existence ». Là s’arrête l’énoncé de l’impératif fixé par la Cour de cassation, celle-ci demeurant muette sur une quelconque indication permettant au juge de dissocier les préjudices subjectifs du préjudice écologique afin d’éviter une double indemnisation ou, à l’instar de la cour d’appel de Paris le 30 mars 2010, la reconnaissance d’un « préjudice écologique personnel ». Tout au plus, la Cour de cassation fait-elle référence à la possibilité pour le juge d’ordonner une expertise afin de mener correctement la mission d’évaluation qui est sienne. Si cette solution préconisée par la Cour de cassation est extrêmement classique, le recours à l’expertise en matière environnementale se heurte de prime abord à l’absence de toute rubrique « environnement » au sein de la nomenclature des experts de justice issue de l’arrêté du 10 juin 200525, quand bien même le domaine est d’une complexité scientifique et juridique redoutable. Il semble qu’en ce domaine, la création d’une haute autorité environnementale appelée des vœux du rapport Jégouzo26, combinée à une spécialisation des juridictions, dont seules certaines seraient compétentes pour connaître de ces questions, soient des voies qui pourraient être utilement empruntées afin de surpasser les difficultés précédemment évoquées. Que la loi soit loquace ou non sur ces propositions, nul ne doute que la main de l’homme fournira de nouveau l’opportunité à la jurisprudence de se voir saisie de ces questions environnementales et du préjudice écologique. La question n’est pas de savoir si, mais quand.
Romain Laulier
Notes de bas de pages
-
1.
CEDH, 9 juin 2009, n° 33401/02.
-
2.
CEDH, 3 nov. 2011, M. B. c/ Roumanie, n° 43982/06, § 64.
-
3.
CEDH, sect. II, 2002, n° 46477/99, Paul et Audrey Edwards c/ Royaume-Uni.
-
4.
V. CEDH, sect. III, 28 mai 2013, n° 3564/11, Eremia c/ République de Moldova ; CEDH, sect. I, 14 oct. 2010, n° 55164/08, A. c/ Croatie ; CEDH, sect. III, 30 oct. 2012, n° 43994/05, E. M. c/ Roumanie ; CEDH, sect. II, 26 mars 2013, n° 33234/07, Valiuliene c/ Lituanie.
-
5.
V. Vanneau V., La paix des ménages. Histoire des violences conjugales, XIXe° XXIe siècles, 2016, éd. Anamosa.
-
6.
V. communiqué de la Commission européenne du 4 mars 2016, IP/16/549.
-
7.
V. p. ex. TGI Lille, 11 févr. 2013 : AJ fam. 2013, p. 234, obs. Labbée X.
-
8.
Ancel B., « Les violences conjugales saisies par le droit européen : évolution ou révolution ? », RTD eur. 2013, p. 701.
-
9.
En ce sens, v. Ancel B., art. préc.
-
10.
Dir. PE et Cons. UE n° 2004/35/CE, 21 avr. 2004 « sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux » : JOUE L 143, 30 avr. 2004. V° infra sur les répercussions de ce texte à l’échelle nationale. Ce texte a été transposé par la célèbre L. n° 2008-757, 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement : JO, 2 août 2008, p. 12361.
-
11.
CA Rennes, 12e ch., 27 sept. 2013, n° 12/02138 : Lexbase Hebdo n° A5126RA4.
-
12.
V° infra.
-
13.
Neyret L et Martin G. J.(dir.), Nomenclature des préjudices environnementaux, 2012, LGDJ.
-
14.
T. corr. Paris, 16 janv.2008 : JCP G 2008, I, 126, étude Le Couviour K., et JCP G 2008, II, 10053, note Parance B. ; D. 2008, p. 2681, chron. Neyret L. ; Dr. Env. 2008, n° 156, 15 ; RSC 2008, p. 344, obs. Robert J.-H. ; AJDA 2008, p. 934, note Van Lang A. – CA Paris, 30 mars 2010 : JCP G 2010, 432, note Le Couviour K. ; D. 2010, p. 967, obs. Lavric S.; D. 2010, p. 1804, chron. Rebeyrol V. ; D. 2010, p. 2238, chron. Neyret L., D. 2010, p. 2468, obs. Trébulle F.-G. ; RSC 2010, p. 873, obs. Robert J.-H.; RTD com 2010, p. 622, obs. Delebecque P. – Cass. crim., 25 sept. 2012, n° 10-82938 : D. 2012, p. 2557, obs. Trebulle F.-G.; D. 2012, p. 2675, chron. Ravit V. et Sutterlin O. ; JCP G 2012, 1243, note Le Couviour K. ; JCP G 2013, 484, obs. Bloch C. ; RTD civ. 2013, obs. Jourdain P. ; RSC 2013, p. 363, obs. Robert J.-H. ; AJ pénal 2012, p. 574, obs. Montas A. et Roussel G. ; Rev. sociétés 2013, p. 110, note Robert J.-H.
-
15.
Ravit V. et Sutterlin O., « Réflexions sur le destin du préjudice écologique “pur” », art. préc.
-
16.
Savatier R., Traité de la responsabilité civile en droit français, t. II, 2e éd., 1951, LGDJ, n° 601.
-
17.
Cass. 2e civ., 28 oct. 1954 : Bull. civ. II, n° 328 ; RTD civ. 1955, p. 324.
-
18.
Le Tourneau P., Responsabilité (en général), Rép. civ. Dalloz, n° 10.
-
19.
Cass. 2e civ., 9 nov. 1976, n° 75-11737 : Bull. civ. II, n° 302 – Cass. 2e civ., 23 janv. 2003, n° 01-00200 : Bull. civ. II, n° 20 ; D. 2003, p. 605 ; JCP G 2003, II, 10110, note Barbièri J.-F. – Cass. 1re civ., 9 nov. 2004, n° 02-12506 : Bull. civ. I, n° 264 ; D. 2004, p. 3117 ; JCP G 2005, I, 114, obs. Grosser P.
-
20.
Jourdain P., « Consécration par la Cour de cassation du préjudice écologique », art. préc.
-
21.
Neyret L., « La réparation des atteintes à l’environnement par le juge judiciaire », D. 2008, 170.
-
22.
V° sur ce point Cass. crim., 29 oct. 2013, n° 12-86518 : Gaz. Pal. 25 janv. 2014, n° 160k7, p. 20, note Denis B., aux termes duquel : « les juges du second degré ne pouvaient, sans se contredire, déclarer le prévenu coupable des faits poursuivis et dire la constitution de partie civile irrecevable, l’affirmation de l’existence du préjudice direct ou indirect porté au territoire de la commune résultant nécessairement de la constatation de l’infraction au Code de l’environnement ».
-
23.
V.°sur ce point de Redon L., « Adoption en 2nde lecture du projet de loi Biodiversité », Énergie – Env. – Infrastr. 2016, alerte 180 ; Bloch L., « Retour sur la brève histoire de l’amendement n° CD1048 (projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages) », RCA avril 2016, alerte 10.
-
24.
Jourdain P., « Consécration par la Cour de cassation du préjudice écologique », art. préc.
-
25.
Arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nomenclature prévue à l’article 1er du D. n° 2004-1463, 23 déc. 2004 : JORF n° 149, 28 juin 2005, p. 10674.
-
26.
Martin G. J., « Le rapport pour la réparation du préjudice écologique », D. 2013, p. 2317 ; Fonbostier L., « Promouvoir et améliorer la réparation du préjudice écologique », JCP G 2013, p. 1006 ; Parance B., « Du rapport Jégouzo relatif à la réparation du préjudice écologique », Gaz. Pal. 31 oct. 2013, n° 152c6, p. 5.