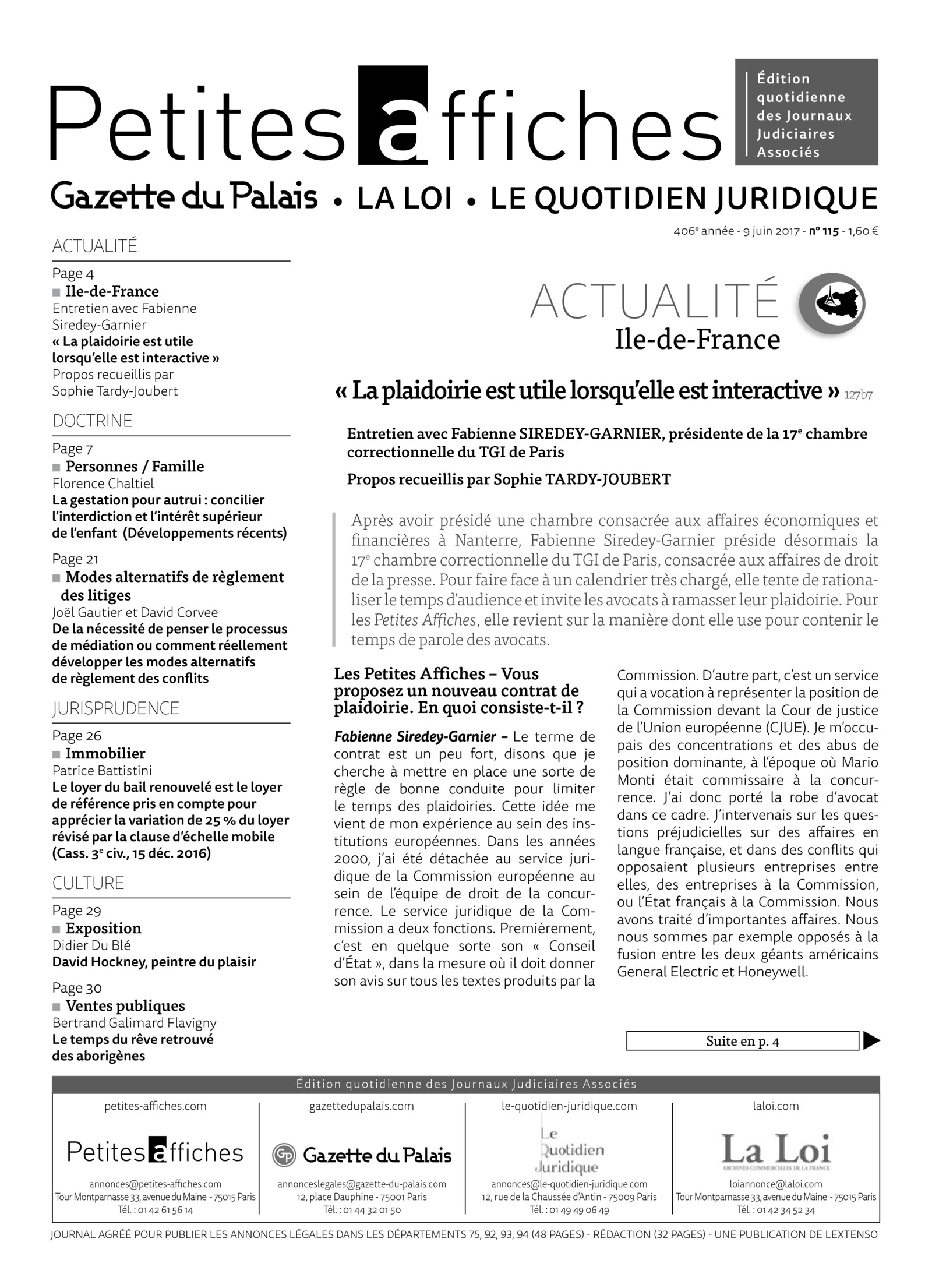La gestation pour autrui : concilier l’interdiction et l’intérêt supérieur de l’enfant (Développements récents)
Les questions relatives à la gestation pour autrui se multiplient devant les juridictions nationales. La Cour européenne des droits de l’Homme se trouve, après épuisement des voies de recours internes, régulièrement face à des questions humaines et éthiques des plus sensibles. Le débat est complexe, mettant en présence des exigences et aspirations qui peuvent se révéler antinomiques. Les cas d’espèce s’enchaînent sans que l’on puisse véritablement lire de jurisprudence aisée à comprendre pour le citoyen. La transnationalisation des échanges appelle une régulation au niveau international au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Deux décisions récentes, rendues par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), ont appelé des commentaires permettant, pour les uns, d’estimer que la Cour porte un coup d’arrêt au développement de la gestation pour autrui (GPA)1, pour les autres, de s’alarmer d’une jurisprudence par trop laxiste et de nature à encourager des procédés que de nombreuses lois nationales répriment2. Ces deux affaires, récentes, et sujettes à discussion, ne font que confirmer la nécessité de dessiner les bases d’une régulation internationale.
L’une des affaires concerne l’Italie, finalement non condamnée3, l’autre la France, de nouveau condamnée4 par la Cour européenne des droits de l’Homme.
L’affaire mettant en cause l’Italie est une triste affaire. C’est l’histoire d’un couple italien infertile ayant eu recours à une mère porteuse en Russie pour concevoir un bébé, via une agence russe rémunérée 49 000 €. Né en février 2011, l’enfant est enregistré comme le fils du couple au bureau d’état civil de Moscou. Mais, à leur retour en Italie, une procédure pénale est lancée à l’encontre des parents d’intention pour avoir contourné la loi italienne qui interdit la GPA.
Un test ADN révèle alors que M. C n’a pas de lien génétique avec le nouveau-né et que l’agence russe n’a pas utilisé son sperme, contrairement à l’engagement qui aurait été pris, pour la conception de l’enfant, comme il était pourtant convenu avec cette dernière selon le couple. La justice italienne prend alors la décision de retirer le bébé âgé de neuf mois aux parents d’intention pour le placer dans une institution d’accueil, sans contact avec ces derniers. L’adoption de l’enfant, considéré comme fils de parents inconnus, leur est refusée. Le petit garçon sera finalement adopté par une autre famille en 2013. Cette espèce a ceci de particulier que, dans un premier temps, les requérants avaient obtenu gain de cause5, le renvoi devant la grande chambre ayant opéré un revirement. La Cour conclut en définitive à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
L’affaire ayant conduit à une nouvelle condamnation de la France se présente différemment de la précédente. Il s’agit en effet d’une condamnation attendue dans la mesure où l’instance avait été introduite avant le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation, suite à de précédentes condamnations du système juridique français en la matière6.
Les termes du débat font apparaître une base commune qui est la conventionnalité des législations nationales interdisant la GPA (I), tout en mettant en évidence des incertitudes autour de la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant (II).
I – La conventionnalité des législations nationales interdisant la GPA
La Cour européenne des droits de l’Homme, selon une jurisprudence constante ne s’appliquant d’ailleurs pas aux seules questions de GPA, cherche un équilibre, tout en laissant des marges de manœuvres substantielles aux États membres, dans les questions qui sont éthiquement très sensibles et pour lesquelles il n’existe pas de consensus. La GPA entre bien évidemment dans ce champ. La Cour a ainsi trouvé progressivement les termes d’un équilibre, que l’on peut qualifier de réaliste, entre une interdiction de principe sur laquelle elle ne prononce pas de condamnation et la nécessaire prise en compte d’une certaine réalité familiale lorsque des procédés de GPA sont avérés et qu’il en résulte un enfant accompagné de ses parents dits d’intention. Le paramètre du lien biologique entre l’un des parents d’intention et l’enfant apparaît central dans cette jurisprudence.
Dans les affaires Mennesson c/ France7, la Cour a donné un aperçu des résultats d’une analyse de droit comparé couvrant trente-cinq États parties à la Convention autres que la France. Il en ressort que la gestation pour autrui est expressément interdite dans quatorze de ces États ; que dans dix autres États, dans lesquels il n’y a pas de réglementation relative à la gestation pour autrui, soit celle-ci est interdite en vertu de dispositions générales, soit elle n’est pas tolérée, soit la question de sa légalité est incertaine ; et qu’elle est autorisée dans sept de ces trente-cinq États (sous réserve de la réunion de certaines conditions strictes).
Dans 13 de ces 35 États, il est possible pour les parents d’intention d’obtenir la reconnaissance juridique du lien de filiation avec un enfant né d’une gestation pour autrui légalement pratiquée dans un autre pays.
Dans les affaires Mennesson c/ France8, deux couples de parents d’intention avaient eu recours à la gestation pour autrui aux États-Unis et s’étaient installés avec leurs enfants en France. Dans ces affaires, l’existence d’un lien biologique entre le père et les enfants était avérée, et les autorités françaises n’avaient à aucun moment envisagé de séparer les enfants des parents. La question au cœur de ces affaires était le refus de transcrire l’acte de naissance établi à l’étranger, dont la conformité au droit du pays d’origine n’était pas contestée, ainsi que le droit des enfants à la reconnaissance de leur filiation. Les parents et les enfants étaient tous requérants devant la Cour.
L’affaire qui conduit à la nouvelle condamnation de la France en 2017 ressemble en plusieurs points à celle de 2014. Ce qui explique la position de la Cour sur le maintien de la conventionnalité de l’interdiction de principe, concilié avec l’intérêt supérieur de l’enfant, considéré dans ses liens à la fois affectifs et biologiques avec ses parents dits – bien que l’expression soit peu heureuse – d’intention.
La Cour européenne tient alors compte des évolutions jurisprudentielles nationales, tout en apportant des précisions sur l’épuisement des voies de recours internes, particulièrement décisif dans ces affaires de GPA. En effet, dans trois arrêts de principe du 6 avril 20119, la Cour de cassation a jugé que le refus de transcrire un acte de naissance établi à l’étranger dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui sur les registres d’état civil était justifié en raison de sa contrariété à l’ordre public international français. Les requérants devaient justifier de l’épuisement des voies de recours internes. Après les arrêts de la Cour de cassation du 6 avril 2011 et avant qu’ils aient eux-mêmes interjeté appel, la cour d’appel de Rennes avait, par un arrêt du 21 février 2012, confirmé un jugement ordonnant la transcription d’actes de naissance de deux enfants suspectés d’être nés à l’étranger d’une gestation pour autrui. La Cour rappelle que la finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention ; elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’Homme10. L’appel étant ainsi une voie de recours à épuiser en principe pour se conformer aux exigences de l’article 35, § 1, de la Convention, les requérants auraient pris le risque de voir leur requête rejetée pour défaut d’épuisement des voies de recours internes s’ils avaient saisi la Cour sans en avoir préalablement usé. La Cour constate du reste que, comme l’indiquent ces derniers, il n’était pas totalement exclu que la cour d’appel de Rennes leur donne gain de cause malgré les arrêts de la Cour de cassation du 6 avril 2011. Elle relève en particulier que dans l’affaire Bouvet11, la cour d’appel de Rennes a, le 21 février 2012, soit postérieurement à ces arrêts, confirmé un jugement ordonnant la transcription sur les registres de l’état civil français des actes de naissance d’enfants nés à l’étranger d’une gestation pour autrui. La Cour estime donc qu’on ne peut donc reprocher aux requérants d’avoir interjeté appel du jugement du 10 novembre 2011 et d’avoir attendu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 8 janvier 2013 pour saisir la Cour. Cette saisine étant intervenue moins de six mois après cet arrêt et les requérants se trouvant dispensés de saisir préalablement la Cour de cassation de leur grief en raison des arrêts du 6 avril 2011, ils ont, conformément aux exigences de l’article 35, § 1, de la Convention, saisi la Cour dans les six mois à partir de la décision interne définitive. Constatant par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35, § 3, a), de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare donc recevable.
Dans cette affaire, le gouvernement déclare ne contester ni que les relations en cause relèvent de la vie privée et familiale, ni que le refus de procéder à la transcription des actes de naissance sur les registres de l’état civil et l’annulation de la reconnaissance de paternité puissent être regardés comme une ingérence dans la vie familiale. Il note par ailleurs que les requérants ne contestent pas que cette ingérence soit prévue par la loi. S’agissant du but légitime et de la proportionnalité de l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale des requérants, le gouvernement renvoie logiquement aux arrêts Mennesson et Labassee. S’agissant de la proportionnalité de l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée, le gouvernement souligne que la Cour de cassation a, le 3 juillet 2015, opéré un revirement de jurisprudence. En présence d’un acte étranger établi régulièrement selon le droit local et permettant d’établir le lien de filiation avec le père biologique, plus aucun obstacle ne peut désormais être opposé à la transcription de la filiation biologique. Il indique que, le 7 juillet 2015, la garde des Sceaux a adressé aux parquets concernés une dépêche indiquant qu’il convenait de procéder à la transcription des actes de naissance étrangers des enfants nés à l’étranger d’une gestation pour autrui, sous réserve de leur conformité à l’article 47 du Code civil. Il ajoute que, si une demande de transcription formulée par les requérants pourrait poser une difficulté dès lors que l’arrêt du 8 janvier 2013 de la cour d’appel de Rennes a acquis autorité de la chose jugée, le deuxième requérant peut en revanche légalement établir le lien de filiation entre les troisième et quatrième requérants et lui par la voie de la reconnaissance de paternité ou de la possession d’état, ou par la voie de l’action en établissement de filiation prévue par l’article 327 du Code civil (aux termes duquel « la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée ; l’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant »). Selon lui, le refus de transcription ne constitue pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée des requérants puisque le droit à l’identité de l’enfant est préservé par la possibilité d’établir sa filiation par d’autres voies juridiques12.
La Cour, dans cette affaire de 201713, constate ainsi que la situation des requérants en l’espèce est similaire à celle des requérants dans les affaires Mennesson, Labassee, Foulon et Bouvet14, dans lesquelles elle a jugé qu’il n’y avait pas eu violation du droit au respect de la vie familiale des requérants (les parents d’intention et les enfants concernés), mais qu’il y avait eu violation du droit au respect de la vie privée des enfants concernés.
Considérant les circonstances de l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de conclure autrement que dans les affaires Mennesson, Labassee, Foulon et Bouvet précitées. Comme dans les arrêts Foulon et Bouvet15, la Cour prend bonne note des indications du gouvernement relatives au revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 3 juillet 2015, postérieurement à l’introduction de la présente requête et au prononcé des arrêts Mennesson et Labassee. Elle observe aussi que le gouvernement entend déduire de ce nouvel état du droit positif français que le deuxième requérant et les troisième et quatrième requérants ont désormais la possibilité d’établir leur lien de filiation par la voie de la reconnaissance de paternité ou de la possession d’état, ou par la voie de l’action en établissement de filiation prévue par l’article 327 du Code civil. Elle constate toutefois qu’à supposer cette circonstance avérée et pertinente – ce que contestent les requérants –, le droit français a en tout état de cause fait obstacle durant presque quatre ans et huit mois à la reconnaissance juridique de ce lien de filiation (les troisième et quatrième requérants étant nés le 22 novembre 2010). La Cour conclut en conséquence qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention s’agissant du droit des requérants au respect de leur vie familiale, mais qu’il y a eu violation de cette disposition s’agissant du droit des troisième et quatrième requérants au respect de leur vie privée.
Cette condamnation est donc attendue. Les évolutions de jurisprudences nationales devraient, en l’état de la jurisprudence européenne, éviter de nouvelles condamnations de la France, en tout cas, lorsqu’un lien biologique peut être établi entre un des parents d’intention et l’enfant, nonobstant l’interdiction de principe. La jurisprudence n’est pour autant encore pas parfaite dans la mesure où demeurent des incertitudes autour de la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant.
II – Les incertitudes autour de la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant
L’arrêt mettant en cause l’Italie, rendu en janvier dernier est l’illustration, par excellence, des incertitudes autour de la notion même de sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dans le premier arrêt Paradiso et Campanelli16, la Cour, statuant en chambre, a refusé de qualifier de violation du droit au respect de la vie familiale le défaut de reconnaissance de l’enfant à l’égard de ses parents d’intention. L’absence de reconnaissance de la filiation de l’enfant à l’égard de la mère d’intention, telle qu’établie par le droit étranger, s’inscrit dans la logique de la jurisprudence de la Cour européenne qui n’accepte d’imposer aux États la reconnaissance d’un lien de filiation que lorsqu’il est fondé sur un lien de sang. Dans l’arrêt de Grande chambre, le revirement s’opère, à la faveur d’une analyse affinée des notions de vie familiale, de vie privée et de vie de l’enfant (A), sans pour autant épuiser la réflexion sur l’intérêt supérieur de l’enfant dans le contexte de GPA illégales (B).
A – Vie familiale, vie privée, vie de l’enfant
L’article 8 de la Convention dispose dans ses parties pertinentes pour les affaires récentes relatives à la GPA, que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Un passage du second arrêt Campanelli de la Cour est particulièrement éloquent sur les difficultés suscitées par les zones grises de la GPA. À la suite de l’exécution de la décision rendue le 20 octobre 2011 par le tribunal pour mineurs, l’enfant est resté placé dans un foyer pendant environ quinze mois, dans un endroit inconnu des requérants. Les contacts entre les requérants et l’enfant furent interdits. Ceux-ci ne purent avoir aucune nouvelle de lui. En janvier 2013, l’enfant fut placé dans une famille en vue de son adoption. Début avril 2013, son tuteur demanda au tribunal pour mineurs d’attribuer une identité conventionnelle à l’enfant, afin que celui-ci puisse être inscrit sans difficulté à l’école. Il expliqua que l’enfant avait été placé dans une famille le 26 janvier 2013, mais qu’il était sans identité. Pour le tuteur, cette « inexistence » avait un fort impact sur les questions administratives, notamment s’agissant de savoir sous quelle identité il fallait inscrire l’enfant à l’école, dans son carnet de vaccinations et à son domicile. Tout en admettant que cette situation répondait au but de ne pas permettre aux requérants de déterminer où était l’enfant afin de mieux le protéger, le tuteur expliqua qu’une identité temporaire conventionnelle permettrait de maintenir le secret sur l’identité réelle de l’enfant et, en même temps, permettrait à ce dernier d’accéder aux services publics alors que, jusqu’à présent, il lui était loisible seulement d’utiliser les services médicaux d’urgence. Il ressort du dossier que cette demande fut accueillie par le tribunal pour mineurs, et que l’enfant reçut une identité conventionnelle. Le gouvernement a fait savoir que l’adoption du mineur est désormais effective17.
D’ailleurs la jurisprudence italienne a connu des évolutions. La Cour rappelle la jurisprudence antérieure à l’audience devant la grande chambre. La Cour de cassation italienne (Sect. I, 26 sept. 2014, arrêt n° 24001) s’est en effet prononcée dans une affaire civile concernant deux ressortissants italiens qui s’étaient rendus en Ukraine pour avoir un enfant à l’aide d’une mère porteuse. La Cour de cassation a estimé que la décision de placer l’enfant était conforme à la loi. Ayant constaté l’absence de liens génétiques entre l’enfant et les parents d’intention, elle en a déduit que la situation litigieuse était illégale au regard du droit ukrainien, ce dernier exigeant un lien biologique avec l’un des parents d’intention. Après avoir rappelé que l’interdiction de la maternité de substitution était toujours en vigueur en Italie, la haute juridiction a expliqué que l’interdiction de la maternité de substitution en droit italien était de nature pénale et avait pour but de protéger la dignité humaine de la mère porteuse ainsi que la pratique de l’adoption. Elle a ajouté que seule une adoption réglementaire, reconnue en droit, rendait possible une parentalité non basée sur le lien biologique. Elle a déclaré que l’évaluation de l’intérêt de l’enfant se faisait en amont par le législateur, et que le juge n’a en la matière aucune marge d’appréciation. Elle en a conclu qu’il ne pouvait pas y avoir de conflit avec l’intérêt de l’enfant lorsque le juge appliquait la loi nationale et ne prenait pas en compte la filiation établie à l’étranger suite à une maternité de substitution. La Cour observe dans un second temps la jurisprudence postérieure à l’audience devant la grande chambre.
La Cour de cassation italienne18 s’est prononcée dans une procédure pénale dirigée contre deux ressortissants italiens qui s’étaient rendus en Ukraine en vue de concevoir un enfant en ayant recours à une donneuse d’ovules et à une mère porteuse. La loi ukrainienne exige que l’un des deux parents soit le parent biologique. Le jugement d’acquittement prononcé en première instance avait été attaqué en cassation par le ministère public. La haute juridiction a rejeté le pourvoi du ministère public, confirmant ainsi l’acquittement, fondé sur le constat que les requérants n’avaient pas violé l’article 12, § 6, de la loi n° 40 du 19 février 2004 sur la procréation médicalement assistée puisqu’ils avaient eu recours à une technique de procréation assistée qui était légale dans le pays où elle avait été pratiquée. En outre, la Cour de cassation a estimé que le fait que les accusés avaient présenté aux autorités italiennes un certificat de naissance étranger ne s’analysait pas en une infraction de « fausse déclaration sur l’identité » (C. pén., art. 495) ou d’« altération d’état civil » (C. pén., art. 567), dès lors que le certificat en question était légal au regard du droit du pays qui l’avait délivré.
La Cour de cassation19 s’est prononcée dans une affaire civile où la requérante avait demandé à pouvoir adopter l’enfant de sa compagne. Les deux femmes s’étaient rendues en Espagne en vue d’avoir recours à des techniques de procréation assistée interdites en Italie. L’une d’elles est la « mère » selon le droit italien, le liquide séminal provient d’un donneur inconnu. La requérante avait obtenu gain de cause en première et deuxième instance. Saisie par le ministère public, la haute juridiction a rejeté le recours de celui-ci et a ainsi accepté qu’un enfant né grâce à des techniques de procréation assistée au sein d’un couple de femmes soit adopté par celle qui n’en avait pas accouché. Pour parvenir à cette conclusion la Cour de cassation a pris en compte le lien affectif stable existant entre la requérante et l’enfant ainsi que l’intérêt du mineur. La Cour a utilisé l’article 44 de la loi sur l’adoption qui prévoit des cas particuliers d’adoption20.
Or le premier arrêt, rendu en chambre par la CEDH, s’était ainsi prononcé21. Ayant reconnu l’existence d’une vie familiale, la chambre a apprécié les intérêts privés des requérants et l’intérêt supérieur de l’enfant conjointement, et les a mis en balance avec l’intérêt public. Elle n’a pas été convaincue par le caractère adéquat des éléments sur lesquels les autorités italiennes s’étaient appuyées pour conclure que l’enfant devait être pris en charge par les services sociaux. Dans son raisonnement, elle s’est basée sur le principe que l’éloignement de l’enfant du contexte familial était une mesure extrême à laquelle on ne devrait avoir recours qu’en tout dernier ressort, pour répondre au but de protéger l’enfant confronté à un danger immédiat pour celui-ci22. Au vu des éléments du dossier, la chambre a estimé que les juridictions nationales avaient pris des décisions sans évaluer concrètement les conditions de vie de l’enfant avec les requérants et l’intérêt supérieur de celui-ci. Elle a par conséquent conclu à la violation de l’article 8 de la Convention, au motif que les autorités nationales n’avaient pas préservé le juste équilibre devant régner entre l’intérêt général et les intérêts privés en jeu23.
Le deuxième arrêt, rendu en grande chambre en 2017, opère un revirement. Si l’on résume, la Cour passe d’une conception de l’enfant, au regard de liens affectifs, fussent-ils de courte durée, avec des parents d’intention, nonobstant tout lien biologique, malgré les engagements pris par les services russes concernés, justifiant que la famille fusse considérée comme telle, à une conception de la vie privée et familiale, n’incluant aucun droit à l’enfant, qui, en l’absence de tout lien de nature biologique, empêche que l’on puisse considérer l’enfant concerné par cette affaire, comme inséré dans sa famille d’intention.
Ainsi, dans la seconde espèce, jugée en 2017, la Cour note d’emblée que l’enfant T. C. est né d’un embryon issu d’un don d’ovocytes et d’un don de sperme provenant de donneurs inconnus, et a été mis au monde en Russie par une femme russe qui a renoncé à ses droits sur lui. Les requérants n’ont donc aucun lien biologique avec l’enfant. Les intéressés ont payé une somme de près de 50 000 € pour recevoir cet enfant. Les autorités russes ont délivré un certificat de naissance attestant qu’ils en étaient les parents au regard du droit russe. Les requérants ont ensuite décidé d’amener l’enfant en Italie et d’y vivre avec lui. L’origine génétique de cet enfant demeure inconnue.
La question juridique qui se pose ici vise à déterminer si, au vu des circonstances de l’affaire, l’article 8 est applicable puis, dans l’affirmative, si les mesures urgentes ordonnées par le tribunal pour mineurs – qui ont entraîné l’éloignement de l’enfant – s’analysent en une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale et/ou de leur vie privée au sens de l’article 8, § 1, de la Convention et, le cas échéant, si les mesures en question ont été prises conformément à l’article 8, § 2, de la Convention. Dans sa décision de 2017, la grande chambre rappelle que la chambre a conclu à l’existence d’une vie familiale de facto entre les requérants et l’enfant. Elle a estimé24 en outre que la situation dénoncée relevait également de la vie privée du requérant, au motif que l’enjeu pour ce dernier tenait à ce que l’existence d’un lien biologique avec l’enfant fût établie25. Dès lors, l’article 8 de la Convention s’appliquait en l’espèce.
La question vise à savoir si les faits relèvent de la vie familiale et/ou de la vie privée des requérants. Il faut, à ce stade, préciser deux éléments. Le premier est que, compte tenu de l’absence de lien biologique entre les parents d’intention et l’enfant, la Cour, suivant la position du gouvernement italien, a refusé que les requérants agissent au nom de l’enfant. Le second est que cette affaire appelle une réflexion sur les notions mêmes de vie privée et familiale.
S’agissant de la notion de vie familiale, la Cour juge, selon une jurisprudence constante, que la question de l’existence ou de l’absence d’une vie familiale est d’abord une question de fait, qui dépend de l’existence de liens personnels étroits26. La notion de « famille » visée par l’article 8 concerne les relations fondées sur le mariage, et aussi d’autres liens « familiaux » de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors de tout lien marital ou lorsque d’autres facteurs démontrent qu’une relation a suffisamment de constance27.
De même, l’article 8 ne garantit ni le droit de fonder une famille ni le droit d’adopter28. Le droit au respect d’une « vie familiale » ne protège pas le simple désir de fonder une famille ; il présuppose l’existence d’une famille, voire au minimum d’une relation potentielle qui aurait pu se développer, par exemple, entre un père naturel et un enfant né hors mariage29, d’une relation née d’un mariage non fictif, même si une vie familiale ne se trouvait pas encore pleinement établie30, d’une relation entre un père et son enfant légitime, même s’il s’est avéré des années après que celle-ci n’était pas fondée sur un lien biologique31 ou encore d’une relation née d’une adoption légale et non fictive32.
Ces bases juridiques et jurisprudentielles étant rappelées, la Cour les applique de la manière suivante à l’espèce. Les dispositions de droit russe applicables le 27 février 2011, date de la naissance de l’enfant, et le 10 mars 2011, date à laquelle les requérants furent enregistrés comme parents à Moscou, semblent confirmer la thèse des requérants devant la Cour selon laquelle l’existence d’un lien biologique entre l’enfant à naître et les parents d’intention n’était à l’époque des faits pas explicitement requis en droit russe. En outre, le certificat en question se borne à indiquer que les requérants étaient les « parents », sans préciser s’ils étaient les parents biologiques. La Cour note que la question de la conformité au droit russe du certificat de naissance n’a pas été examinée par le tribunal pour mineurs, dans le cadre des mesures urgentes adoptées à l’égard de l’enfant. Devant les juridictions italiennes, l’autorité parentale que les requérants ont exercée sur l’enfant a été implicitement reconnue dans la mesure où celle-ci a fait l’objet d’une demande de suspension. Cependant, l’autorité parentale en question était précaire, pour les raisons suivantes.
La situation des requérants se heurtait au droit national. Selon le tribunal pour mineurs de Campobasso, et indépendamment des aspects de droit pénal, les requérants étaient dans l’illégalité, d’une part pour avoir amené en Italie un enfant étranger ne présentant aucun lien biologique avec au moins l’un d’eux, en violation des règles fixées en matière d’adoption internationale et, d’autre part, pour avoir souscrit un accord prévoyant la remise du liquide séminal du requérant pour la fécondation d’ovocytes d’une autre femme, ce qui était contraire à l’interdiction de la procréation assistée hétérologue. La Cour devait ainsi rechercher si, dans les circonstances de l’espèce, la relation entre les requérants et l’enfant relève de la vie familiale au sens de l’article 8. La Cour accepte, dans certaines situations, l’existence d’une vie familiale de facto entre un adulte ou des adultes et un enfant en l’absence de liens biologiques ou d’un lien juridiquement reconnu, sous réserve qu’il y ait des liens personnels effectifs33.
En dépit de l’absence de liens biologiques et d’un lien de parenté juridiquement reconnu par l’État défendeur, la Cour a estimé qu’il y avait vie familiale entre les parents d’accueil qui avaient pris soin temporairement d’un enfant et ce dernier, et ce en raison des forts liens personnels existants entre eux, du rôle assumé par les adultes vis-à-vis de l’enfant, et du temps vécu ensemble34.
Pour juger l’affaire, la Cour reprend un certain nombre d’éléments déjà jugés. Dans l’affaire Moretti et Benedetti, la Cour a attaché de l’importance au fait que l’enfant était arrivée à l’âge d’un mois dans la famille et que, pendant dix-neuf mois, les requérants avaient vécu avec l’enfant les premières étapes importantes de sa jeune vie. Elle avait constaté, en outre, que les expertises conduites sur la famille montraient que la mineure y était bien insérée et qu’elle était profondément attachée aux requérants et aux enfants de ces derniers. Les requérants avaient également assuré le développement social de l’enfant. Ces éléments avaient alors suffi à la Cour pour dire qu’il existait entre les requérants et l’enfant un lien interpersonnel étroit et que les requérants se comportaient à tous égards comme ses parents de sorte que des « liens familiaux » existaient « de facto » entre eux35.
Dans l’affaire Kopf et Liberda, il s’agissait d’une famille d’accueil, qui s’était occupée pendant environ quarante-six mois d’un enfant arrivé à l’âge de deux ans. Là aussi, la Cour a conclu à l’existence d’une vie familiale, compte tenu de ce que les requérants avaient réellement à cœur le bien-être de l’enfant et compte tenu du lien affectif existant entre les intéressés36. S’agissant de la durée de la cohabitation entre les requérants et l’enfant en l’espèce, la Cour relève qu’il y a eu six mois de cohabitation entre les requérants et l’enfant en Italie, précédés d’une période d’environ deux mois entre la requérante et l’enfant en Russie.
La Cour estime qu’il serait certes inapproprié de définir une durée minimale de vie commune qui puisse caractériser l’existence d’une vie familiale de facto, étant donné que l’appréciation de toute situation doit tenir compte de la « qualité » du lien et des circonstances de chaque espèce. Toutefois, la durée de la relation à l’enfant est un facteur-clé pour que la Cour reconnaisse l’existence d’une vie familiale. Dans l’affaire Wagner et J.M.W.L37, la vie commune avait duré plus de dix ans. Ou encore, dans l’affaire Nazarenko38 dans laquelle un homme marié avait assumé le rôle paternel avant de découvrir qu’il n’était pas le père biologique de l’enfant, la vie commune s’était étendue sur plus de cinq ans.
La Cour admet qu’en l’espèce, la durée de la vie commune avec l’enfant a été supérieure à celle de l’affaire D. et autres c/ Belgique39, dans laquelle la Cour a estimé qu’il y avait vie familiale protégée par l’article 8 pour une cohabitation ayant duré seulement deux mois avant la séparation provisoire d’un couple belge et d’un enfant né en Ukraine d’une mère porteuse. Toutefois, dans cette affaire, il y avait un lien biologique entre l’enfant et au moins l’un des parents, et la cohabitation avait repris par la suite. Quant à l’argument du requérant selon lequel il était convaincu d’être le père biologique de l’enfant étant donné qu’il avait remis son propre liquide séminal à la clinique, la Cour estime que cette conviction – qui a été démentie en août 2011 par le résultat du test ADN – ne peut, selon la cour, pas compenser la courte durée de la vie commune avec l’enfant40 et ne suffit donc pas pour qu’il y ait une vie familiale de facto.
Sur ce point, s’agissant de l’espèce à juger, la Cour, tout en admettant que la fin de la vie familiale entre les parents d’intention et l’enfant n’est pas de leur fait, estime que cette fin est directement liée à la situation de précarité dans laquelle les parents se sont sciemment mis. Elle estime donc, au regard de l’absence de tout lien biologique entre l’enfant et les parents d’intention, la courte durée de la relation avec l’enfant et la précarité des liens du point de vue juridique, et malgré l’existence d’un projet parental et la qualité des liens affectifs, que les conditions permettant de conclure à l’existence d’une vie familiale de facto ne sont pas remplies.
S’agissant de la notion de vie privée, la Cour rappelle que la notion de « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive. Elle recouvre l’intégrité physique et morale de la personne41 et, à un certain degré, le droit, pour l’individu, de nouer et développer des relations avec ses semblables42. Elle peut parfois englober des aspects de l’identité physique et sociale d’un individu43. La notion de vie privée englobe aussi le droit au développement personnel ou encore le droit à l’autodétermination44, de même que le droit au respect des décisions de devenir ou de ne pas devenir parent45.
Dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire Dickson c/ Royaume-Uni46, où était en cause le refus d’octroyer aux requérants – un détenu et son épouse – la possibilité de pratiquer une insémination artificielle, la Cour a conclu à l’applicabilité de l’article 8 au motif que la technique de procréation en question concernait la vie privée et familiale des intéressés, précisant que cette notion englobait un droit pour eux à voir respecter leur décision de devenir parents génétiques. Dans l’affaire S.H. et autres qui concernait des couples désireux d’avoir un enfant en ayant recours au don de gamètes – la Cour a considéré que le droit des couples à concevoir un enfant et à recourir pour ce faire à la procréation médicalement assistée relevait de la protection de l’article 8, un tel choix constituant une forme d’expression de la vie privée et familiale.
Dans l’espèce ici analysée, la Cour estime qu’il n’y a aucune raison valable de comprendre la notion de « vie privée » comme excluant les liens affectifs s’étant créés et développés entre un adulte et un enfant en dehors de situations classiques de parenté. Ce type de liens relève également de la vie et de l’identité sociale des individus. Dans certains cas impliquant une relation entre des adultes et un enfant qui ne présentent aucun lien biologique ou juridique, les faits peuvent néanmoins relever de la « vie privée »47.
En particulier, dans l’affaire X. c/ Suisse48, la Commission a examiné le cas d’une personne à laquelle des amis avaient confié leur enfant afin qu’elle s’en occupe, ce qu’elle avait fait. Lorsque, des années plus tard, les autorités avaient décidé que l’enfant ne pouvait plus rester avec la personne en question, les parents ayant demandé à le reprendre en charge, la requérante avait introduit un recours en vue de pouvoir garder l’enfant et avait invoqué l’article 8 de la Convention. La Commission a estimé que la vie privée de l’intéressée était en jeu, car elle s’était fortement attachée à cet enfant49.
En l’espèce, la Cour relève que les requérants avaient conçu un véritable projet parental, en passant d’abord par des tentatives de fécondation in vitro, puis en demandant et obtenant l’agrément pour adopter, et, enfin, en se tournant vers le don d’ovules et le recours à une mère porteuse. Une grande partie de leur vie était projetée vers l’accomplissement de leur projet, devenir parents en vue d’aimer et éduquer un enfant. Est en cause dès lors le droit au respect de la décision des requérants de devenir parents50, ainsi que le développement personnel des intéressés à travers le rôle de parents qu’ils souhaitaient assumer vis-à-vis de l’enfant. Enfin, dès lors que la procédure devant le tribunal pour mineurs se rapportait à la question de l’existence de liens biologiques entre l’enfant et le requérant, cette procédure et l’établissement des données génétiques ont eu un impact sur l’identité de ce dernier, ainsi que sur la relation des deux requérants. À la lumière des considérations qui précèdent, la Cour conclut que les faits de la cause relèvent de la vie privée des requérants51.
Il restait alors à savoir si l’atteinte à la vie privée était conforme aux exigences de la Convention. La Cour rappelle que, pour se prononcer sur l’ampleur de la marge d’appréciation devant être reconnue à l’État dans une affaire soulevant des questions au regard de l’article 8, il y a lieu de prendre en compte un certain nombre de facteurs52. Lorsqu’un aspect particulièrement important de l’existence ou de l’identité d’un individu se trouve en jeu, la marge laissée à l’État est d’ordinaire restreinte. En revanche, lorsqu’il n’y a pas de consensus au sein des États membres du Conseil de l’Europe, que ce soit sur l’importance relative de l’intérêt en jeu ou sur les meilleurs moyens de le protéger, en particulier lorsque l’affaire soulève des questions morales ou éthiques délicates, la marge d’appréciation est plus large53. La marge d’appréciation est en principe également large lorsque l’État doit ménager un équilibre entre des intérêts privés et publics concurrents ou différents droits protégés par la Convention. Les difficultés d’application de l’article 8 à ce genre d’espèce sont nombreuses comme le soulignent des juges dans une opinion émise à part dans cette affaire : l’arrêt souligne comme un argument en faveur des requérants le fait que ceux-ci ont développé un « projet parental »54. Cet argument entraîne trois remarques. Premièrement, toute parentalité qui ne repose pas sur des liens biologiques se fonde nécessairement sur un projet et est le résultat de longs efforts. L’existence d’un « projet parental » ne différencie pas cette affaire d’autres cas de parentalité non fondée sur des liens biologiques.
Deuxièmement, comme mentionné ci-dessus, le lien de facto entre les requérants et l’enfant a été établi illégalement. L’approche adoptée par la majorité n’est pas convaincante dès lors qu’elle considère l’existence d’un projet parental comme un argument militant en faveur de la protection, indépendamment de la nature illégale, reconnue dans le raisonnement, du projet concret. Le fait que les requérants ont agi avec préméditation afin de tourner la législation nationale ne peut que jouer en leur défaveur. Dans les circonstances de l’espèce, l’existence d’un « projet parental » est en réalité une circonstance aggravante.
Troisièmement, la parentalité appelle une protection indépendamment du fait qu’elle relève ou non d’un projet plus général. Il n’y a aucune raison de considérer que l’article 8 offre une protection plus forte aux actes prémédités.
Une protection effective en matière de droits de l’Homme exige de définir clairement le contenu et la portée des droits protégés, ainsi que la notion d’ingérence contre laquelle un droit spécifique offre un bouclier. Nous relevons à cet égard que selon la majorité, « les faits de la cause relèvent de la vie privée des requérants »55.
De plus, « [e]st en cause (…) le droit au respect de la décision des requérants de devenir parents56, ainsi que le développement personnel des intéressés à travers le rôle de parents qu’ils souhaitaient assumer vis-à-vis de l’enfant »57.
Le raisonnement contient également les considérations suivantes : « En l’espèce, les requérants ont été affectés par les décisions judiciaires ayant conduit à l’éloignement de l’enfant et à la prise en charge par les services sociaux de celui-ci en vue de son adoption. La Cour estime que les mesures adoptées à l’égard de l’enfant – éloignement, placement en foyer sans contact avec les requérants, mise sous tutelle – s’analysent en une ingérence dans la vie privée des requérants »58.
Il est difficile de souscrire à l’approche de la majorité telle qu’exprimée dans les passages cités ci-dessus. Premièrement, la notion de « faits de la cause » est nécessairement beaucoup plus large que l’ingérence elle-même même si celle-ci doit être placée dans un contexte plus général. Ces « faits » peuvent relever de nombreux droits reconnus par la Convention. La Cour doit apprécier la compatibilité avec la Convention non pas des faits de la cause mais de l’ingérence litigieuse, considérée dans un contexte plus général. Ce qui importe, ce n’est pas de savoir si les « faits de la cause » relèvent de la vie privée des requérants mais seulement si l’ingérence litigieuse tombe sous l’empire du droit des requérants à la protection de leur vie privée. Deuxièmement, on ne saurait dire que l’enjeu a trait au droit des requérants au respect de leur décision de devenir parents. L’enjeu ne porte pas sur cette décision en soi mais sur la manière dont ils ont essayé d’atteindre leur but. L’État n’a pas commis d’ingérence dans la décision des requérants de devenir parents mais seulement dans la mise en œuvre, contraire à la loi, de cette décision. Troisièmement, il ne fait aucun doute que les requérants ont été affectés par les décisions judiciaires ayant conduit à l’éloignement de l’enfant et à sa prise en charge par les services sociaux en vue de son adoption. Cela ne justifie en rien la conclusion selon laquelle les mesures prises à l’égard de l’enfant ont nécessairement entraîné une ingérence dans la vie privée des requérants. L’article 8 ne vise pas la protection contre tout acte qui affecte une personne mais contre des types spécifiques d’actes qui s’analysent en une ingérence au sens de cette disposition. Afin d’établir l’existence d’une ingérence dans l’exercice d’un droit, il est nécessaire d’établir d’abord le contenu du droit et les types d’ingérence contre lesquels il protège.
En conclusion, le raisonnement adopté par la majorité ne dit pas clairement ce que recouvre la vie privée, quelle est la portée de la protection du droit reconnu par l’article 8, et ce qu’est une ingérence au sens de cette disposition. Nous déplorons que ces notions n’aient pas été clarifiées dans le raisonnement de l’arrêt59 ».
Au regard de la reconnaissance par la Cour du fait que les États doivent en principe se voir accorder une grande marge d’appréciation s’agissant de questions qui suscitent de délicates interrogations d’ordre éthique pour lesquelles il n’y a pas de consensus à l’échelle européenne, la Cour renvoie à l’approche nuancée qu’elle a adoptée sur la question de la fécondation assistée hétérologue dans l’affaire S.H. et autres60, et à son analyse concernant la gestation pour autrui et la reconnaissance juridique du lien de filiation entre les parents d’intention et les enfants ainsi légalement conçus à l’étranger dans l’arrêt Mennesson61. En l’espèce, la Cour prend acte de ce que les requérants se trouvaient dans l’illégalité au regard tant de l’interdiction de la GPA que des règles applicables en matière d’adoption. Elle devait alors examiner si ces motifs sont pertinents et suffisants et si les juridictions nationales ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts privés et publics concurrents. Pour ce faire, elle doit au préalable déterminer l’ampleur de la marge d’appréciation à accorder à l’État en la matière.
D’après les requérants, la marge d’appréciation est restreinte, étant donné que l’objet de leur affaire porte sur la mesure d’éloignement définitif de l’enfant et que l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer. Pour le gouvernement, les autorités disposent d’une large marge d’appréciation pour ce qui est de la maternité subrogée et des techniques de procréation médicalement assistée62. La Cour observe que les faits de la cause touchent à des sujets éthiquement sensibles – adoption, prise en charge par l’État d’un enfant, procréation médicalement assistée et gestation pour autrui – pour lesquels les États membres jouissent d’une ample marge d’appréciation.
Or contrairement à la situation dans l’arrêt Mennesson63, la question de l’identité de l’enfant et de la reconnaissance de sa filiation génétique ne se pose pas en l’espèce puisque, d’une part, un éventuel refus par l’État de donner une identité à l’enfant ne peut être contesté par les requérants, qui ne représentent pas celui-ci devant la Cour et, d’autre part, il n’existe aucun lien biologique entre l’enfant et les requérants. En outre, la présente affaire ne concerne pas le choix de devenir parents génétiques, domaine dans lequel la Cour juge que la marge d’appréciation des États est restreinte.
Sur la question de savoir si les motifs avancés par les juridictions internes étaient également suffisants, la grande chambre rappelle que, contrairement à la chambre, elle estime que les faits de la cause ne relèvent pas de la notion de vie familiale, mais uniquement de la vie privée. Ainsi, il convenait d’examiner l’affaire non pas du point de vue de la préservation d’une unité familiale, mais plutôt sous l’angle du droit des requérants au respect de leur vie privée, dès lors que ce qui est en jeu en l’espèce est leur droit au développement personnel au travers de leur relation avec l’enfant.
Dans les circonstances particulières de la cause, la Cour estime que les motifs donnés par les juridictions internes, qui étaient centrés sur la situation de l’enfant et sur l’illégalité de la conduite des requérants, étaient suffisants. Sur la notion même de vie familiale, tout en souscrivant à la conclusion de la Cour sur cette affaire, deux juges ont émis une opinion qui montre que les conceptions de la vie familiale donneront sans doute lieu à de nouveaux développements. Ils soulignent en effet que la mise en œuvre de l’article 8 appelle une définition minutieuse de son champ d’application. Selon l’arrêt, l’existence ou l’absence d’une vie familiale est d’abord une question de fait, qui dépend de l’existence de liens personnels étroits et constants64. À notre avis, la formule proposée est à la fois trop vague et trop large. Cette approche semble fondée sur l’idée implicite que les liens interpersonnels existants devraient bénéficier d’une protection, au moins prima facie, contre les ingérences de l’État. Nous relevons à cet égard que des liens personnels étroits et constants peuvent exister hors du champ de toute vie familiale. Le raisonnement exposé dans l’arrêt n’explique pas la nature des liens interpersonnels qui forment la vie familiale. En même temps, il semble attacher une grande importance aux liens affectifs65. Toutefois, les liens affectifs ne peuvent en soi créer une vie familiale. Selon une des opinions produites66, les différentes dispositions de la Convention doivent être interprétées au regard de l’ensemble de son texte et d’autres traités internationaux pertinents. Il s’ensuit que l’article 8 doit être lu à la lumière de l’article 12, qui garantit le droit de se marier et de fonder une famille. Ces deux articles doivent également être placés dans le contexte de l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et de l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette dernière disposition, fortement inspirée par l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, est ainsi libellée : 1. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État. 2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l’homme et à la femme à partir de l’âge nubile. 3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux. 4. Les États parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l’égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d’assurer aux enfants la protection nécessaire67.
La Cour devait s’interroger sur le point de savoir si les mesures litigieuses étaient proportionnées au but légitime poursuivi, en particulier si les juridictions internes, agissant dans le cadre de l’ample marge d’appréciation qui leur était accordée en l’espèce, ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu.
Les juridictions internes ont particulièrement retenu l’élément central lié au non-respect par les requérants de la loi sur l’adoption et au fait qu’ils ont eu recours à l’étranger à des méthodes de procréation médicalement assistée interdites en Italie. Dans le cadre de la procédure interne, la Cour européenne souligne que les tribunaux, qui se sont concentrés sur la nécessité impérieuse de prendre des mesures urgentes, ne se sont pas étendus sur les intérêts généraux en jeu ni n’ont abordé explicitement les questions éthiquement sensibles sous-jacentes aux dispositions juridiques transgressées par les requérants.
Dans la procédure devant la Cour, le gouvernement défendeur a expliqué que, en droit italien, la filiation peut être établie soit par l’existence d’un lien biologique soit par une adoption respectant les règles établies par la loi. D’après lui, le législateur italien, par ce choix, cherchait à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, comme le requiert l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant. La Cour admet que, en interdisant l’adoption privée fondée sur une relation contractuelle entre les individus et en restreignant le droit des parents adoptifs de faire entrer des mineurs étrangers en Italie aux cas dans lesquels les règles sur l’adoption internationale sont respectées, le législateur italien s’efforce de protéger les enfants contre des pratiques illicites, dont certaines peuvent être qualifiées de trafic d’êtres humains. La Cour souligne donc que les juridictions internes avaient pour souci principal de mettre fin à une situation illégale. Eu égard aux considérations ci-dessus, la Cour admet que les lois qui ont été transgressées par les requérants et les mesures qui ont été prises en réponse à leur conduite avaient vocation à protéger des intérêts généraux importants.
Concernant les intérêts privés en jeu, la Cour souligne bien qu’il y a ceux de l’enfant d’une part et ceux des requérants de l’autre. Quant aux intérêts de l’enfant, la Cour rappelle que le tribunal des mineurs de Campobasso a eu égard à l’absence de lien biologique entre les requérants et l’enfant, et a déclaré qu’un couple susceptible de prendre soin de lui devait être identifié dès que possible. Compte tenu du jeune âge de l’enfant et de la courte période qu’il avait passée avec les requérants, le tribunal n’a pas souscrit à l’expertise d’une psychologue soumise par les requérants, selon laquelle la séparation aurait des conséquences dévastatrices pour l’enfant. Renvoyant à la littérature en la matière, le tribunal a estimé que le simple fait d’être séparé des personnes prenant soin de lui n’entraînerait pas un état psychopathologique chez le mineur en l’absence d’autres facteurs de causalité. Il a conclu que le traumatisme causé par la séparation ne serait pas irréparable.
S’agissant de l’intérêt des requérants à poursuivre leur relation avec l’enfant, le tribunal des mineurs a relevé que rien dans le dossier ne venait confirmer les déclarations des intéressés selon lesquelles ils avaient remis à la clinique russe le matériel génétique du requérant. Le tribunal a ajouté qu’après avoir obtenu l’agrément à l’adoption internationale, ils avaient contourné la loi sur l’adoption en ramenant l’enfant en Italie sans l’approbation de l’organe compétent, c’est-à-dire la Commission pour les adoptions internationales. Au vu de cette conduite, le tribunal des mineurs a déclaré craindre que l’enfant ne fût un instrument pour réaliser un désir narcissique du couple ou exorciser un problème individuel ou de couple. De plus, il a estimé que la conduite des requérants jetait « une ombre importante sur l’existence de réelles capacités affectives et éducatives et d’un instinct de solidarité humaine, qui doivent être présents chez ceux qui désirent intégrer les enfants d’autres personnes dans leur vie comme s’il s’agissait de leurs propres enfants68 ».
Avant de se pencher sur la question de savoir si les autorités italiennes ont dûment pesé les différents intérêts en jeu, la Cour rappelle que l’enfant n’est pas requérant en l’espèce. De plus, l’enfant n’était pas un membre de la famille des requérants au sens de l’article 8 de la Convention. Cela dit, il n’en résulte pas que l’intérêt supérieur de l’enfant et la manière dont celui-ci a été pris en compte par les juridictions internes ne revêtent aucune importance. À cet égard, la Cour observe que l’article 3 de la Convention sur les droits de l’enfant exige que « [d]ans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale », sans toutefois préciser la notion d’« intérêt supérieur de l’enfant »69 .
L’espèce diffère des affaires concernant l’éclatement d’une famille par la séparation d’un enfant et de ses parents dans lesquelles, en principe, la séparation est une mesure qui peut seulement être ordonnée si l’intégrité physique ou morale de l’enfant est en danger70. En l’espèce au contraire, la Cour estime que les juridictions internes n’étaient pas tenues de donner la priorité à la préservation de la relation entre les requérants et l’enfant. Elles étaient plutôt face à un choix délicat : soit permettre aux requérants de continuer leur relation avec l’enfant, et ainsi légaliser la situation que ceux-ci avaient imposée comme un fait accompli, soit prendre des mesures en vue de donner à l’enfant une famille conformément à la loi sur l’adoption. La Cour a déjà relevé l’importance des intérêts généraux en jeu. En outre, elle estime que le raisonnement des juridictions italiennes concernant l’intérêt de l’enfant ne revêtait pas un caractère automatique ou stéréotypé71. Les tribunaux, dans le cadre de leur appréciation de la situation spécifique de l’enfant, ont jugé souhaitable de le placer chez un couple approprié en vue de l’adoption mais ont également évalué l’impact qu’aurait sur lui la séparation d’avec les requérants. Elles ont conclu pour l’essentiel que la séparation ne causerait pas à l’enfant un préjudice grave ou irréparable.
Les juridictions italiennes n’ont pas retenu l’intérêt des requérants à continuer à développer des relations avec un enfant dont ils souhaitaient être les parents. Elles n’ont pas explicitement abordé l’impact que la séparation immédiate et irréversible d’avec l’enfant aurait sur leur vie privée. Cependant, selon la Cour, l’affaire doit être examinée au regard de l’illégalité de la conduite des requérants et du fait que leur relation avec l’enfant était précaire depuis le moment même où ils ont décidé de résider avec lui en Italie. La Cour ne sous-estime pas l’impact que la séparation immédiate et irréversible d’avec l’enfant doit avoir eu sur la vie privée des requérants. Si la Cour estime que les juridictions nationales ont ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu en demeurant dans les limites de l’ample marge d’appréciation dont elles disposaient en l’espèce, elle ne consacre aucun droit de devenir parent. La Cour ne saurait ignorer la douleur morale ressentie par ceux dont le désir de parentalité n’a pas été ou ne peut être satisfait. Toutefois, l’intérêt général en jeu pèse lourdement dans la balance, alors que, comparativement, il convient d’accorder une moindre importance à l’intérêt des requérants à assurer leur développement personnel par la poursuite de leurs relations avec l’enfant. Accepter de laisser l’enfant avec les requérants, peut-être dans l’optique que ceux-ci deviennent ses parents adoptifs, serait revenu à légaliser la situation créée par eux en violation de règles importantes du droit italien. La Cour admet donc que les juridictions italiennes, ayant conclu que l’enfant ne subirait pas un préjudice grave ou irréparable en conséquence de la procédure retenue, n’ont pas porté atteinte à la convention.
Dans une des opinions exprimées par les juges de la Cour dans cette affaire, des interrogations sur l’avenir de cette jurisprudence apparaissent. Ils indiquent en effet que plus généralement, nous estimons que la gestation pour autrui, qu’elle soit ou non rémunérée, n’est pas compatible avec la dignité humaine. Elle constitue un traitement dégradant non seulement pour l’enfant mais également pour la mère de substitution. La médecine moderne offre de plus en plus d’éléments démontrant l’impact déterminant de la période prénatale de la vie humaine pour le développement ultérieur de l’être humain. La grossesse avec ses soucis, ses contraintes et ses joies, ainsi que l’épreuve et le stress de la naissance, crée un lien unique entre la mère biologique et l’enfant. La gestation pour autrui est d’emblée orientée vers une rupture radicale de ce lien. La mère de substitution doit renoncer à développer une relation d’amour et de soins pendant toute une vie. L’enfant à naître non seulement est placé de force dans un environnement biologique étranger mais est également privé de ce qui aurait dû être l’amour sans limite de la mère au stade prénatal. La gestation pour autrui empêche également le développement de ce lien particulièrement fort entre l’enfant et le père qui accompagne la mère et l’enfant pendant toute la grossesse. Aussi bien l’enfant que la mère de substitution ne sont pas traités comme des buts en soi mais comme des moyens de satisfaire les désirs d’autres personnes. Pareille pratique n’est pas compatible avec les valeurs sous-jacentes à la Convention. La gestation pour autrui est particulièrement inacceptable si la mère de substitution est rémunérée. Nous regrettons que la Cour n’ait pas pris une position claire contre de telles pratiques72.
En somme, un certain malaise est suscité par ces deux affaires, l’une jugée en 2015, l’autre en 2017. La raison du malaise tient dans l’approche que l’on peut sentir instable de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi, dans les réponses à la presse, dans l’affaire, telle que jugée, en chambre en 2015, à la question de la raison de la condamnation prononcée par la cour, la réponse donnée est la suivante.
La Cour a estimé que les autorités italiennes n’ont pas donné assez de poids à l’intérêt supérieur de l’enfant face aux considérations d’ordre public. En effet, elles ont décidé d’éloigner l’enfant et de le mettre sous tutelle au motif qu’il n’avait aucun lien biologique avec les requérants et que ces derniers étaient dans l’illégalité (en s’adressant à une agence russe pour devenir parents puis en amenant en Italie un enfant dont ils faisaient croire qu’il s’agissait de leur fils, ils avaient tenté de contourner l’interdiction en Italie du recours à la GPA ainsi que les règles régissant l’adoption internationale). Les autorités n’ont notamment pas reconnu le lien de fait établi entre les requérants et l’enfant et ont pris une mesure extrême réservée à des cas où les enfants se trouvent en danger.
Il est important de noter que dans cette affaire la Cour se focalise sur l’éloignement et la mise sous tutelle de l’enfant, et non sur la question de la GPA. La situation juridique dans laquelle s’est trouvé l’enfant à son arrivée – filiation non reconnue en droit italien – aurait pu avoir une autre origine, par exemple la non-reconnaissance d’une adoption par une personne célibataire comme dans l’arrêt Wagner et J.M.W.L. c/ Luxembourg73. Dans cette dernière affaire, la Cour observe que la question de l’adoption par des célibataires se trouve à un stade avancé d’harmonisation en Europe. En effet, une étude de la législation des États membres révèle que l’adoption par les célibataires est permise sans limitation dans la majorité des 47 pays.
La Cour note qu’il existait au Luxembourg une pratique, selon laquelle les jugements péruviens ayant prononcé une adoption plénière étaient reconnus de plein droit au Luxembourg. L’intéressée ayant suivi toutes les règles imposées par la procédure péruvienne, le juge prononça l’adoption plénière de la deuxième requérante. Une fois au Luxembourg, les requérantes pouvaient légitimement s’attendre à ce que le jugement péruvien soit transcrit. Toutefois, la pratique de la transcription des jugements avait subitement été abrogée et leur dossier fut soumis à l’examen des autorités judiciaires luxembourgeoises, lesquels rejetèrent la demande d’exéquatur74.
La Cour estime que la décision de refus d’exequatur ne tient pas compte de la réalité sociale de la situation. Dès lors que les juridictions luxembourgeoises n’ont pas admis officiellement l’existence juridique des liens familiaux créés par l’adoption plénière péruvienne, ceux-ci ne déploient pas pleinement leurs effets au Luxembourg. De ce fait, les requérantes en subissent des inconvénients dans leur vie quotidienne et l’enfant ne se voit pas accorder une protection juridique rendant possible son intégration complète dans la famille adoptive. Rappelant que c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit primer dans ce genre d’affaires, la Cour estime que les juges luxembourgeois ne pouvaient raisonnablement passer outre au statut juridique créé valablement à l’étranger et correspondant à une vie familiale au sens de l’article 8. Par conséquent, la Cour avait alors conclu à la violation de l’article 875.
La jurisprudence européenne sur la GPA se construit ainsi peu à peu, au gré des espèces qui se présentent à elle. L’harmonie et la lisibilité de la jurisprudence en la matière ne peuvent être que périlleuses. Plusieurs raisons l’expliquent. La première est que la conciliation entre la reconnaissance des interdictions nationales avec l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de la vie familiale se heurte, dans certains cas, à des impasses. La deuxième tient dans la difficulté, dans certains cas aussi, de faire un départ lisible entre la vie familiale et la vie privée, dans les contextes de GPA qui se présentent à la cour. La troisième tient dans la prise en compte de l’illégalité dans laquelle peut se trouver tel requérant. Ce paramètre, s’il apparaît conforme à un État de droit européen, ose une difficulté dès lors que la cour accepte, selon les cas, d’admettre que l’illégalité première – celle tenant à avoir recours à des procédés de GPA hors de son pays qui l’interdit – peut être surmontée au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant. On est d’une certaine manière face à une inégalité face aux illégalités. La jurisprudence doit donc encore s’affiner, mais la réglementation mériterait, sur ce sujet éminemment sensible, d’être davantage internationalisée pour une meilleure protection de l’enfant.
Notes de bas de pages
-
1.
CEDH, 24 janv. 2017, n° 25358/12, Paradiso et Campanelli c/ Italie ; CEDH, 19 janv. 2017, n° 44024/13, Laborie c/ France.
-
2.
Voir l’état des lieux des législations, dans notre précédent article sur ce sujet : LPA 21 mars 2016, p. 6.
-
3.
CEDH, 24 janv. 2017, n° 25358/12, Paradiso et Campanelli c/ Italie.
-
4.
CEDH, 19 janv. 2017, n° 44024/13, Laborie c/ France.
-
5.
CEDH, 24 janv. 2017, n° 25358/12, Paradiso et Campanelli c/ Italie : par son arrêt du 27 janvier 2015, la Cour s’oppose au droit italien et considère que la justice italienne a porté une atteinte disproportionnée à la « vie familiale » des commanditaires, notamment en ordonnant la mesure de placement de l’enfant qu’ils avaient acquis en Russie. L’Italie doit payer au couple de commanditaires la somme de 20 000 €.
-
6.
Rappelées dans : CEDH, 26 juin 2014, n° 65192/11, Mennesson c/ France, § 40-42 (extraits) ; CEDH, 26 juin 2014, n° 65941/11, Labassee c/ France, § 31-33.
-
7.
CEDH, 26 juin 2014, n° 65192/11, Mennesson c/ France, § 40-42 (extraits) ; CEDH, 26 juin 2014, n° 65941/11, Labassee c/ France, § 31-33. Voir nos précédents articles sur le sujet dans cette revue.
-
8.
Préc.
-
9.
Domingo M., « Filiation par mère porteuse : entre l’ordre public international et le droit à une vie de famille », Gaz. Pal. 12 mai 2011, n° I6754, p. 13 ; Vialla F. et Reynier M., « Pour le droit positif français, Ismaël n’est pas Isaac ! », JCP G 2011, 441 ; Rome F., « Stérile randonnée… », D. 2011, p. 1001 ; Labbée X., « La gestation pour autrui devant la Cour de cassation – à propos des arrêts du 6 avril 2011 », D. 2011, p. 1064 ; Berthiau D. et Brunet L., « L’ordre public au préjudice de l’enfant », Études et commentaires 2011, p. 1522 à 1529 ; Le Boursicot M.-C., « Vrais enfants au-delà de l’Atlantique, faux enfants en deçà… », RJPF 2011/6, p. 14 ; Weiss-Gout B., « Trois décisions, une même déception », Gaz. Pal. 26 mai 2011, n° I5894, p. 7 ; Neirinck C., « La gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et l’état civil de l’enfant qui en est né », Dr. famille 2011, étude 14 ; Chénedé F., « Conventions de mère-porteuse : la Cour de cassation met un frein au tourisme procréatif », AJ fam. 2011, p. 262 ; Haftel B., « Gestation pour autrui : éclairage de droit international », AJ fam. 2011, p. 265 ; Gallois J., « État civil d’enfants nés d’une convention de mère porteuse : la Cour de cassation n’a pas su faire preuve d’audace », RLDC 2011/82, n° 4244. Cités par conclusions X. Domino sur CE, 12 déc. 2014, nos 365779, 366710, 366989, 367317, 367324, 368861.
-
10.
V. par ex. : CEDH, 28 juill. 1999, n° 25803/94, Selmouni c/ France, § 74.
-
11.
CEDH, 21 juill. 2016, nos 9063/14 et 10410/14, Foulon et Bouvet c/ France, § 36-38.
-
12.
Positions relatées dans l’arrêt de la cour ici analysé.
-
13.
Préc.
-
14.
Préc.
-
15.
Préc., pt 58.
-
16.
Dans son arrêt de chambre, rendu le 27 janvier 2015, dans l’affaire Paradiso et Campanelli c/ Italie, la Cour européenne des droits de l’Homme dit à la majorité : qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’Homme. L’affaire concernait la prise en charge par les services sociaux italiens d’un enfant de neuf mois né en Russie à la suite d’un contrat de gestation pour autrui (GPA), conclu par un couple dont il fut ultérieurement établi qu’il n’avait aucun lien biologique avec l’enfant. La Cour a estimé que les considérations d’ordre public ayant orienté les décisions des autorités italiennes – qui ont estimé que les requérants avaient tenté de contourner l’interdiction de la GPA en Italie ainsi que les règles régissant l’adoption internationale – ne pouvaient l’emporter sur l’intérêt supérieur de l’enfant, malgré l’absence de tout lien biologique et la brièveté de la période pendant laquelle les requérants se sont occupés de lui. Rappelant que l’éloignement d’un enfant du contexte familial est une mesure extrême ne pouvant se justifier qu’en cas de danger immédiat pour lui, la Cour a estimé qu’en l’espèce, les conditions pouvant justifier un éloignement n’étaient pas remplies. Les conclusions de la Cour ne sauraient toutefois être comprises comme obligeant l’État italien à remettre l’enfant aux requérants, ce dernier ayant certainement développé des liens affectifs avec la famille d’accueil chez laquelle il vit depuis 2013.
-
17.
Pts 50 à 53 de l’arrêt ici commenté.
-
18.
Sect. V, 5 avr. 2016, arrêt n° 13525.
-
19.
Sect. I, 22 juin 2016 , arrêt n° 12962/14.
-
20.
Pts 70 à 72 de la décision ici commentée.
-
21.
Préc.
-
22.
La chambre a renvoyé à cet égard aux arrêts suivants : CEDH, 13 juill. 2000, nos 39221/98 et 41963/98, Scozzari et Giunta c/ Italie, § 148 ; CEDH, 6 juill. 2000, n° 41615/07, Neulinger et Shuruk c/ Suisse, § 136 ; CEDH, 13 mars 2012, n° 4547/10, Y.C. c/ Royaume-Uni, § 133-138 ; CEDH, 10 avr. 2012, n° 19554/09, Pontes c/ Portugal, § 74-80.
-
23.
Paragraphes 75 et suivants de l’arrêt de chambre précité.
-
24.
Paragraphe 69 de l’arrêt de la chambre.
-
25.
Paragraphe 70 de l’arrêt de la chambre.
-
26.
CEDH, 13 juin 1979, n° 6833/74, Marckx c/ Belgique, § 31, série A, n° 31 ; CEDH, 12 juill. 2001, n° 25702/94, K. et T. c/ Finlande, § 150.
-
27.
CEDH, 27 oct. 1994, n° 18535/91, Kroon et autres c/ Pays-Bas, § 30, série A, n° 297-C ; CEDH, 18 déc. 1986, n° 9697/82, Johnston et autres c/ Irlande, § 55, série A, n° 112 ; CEDH, 26 mai 1994, n° 16969/90, Keegan c/ Irlande, § 44, série A, n° 290 ; CEDH, 22 avr. 1997, n° 21830/93, X, Y et Z c/ Royaume-Uni, § 36.
-
28.
CEDH, 22 janv. 2008, n° 43546/02, E.B. c/ France, § 41.
-
29.
CEDH, 29 juin 1999, n° 27110/95, Nylund c/ Finlande.
-
30.
CEDH, 28 mai 1985, n° 9214/80, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/ Royaume-Uni, § 62, série A, n° 94.
-
31.
CEDH, 16 juill. 2015, n° 39438/13, Nazarenko c/ Russie, § 58.
-
32.
CEDH, 22 sept. 2004, nos 78028/01 et 78030/01, Pini et autres c/ Roumanie, § 148.
-
33.
Éléments relatés dans l’arrêt de la Cour ici analysé.
-
34.
CEDH, 27 avr. 2010, n° 16318/07, Moretti et Benedetti c/ Italie, § 48 ; CEDH, 17 janv. 2012, n° 1598/06, Kopf et Liberda c/ Autriche, § 37.
-
35.
CEDH, 27 avr. 2010, n° 16318/07, Moretti et Benedetti c/ Italie, § 49-50.
-
36.
CEDH, 17 janv. 2012, n° 1598/06, Kopf et Liberda c/ Autriche, § 37.
-
37.
CEDH, 28 juin 2007, n° 76240/01.
-
38.
CEDH, 16 juill. 2015, n° 39438/13, Nazarenko c/ Russie, § 58.
-
39.
CEDH, 8 juill. 2014, n° 29176/13, § 49.
-
40.
V. a contrario : CEDH, 16 juill. 2015, n° 39438/13, Nazarenko c/ Russie, § 58.
-
41.
CEDH, 26 mars 1985, n° 8978/80, X et Y c/ Pays-Bas, § 22, série A, n° 91.
-
42.
CEDH, 16 déc. 1992, n° 13710/88, Niemietz c/ Allemagne, § 29, série A, n° 251-B.
-
43.
CEDH, 7 févr. 2002, n° 53176/99, Mikulić c/ Croatie, § 53.
-
44.
CEDH, 29 avr. 2002, n° 2346/02, Pretty c/ Royaume-Uni, § 61.
-
45.
CEDH, 10 avr. 2007, n° 6339/05, Evans c/ Royaume-Uni ; CEDH, 16 déc. 2010, n° 25579/05, A, B et C c/ Irlande, § 212.
-
46.
CEDH, 4 déc. 2007, n° 44362/04, § 66
-
47.
Commission, 10 juill. 1978, n° 8257-78, X. c/ Suisse ; CEDH, 16 déc. 1992, n° 13710/88, Niemietz c/ Allemagne, § 29.
-
48.
Préc.
-
49.
Pts 162 et s. de l’arrêt ici analysé.
-
50.
CEDH, 3 nov. 2011, n° 57813/00, S.H. et autres c/ Autriche, § 82.
-
51.
Pt 164.
-
52.
V. par ex : CEDH, 3 nov. 2011, n° 57813/00, S.H. et a. c/ Autriche, § 94 ; CEDH, 16 juill. 2004, n° 37359/09, Hämäläinen c/ Finlande, § 67.
-
53.
CEDH, 10 avr. 2007, n° 6339/05, Evans c/ Royaume-Uni, § 77 ; CEDH, 16 déc. 2010, n° 25579/05, A, B et C c/ Irlande, § 232.
-
54.
V. les paragraphes 151 et 157 de l’arrêt.
-
55.
V. le paragraphe 164 de l’arrêt.
-
56.
CEDH, 3 nov. 2011, n° 57813/00, S.H. et a. c/ Autriche, préc., § 82.
-
57.
V. le paragraphe 163 de l’arrêt.
-
58.
V. le paragraphe 166 de l’arrêt.
-
59.
Opinion concordante commune aux juges De Gaetano, Pinto de Albuquerque, Wojtyczek et Dedov : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-170867.
-
60.
Préc.
-
61.
Préc.
-
62.
Pt 193 de l’arrêt ici étudié.
-
63.
CEDH, 26 juin 2014, n° 65192/11, Mennesson c/ France, § 80, 96 et 97.
-
64.
V. le paragraphe 140 de l’arrêt.
-
65.
V. les paragraphes 149, 150, 151 et 157 de l’arrêt.
-
66.
Opinion concordante commune aux juges De Gaetano, Pinto de Albuquerque, Wojtyczek et Dedov : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-170867.
-
67.
Opinion concordante commune aux juges De Gaetano, Pinto de Albuquerque, Wojtyczek et Dedov : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-170867.
-
68.
CEDH, 24 janv. 2017, n° 25358/12, Paradiso et Campanelli c/ Italie, pt 161.
-
69.
Ibid.
-
70.
Cité par la cour point 209 : voir, not. : CEDH, 13 juill. 2000, nos 39221/98 et 41963/98, Scozzari et Giunta c/ Italie, § 148-151 ; CEDH, 26 févr. 2002, n° 46544/99, Kutzner, § 69-82.
-
71.
V. pour un exemple comparable : CEDH, 26 nov. 2013, n° 27853/09, X c/ Lettonie, § 107.
-
72.
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-170867.
-
73.
CEDH, 28 juin 2007, n° 76240/01.
-
74.
Ibid.
-
75.
Ibid.