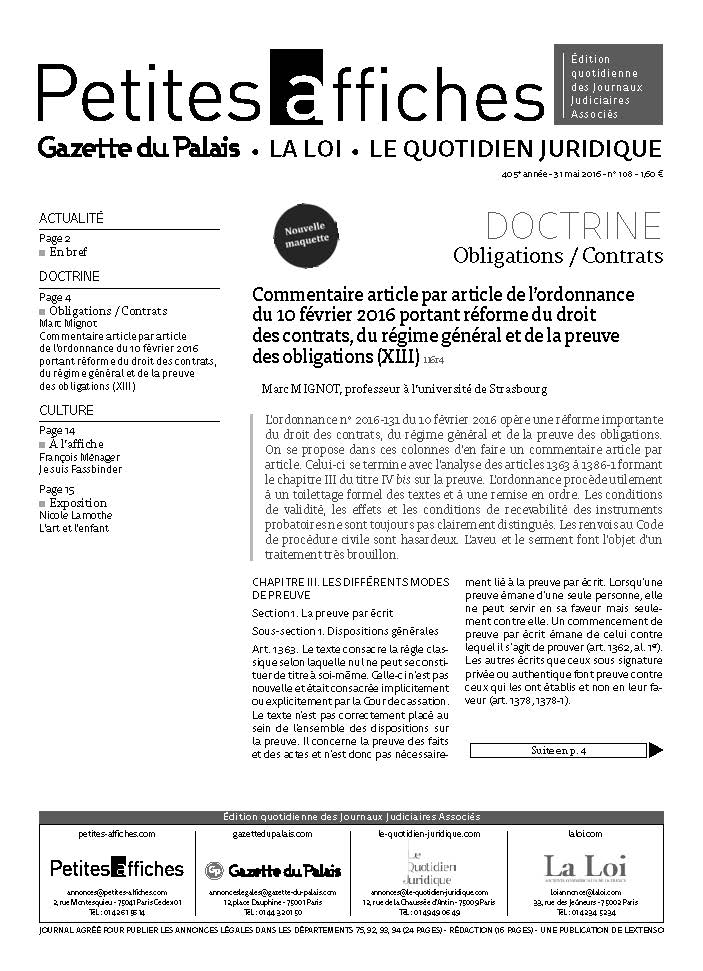Commentaire article par article de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (XIII)
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 opère une réforme importante du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. On se propose dans ces colonnes d’en faire un commentaire article par article. Celui-ci se termine avec l’analyse des articles 1363 à 1386-1 formant le chapitre III du titre IV bis sur la preuve. L’ordonnance procède utilement à un toilettage formel des textes et à une remise en ordre. Les conditions de validité, les effets et les conditions de recevabilité des instruments probatoires ne sont toujours pas clairement distingués. Les renvois au Code de procédure civile sont hasardeux. L’aveu et le serment font l’objet d’un traitement très brouillon.
CHAPITRE III. LES DIFFÉRENTS MODES DE PREUVE
Section 1. La preuve par écrit
Sous-section 1. Dispositions générales
Art. 1363. Le texte consacre la règle classique selon laquelle nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Celle-ci n’est pas nouvelle et était consacrée implicitement1 ou explicitement2 par la Cour de cassation. Le texte n’est pas correctement placé au sein de l’ensemble des dispositions sur la preuve. Il concerne la preuve des faits et des actes et n’est donc pas nécessairement lié à la preuve par écrit. Lorsqu’une preuve émane d’une seule personne, elle ne peut servir en sa faveur mais seulement contre elle. Un commencement de preuve par écrit émane de celui contre lequel il s’agit de prouver (art. 1362, al. 1er). Les autres écrits que ceux sous signature privée ou authentique font preuve contre ceux qui les ont établis et non en leur faveur (art. 1378, 1378-1). Au-delà, l’exigence du texte est liée à celle d’impartialité. L’officier public qui reçoit un acte authentique doit être impartial (art. 2, D. n° 71-941 du 26 nov. 1971). Le témoin doit également l’être (CPC, art. 206). Dans le domaine des actes, le texte s’applique restrictivement. Il faut distinguer l’acte unilatéral, d’une part, et le contrat, d’autre part. Dans le premier cas, la preuve est par hypothèse constituée par son seul auteur. Il en est ainsi de tout acte unilatéral et spécialement du serment (art. 1384). L’aveu fait exception à la règle car il fait preuve contre son auteur (art. 1383, al. 1er). Dans le second cas, la règle se confond avec le caractère contradictoire de l’acte instrumentaire. L’écrit instrumentaire, sous signature privée ou authentique, relatant un contrat auquel plusieurs personnes sont parties, obéit aux exigences du texte (art. 1364).
Art. 1364. Le texte énonce les actes instrumentaires admis comme preuve préconstituée. Il s’agit de l’acte sous signature privée et de l’acte authentique. La préconstitution peut s’entendre de deux façons. D’abord, la preuve préconstituée est celle réalisée au moment même de l’existence du negocium dont il est question d’établir l’existence. La preuve a priori par acte sous signature privée s’oppose à la preuve a posteriori par témoignage ou présomption. La validité de la preuve ne serait néanmoins pas affectée si elle était réalisée postérieurement au negocium. Ensuite, la preuve préconstituée est celle réalisée à des fins probatoires. Certains écrits sont réalisés dans ce but (art. 1369 à 1376). D’autres le sont dans un autre but mais peuvent finalement être utilisés comme preuves (art. 1378 à 1378-2). Le texte considère seulement que la preuve d’un acte peut être préconstituée par un écrit. La préconstitution est présentée comme une faculté. Elle est en réalité un devoir ou une incombance. Les parties doivent préconstituer la preuve écrite sous peine de ne pouvoir ultérieurement faire la preuve de l’existence de l’acte. L’article 1359, alinéa 1er l’admet implicitement : si l’acte doit être prouvé par écrit, c’est nécessairement que l’écrit doit être préconstitué. Il faudrait pour être précis distinguer le devoir de préconstituer l’écrit et celui de le rapporter ultérieurement (art. 1360). Un contractant ne peut naturellement rapporter l’écrit que s’il a pris la précaution de le préconstituer. Mais il peut être dispensé de rapporter l’acte s’il l’a préconstitué et qu’il a disparu par cas de force majeure.
Art. 1365. Le texte définit l’écrit comme un message intelligible fixé sur un support quelconque (art. 1316 anc. issu de la L. n° 2000-230 du 13 mars 2000). Il manque partiellement son objet. Il définit moins l’écrit que l’information qui en est le contenu (comp. art. 1379, al. 2e)3. Il doit être mis en relation avec la distinction entre le signifié (« signification intelligible ») et le signifiant (« suite de lettres… »)4. En réalité, l’écrit est le document qui fixe durablement l’information (comp. art. 1379, al. 2e). Dans le langage moderne, il en est le support. Le texte ne précise pas les caractéristiques requises du support (sécurité, durabilité, pérennité) et la sanction en leur absence (nullité). Le support peut être papier ou électronique (art. 1366).
Art. 1366. Le texte pose deux conditions de validité à l’écrit électronique (CPC, art. 287, al. 2e). D’abord, l’auteur de cet écrit doit être identifié. Ensuite, il doit être établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. Ces deux conditions sont en principe remplies s’agissant d’un écrit papier du fait de la nature du support. Elles doivent l’être d’un point de vue électronique quand il a la nature d’un écrit instrumentaire électronique. Le texte est légèrement imprécis dans l’expression de la première condition. Il confond l’acte instrumentaire et le negocium lorsqu’il requiert que la personne dont il émane puisse être identifiée. Il aurait été préférable de considérer que doit être identifiée la personne qui est l’auteur de la volonté qu’il relate. Si ces deux conditions sont remplies, l’écrit sous forme électronique aura la même valeur que l’écrit sous forme papier (art. 1316-1 anc.).
Art. 1367. Le texte précise le rôle de la signature d’un acte sur support papier (al. 1er). Il ne distingue pas suffisamment les aspects de forme et de fond. La signature est nécessaire à la perfection de l’acte et identifie son auteur (al. 1er, 1re phrase). Le texte est imprécis. Il ne précise pas la nature de la signature et son champ d’application. La signature doit être manuscrite lorsque l’acte est sur support papier. Surtout, la signature des parties est une condition de validité de l’acte instrumentaire, qu’il soit sous signature privée ou authentique (art. 1370). Lorsque l’acte est authentique, la signature de l’officier public ou du fonctionnaire authentifie l’acte (al. 1er, 3e phrase). Sur le fond, la signature manifeste le consentement de la partie aux obligations qui découlent de l’acte (al. 1er, 2e phrase). Le texte est encore imprécis. La signature manifeste le consentement à tous les effets du negocium5. Par rapport à lui, elle n’est nullement une condition de validité (art. 1109, al. 1er, 1172, al. 1er). Le texte définit la signature d’un acte sur support électronique (al. 2e).
Art. 1368. Le texte est relatif aux conflits entre preuves littérales de toutes natures (art. 1316-2 anc. issu de la L. n° 2000-230 du 13 mars 2000 ; comp. art. 1359, al. 1er). Le juge les règle en se déterminant par tout moyen. Il peut donc ordonner toute mesure d’instruction à l’effet de déterminer l’écrit le plus sûr. La notion de conflit de preuves littérales est imprécise et plusieurs hypothèses doivent être distinguées. Comme par le passé, on peut imaginer un conflit entre deux actes sous signature privée d’un même negocium. Si la différence est de forme et résulte d’une fraude, il appartiendra au juge de déterminer si l’un des actes est un faux et de procéder à son annulation en tout ou en partie le cas échéant. Si la divergence est de forme et ne résulte pas d’une fraude, la question ne relève pas de la preuve. Elle doit être résolue par une interprétation de la volonté commune des parties (art. 1188, al. 1er)6. Si la divergence est de fond et de forme et ne résulte toujours pas d’une fraude, la question ne relève pas seulement de la preuve. Il faudrait considérer que le negocium ne recouvre que les éléments communs aux deux actes instrumentaires (art. 1119, al. 2e, 1380, al. 2e). Il peut y avoir un conflit entre un écrit instrumentaire et un aveu écrit. Il semble résulter de l’article 1359, alinéa 2e que ce dernier est irrecevable contre le premier. En réalité, il faudrait appliquer à ce conflit exactement les mêmes solutions que celles exposées plus haut.
Sous-section 2. L’acte authentique
Art. 1369. Le texte définit l’acte authentique (al. 1er). Il est restrictif dans la désignation de la personne à l’origine de l’authenticité. L’acte authentique peut être dressé par un officier public ou un fonctionnaire, notamment par un juge (CPC, art. 457) ou un agent consulaire et diplomatique (D. n° 91-152 du 7 févr. 1991). La nature du rôle de l’officier public ne ressort pas clairement du texte. Lorsqu’il est établi sur support papier, l’acte est reçu par l’officier qui l’instrumente ; lorsqu’il est établi sur support électronique, l’acte est dressé par l’officier qui l’instrumente. Le texte tend à confondre le negocium et l’instrumentum. L’officier public reçoit la volonté de la partie ou des parties et établit l’acte instrumentaire en conséquence.
La validité de l’acte authentique est subordonnée au respect des solennités requises. La forme d’un acte étant libre par principe (art. 1102, al. 1er), celles requises devront être posées par la loi et interprétées restrictivement. Elles varient dans une certaine mesure en fonction de la personne l’instrumentant. La signature de l’officier public est une condition générale de validité de l’acte (art. 10, D. n° 71-941 du 26 nov. 1971 ; art. 7, D. n° 91-152 du 7 févr. 1991). Sa validité dépend également du respect des règles relatives à sa compétence. Le texte ajoute comme dernière condition le respect des règles relatives à la qualité de l’officier public. Cette dernière condition est imprécise : elle se confond soit avec la capacité (art. 1370), soit avec la compétence territoriale (art. 2, D. n° 91-152 du 7 févr. 1991) ou matérielle (art. 1er, ord. n° 45-2592 du 2 nov. 1945). Il semble ici qu’elle vise cette dernière. L’acte authentique peut être établi sur support électronique (al. 2e). L’acte notarié est dispensé de toute mention manuscrite (al. 3e).
Art. 1370. L’acte authentique nul pour défaut de forme, pour incompétence ou incapacité de l’officier public vaut comme acte sous signature privée (art. 1318 anc. ; art. 41, D. n° 71-941 du 26 nov. 1971 ; art. 9, D. n° 71-942 du 26 nov. 1971). On notera que le texte remplace la qualité par la capacité (v. art. 1369). Il ne précise pas la nature de la nullité de l’acte authentique. Elle est en principe absolue et ne frappe que l’acte instrumentaire (art. 1102 al. 1er, 1172 al. 1er). La nullité frappe le negocium lorsqu’il est solennel (art. 1172 al. 2e). Le texte semble considérer que la seule condition de validité de l’acte sous signature privée est la signature de la partie ou des parties au negocium. D’autres textes considèrent implicitement que l’intégrité de l’acte en est également une (v. art. 1372).
Art. 1371. Le texte est relatif à la fois à l’objet de la preuve et aux effets probatoires. Il modifie assez profondément les dispositions de l’article 1319, alinéa 1er ancien en consacrant la jurisprudence antérieure. Le texte considère que l’acte prouve avec une force particulière ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté7. Le texte est confus et incomplet. Il faudrait distinguer la validité de l’acte, l’objet de la preuve et son effet. 1° La mention de la procédure de faux est relative à la validité de l’acte. Le texte fait de la validité une limite (« jusqu’à inscription de faux ») à l’effet probatoire (« fait foi »). En cas de procédure de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte (al. 2e ; art. 1319, al. 2e). Il aurait été préférable de traiter de cette validité et de l’hypothèse du faux une fois pour toute et de ne plus y revenir (art. 1369). 2° Un acte est susceptible de prouver d’abord l’écriture, lato sensu, et son origine, ensuite la réalité du fait ou du negocium relaté dans l’acte et enfin la vérité ou sincérité du fait ou du negocium relaté dans l’acte8. 3° L’acte authentique prouve ces trois objets mais avec une force différente. Aucune preuve contraire ne peut être rapportée contre ce qui est personnellement accompli ou constaté par l’officier public. Seule la validité de l’acte est contestable par la procédure de faux mais aucunement ses effets. De ce point de vue, le texte est mal rédigé car il amalgame la contestation de la validité et celle des effets. Ce qui n’est pas personnellement accompli ou constaté par l’officier public a la même force probatoire qu’un acte sous signature privée. La règle était justement énoncée par l’article 1320 ancien qui n’a pas été repris. La preuve contraire est possible par un autre acte instrumentaire sous signature privée ou authentique (art. 1359, al. 2e). Il n’est plus fait mention dans le texte de ce que l’acte fait foi seulement à l’égard des parties, de leurs héritiers ou ayants cause (comp. art. 1372). La précision était considérée comme erronée : l’acte fait foi à l’égard des parties et des tiers (art. 1200, al. 1er ; comp. CPC, art. 310).
Sous-section 3. L’acte sous signature privée
Art. 1372. Le texte ne définit pas l’acte sous signature privée. Il ne précise pas ses conditions de validité et mentionne seulement l’une des procédures par laquelle son existence ou sa validité est contestée. Il ne traite pas des effets probatoires de cet acte.
La condition de validité la plus évidente est la signature. Il aurait été utile que le texte le précise (art. 1367, al. 1er, 1370, 1376 ; art. 41, D. n° 71-941 du 26 nov. 1971 ; art. 9, D. n° 71-942 du 26 nov. 1971). Les textes ont tendance à considérer que l’intégrité de l’acte est une autre condition de validité de celui-ci. La condition est explicite s’agissant de l’écrit électronique (art. 1366, 1367, al. 2e ; CPC, art. 287, al. 2e) mais implicite s’agissant de l’écrit papier (art. 1376 ; CPC, art. 299). Bizarrement, les articles 1372 et 1373 ne mentionnent que la procédure de vérification d’écriture (CPC, art. 287 à 298) et pas celle de faux matériel (CPC, art. 299 à 302). Il aurait été souhaitable que ce point soit clarifié (comp. art. 1373). La forme de l’acte est libre (art. 1102, al. 1er, 1172, al. 1er).
Le texte ne se prononce pas sur la nature de la nullité. Tout indique qu’elle est relative (art. 1182, al. 3e, 1375, al. 3e). Le texte déroge néanmoins à la règle applicable en matière de nullité selon laquelle seule la partie protégée par la règle violée peut agir en nullité (art. 1181, al. 1er). L’acte doit être reconnu par la partie à laquelle il est opposé. La reconnaissance peut résulter de son silence. En cas de dénégation, il appartient à celui qui invoque l’acte de prouver sa sincérité9. La dénégation contraint celui qui n’est pas protégé par la règle à agir. Ceci étant, les textes du Code de procédure civile donnent un rôle actif au juge dans la vérification d’écriture et ne marquent nullement la distinction des rôles entre le demandeur et le défendeur (art. 287, 288). La partie qui dénie son écriture ou sa signature peut être contrainte de fournir des documents (art. 288) ou de comparaître (art. 291).
Le texte évoque à peine l’effet probatoire de l’acte (« fait foi »). Il fait preuve de la sincérité du fait ou du negocium qu’il relate et de la sincérité de son contenu jusqu’à la preuve contraire résultant d’un autre acte sous signature privée ou authentique (art. 1359, al. 2e). Selon le texte, l’acte fait foi entre les parties, leurs héritiers et ayants cause. A contrario, on serait tenté de considérer que l’acte n’a aucune valeur probatoire à l’égard des tiers. La précision contenue dans le texte est de nature à tromper. D’abord, les parties doivent prouver l’acte par les modes de preuve de droit commun et donc par écrit lorsque la valeur de ses effets dépasse une certaine somme (art. 1359, al. 1er). Ensuite, comme le negocium, l’acte instrumentaire est opposable aux tiers (art. 1200, al. 1er). La seule exception est relative à sa date (art. 1377).
Art. 1373. Le texte revient sur la question de la validité de l’acte. Son contenu normatif est très limité puisqu’il se contente de répéter ce que l’article 287 du Code de procédure civile énonce déjà. Il est particulièrement étonnant que l’hypothèse du faux soit omise, alors qu’elle est, dans les conditions actuelles, beaucoup plus importante que la dénégation d’écriture (v. art. 1372 ; CPC, art. 299). Elle n’est évoquée qu’à propos de l’acte contresigné par avocat (art. 1374, al. 2e).
Art. 1374. Le texte est relatif à l’acte contresigné par avocat qui fait une entrée remarquée dans le Code civil. Il reprend avec quelques changements mineurs les articles 66-3-2 et 66-3-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 197110 qui sont abrogés (art. 6 XXXIII ord. 2016-131). Le texte n’est pas d’une parfaite cohérence. Il convient d’en faire l’analyse dans le sens inverse de son ordre de présentation. L’acte contresigné est dispensé de mention manuscrite (al. 3e). La règle s’explique par le devoir d’information de l’avocat qui remplace utilement toute mention manuscrite (art. 66-3-1 de la L. n° 71-1130, préc.). Un tel acte contresigné fait foi de l’écriture et de la signature des parties (al. 1er). La foi dans la signature se comprend parfaitement, à condition que l’avocat vérifie préalablement l’identité des parties. En revanche, la foi dans l’écriture est sans objet puisque, d’une part, les actes sont en général dactylographiés et, d’autre part, toute mention manuscrite est exclue en fait. L’acte contresigné peut être contesté par la procédure de faux (al. 2e). Un faux matériel est effectivement toujours envisageable. Implicitement, cela veut dire que les avocats ne sont pas tenus de conserver un original de l’acte. Ils peuvent le faire mais n’en supportent pas l’obligation légale.
Art. 1375. L’article reprend avec quelques modifications les dispositions de l’article 1325 ancien. Le texte requiert l’existence de plusieurs originaux et fait ainsi exception à la liberté de la forme (al. 1er ; art. 1102, al. 1er, 1172, al. 1er). Est visé l’acte relatant un contrat synallagmatique. Compte tenu du contenu de la catégorie et de la référence à l’intérêt, il aurait été préférable de viser les contrats à titre onéreux qui sont intéressés de part et d’autre (art. 1107). La sanction apparaissait plus nettement dans l’article 1325 ancien que dans le présent texte. On peut néanmoins considérer qu’elle demeure la nullité relative de l’acte instrumentaire. Les parties peuvent convenir de remettre l’acte original unique à un dépositaire (al. 1er, in fine). Le contrat de dépôt devra être prouvé par écrit le cas échéant (art. 1359, al. 1er). Chaque original de l’acte doit mentionner le nombre des originaux établis (al. 2e). La nullité relative peut désormais être confirmée dans deux hypothèses et non dans une seule comme auparavant (art. 1182, al. 3e). Celui qui a exécuté le contrat ne peut opposer la nullité tirée de l’insuffisance du nombre des originaux ou de l’absence de mention y relative (al. 3e). L’acte sous signature privée nul peut valoir comme commencement de preuve par écrit (art. 1362). Lorsque l’écrit est établi sur support électronique, l’exigence d’une pluralité d’exemplaires est satisfaite lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367 et que chaque partie dispose d’un exemplaire ou y a accès (al. 4e).
Art. 1376. Le texte reprend les dispositions de l’article 1326 ancien. Il est encore fait exception à la liberté de la forme (art. 1102, al. 1er, 1172, al. 1er). Le texte confond l’acte instrumentaire et le negocium. Ce n’est pas par l’acte sous seing privé qu’une partie s’engage mais par sa volonté (art. 1101). Il aurait été préférable d’énoncer la règle par une formule similaire à celle de l’article 1375 ou de reprendre purement et simplement celle de l’article 1326 ancien. L’acte sous signature privée est nul s’il ne comporte pas la mention écrite par le débiteur de la somme ou de la quantité en lettres et en chiffres et sa signature. L’exigence de la signature est une condition générale de validité de l’acte sous signature privée. La mention de la somme ou quantité en lettres et en chiffres a pour but d’empêcher ou de rendre plus difficile la falsification de l’acte. On retrouve ainsi les deux conditions de validité de tout acte sous signature privée (art. 1372). L’acte sous signature privée nul pour non-respect des présentes exigences formelles peut valoir comme commencement de preuve par écrit (art. 1362).
Art. 1377. Le texte reprend les dispositions de l’article 1328 ancien. Il ne concerne que la date de l’acte à l’égard des tiers. Entre les parties, elle ne fait foi que jusqu’à preuve contraire, laquelle doit être rapportée par écrit (art. 1359, al. 2e). S’il y a fraude, cette preuve peut être rapportée par tout moyen (art. 1358). À l’égard des tiers, la preuve de la date résulte de l’enregistrement de l’acte, de la mort de l’une des parties ou du report de la substance de l’acte dans un acte authentique ayant date certaine. L’énonciation demeure limitative. La règle prouve que l’acte instrumentaire est opposable aux tiers (v. art. 1372). Il est fait exception à la règle dans deux hypothèses. La date de la cession de créance peut être prouvée par tout moyen (art. 1323, al. 2e). Il en est de même en cas de novation par changement de créancier (art. 1333, al. 2e).
Sous-section 4. Autres écrits
Art. 1378. Le texte reprend moyennant des modifications formelles les articles 1329 et 1330 anciens. Le champ du texte est élargi à tous les professionnels. S’agissant des commerçants, il y a lieu de combiner le texte avec l’article L. 123-23 du Code de commerce. Chaque commerçant peut produire en justice sa comptabilité contre un commerçant si elle est régulièrement tenue.
Art. 1378-1. Le texte reprend l’article 1331 ancien, sans en moderniser les termes et ouvrir sur la possibilité de prendre en compte l’écrit électronique. Le papier ne fait pas preuve au profit de celui qui l’a écrit (al. 1er). La règle est inutile (art. 1363). Il fait preuve contre celui qui l’a écrit dans les deux hypothèses visées au texte (al. 2e). 1° L’écrit fait preuve lorsqu’il énonce un paiement reçu. Il y a aveu du créancier. Le paiement se prouvant par tout moyen, la règle est en partie inutile (art. 1342-8). 2° L’écrit fait preuve lorsqu’il contient la mention qu’il a été fait pour suppléer le défaut de titre en faveur du créancier. La règle paraît inutile puisqu’il y a là un contrat sur la preuve (art. 1356). Par le passé, il fallait que la mention soit écrite de la main de son auteur ou signée de lui pour que l’écrit produise son effet probatoire. Cette exigence doit être maintenue (« qui les a écrits »).
Art. 1378-2. Le texte modifie l’article 1332 ancien dans le sens d’une modernisation. Il n’est plus fait référence à l’écriture du créancier ni à l’absence de signature ou de date. Le champ d’application du texte et son contenu ne sont pas modifiés. Il ne pourra pas s’appliquer aux écrits électroniques (art. 1316-1). Deux cas sont distingués. Dans le premier, le créancier mentionne un paiement ou une autre cause de libération du débiteur sur un titre original dont il demeure en possession. Le texte considère que cette mention vaut présomption simple de libération (al. 1er). Dans le second, le créancier mentionne un paiement ou une cause de libération soit sur le double d’un titre, soit sur une quittance, mais à condition que le double du titre soit en la possession du débiteur. Le texte est imprécis, voire erroné. D’abord, il ne mentionne pas la quittance demeurée en la possession du débiteur mais seulement le double du titre. Ce qui vaut pour le double, vaut de la même manière pour la quittance. Ensuite, il sous-entend que le double du titre et la quittance valent présomption simple de libération. C’est contestable. Ces deux écrits comportent une mention écrite par le créancier qui rend vraisemblable la libération du débiteur. Ils constituent donc un commencement de preuve par écrit (art. 1362, al. 1er), voire un écrit sous signature privée le cas échéant (art. 1372).
Sous-section 5. Les copies
Art. 1379. Le texte modifie très substantiellement les règles qui s’appliquent à la copie. Il fallait déjà distinguer en fonction de la nature de l’acte. S’agissant de l’acte sous seing privé, l’article 1348, alinéa 2e ancien (réd. L. n° 80-525 du 12 juill. 1980) permettait la preuve par tout moyen lorsqu’une partie présentait une copie fidèle et durable. La règle avait pour but de donner une assise légale à la pratique des professionnels consistant dans l’archivage sous forme de microfilms des actes originaux avant leur destruction. S’agissant des actes authentiques, le Code civil prévoyait des dispositions complexes et d’une utilité douteuse (art. 1334 et 1335 anc.) supplantées en grande partie par des dispositions spéciales plus récentes (art. 32 à 37, D. n° 71-941 du 26 nov. 1971 ; art. 16 à 18, D. n° 91-152 du 7 févr. 1991). Il ne reste plus grand-chose du dispositif ancien.
Le texte pose une règle générale qu’il applique à l’acte authentique et à l’acte sous signature privée (art. 1335 1° anc.). La copie fiable produit les mêmes effets probatoires que l’original (al. 1er, 1re phrase). La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge (al. 1er, 2e phrase). On notera que le texte ne pose pas l’exigence propre à la copie de fidélité à l’original et la durabilité du support et qu’il remplace cette double exigence par un critère unique et subjectif, à savoir la fiabilité. Cela dit, la fiabilité dépendra certainement de la fidélité et de la durabilité ou de l’intégrité du support de la copie. Dans le détail, le texte distingue en fonction de la nature de l’écrit. La copie de l’acte authentique est réputée fiable (al. 1er, 3e phrase). Le texte pose une présomption irréfragable de fiabilité. Elle sera fiable si les conditions de reproduction posées par les textes applicables sont respectées (art. 32 à 37, D. n° 71-941 du 26 nov. 1971 ; art. 16 à 18, D. n° 91-152 du 7 févr. 1991). La copie de l’acte sous signature privée est présumée fiable si les conditions posées au texte sont réunies. Il s’agit d’une présomption simple supportant la preuve contraire. Il faut qu’il y ait une reproduction de l’original à l’identique et que l’intégrité de la copie soit garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions posées par décret. On peut supposer que le futur décret prévoira la reproduction sur support papier ou électronique de l’original, quel que soit son support d’origine.
Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours en être exigée (al. 3e). Il appartiendra à celui alléguant la disparition de l’original de la prouver (art. 1353, al. 2e, 1360)
Sous-section 6. Les actes récognitifs
Art. 1380. Le texte réduit les dispositions de l’article 1337 ancien relatives à l’acte récognitif. Ce dernier est la reproduction dans un acte instrumentaire nouveau de la substance d’un negocium contenue dans un acte instrumentaire initial. L’acte récognitif est une reproduction de l’acte non pas mécanique par un procédé moderne mais par nouvelle écriture. Il était dressé dans le but de procurer aux parties un nouveau moyen de preuve pour remplacer le titre perdu ou en prévision de sa perte. La facilité avec laquelle un acte peut être copié rend les dispositions de cet article sans grand intérêt. Le texte prévoit que la confection de l’acte récognitif ne dispense pas de la présentation du titre original sauf si sa teneur y est spécialement relatée (al. 1er). La règle est contestable parce qu’elle ne s’accorde nullement avec celle selon laquelle la copie a la même force probante que l’original (art. 1379, al. 1er, 1re phrase). Elle réduit à néant l’intérêt probatoire de l’acte instrumentaire récognitif. Au final, on ne voit pas vraiment ce qui a pu justifier le maintien de la règle. Ce qu’il y a de différent par rapport à l’original n’a pas d’effet (al. 2e). La règle ne peut s’appliquer qu’en l’absence de volonté contraire des parties de modifier le negocium initial (art. 1193).
Section 2. La preuve par témoins
Art. 1381. Les effets probatoires des déclarations faites par un tiers dans les conditions du Code de procédure civile sont appréciés par les juges du fond (CPC, art. 199). Précisément, ils apprécient, selon leur conviction, le degré de crédibilité des témoignages qui leur sont soumis11. Il aurait été utile de définir le témoignage et d’énoncer ses conditions de validité (CPP, art. 202, 205, 211). Il aurait été également souhaitable de réglementer les divers témoignages et notamment l’acte de notoriété (art. 71, 310-3, 730-1).
Section 3. La preuve par présomption judiciaire
Art. 1382. Le texte reprend, moyennant quelques modifications formelles, les dispositions de l’article 1353 ancien. Ces présomptions sont recevables seulement lorsque la preuve peut être faite par tout moyen (art. 1358). Il faut ajouter à cette hypothèse celle dans laquelle le demandeur justifie d’un commencement de preuve par écrit. Il peut alors le compléter par des présomptions (art. 1361, 1362). Il y a lieu de considérer que les présomptions légales et judicaires relèvent d’une même catégorie (art. 1354, al. 1er). Les premières sont celles que la loi tire d’un fait connu à un fait inconnu. Les secondes sont celles que le juge tire d’un fait connu à un fait inconnu (art. 1349 anc.). Elles sont laissées à son appréciation. Il ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes. La jurisprudence est plus nuancée. Selon elle, les juges du fait peuvent former leur conviction en se fondant sur un fait unique s’il paraît de nature à établir une preuve suffisante12. En revanche, ils méconnaissent les conditions légales de l’application des présomptions judiciaires lorsqu’ils se fondent sur un fait unique insusceptible à lui seul d’établir une preuve suffisante13.
Section 4. L’aveu
Art. 1383. Le texte définit l’aveu d’une façon classique (al. 1er)14. Il ne précise pas sa nature juridique. L’aveu est un acte juridique unilatéral déclaratif15. Il peut être extrajudiciaire ou judiciaire (al. 2e). Les deux textes suivants déterminent le régime de l’aveu en fonction de son caractère extrajudiciaire ou judiciaire. La distinction est réelle mais largement exagérée. Le juge peut considérer qu’un aveu extrajudiciaire est pleinement convaincant et qu’il fait preuve contre celui qui en est à l’origine16. La nature de l’aveu ne diffère pas selon qu’il est extrajudiciaire ou judiciaire. Il relève du régime de tout acte juridique d’une façon générale et de tout acte juridique unilatéral en particulier. Ces règles forment le droit commun de l’aveu extrajudiciaire ou judiciaire. Il obéit aux conditions de validité des actes (art. 1100-1, al. 2e, 1128). L’auteur de l’aveu doit être capable et avoir le pouvoir d’avouer (C. assur., art. L. 124-2, al. 1er). Il doit avoir l’intention de reconnaître un fait ou un acte et la parfaite conscience que l’aveu produira des conséquences contre lui17. L’aveu ne doit pas être la conséquence d’un vice de la volonté de son auteur. Il est nul en cas d’erreur de fait ou de droit (art. 1132)18, de dol (art. 1137) ou de crainte (art. 1140). L’objet de l’aveu est déterminé restrictivement par le texte. Une personne peut reconnaître un acte (art. 1100-1) ou un fait (art. 1100-2). L’aveu est consensuel (art. 1100-1, al. 2e, 1102, al. 1er, 1172 ; CPC, art. 198). Il peut être exprès ou tacite, écrit ou verbal.
Les effets de l’aveu extrajudiciaire ou judiciaire sont les mêmes. Il produit des conséquences juridiques contre son auteur qui s’imposent à lui (art. 1103, 1363). L’aveu étant déclaratif, elles dépendent directement de la nature du fait ou de l’acte avoué. L’aveu doit porter sur le fait ou l’acte et non sur les conséquences juridiques à en tirer qui le sont souverainement par le juge du fait. Toute personne pourra invoquer à son bénéfice les effets de l’aveu (art. 1100-1, al. 2e, 1200, al. 2e). Précisément, l’aveu rend inutile la preuve de ce qui est reconnu. Le fait ou l’acte n’est plus contesté et n’a donc plus à faire l’objet de la preuve. Il a donc pour conséquence d’alléger la charge de la preuve au bénéfice du demandeur.
Les conditions de recevabilité de l’aveu ne sont pas précisées. L’aveu est toujours recevable lorsqu’il est judiciaire (art. 1361). Dans le détail, il faudrait distinguer entre l’aveu écrit par conclusions et l’aveu oral en cas de comparution personnelle. L’aveu écrit est toujours recevable. L’aveu oral n’est pas autonome et dépend des conditions de la comparution personnelle (CPC, art. 184). Les conditions de recevabilité de l’aveu extrajudiciaire dépendent de sa forme écrite ou verbale. Si l’aveu résulte d’un écrit instrumentaire, il sera toujours recevable. Si l’aveu est oral, sa preuve pourra être rapportée par témoignages qui seront recevables dans les conditions du droit commun (art. 1383-1, al. 1er).
Art. 1383-1. Le texte est ambigu dans sa formulation (« n’est reçu »). Il semble traiter du negocium alors qu’il est relatif à l’acte instrumentaire (art. 1355 anc.). Le negocium n’est soumis à aucune condition de forme (v. art. 1383). Sa preuve ne déroge à aucune règle. En principe, elle peut être faite par tout moyen (art. 1358)19. Par exception, une preuve littérale est requise lorsque l’aveu porte sur un acte juridique dont la valeur des effets est supérieure à celle fixée par décret (art. 1359, al. 1er). Le texte ne s’applique pas à l’aveu écrit portant sur un acte soumis à l’exigence d’une preuve écrite20. Il s’applique seulement à l’aveu oral portant sur un tel acte. Un tel aveu peut être prouvé par témoignages à condition qu’ils soient recevables selon le droit commun de la preuve. Ils ne le sont en principe que lorsque la preuve est libre (art. 1358). Lorsque la preuve doit être faite par écrit (art. 1659, al. 1er), celle de l’aveu oral pourra résulter de témoignages, s’il existe un commencement de preuve par écrit de son existence (art. 1362). Le texte se prononce sur la valeur de cet aveu (al. 2e). Elle est laissée à l’appréciation du juge. La règle est incontestable mais d’une utilité toute relative puisque toute preuve est laissée à l’appréciation du juge (CPC, art. 198).
Art. 1383-2. Le texte définit l’aveu judiciaire. Il est la déclaration faite en justice par la partie (al. 1er). Précisément, il est celui fait par une partie à une autre partie à l’instance en vue de faire la preuve de faits ou d’actes litigieux. L’aveu fait au cours d’une autre instance, même opposant les mêmes parties, n’est pas judiciaire21. Cet aveu peut être fait par conclusions ou oralement en cas de comparution personnelle. Le texte prévoit que l’aveu peut être fait par le représentant spécialement mandaté de la partie. C’est imprécis. Il faudrait distinguer le mandat ad agendum et ad litem. Dans le premier cas, le mandataire a le pouvoir d’avouer, même sans mandat spécial, et d’engager son mandant par cet aveu si, ce faisant, il n’excède pas les limites de son pouvoir et que l’aveu porte sur ces faits qui lui sont personnels (CPC, art. 197)22. Dans le second, l’avocat est réputé avoir reçu pouvoir spécial de faire un aveu à l’égard du juge et de la partie adverse (CPC, art. 417)23.
L’aveu fait foi contre celui qui l’a fait (al. 2e). La règle est incontestable mais concerne sur le principe tout aveu et pas seulement l’aveu judiciaire (v. art. 1383)24. Elle suppose que le negocium soit valable, donc que l’aveu soit libre, sincère et ne résulte pas d’une erreur (art. 1100-1, al. 2e, 1130).
L’aveu est indivisible (al. 3e). L’opportunité de maintenir cette règle était discutable pour plusieurs raisons. D’abord, la règle ne concerne pas que l’aveu judiciaire. Elle a été transposée à raison par la jurisprudence à l’aveu extrajudiciaire25. Ensuite, la règle est évidente et signifie que toute la volonté de l’avouant doit être prise en compte26 et que toutes les conséquences doivent être tirées du fait ou de l’acte avoué27. Enfin, la règle connaît de nombreuses exceptions qui révèlent que l’aveu n’est pas absolument mais relativement indivisible. On ne citera ici que deux exceptions considérées comme significatives. 1° Parmi toutes les déclarations de l’avouant, le juge doit admettre ce qui est vraisemblable et rejeter ce qui ne l’est pas (art. 1100-1, al. 2e, 1130)28. C’est clairement la validité de l’aveu qui est en cause ici : l’aveu mensonger est nul (art. 1137). 2° Parmi toutes les déclarations de l’avouant, le juge doit admettre ce qui fait preuve contre lui et rejeter ce qui serait une preuve en sa faveur (art. 1363)29. Par où l’on voit finalement que l’indivisibilité est une règle floue qui n’a aucune signification propre. Le mieux aurait été d’en consacrer les principales applications d’une façon détaillée, plutôt que de s’en remettre à une règle sans contenu propre.
L’aveu est irrévocable, sauf erreur de fait (al. 4e). Le texte confond la validité de l’aveu et son irrévocabilité, conséquence de sa force obligatoire. L’aveu relève des conditions de validité de tout acte juridique (art. 1100-1, al. 2e, 1128). Il est nul en cas d’erreur qu’elle soit de droit ou de fait (art. 1132)30. S’il est valable, il a force obligatoire (art. 1103). À ce titre, il est irrévocable, comme tout acte juridique.
Section 5. Le serment
Art. 1384. Le texte distingue entre le serment décisoire et supplétoire (art. 1357 anc.). Ces deux serments judiciaires sont réglementés par le Code de procédure civile (art. 317 à 322). En raison de leur nature procédurale, leur réglementation dans le Code civil ne s’imposait nullement (art. 1357). Le texte ne définit pas le serment judiciaire. On ne sait donc si la garantie du serment réside dans l’appel à la divinité ou dans la conscience de celui à qui le serment est déféré. Le serment décisoire et le serment supplétoire ont la même nature mais leurs conséquences juridiques sont conçues différemment.
Sous-section 1. Le serment décisoire
Art. 1385. Le texte porte sur le domaine du serment décisoire (art. 1358, 1360 anc.). Avant de se prononcer sur cette question, il fallait déterminer sa nature juridique. Ce serment est en général analysé comme une transaction conditionnelle : le plaideur qui défère le serment à son adversaire propose de renoncer à sa prétention si celui-ci affirme l’exactitude de la sienne sous la foi du serment31. Cette qualification est contestable pour deux raisons. D’abord, le serment envisagé dans sa globalité n’est pas une convention mais un ensemble d’actes unilatéraux. Celui qui le défère l’impose à son adversaire sans qu’il ne puisse échapper à l’option entre le prêter, refuser de le prêter ou le référer. Ensuite, les parties ne sont pas à l’origine de concessions réciproques. Il y a à la fin un gagnant et un perdant. Il faut se tourner vers une autre analyse. Le serment est constitué d’un ensemble d’actes unilatéraux qui interagissent d’une manière complexe. Chaque plaideur a le pouvoir de situer la résolution du litige hors du droit. En déférant le serment à son adversaire, le plaideur le contraint à quitter le droit pour entrer dans le domaine religieux ou de la conscience en vue de résoudre le litige. Il en est exactement de même lorsque le plaideur à qui le serment est déféré le réfère. Le plaideur à qui le serment est déféré ou référé est lui-même investi du pouvoir de mettre fin au litige par sa volonté unilatérale. Le plaideur qui défère ou réfère le serment se place en situation de sujétion face à son adversaire. Il se soumet à la décision unilatérale de celui qui prêtera ou refusera de prêter serment. Au sein de tous ces actes, on peut distinguer ceux qui ne sont pas décisoires (acte par lequel le serment est déféré et référé) et ceux qui sont décisoires (prêter ou refuser de prêter serment).
Le serment peut être déféré sur toute contestation. Comme tout acte juridique, le serment doit être conforme aux règles d’ordre public. Il faudrait donc considérer qu’il ne peut porter que sur les prérogatives dont les plaideurs ont la libre disposition (art. 1100-1, al. 2e, 1102, al. 2e, 1356). Le serment ne peut être relatif à un acte illicite (art. 1100-1, al. 2e, 1162)32. D’un point de vue procédural, le serment peut être déféré en tout état de cause, en première instance ou en appel, y compris lorsque d’autres moyens auraient été invoqués. Le texte ne se prononce pas sur les conditions de recevabilité du serment. Il n’y en a pas (art. 1361 ; art. 1360 anc.). Le serment décisoire peut être déféré en l’absence de toute preuve. On pourrait croire qu’il est irrecevable pour prouver contre l’écrit (art. 1359, al. 2e). Si l’on considère que le serment n’est pas une preuve mais un mode de résolution des litiges, le texte n’a pas vocation à s’appliquer. Le serment ne prouve pas outre ou contre l’écrit mais permet de trancher le litige.
Art. 1385-1. Le serment ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle il est déféré (al. 1er ; art. 1359, 1362 anc.). Le serment peut être référé par cette dernière, sauf si le fait lui est purement personnel (al. 2e). Le texte est imprécis. La règle tient à la nature du serment. Le serment ne peut porter que sur des faits dont celui à qui il est déféré a une connaissance personnelle. Elle vaut donc pour tout serment. Le serment peut porter sur un fait (art. 1100-2) ou un acte (art. 1100-1).
Art. 1385-1. Le texte décrit le mécanisme du serment en fonction des hypothèses. Il y en a deux principales. 1° Le serment est déféré par une partie à une autre. Cette dernière a le choix entre le prêter ou le refuser. Dans le premier cas, sa prétention doit être considérée comme bien-fondée ; dans le second, elle succombe dans celle-ci. 2° La partie à qui le serment est déféré peut le référer. Ce faisant, elle retourne la situation et impose à la partie qui avait initialement demandé qu’elle prête serment de le faire. Il y a alors deux hypothèses. Dans la première, elle prête serment et sa prétention est considérée comme bien fondée. Dans la seconde, elle refuse de prêter serment et elle succombe dans sa prétention. Il faut considérer que chaque décision prise par l’un des plaideurs (déférer le serment, le prêter, refuser de le prêter et le référer) est un acte juridique unilatéral soumis au régime des actes unilatéraux (art. 1100-1, al. 2e). Ces actes obéissent mutatis mutandis aux conditions de fond (art. 1128) et de forme (art. 1102, al. 1er, 1172, al. 1er) de droit commun.
Art. 1385-2. La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l’autre a déclaré qu’elle ferait le serment (al. 1er). Bien que classique (art. 1364 anc.), la règle consacrée par le texte est assez inexplicable. Le serment décisoire est demandé au juge par l’une des parties. Il l’ordonne s’il considère qu’il est recevable et utile (CPC, art. 317, 319). L’autre partie n’est pas en situation d’accepter le serment. Elle doit le prêter, refuser de le prêter ou le référer. La jurisprudence considère d’ailleurs que la seule acceptation de prêter serment ne forme pas un contrat judiciaire et n’empêche pas l’appel du jugement ordonnant le serment (CPC, art. 320)33.
Une fois le serment prêté, l’autre partie ne peut plus prouver sa fausseté (al. 2e ; art. 1363 anc.). La règle découle de la nature du serment décisoire. Il a pour fonction de mettre fin au litige en le tranchant définitivement. Le juge doit tenir pour vrai les faits faisant l’objet du serment prêté. L’appel est irrecevable contre la décision entérinant la prétention du plaideur ayant prêté serment. La victime d’un faux serment ne peut se constituer partie civile devant les juridictions répressives. Mais si le ministère public poursuit et qu’une juridiction pénale constate la fausseté du serment, le recours en révision sera recevable (CPC, art. 595, 4°).
Art. 1385-4. Le texte est relatif au domaine subjectif des effets du serment (art. 1365 anc.). Le serment ne fait preuve qu’au profit de celui qui l’a déféré, de ses héritiers ou ayants cause ou contre eux (al. 1er). Le texte est très imprécis. Le serment n’est pas une preuve. C’est un mécanisme mettant fin au litige. Une fois le litige terminé, ce sont moins les effets du serment que les effets du jugement qui importent. Ce jugement produit les effets de tout jugement, à l’exception des voies de recours qui sont en principe fermées.
La suite du texte donne des solutions en cas d’obligation solidaire active (al. 2e) et passive (al. 4e, 6e) et encore de cautionnement (al. 3e, 5e, 6e). Les règles consacrées sont d’une utilité douteuse du fait de leur totale imprécision. Il faudrait distinguer deux aspects qui ne le sont nullement. La première question à se poser est celle du pouvoir de déférer ou de référer le serment. Ce pouvoir dépend de son objet. Si le serment porte sur l’existence de la source et finalement sur l’existence de la dette commune aux cocréanciers ou codébiteurs, qu’ils soient divis, solidaires ou indivisibles, un seul cocréancier ou codébiteur ne pourrait déférer ou référer le serment. Le serment ayant été déféré ou référé régulièrement, la même solution prévaut pour la prestation de serment ou le refus de la prestation. Tous les cocréanciers ou codébiteurs doivent prêter ou refuser de prêter serment. Lorsque plusieurs doivent agir ensemble, il faudrait déterminer la solution à l’hypothèse dans laquelle tous ne sont pas d’accord pour déférer, prêter, refuser de prêter ou référer le serment. Si le serment porte sur un moyen de défense propre à un cocréancier ou à un codébiteur, il pourra seul déférer le serment, prêter ou refuser de prêter serment ou référer le serment. La seconde question est relative aux effets du serment. Ils ne se produisent que si le serment a été déféré, prêté, refusé ou référé régulièrement et notamment dans le respect des règles précitées relatives aux pouvoirs des diverses parties. Si tel est le cas, les effets dépendront de la nature de l’acte décisoire (serment prêté ou refusé) et de l’objet du serment.
Sous-section 2. Le serment déféré d’office
Art. 1386. Le texte ne définit pas le serment supplétoire. Ce serment est déféré d’office par le juge à l’une des parties (al. 1er). Il ne peut être référé par la partie à laquelle il est déféré à l’autre partie (al. 2e). La valeur probante du serment est laissée à l’appréciation du juge (al. 3e). Ces trois solutions tiennent à l’origine judiciaire de la délation du serment.
Art. 1386-1. Le serment supplétoire doit être utile. Il ne l’est évidemment pas si les faits ou actes invoqués au soutien de la prétention sont pleinement justifiés. Le serment supplétoire ne peut pas être déféré d’office par le juge en l’absence totale de preuve. La jurisprudence subordonnait ce serment à l’existence d’un commencement de preuve et notamment à des présomptions ou témoignages34. Un commencement de preuve par écrit n’était pas requis. Pour l’avenir, on peut hésiter. L’article 1361 précise qu’il ne peut être suppléé à l’écrit qu’en cas de serment décisoire. Dans le domaine de la preuve littérale (art. 1359, al. 1er, 1362), la recevabilité du serment supplétoire serait subordonnée à un commencement de preuve par écrit (art. 1362). Néanmoins, le texte n’exige aucun commencement de preuve par écrit (« totalement dénuée de preuves ») et invite plutôt à reconduire les solutions jurisprudentielles anciennes.
Notes de bas de pages
-
1.
Cass. soc., 21 juill. 1951, n° 983 : Bull. civ. III, n° 593 – Cass. 1re civ., 6 déc. 1954, n° 39.587 : Bull. civ. I, n° 348.
-
2.
Cass. com., 15 févr. 1965, n° 63-10151 : Bull. civ. III, n° 123 – Cass. com., 16 juill. 1965, n° 64-11092 : Bull. civ. III, n° 442.
-
3.
Darangon E., « Étude sur le statut juridique de l’information », D. 1998, Chron., p. 65. Comp. : Catala P., « Ébauche d’une théorie juridique de l’information », in Le droit à l’épreuve du numérique. Jus ex Machina, 1998, PUF, Droit, éthique, société, n° 7, p. 229.
-
4.
Cornu G., Linguistique juridique, 3e éd., 2005, Montchrestien, Domat-Droit privé, n° 8.
-
5.
V. commentaire général des articles 1193 à 1198 in LPA 30 mars 2016, p. 7.
-
6.
Cass. soc., 7 déc. 1950, n° 39.578 : Bull. civ. III, n° 919 – Cass. 1re civ., 6 févr. 1967, n° 64-13244 : Bull. civ. I, n° 44. Comp. : Cass. 3e civ., 26 juin 1973, n° 72-11562 : Bull. civ. III, n° 444.
-
7.
La formule du texte peut être attribuée à Aubry C. et Rau C. (Droit civil français, par Esmein P., t. XII, 1958, Lib. Techniques, p. 141, § 755) : « Tout acte authentique fait foi, jusqu’à inscription de faux, de l’existence matérielle des faits que l’officier public y a énoncés, comme les ayant accomplis lui-même, ou comme s’étant passés en sa présence, dans l’exercice de ses fonctions ».
-
8.
de Page H., op. cit., t. III, n° 747.
-
9.
Cass. 1re civ., 7 juin 1963, n° 61-13744 : Bull. civ. I, n° 293.
-
10.
Issus de L. n° 2011-331, 28 mars 2011, art. 3.
-
11.
Cass. 2e civ., 16 mars 1956, n° 1.779 : Bull. civ. II, n° 190 – Cass. 2e civ., 26 avr. 1963, n° 62-11513 : Bull. civ. II, n° 323.
-
12.
Cass. 2e civ., 24 janv. 1964, n° 62-11313 : Bull. civ. II, n° 90.
-
13.
Cass. com., 9 mai 1951, n° 3.236 : Bull. civ. III, n° 163.
-
14.
Cass. soc., 4 déc. 1958, n° 57-12428 : Bull. civ. IV, n° 1281. Aubry C. et Rau C. par Esmein P., op. cit., t. XII, p. 191, § 751.
-
15.
Martin de la Moutte J., L’acte juridique unilatéral, Raynaud P. (préf.), thèse, 1951, Recueil-Sirey, p. 263, n° 24.
-
16.
Cass. 3e civ., 29 mai 1973, n° 72-11625 : Bull. civ. III, n° 371.
-
17.
Cass. soc., 7 mai 1951, n° 494 : Bull. civ. III, n° 358 – Cass. 2e civ., 4 déc. 1953, n° 8.094 : Bull. civ. II, n° 338 – Cass. 2e civ., 4 janv. 1958, n° 1.352 : Bull. civ. II, n° 10.
-
18.
En ce sens : Cass. 2e civ., 24 févr. 1961, n° 59-11774 : Bull. civ. II, n° 158.
-
19.
En ce sens : Cass. 1re civ., 30 nov. 1955, n° 845 : Bull. civ. I, n° 420.
-
20.
Cass. 1re civ., 11 déc. 1961, n° 60-10999 : Bull. civ. I, n° 592.
-
21.
Cass. 1re civ., 5 juill. 1961, n° 60-10883 : Bull. civ. I, n° 374.
-
22.
Cass. soc., 12 déc. 1962, n° 61-11197 : Bull. civ. IV, n° 892.
-
23.
Cass. 1re civ., 3 févr. 1993, n° 91-12714 : Bull. civ. I, n° 57, p. 38.
-
24.
Cass. 3e civ., 29 mai 1973, n° 72-11625, préc.
-
25.
Cass. 1re civ., 9 mars 1954, n° 5.900 : Bull. civ. I, n° 88 – Cass. 1re civ., 31 mai 1958, n° 602 : Bull. civ. I, n° 275 – Cass. 2e civ., 14 déc. 1961, n° 59-12896 : Bull. civ. II, n° 867.
-
26.
Cass. 1re civ., 9 mars 1954, n° 5.900, préc.
-
27.
Cass. com., 5 févr. 1958, n° 1.179 : Bull. civ. III, n° 60.
-
28.
Cass. civ., 15 mars 1950, n° 27.308 : Bull. civ. I, n° 75 – Cass. 1re civ., 13 mars 1956, n° 752 : Bull. civ. I, n° 128.
-
29.
Cass. soc., 21 juill. 1951, n° 983 : Bull. civ. III, n° 593 – Cass. 1re civ., 6 déc. 1954, n° 39.587 : Bull. civ. I, n° 348 – Cass. 2e civ., 21 déc. 1954, n° 556 : Bull. civ. II, n° 435 – Cass. 1re civ., 30 mai 1956, n° 898 : Bull. civ. I, n° 212 – Cass. 1re civ., 8 juill. 1957, n° 2.200 : Bull. civ. I, n° 308 – Cass. 1re civ., 4 nov. 1959, n° 1.395 Civ. 56 : Bull. civ. I, n° 459 – Cass. soc., 28 févr. 1962, n° 58-40735 : Bull. civ. IV, n° 230.
-
30.
En ce sens : Cass. 2e civ., 24 févr. 1961, n° 59-11774, préc.
-
31.
Cass. civ., 24 ou 28 févr. 1938 : DC 1942, p. 99, 1re esp., note Holleaux G.
-
32.
Cass. soc., 16 mars 1959, n° 7.663 SS : Bull. civ. IV, n° 278.
-
33.
Cass. 2e civ., 3 avr. 1979, n° 78-11173 : Bull. civ. II, n° 118.
-
34.
Cass. soc., 7 juin 1963, n° 62-20253 : Bull. civ. IV, n° 480.