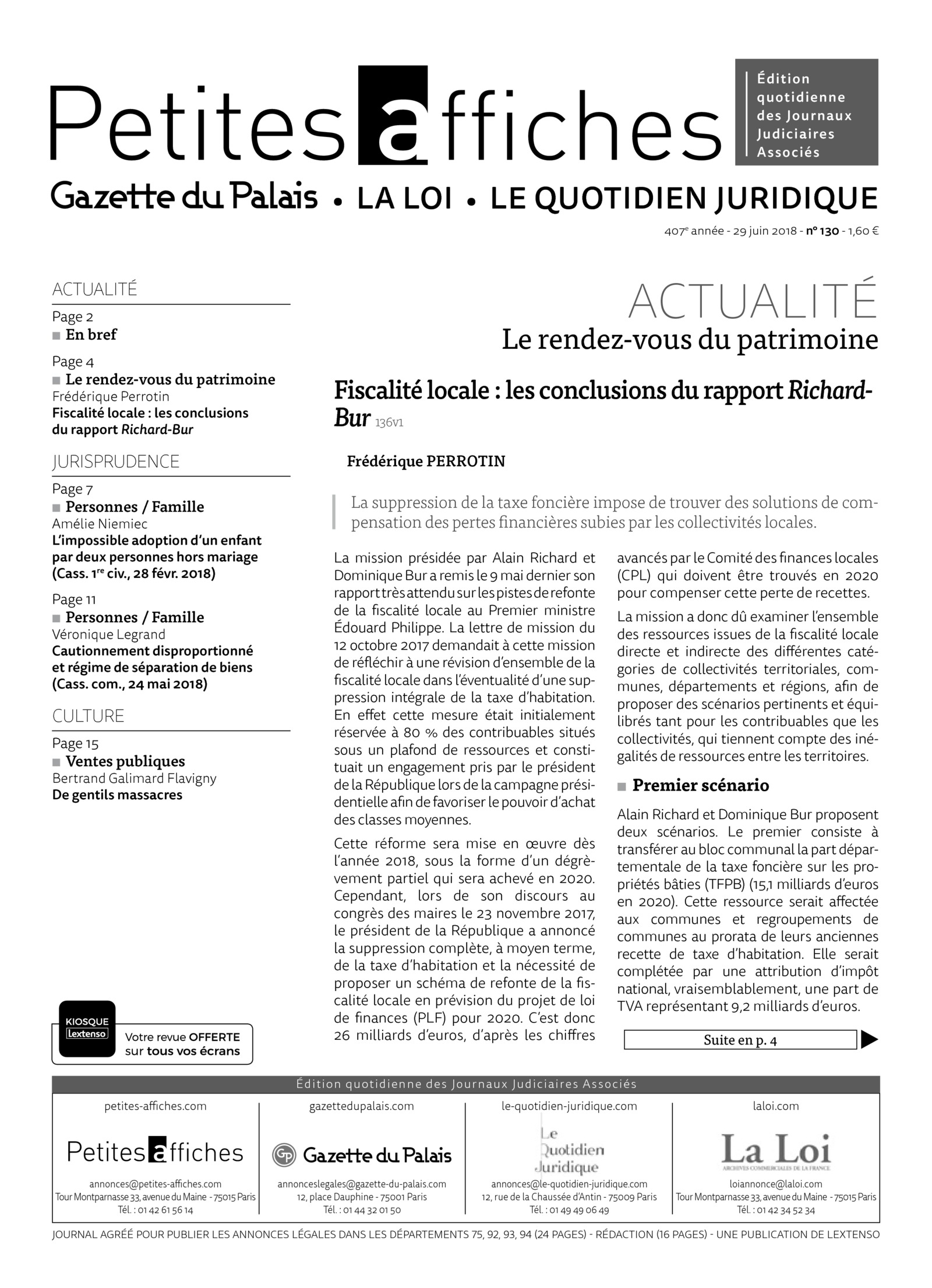Cautionnement disproportionné et régime de séparation de biens
Conformément à l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du Code de la consommation, la caution qui a souscrit un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment où elle s’est engagée, est déchargée à moins qu’au moment où elle est appelée en garantie son patrimoine ne lui permette de faire face à ses obligations. L’appréciation de la disproportion est source d’un contentieux abondant et l’arrêt du 24 mai 2018 permet de rappeler l’incidence du régime de séparation de biens sur l’appréciation de la disproportion du cautionnement d’un époux.
Cass. com., 24 mai 2018, no 16-23036, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00457
Il y va de l’intérêt du créancier et de la caution que l’engagement de cette dernière soit proportionné à ses facultés contributives. La Cour de cassation a ainsi affirmé, dans un arrêt de 19971 très commenté, que le fait pour une banque de réclamer un cautionnement à hauteur d’une somme manifestement disproportionnée au patrimoine et aux revenus de la caution est source de responsabilité. Cette jurisprudence a inspiré le législateur qui a imposé une exigence légale de proportionnalité du cautionnement dans le Code de la consommation.
Ainsi l’article L. 341-4, devenu L. 332-1, du Code de la consommation2 issu de la loi du 1er août 20033 prévoit qu’un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sauf à ce qu’au moment où elle est actionnée, le patrimoine de cette caution lui permette de faire face à son obligation. On rappellera qu’il revient à la caution de prouver le caractère disproportionné de son engagement4 mais, le texte ne fixe pas de critère qui pourrait guider l’appréciation du juge5, et il s’avère que cette appréciation n’est pas toujours aisée, comme en témoigne la présente affaire.
En effet, la société Le Xenios avait obtenu auprès d’une banque un crédit garanti par le cautionnement de la société Heineken, laquelle avait obtenu la garantie d’un associé de la société Le Xenios. Cette dernière étant défaillante, la caution principale a payé puis, a agi contre l’associé. Or, en présence de cofidéjusseurs, si l’un est déchargé à raison de la disproportion de son engagement, ni le créancier, ni la caution solvens, dans le cadre de ses recours après paiement, ne peuvent se retourner contre lui. En l’espèce, l’associé de la société Le Xenios arguait du caractère disproportionné de son obligation.
Il convient de préciser que celui-ci était marié sous le régime de séparation de biens. Il invoquait donc qu’il fallait uniquement prendre en compte ses revenus personnels et son propre patrimoine pour apprécier la disproportion, sans considération des revenus et biens personnels de son épouse. Or les juges du fond n’avaient pas raisonné de la sorte. Au contraire, ils avaient estimé que bien que la somme garantie représentait deux années et demi de revenus professionnels, le cautionnement n’était pas manifestement disproportionné car le conjoint de la caution percevait un revenu fixe et était propriétaire du logement familial de sorte qu’il pouvait contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante.
La Cour de cassation n’approuve pas ce raisonnement et censure la cour d’appel pour violation de la loi au visa de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, ensemble l’article 1536 du Code civil.
Effectivement, le régime de séparation de biens se caractérise par une indépendance patrimoniale des époux. Ce qui, au passif, se traduit par le fait que chaque époux « reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage », hors le cas des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 1536, alinéa 2, du Code civil. La Cour de cassation pose ainsi le principe d’une corrélation entre l’étendue du gage des créanciers et l’appréciation du caractère disproportionné du cautionnement (I), dont les conséquences pratiques devraient inciter les banques à davantage de vigilance (II).
I – Appréciation de la disproportion du cautionnement en fonction de l’étendue du gage du créancier
Il paraît logique de considérer que pour juger de la disproportion d’un cautionnement, il convient de se préoccuper des biens et revenus que le créancier pourra saisir si la caution ne parvient pas à honorer son obligation. Pourtant, cette solution ne s’imposait peut-être pas avec la force de l’évidence.
Certes, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion à propos du cautionnement solidaire de deux époux mariés sous le régime de séparation de biens d’affirmer que la proportionnalité du cautionnement du mari devait s’apprécier au regard de ses seuls biens et revenus6. On pourrait donc penser qu’elle considère que l’appréciation de la disproportion doit être faite en considération des biens saisissables par le créancier en cas de défaillance de la caution. Cela justifierait également que lorsqu’un époux commun en biens s’engage comme caution avec le consentement de son conjoint, la disproportion s’apprécie au regard des revenus et biens propres de la caution ainsi que des biens communs7 puisque dans une telle hypothèse les biens communs sont engagés conformément à l’article 1415 du Code civil.
Cependant, des juges du fond ont parfois considéré que si l’absence de consentement du conjoint de la caution mariée sous un régime de communauté prive la banque de son droit de gage sur les biens communs, cela n’influence pas le caractère éventuellement disproportionné du cautionnement que l’on apprécie par rapport au patrimoine commun car l’époux commun en biens profite des biens de communauté8.
Et, la Cour de cassation a suivi ce raisonnement dans un arrêt du 15 novembre 20179. Elle a approuvé les juges du fond d’avoir jugé que les biens communs devaient être pris en compte pour apprécier la disproportion du cautionnement de l’époux qui s’était engagé seul quand bien même les biens communs ne seraient pas saisissables par le créancier du fait de l’absence de consentement du conjoint. Cette solution a également été réitérée dans un arrêt du 6 juin 201810, dans lequel la Cour de cassation affirme que « la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du Code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que devaient être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs ».
Une telle solution pourrait se justifier car l’exigence de proportionnalité découle de l’idée que la caution ne doit pas se retrouver complètement démunie face à son engagement. Or ce n’est pas le cas pour la caution qui bénéficie dans un tel cas, des biens communs insaisissables par le créancier.
C’est peut-être le même cheminement qu’avaient fait les juges du fond dans l’affaire sous commentaire. Effectivement, la cour d’appel avait jugé que l’épouse de la caution était propriétaire d’un immeuble et disposait de revenus qui permettaient à la caution, du fait de la communauté de vie avec son conjoint, de ne pas être totalement démunie, même en s’acquittant de ses obligations.
Malgré tout, une telle analyse est surprenante. Dans un régime de communauté, l’époux est aussi propriétaire des biens communs, il en profite directement, tandis que le régime de séparation de biens est marqué par une indépendance financière de chacun des époux qui se traduit par l’existence de deux masses de biens séparées. Prendre en compte les biens et revenus de l’époux de la caution pour apprécier la disproportion de son engagement ne se justifie pas. D’un autre côté, les conjoints séparés de biens peuvent décider d’acquérir des biens en indivision. Mais dans ce cas, à suivre le raisonnement de la Cour de cassation, il faudrait juste tenir compte de la quote-part de droits indivis qui revient à l’époux caution et non pas l’ensemble du patrimoine indivis.
En définitive, la solution ainsi consacrée rattache l’évaluation de la disproportion à l’étendue de la masse des biens saisissables par le créancier. Au premier abord, elle paraît en retrait par rapport à la dernière jurisprudence de la Cour de cassation rendue à propos du cautionnement par un époux commun en biens sans le consentement de l’autre qui semblait au contraire détacher la disproportion du cautionnement et le gage des créanciers qui en sont bénéficiaires. Toutefois, la perspective est totalement différente dans un régime de séparation de biens. L’autonomie financière de chaque époux dicte en effet l’appréciation de la disproportion du cautionnement en rapport avec le gage des créanciers.
Quoi qu’il en soit, cela n’est pas satisfaisant et les conséquences d’une telle solution ne manqueront pas de susciter davantage de vigilance de la part des banques.
II – Solution aux conséquences insatisfaisantes
Il est évident qu’à l’avenir les banques se montreront prudentes lorsque la caution déclarera être mariée sous un régime de séparation de biens. En effet, afin de se prémunir d’un recours de la caution invoquant la disproportion de son engagement, il faudra solliciter une liste précise de ses biens personnels et, si celle-ci fait état d’un bien indivis, seule la quote-part des droits indivis de la caution devra être prise en compte. Du point de vue de la logique juridique, il semble d’ailleurs tout à fait conforme aux objectifs du législateur de comparer l’engagement de l’époux à son patrimoine personnel, ses revenus, et ses droits indivis car cela traduit ses véritables capacités contributives11.
Il n’en reste pas moins que la solution dégagée par la Cour de cassation pourrait se révéler néfaste pour le crédit des époux séparés de biens. Évidemment, il y a toujours un risque sous-jacent pour les banques. Il est clair que le couple pourrait organiser l’insolvabilité de l’un des conjoints au profit de l’autre, de telle sorte que celui qui s’engage en tant que caution se retrouve déchargé sur le fondement de la disproportion. Dès lors, les banques ne manqueront pas de préférer une autre garantie plus onéreuse que le cautionnement, ou bien, elles exigeront l’engagement solidaire des deux époux. Assurément, en présence de plusieurs cautions solidaires, la Cour de cassation a affirmé que le caractère disproportionné de leur engagement s’apprécie au regard de chacune d’entre elles et non pas en fonction de leurs biens et revenus cumulés12. Cela implique que le cautionnement pourra paraître disproportionné à l’égard d’un des époux et non à l’égard de l’autre. Ici encore, les banques devront se montrer vigilantes car en principe, lorsqu’un créancier sollicite la garantie de plusieurs cautions, c’est parce qu’il estime que les facultés financières de chacune d’elles sont insuffisantes.
Enfin, et indépendamment du régime matrimonial de la caution, un autre paramètre devra être pris en compte par les banques qui réclament le cautionnement d’un entrepreneur dans le cadre de son activité. En effet, si l’on s’en tient à l’analyse selon laquelle la disproportion s’apprécie au regard des biens saisissables de la caution, il ne faudrait pas oublier que la loi du 6 août 2015 a introduit le principe de l’insaisissabilité légale de la résidence principale de l’entrepreneur vis-à-vis des créanciers professionnels13. Dès lors, à moins que l’intéressé n’ait renoncé à l’insaisissabilité au profit du créancier bénéficiaire du cautionnement la valeur de l’immeuble ne sera pas prise en compte pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement, ce qui pourrait conduire à la décharge de la caution. Mais, à cet égard, on se demande si l’analyse doit être différente selon que l’entrepreneur est marié sous un régime de séparation de biens et que l’immeuble lui appartient en propre ou au contraire que l’entrepreneur est marié sous un régime de communauté et que l’immeuble est en communauté. Autant de questions qui nécessitent encore quelques éclaircissements.
Notes de bas de pages
-
1.
Cass. com., 17 juin 1997, n° 95-14105 : Bull. civ. IV, n° 188 ; D. 1998, p. 208, note Casey L. ; Defrénois 15 déc. 1997, n° 36703, p. 1417, note Aynès L. ; JCP E 1997, II 1007, note Legeais D. ; JCP G 1998, I 108, note Simler P. ; RTD civ. 1998, p. 157, note Crocq P. ; RTD com. 1997, p. 662, note Mestre J.
-
2.
C. consom., art. L. 341-4 anc., devenu C. consom., art. L. 332-1 ; ord. n° 2016-301, 14 mars 2016 : JO n° 0064, 16 mars 2016, texte n° 29.
-
3.
Loi Dutreil, L. n° 2003-721, 1er août 2003, pour l’initiative économique : JO n° 179, 5 août 2003, p. 13449.
-
4.
Cass. com., 22 janv. 2013, n° 11-25377 : Gaz. Pal. 21 mars 2013, n° 122z5, p. 18, obs. Albigès C. ; JCP G 2013, 585, note Simler P.
-
5.
Sur cette critique, v. Bouchard V., « Proportionnalité et saisissabilité des revenus professionnels du conjoint de la caution : consentir, c’est s’engager… », JCP N 2017, 1201.
-
6.
Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° 14-24800 : Gaz. Pal. 19 avr. 2016, n° 262q3, p. 55, note Peltzman P.
-
7.
Cass. com., 22 févr. 2017, n° 15-14915 : JCP E 2017, 1246, Mathey N.
-
8.
CA Toulouse, 8 oct. 2013, n° 12/00796 : JurisData n° 2013-022464 – CA Riom, 1er oct. 2014, n° 13/01495 : JurisData n° 2014-027011 – CA Grenoble, 18 sept. 2014, n° 12/05074 : JurisData n° 2014-022045.
-
9.
Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-10504 : D. 2018, p. 392, note Dumont-Lefrand M.-P. ; JCP G 2018, n° 13, note Simler P. ; RD bancaire et fin. 2018, comm. 6, obs. Legeais D. ; RTD civ. 2018, p. 199, Nicod M.
-
10.
Cass. com., 6 juin 2018, n° 16-26182.
-
11.
En ce sens, Bouchard V., « Proportionnalité et saisissabilité des revenus professionnels du conjoint de la caution : consentir, c’est s’engager… », préc., qui propose à propos du cautionnement du conjoint commun en biens, de prendre en considération ses propres, ses revenus et la moitié des biens communs.
-
12.
Cass. 1re civ., 22 oct. 1996, n° 94-15615 : Contrats, conc. consom. 1997, comm. 14, Raymond G. ; D. 1997, p. 515, note Wagcongue M. ; JCP G 1997, II 22826, note Piedelièvre S. V. égal. Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° 14-24800 : Gaz. Pal. 19 avr. 2016, n° 262q3, p. 55, note Peltzman P.
-
13.
C. com., art. L. 526-1 mod. par L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 206 : JO, 7 août 2015, p. 13537.