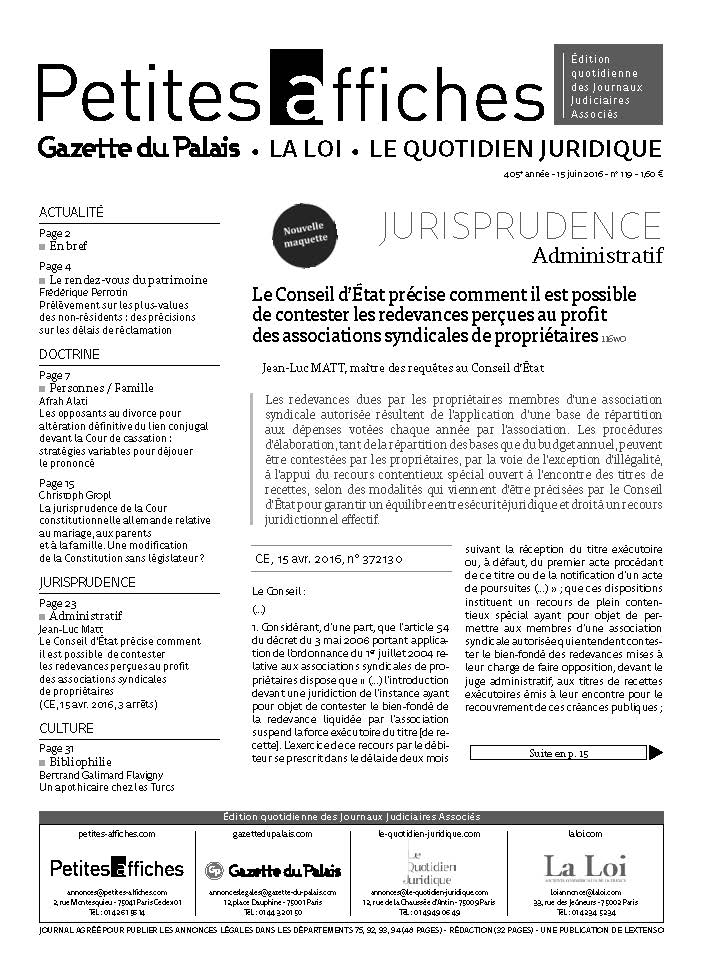Les opposants au divorce pour altération définitive du lien conjugal devant la Cour de cassation : stratégies variables pour déjouer le prononcé
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal constitue un progrès dans la législation du divorce par la volonté unilatérale d’un conjoint. Mais pour ceux qui s’y opposent, ce divorce est une répudiation inacceptable. À travers certains arrêts présentés devant la Cour de cassation, les opposants à ce divorce ont tenté de déjouer le prononcé. Leurs stratégies sont variées, tantôt en attaquant le principe même de ce type de divorce, tantôt en jouant sur ses conditions.
Consacrant un divorce pour cause objective, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, adopté par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, constitue un changement très important dans la loi française1. Ce type de divorce, prévu dans les articles 2372 et 2383 du Code civil, donne une marge très large et libérale à la volonté unilatérale d’un époux de décider la rupture du lien conjugal. En raison de son contenu et depuis sa consécration, ce divorce provoque des critiques de la part de la doctrine. Celle-ci le considère comme une répudiation4. Avec l’application pratique devant les tribunaux, l’hostilité au divorce pour altération définitive sort de son cadre doctrinal et entame une autre étape dans les couloirs de la justice. Tout dans ce divorce était ciblé par les critiques, de ses conditions d’application à sa légitimité même. Depuis 2009, quelques arrêts ont été présentés devant la Cour de cassation. Les stratégies des opposants à ce divorce sont variées : certains ont choisi d’attaquer le principe même de ce type de divorce, d’autres ont préféré jouer, dans quelques applications, sur les conditions en vue d’en déjouer le prononcé. C’est ainsi que les questions s’articulent autour de deux sujets : le principe de ce divorce (I) et ses conditions (II).
I – Des questions relatives au principe de divorce pour altération
Avec le pas franchi par le législateur de 2004, qui a permis de surmonter certains obstacles culturels à la volonté unilatérale dans la décision de mettre fin à la vie conjugale, la Cour de cassation a reçu, à plusieurs reprises, des questions concernant le principe de divorce pour altération définitive du lien conjugal et sa légitimité. Les arrêts du 6 juin 2012 (A) et l’arrêt du 15 avril 2015 (B), notamment expliquent comment le principe de ce divorce était ciblé en priorité.
A – Les arrêts du 6 juin 2012 : le divorce pour altération porte-t-il « atteinte au droit de mener une vie familiale normale, à l’égalité devant la loi et aux droits de la défense » ?
Transmises par la cour d’appel de Versailles, deux questions prioritaires de constitutionnalité concernant le divorce pour altération définitive du lien conjugal ont été adressées à la Cour de cassation. Les demandeurs dans ces arrêts ne reprochent pas la mauvaise application de ce divorce mais s’opposent à son adoption comme un type de divorce. Le reproche du premier demandeur considère que le divorce pour altération porte atteinte au droit de mener une vie familiale normale et à l’égalité devant la loi du fait que « l’application faite des articles 237 et 238 conduit à une quasi-automaticité de la dissolution du lien conjugal du seul fait de la constatation d’une séparation de deux ans, les conditions dans lesquelles la séparation est intervenue étant indifférente. Dès lors la séparation à l’initiative d’un seul des époux conduit à la dissolution du lien conjugal, puisque l’absence de communauté de vie se déduit de ladite séparation. Ce faisant la volonté d’un seul des époux suffit à faire prononcer le divorce et il est mis fin à la vie familiale »5. Pour le deuxième demandeur, les dispositions des articles 237 et 238 portent atteinte aux droits de la défense, tels qu’établis par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen car « la jurisprudence consacrée par la Cour de cassation (…), impose au juge du fond de tirer de la simple constatation de la séparation de deux ans la conséquence du prononcé du divorce, (…) cela concourt à priver le défendeur de tout moyen effectif de défense puisque la constatation d’un délai de séparation de deux ans, quelles que soient les circonstances dans lesquelles la séparation est intervenue, entraîne obligatoirement le prononcé du divorce et, de même, prive le juge de tout pouvoir réel d’appréciation, la clause d’exceptionnelle dureté ayant disparu »6.
Les hauts magistrats rejettent les arguments précédents et refusent de renvoyer les deux questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Ils motivent leur refus, en déclarant le 6 juin 2012, « que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ». Ensuite, « que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors (…) » : pour la première QPC, « d’abord, que le prononcé du divorce après constatation de l’altération définitive du lien conjugal ne contrevient pas au droit de mener une vie familiale normale, ensuite, qu’étant accordée à chacun des époux, cette possibilité de demander le divorce n’est pas contraire au principe d’égalité »7. Et pour la deuxième QPC, « (…) qu’il ne résulte ni des articles 237 et 238 du Code civil, ni de l’interprétation que la jurisprudence de la Cour de cassation donne de ces textes que ceux-ci institueraient, comme il est prétendu, une présomption quasiment irréfragable de cessation de vie commune tant matérielle qu’affective, privant le défendeur de tout moyen effectif de défense »8. En réalité, les arguments présentés par les opposants au divorce pour altération, décrivent bien le conjoint qui refuse le principe même du divorce hors de l’hypothèse d’une faute commise par l’autre conjoint. La véritable raison qui gêne ces opposants est la possibilité qu’une seule volonté unilatérale d’un conjoint puisse mettre fin au mariage. Leurs questions se sont concentrées sur trois aspects : la capacité de la volonté unilatérale d’un conjoint de rompre le mariage sans faute reprochée à l’autre, la non-efficacité de la défense de celui-ci dans ce type de divorce et l’absence d’un véritable rôle du juge de fond. Pour eux, ces trois aspects qui caractérisent ce type de divorce portent atteinte au droit de mener une vie familiale normale, à l’égalité devant la loi et aux droits de la défense. Aux yeux des opposants, le divorce pour altération définitive du lien conjugal consacre, alors, une répudiation inacceptable.
L’analyse approfondie de ce divorce peut affirmer l’émergence d’un véritable droit au divorce dans le divorce pour altération9. Certes, dans certains cas, notamment ceux résultant d’une séparation de fait, le juge reste possesseur d’une marge d’appréciation quant à la cessation de la communauté de vie et la durée de deux ans. Le conjoint refusant ce divorce peut jouer sur le contrôle de ces deux conditions en tentant de faire obstacle au prononcé du divorce, ce qui pourra empêcher la réalisation de la volonté unilatérale du demandeur en cas de défaut dans ces conditions. Cependant, dans d’autres cas, résultant d’une séparation organisée par la justice, notamment les cas issus d’une ordonnance de non-conciliation, apparaît un pur droit discrétionnaire au divorce. Tout est organisé : l’époux désireux de mettre fin au mariage dépose une requête en divorce sans indiquer les motifs et le fondement juridique du divorce10. Le magistrat conciliateur organise la résidence séparée11. L’époux désireux de divorcer patiente « (…) deux années [12] pour remplir la condition de délai exigée et déposer une assignation fondée, si tel est toujours son choix, sur l’altération définitive du lien conjugal »13. Ni l’autre conjoint, ni le juge ne peut s’opposer à cette volonté unilatérale et discrétionnaire du demandeur du divorce. La loi reconnait à la volonté unilatérale d’un époux le droit de décider seule la rupture du lien conjugal sans faute reprochée à l’autre conjoint. Ici, ce dernier n’a pas le droit de s’opposer à cette décision, et par conséquent, n’a aucun moyen d’empêcher le prononcé du divorce décidé par son conjoint14. Le demandeur, dans ce type de divorce, ne veut plus poursuivre sa vie avec l’autre conjoint et la loi lui permet d’imposer cette décision à l’autre en cessant la communauté de vie pendant deux ans lors de l’assignation en divorce. Le conjoint opposé à ce divorce n’a que le droit de demander un divorce pour faute s’il y en a une. Le divorce pour altération est devenu un droit du conjoint pour cause non soumise au pouvoir discrétionnaire du juge. Si le désir de divorce est présent chez l’un des conjoints, il n’y a pas de vie familiale normale puisque le conjoint demandeur du divorce a cessé cette vie depuis au moins deux ans. La vie familiale normale existe tant que l’harmonie et l’entente sont présentes dans le couple. En l’absence de celles-ci, il est impossible de parler d’une vie familiale normale. Les opposants au divorce pour altération souhaitent donc maintenir une vie familiale soit artificiellement, soit par la force. Quant au droit de défense dont ces opposants parlent, il est concevable dans un type de divorce dans lequel un époux reproche un fait au conjoint comme le cas du divorce pour faute. En revanche, dans le divorce pour altération, le demandeur ne reproche rien à son conjoint, mais ne souhaite simplement plus poursuivre sa vie avec lui, voire il paie deux ans de sa vie pour seulement engager ce divorce. Enfin, pour l’égalité devant la loi, les opposants au divorce ont employé ce moyen de fait : « la volonté d’un seul des époux suffit à faire prononcer le divorce et il est mis fin à la vie familiale ». Ils ont tenté d’inspirer les arguments employés par la Cour de cassation même dans un arrêt refusant la reconnaissance de la répudiation faite par le mari musulman en 2004. En fait, les hauts magistrats ont déjà utilisé des motivations très proches de celles employées par les adversaires du divorce pour altération. Ils ont reproché au jugement algérien le fait « qu’il en résulte que cette décision constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d’effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme et en privant l’autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d’aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l’article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme »15. À la lecture de ces motivations, il apparaît que le reproche adressé à la répudiation concerne deux points : l’inefficacité de l’opposition de la femme à la décision prise par le mari et l’inefficacité du rôle du juge privé de tout pouvoir discrétionnaire pour contrôler l’opportunité de la rupture. Ainsi, le reproche est concentré sur le fait qu’une seule volonté unilatérale a décidé et était suffisante pour rompre le mariage. Les opposants au divorce pour altération, s’appuyant sur l’avis d’une partie de la doctrine16, ont tenté de bénéficier de ces motivations pour reprocher à ce divorce l’impuissance de l’autre époux ainsi que celle du juge à s’opposer à la décision prise par l’autre conjoint. En fait, malgré la pertinence de ce raisonnement, il n’était pas opportun de lier ces arguments au principe de l’égalité. La Cour de cassation, bien qu’elle ait déjà en 2004 appliqué la même méthode pour ne pas reconnaître la répudiation islamique, a, sans difficulté, réfuté le support de ce principe, au motif « qu’étant accordée à chacun des époux, cette possibilité de demander le divorce n’est pas contraire au principe d’égalité ». Le combat des opposants ne s’est pas arrêté malgré la position claire de la haute juridiction. Ils reviennent devant celle-ci en 2015 avec un autre argument.
B – L’arrêt du 15 avril 2015 : le divorce pour altération est-il contraire aux « articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales » ?
Ce qu’un auteur17 avait énoncé comme une question devient un pourvoi présenté devant la Cour de cassation. Celle-ci se trouve, le 15 avril 2015, encore une fois devant une opposition au divorce pour altération définitive. Un mari, qui ne reproche aux juges de fond ni le défaut de condition de cessation, ni le défaut de durée de deux ans exigée par la loi, reproche à ce divorce son principe. Selon le moyen du mari qui a formé ce pourvoi, « toute personne a droit au respect de ses croyances et de sa vie privée et familiale ; qu’en s’abstenant de rechercher si, dans le cas d’espèce, le divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal n’était pas de nature à emporter pour le mari, meurtri dans ses convictions personnelles les plus profondes, une atteinte à sa vie privée et familiale et à sa liberté de religion disproportionnée par rapport à la liberté de mettre fin au lien matrimonial, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme ». La Cour de cassation, comme hier18, de son côté, rejette ce pourvoi. Elle n’accueille pas l’argument de la violation de l’article 9 de la ladite Convention, car il n’a pas été invoqué devant la cour d’appel et répond à l’autre argument en déclarant « que le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui implique une cessation de la communauté de vie entre des époux séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce, ne peut être contraire aux dispositions de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales »19. Alors, cette fois, les adversaires au divorce pour altération ont recours à la Convection européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pour trouver un support à leurs reproches à ce divorce. Mais la haute juridiction y a apporté une réponse ferme. Même l’argument de la conviction religieuse, qui a été écarté en raison de sa nouveauté, n’aurait pas eu la chance d’être pris en considération. Car l’accueil de cet argument aurait ouvert la porte à la discussion sur la question de la répudiation algérienne ou marocaine. La non-reconnaissance de la répudiation musulmane porte aussi atteinte à la conviction religieuse, car sur les plans religieux et juridique, la relation matrimoniale entre les époux est finie et l’union après cet acte est illégitime. Si les hauts magistrats acceptent l’argument de la conviction religieuse pour empêcher le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugale, ils seront tenus d’accepter cet argument pour reconnaître la répudiation algérienne et marocaine. La position de la Cour de cassation, semble-t-il, ne porte aucune considération à la conviction religieuse. La solution adoptée par cette cour confirme ainsi la supériorité de la liberté matrimoniale et de la liberté de rompre l’union matrimoniale, sur le droit au respect de la vie privée et familiale20. Elle « clôt la discussion sans laisser la moindre possibilité qu’au regard de ses convictions personnelles ou du sens qu’il donne au mariage, l’un des époux puisse être très profondément atteint par un divorce que l’autre lui impose »21. Enfin, la Cour de cassation, soit dans les arrêts de 2012 soit dans l’arrêt de 2015, ne fait que confirmer ce que le législateur, en 2004, a voulu quant à l’adoption du divorce pour altération. Une adoption qui concrétise le droit de la volonté unilatérale d’un époux de rompre le mariage et contient un message clair et catégorique, à savoir que « le mariage-prison » n’existe plus en France. La stratégie des opposants au divorce pour altération ne s’arrête pas à attaquer son principe mais cherche également à jouer sur ses conditions pour faire obstacle à son prononcé.
II – Des questions relatives aux conditions du divorce pour altération
Certains opposants au divorce pour altération définitive ont choisi de déjouer le prononcé de ce divorce en tentant de trouver des lacunes dans ses conditions. Les reproches étaient concentrés sur la mauvaise application des conditions de ce divorce : la cessation de la vie commune (A) pendant deux ans (B).
A – La cessation de la vie commune face aux biens immobiliers indivis
La conception de cessation de vie commune a fait l’objet d’un pourvoi formé devant la haute juridiction. Les juges de fond ont prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal suite à la requête d’un époux. Ils ont considéré que la séparation de deux ans exigée par l’article 238, alinéa 1 du Code civil, était établie. La femme s’est pourvue devant la Cour de cassation au motif que le couple possédait toujours plusieurs biens immobiliers indivis. La Cour de cassation a écarté ce raisonnement en énonçant le 14 avril 2010 que « la seule existence de biens immobiliers indivis était insuffisante à caractériser une communauté de vie au sens de l’article 238 du Code civil »22. L’argument de la femme, en l’espèce, signifie que le patrimoine partagé entre les époux empêche l’existence de la séparation exigée par la loi pour prononcer le divorce. Mais comme le professeur Thierry Garé le dit, « la subsistance d’un patrimoine indivis entre les époux est sans incidence sur l’existence de la séparation. Car on peut parfaitement vivre séparé (corpore et animo) tout en ayant encore des intérêts patrimoniaux communs. La séparation exigée par l’article 238 est une séparation personnelle, pas une séparation patrimoniale »23. La cessation de la communauté de vie ne se déduit pas d’un élément patrimonial, mais des éléments tant matériel qu’intentionnel24. La caractérisation d’une vie séparée vient seulement prouver que le couple vit séparément25 depuis au moins deux ans, calculés à partir de l’assignation de la requête.
B – Le délai de deux ans face à divers reproches
La question du respect de l’exigence du délai a fait l’objet de trois pourvois : l’un prétendait à la nécessité de constater ce délai dans l’application de l’alinéa 2 de l’article 238 (1). Les deux autres pourvois sont concentrés sur la date de calcul de cette durée (2).
1 – Nécessité de constater un délai dans l’article 238, alinéa 2 ?
Le 5 janvier 2012, la Cour régulatrice reçoit un pourvoi s’opposant à un prononcé de divorce pour altération. Après avoir été autorisée par ordonnance de non conciliation le 30 juin 2006, une épouse assigne son mari en divorce pour faute le 30 octobre 2006 sur le fondement de l’article 242 du Code civil. Ce à quoi le mari a répondu en formant, reconventionnellement, une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238 du même Code. Le 21 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Beauvais rejette la demande en divorce pour faute et prononce le divorce pour altération définitive. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel d’Amiens. La femme forme un pourvoi dans lequel elle reproche aux juges de fond de ne pas constater préalablement une séparation de deux ans à compter de l’assignation en divorce, comme l’exige la loi. La Cour de cassation rappelle « en une formule lapidaire »26 qu’« en cas de présentation d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce sur la seconde »27. Autrement dit, le juge doit prononcer automatiquement le divorce pour altération sans avoir à vérifier l’existence d’une séparation de deux ans entre les époux28. La solution adoptée par les hauts magistrats ne reflète que l’application stricte de la lettre de la loi29. Il s’agit d’appliquer la combinaison de l’alinéa 2 de l’article 238 avec l’article 246 du Code civil. Elle met en lumière deux points : « la hiérarchie des causes de divorce et (…) la durée de la séparation »30. Pour le premier point, la demande en divorce pour faute a la priorité sur la demande en divorce pour altération31. Quand ces deux demandes « sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » (C. civ, art. 246)32. Dans l’arrêt commenté, c’est ce que le juge de fond a fait et sur ce point tout le monde est d’accord. Cependant, ce que la femme a reproché au jugement concerne le deuxième point. Il s’agit de la durée de la séparation entre les époux. Selon elle, il faudrait constater deux ans de séparation à compter de l’assignation en divorce. Cette opposition n’a aucune chance d’aboutir dans la mesure où, et c’est ce que la Cour de cassation a rappelé33 en l’espèce, l’alinéa 2 de l’article 238 a dispensé le divorce pour altération définitive présenté à titre reconventionnel de la durée de deux ans de séparation34. Le divorce pour altération définitive ici « est donc de droit, quelle que soit la durée de la séparation »35. Son prononcé n’a pas besoin de preuve de durée car l’altération a été démontrée par l’existence de deux demandes en divorce, même sur deux fondements différents36. La femme en l’espèce, bien qu’elle ait aussi demandé le divorce, s’est opposée au divorce pour altération car elle ne veut pas n’importe quel divorce. Pour elle, seul le divorce pour faute est acceptable37.
2 – Le calcul de la durée
Les deux ans de séparation entre les époux sont une condition pour prononcer le divorce pour altération définitive. Les opposants à ce divorce ont essayé de jouer sur la date à partir de laquelle le juge devrait compter cette durée. Deux pourvois sont notables en la matière, dont l’un a fait valoir la date de la convention signée (a) et l’autre, la date de l’assignation en séparation de corps (b).
a – Le calcul de durée avec l’existence d’une convention signée
S’appuyant sur une séparation de fait pendant deux ans, un homme assigne son épouse en divorce pour altération le 8 août 2005 et obtient le prononcé de ce divorce. Les juges de fond, en s’appuyant sur le fait que le mari ait signé un bail avec effet au 28 juillet 2003 pour se loger et une preuve affirmée par les témoignages des voisins, ont estimé que la durée exigée par l’article de 237 était remplie. Mais la femme forme un pourvoi, après avoir échoué à convaincre les juges d’appel, en prétendant que la durée de deux ans n’était pas constituée. Elle invoque un accord signé avec son mari le 12 septembre 2003 qui organise leur séparation de fait. Les juges de la haute juridiction, qui ne sont pas convaincu par l’argument de cette femme, ont considéré : « qu’appréciant la valeur et la portée des pièces versées au débat, la cour d’appel a souverainement estimé d’une part, qu’il ne résultait pas des termes de l’accord signé par les époux le 12 septembre 2003 que le mari résidait encore au domicile conjugal au moment de sa signature, d’autre part, que le contrat de bail conclu par l’époux le 16 juillet 2003 avec prise d’effet au 28 juillet 2003 et le témoignage de deux voisins l’ayant vu s’installer à cette période démontraient que la séparation du couple était effective dès fin juillet 2003 ; qu’elle n’a pu qu’en déduire que la demande en divorce formulée par assignation du 8 août 2005, plus de deux ans après la séparation, était recevable ; que le moyen n’est pas fondé »38. Le contenu de cet arrêt relatif à une séparation de fait ainsi que la réponse de la Cour de cassation permettent de déduire certaines remarques : d’abord, la détermination de la durée de séparation de fait offre une marge de mouvement au conjoint qui refuse le divorce. Cette séparation peut être délicate du fait que les deux époux ne sont pas d’accord sur la date exacte de la séparation39. Dans ce cas, comme le professeur Jean Hauser le relève : « Les faits du présent arrêt illustrent bien cette stratégie souvent adoptée par le conjoint qui ne veut pas divorcer ou au moins obliger l’autre à attendre que le délai soit constitué »40. Deuxièmement, la souveraineté de l’appréciation des juges du fond est effective pour déterminer à quel moment la séparation des époux a eu lieu. Dans une séparation, résultant d’une séparation de fait, nous remarquons que le rôle du juge de fond reste efficace pour apprécier les conditions de ce type de divorce. Troisièmement, la preuve de cette séparation peut comprendre tous moyens et non seulement les preuves écrites. Voire, au regard de la réponse de la Cour de cassation dans le présent arrêt, il ne faut pas privilégier l’écrit41. Enfin, il suffit que l’intention de la séparation fût existante chez le demandeur du divorce et c’est ce que consacre ce jugement. Même si la femme, dans ce cas, a voulu intervenir pour établir le début de la séparation en signant un accord avec son mari, l’importance est suspendue à l’intention du demandeur et de sa volonté. C’est lui qui veut mettre fin au mariage et c’est pour lui que le législateur a consacré ce type de divorce. À l’inverse, si l’on prenait en considération l’intention de l’opposant à ce divorce, cela signifie que l’on suspendrait le divorce pour altération à la volonté de celui qui refuse le divorce. Ce qui serait contraire à la finalité de l’adoption de ce divorce.
b – Le calcul de durée en cas de demande de séparation de corps
Une autre stratégie a été déployée par un conjoint refusant le divorce pour altération. Deux époux sont séparés le 14 août 2010 et le 3 novembre 2010, l’époux dépose une requête en divorce. Le 1er février 2011, le juge des affaires familiales prononce une ordonnance de non-conciliation. Le 4 mai 2012, la femme assigne son époux en séparation de corps à ses torts exclusifs. Le mari attend jusqu’au 30 août 2012 et présente une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive. Le juge de fond prononce le divorce à la demande du mari le 7 novembre 2013. La femme conteste ce jugement confirmatif en formant un pourvoi devant la Cour de cassation. Se fondant sur l’article 238 du Code civil et faisant une assimilation entre l’assignation en divorce et celle en séparation de corps, l’épouse considère que la condition de durée de deux ans du divorce pour altération devrait être calculée au jour de la requête initiale en séparation de corps et non à la date de la demande reconventionnelle en divorce. Comme le législateur n’a rien prévu dans ce cadre, la haute juridiction prend la parole le 28 mai 2015, pour combler « un angle mort législatif »42, en déclarant que c’est « à la date de la demande reconventionnelle en divorce »43 que l’écoulement de deux ans de cessation s’apprécie et non à la date de la demande initiale en séparation de corps. La solution adoptée par les hauts magistrats est logique puisque « ce sont les conclusions aux fins de divorce, et non l’assignation en séparation de corps, qui constituent le support de la demande pour altération définitive du lien conjugal »44. La stratégie de la femme, en l’espèce, n’était pas d’attaquer le début de la séparation avec son mari. Elle ne conteste pas que son époux ait quitté le domicile conjugal le 14 août 2010, date antérieure à l’ordonnance de non conciliation. Le but de l’épouse était de faire barrage à la demande éventuelle du mari pour altération puisque ce dernier avait, en réalité, déposé le 3 novembre 2010 une requête en divorce et suite à cette requête, une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 1er février 2011. Son choix de séparation de corps pour faute et non de divorce pour faute fait prévaloir que la femme ne souhaite pas le divorce, même en principe. Elle sait bien que le choix du divorce pour faute, si elle le choisissait, serait examiné en premier lieu même si le mari l’assignait en divorce pour altération définitive selon l’article 246 du Code civil. Elle sait bien aussi que son choix en séparation de corps ne peut faire un obstacle au divorce en lui-même, car selon le premier alinéa de l’article 297-1 du Code civil, « lorsqu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies ». La stratégie du choix de séparation de corps vise deux objectifs : le premier, c’est d’inciter le mari à tomber dans un piège en assignant son épouse en divorce pour altération d’emblée suite à sa demande en séparation. Dans ce cas-là, la femme peut facilement contester la condition de durée de deux ans. La séparation entre les deux époux a commencé le 14 août 2010 et l’assignation de l’épouse à son mari en séparation de corps était le 4 mai 2012. Mais il semble que le mari avait conscience de ce piège puisqu’il n’a assigné son épouse en divorce pour altération qu’à la date réalisant l’écoulement de deux ans, à savoir le 30 août 2012. Le second objectif qui était visé était que la femme essaie de convaincre le juge de calculer la durée de deux ans à la date qu’elle a choisie, en l’occurrence celle de l’assignation en séparation de corps le 4 mai 2012, en exploitant l’absence législative en l’espèce. Mais, cette fois, les juges de fond ainsi que les juges de droit ont eu conscience de ce piège en refusant l’argument présenté par la femme. En fait, la solution adoptée ici par les juges est conforme à l’esprit de la loi de 2004 qui a voulu accorder un véritable droit au divorce. Le conjoint qui ne désire pas le divorce, n’a pas le droit de jouer avec les conditions posées par la loi, notamment la condition de durée. Il peut contrôler les deux conditions mais non en abuser. Si la loi a donné au demandeur du divorce le droit de l’acter par sa propre volonté, elle n’a jamais accordé à son conjoint le moyen de paralyser son désir de divorce. Car si la loi donnait cette possibilité, elle viderait le divorce pour altération de son essence et de sa finalité. Enfin, il est remarqué que la Cour de cassation a joué un rôle législatif en remplaçant le législateur qui était resté muet sur la question posée.
Conclusion. L’ensemble des arrêts cités, rendus par la Cour de cassation, permet de noter un constat qui dévoile un message adressé aux personnes hostiles au divorce pour altération définitive du lien conjugal. Un constat qui repose sur le fait qu’aucun des opposants n’a pu remporter le combat ni sur le principe de ce divorce, ni sur ses conditions. Malgré les stratégies variées mises en œuvre pour faire obstacle au prononcé de ce divorce et malgré les arguments employés en ce sens, le droit au divorce sort gagnant. Ce constat ne signifie pas que les opposants baisseront les bras à l’avenir, mais il exprime un message de la part du législateur, également affirmé par la haute juridiction. Ce message clairement énoncé serait : est révolu le temps où la volonté impliquée dans le mariage ne peut en sortir que par la mort ou, dans les meilleures situations, par la faute. Le mariage qui ne repose plus sur l’harmonie et l’entente n’a aucun intérêt à continuer et à être maintenu. Le divorce est devenu, comme le mariage, un droit pour celui qui le demande. Si la commune volonté ne parvient à tomber d’accord sur le divorce, une seule volonté suffit et a le droit de le réaliser. Bien que le législateur français se soit réveillé tardivement pour consacrer ce type de divorce, il est préférable de l’accueillir tardivement plutôt qu’il n’arrive jamais.
Notes de bas de pages
-
1.
Larribau-Terneyre V., « La réforme du divorce : premier bilan à mi-parcours », Dr. famille 2004, n° 3, chron. 6, p. 5.
-
2.
L’article 237 prévoit que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ».
-
3.
L’article 238 prévoit que « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel ».
-
4.
Malaurie P., « Conclusions sur la réforme du divorce “Le divorce pour altération définitive du lien conjugal et la société de la peur” », Rép. Defrénois 2004, art. n° 38062, p. 1601. Labbée X., Le droit commun du couple, Presse Universitaire du Septentrion, 2e éd., 2012, p. 207 et s ; Claux P.-J., David S. et a., Droit et pratique du divorce, 2e éd., 2013, Dalloz Référence, Dalloz, p. 39, n° 121.93 et s.
-
5.
Cass. 1re civ., 6 juin 2012, n° 12-40027.
-
6.
Cass. 1re civ., 6 juin 2012, n° 12-40028.
-
7.
Cass. 1re civ., 6 juin 2012, n° 12-40027 : Gaz. Pal. 15 sept. 2012, p. 25, note Mulon É. ; RTD civ. 2012, p. 513, note Hauser J. ; RJPF 2012, n° 9-10/27, p. 38, note Garé T. ; Dr famille 2012, n° 10, comm. n° 141, p. 20, note Larribau-Terneyre V. ; LEFP sept. 2012, n° 118, p. 1, Salhi K.
-
8.
Cass. 1re civ., 6 juin 2012, n° 12-40028 : Gaz. Pal. 15 sept. 2012, p. 25, note Mulon É. ; RTD civ. 2012, p. 513 et s ; RJPF 2012, n° 9 à 10, p. 38 et s., note Garé T. ; LEFP sept. 2012, n° 118, p. 1, Salhi K.
-
9.
Comme de nombreux auteurs l’ont décrit. Voir à titre d’exemple : Malaurie P. et Fulchiron H., La famille, 4e éd., 2011, Paris, Defrénois, Lextenso éditions, p. 284 ; Delecraz Y., « Le projet de réforme du divorce », Rép. Defrénois 2004, art. n° 37935, p. 647 ; Pieratti G., « Un point de vue sur la réforme du divorce : le XXIe siècle témoin de l’affaiblissement du mariage et de l’apparition d’un droit au divorce », LPA 15 avr. 2004, p. 8.
-
10.
Selon les articles 251 du Code civil et alinéa 1 de l’article 1106 du Code procédural civil, les motifs et le fondement juridique du divorce ne doivent pas être indiqués. Pour plus d’informations sur les formules et procédures du divorce, V. Thouret S. et Avena-Robardet V., Dossier « Divorce : formules et procédure » : Fiche de procédure- Divorce pour altération définitive du lien conjugal, AJ fam. 2015, p. 147.
-
11.
Il est capital d’indiquer que le juge peut notamment, selon les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 255 du Code civil, « Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux » et non « autoriser les époux à résider séparément » comme la loi du 11 juillet 1975 l’avait prévu. Fenouillet D., Droit de la famille, Cours Dalloz L1, Dalloz, 3e éd., 2013, p. 193.
-
12.
Puisque la durée de deux ans est calculée à la date de l’assignation en divorce et non à celle du dépôt de requête.
-
13.
Claux P.-J., David S. et a., Droit et pratique du divorce, op. cit., p. 33 et s.
-
14.
Le droit de la défense a disparu par la disparition de la clause de dureté. Celle-ci, que l’ancienne loi de 1975 avait prévue dans l’ancien article 240, prévoyait dans l’alinéa 1 que « Si l’autre époux établit que le divorce aurait, soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d’une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande ».
-
15.
Cass. 1re civ., 17 févr. 2004, n° 02-11618.
-
16.
Le doyen Fulchiron, en commentant la position de la Cour de cassation sur la répudiation algérienne, a écrit : « Passons sur l’ambiguïté consistant à laisser penser que ce qui gêne la cour serait qu’en droit algérien le divorce pût être prononcé à la demande du mari sans que la femme ni le juge ne pussent s’y opposer. Dans le divorce pour altération des facultés mentales instauré par la loi du 26 mai 2004, un époux peut imposer le divorce à l’autre sans avoir à faire la preuve d’un grief particulier, sans que le conjoint puisse y faire barrage et sans que le juge puisse refuser de la prononcer dès lors qu’il est établi que les époux sont séparés depuis deux ans » : Fulchiron H., « “Ne répudiez point…” : Pour une interprétation raisonnée des arrêts du 17 février 2004 », RIDC 2006, vol. 58, n° 1, p. 14.
-
17.
Larribau-Terneyre V., Clause de dureté : Requiem…, note sous CA Grenoble, 2e ch. civ., 10 nov. 2003 ; Cass. 1re civ., 30 juin 2004, n° 02-21101 : Dr. fam. 2004, n° 9, comm. n° 145, 2e espèce, p. 32.
-
18.
La Cour de cassation, sous l’empire de la loi de 1975, a déjà rendu que le prononcé du divorce pour rupture de la vie commune n’est pas contraire aux dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Cass.2e civ., 25 mars 1987 : JCP G 1987, IV, 24, p. 191. En 2004, la Cour de cassation a aussi considéré que le prononcé du divorce pour rupture de la vie commune n’était pas contraire aux dispositions des articles 8, 9 et 12 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 5 du protocole n° 7 additionnel à ladite Convention. Cass. 1re civ., 30 juin 2004, n° 02-21101 : Dr fam. 2004, n° 9, comm. n° 145, 2e espèce, p. 32, note Larribau-Terneyre V.
-
19.
Cass. 1re civ., 15 avr. 2015, n° 13-27898 : Dr fam. 2015, n° 6, comm. n° 114, p. 21, note Binet ; AJ fam. 2015, p. 404, note Ferré-André S. ; RTD civ. 2015, p. 591, note Hauser J. ; D, 2015, p. 921, note Mésa R. ; LEFP juin 2015, n° 87, p. 3, note Batteur A. ; Gaz. Pal 23 juin 2015, n° 229s7, p. 16, note Hamou S.
-
20.
Mésa R., « Divorce pour altération définitive du lien conjugal : pas d’atteinte à la vie privée et familiale, note sous Cass. 1re civ., 15 avr. 2015 », D. 2015, p. 921 et s.
-
21.
Binet J.-R., « Le divorce pour altération définitive du lien conjugal, un divorce imposé… et puis c’est tout !, note sous Cass. 1re civ., 15 avr. 2015 », Dr fam. 2015, n° 6, comm. n° 114, p. 22.
-
22.
Cass. 1re civ., 14 avr. 2010, n° 09-14672 : RJPF 2010, n° 7 à 8, p. 19, analyse Garé T.
-
23.
Le professeur T. Garé ajoute « D’ailleurs, faire droit à l’argumentation de l’épouse sur ce point aurait conduit à considérer que les époux ne sont séparés qu’après la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, ce qui n’est conforme ni à la lettre, ni à l’esprit du texte, dont on observera qu’il évoque seulement la vie séparée et non la séparation des patrimoines » : Garé T., « Divorce pour altération : ni l’existence d’un patrimoine indivis ni des courts séjours en famille ne sont de nature à remettre en cause la séparation des époux, analyse sous Cass. 1re civ., 14 avr. 2010, n° 09-14672 », RJPF 2010, n° 7 à 8, p. 19.
-
24.
La Cour de cassation a déjà prononcé sous l’ancienne loi de 1975 « Mais attendu que l’arrêt, après avoir rappelé que l’article 237 du Code civil n’effectue aucune distinction quant aux circonstances ayant accompagné la séparation des époux, énonce exactement qu’il suffit, pour que les conditions prévues par la loi soient remplies, que la communauté de vie, tant matérielle qu’affective, ait cessé entre les conjoints ». Cass. 2e civ., 30 janv. 1980 : JCP G 1981, II, J, 19521, obs. Lindon R. ; Rép. Defrénois 1980, art. n° 32421, p. 1206, note Massip J. La Chancellerie a expliqué la cessation de la communauté de vie en disant : « Cette condition revêt, à l’instar de ce que la jurisprudence exigeait en matière de divorce pour rupture de la vie commune, un aspect à la fois matériel (l’absence de cohabitation) et psychologique (la volonté de rupture) ». Circ. min. n° CIV/16/04, 23 nov. 2004.
-
25.
Pour plus de détails sur la conception de cette séparation : Cornu G., Droit civil la famille, p. 545 et s.
-
26.
Massip J., « L’article 238, alinéa 2, du Code civil et le domaine du divorce pour altération définitive du lien conjugal, note sous Cass. 1re civ., 5 janv. 2012, n° 10-16359 », JCP G 2012, 362, spéc. n° 8.
-
27.
Cass. 1re civ., 5 janv.2012, n° 10-16359, RTD civ, 2012, p. 99, note Hauser J. ; JCP. G, 16 janvier 2012, n° 3, p. 76, note Coutant-Lapalus C. ; D, 19 janvier 2012, n° 3, p. 150, note Marrocchella J. ; AJ Fam, 2012, n° 2, p. 104, obs. David S. ; JCP. G, 20 février 2012, n° 8, p. 361, note Massip J. ; RJPF, 2012, n° 2, p. 20, analyse Garé T. ; D, 8 mars 2012, n° 10, Chronique Cour de cassation, p. 635, note Vassallo B. ; Gaz. Pal 17 mars 2012, p. 25, note Casado A.-L.
-
28.
Claux P.-J., David S. et a., Droit et pratique du divorce, op. cit., p. 36 et s. n° 121.71. Dans le même sens : Vassallo B., « Divorce pour faute : rejet de la demande principale », D. 2012, n° 10, Chronique Cour de cassation, p. 636 ; Cheynet de Beaupré A., « Spécificité du divorce pour altération définitive du lien conjugal après rejet de la demande reconventionnelle en torts exclusifs », RJPF 2013, n° 11, sélection du mois, p. 22.
-
29.
« Cette décision semble conforme à la lettre du texte » dit Marrocchella J. : D. 2012, n° 3, p. 150.
-
30.
Hauser J., « Divorce pour faute et demande reconventionnelle en altération définitive du lien conjugal : de la hiérarchie des causes de divorce et de la durée de la séparation, note sous : Cass. 1re civ., 5 janv. 2012, n° 10-16359 », RTD civ. 2012, p. 99.
-
31.
Cheynet de Beaupré A., « Spécificité du divorce pour altération définitive du lien conjugal après rejet de la demande reconventionnelle en torts exclusifs », op. cit., p. 22.
-
32.
Quelle que soit la première demande en divorce pour faute ou pour altération, qu’elle soit à titre principal ou reconventionnel. Une règle logique et évidente dans la mesure où nous sommes devant deux demandes différentes de causes pour les deux époux : un époux qui prétend une faute et l’autre qui ne la prétend pas. Dans ce cas, il faut vérifier l’existence de la faute pour ne pas donner une voie au conjoint fautif d’échapper au divorce pour faute.
-
33.
Comme l’auteur Casado l’a dit, même si la solution adoptée par la Cour de cassation n’est en rien révolutionnaire, elle est utile sur la question des délais. Cette utilité apparaît pour mettre un terme à certains arrêts du fond qui persistent à relever que la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive, peut être accueille en raison de la séparation des conjoints depuis plus de deux ans à la date de l’assignation du divorce. Casado A.-L., « La demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal : le divorce sans délai, note sous : Cass. 1re civ., 5 janv. 2012, n° 10-16359 », Gaz. Pal 17 mars 2012, p. 26.
-
34.
À l’inverse, si le divorce pour altération définitive a été présenté à titre principal, le prononcé du divorce, après le rejet de la demande reconventionnelle en divorce pour faute, sera subordonné au constat d’une séparation de deux ans à compter de l’assignation en divorce. David S., « L’article 238, alinéa 2, du Code civil ou comment le « divorce altération » peut être prononcé sans délai ?, Observation sur : Cass. 1re civ., 5 janv. 2012, n° 10-16359 », AJ fam. 2012, n° 2, p. 104 ; Coutant-Lapalus C., « Un divorce pour altération définitive du lien conjugal sans séparation, note sous Cass. 1re civ., 5 janv.2012, n° 10-16359 », JCP G 2012, 76, n° 3.
-
35.
Garé T., « Le rejet de la demande principale en divorce pour faute emporte le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, analyse sous Cass. 1re civ., 5 janv.2012, n° 10-16359 », RJPF 2012, n° 2, p. 20.
-
36.
Dans ce sens le professeur Jean Hauser dit : « Il demeure tout de même que, quand les époux en sont là, il n’est peut-être pas très utile de leur imposer un délai supplémentaire pour constater que la vie commune est devenue difficile ». Hauser J., « Divorce pour faute et demande reconventionnelle en altération définitive du lien conjugal : de la hiérarchie des causes de divorce et de la durée de la séparation », op. cit., p. 100. Selon la Chancellerie, la finalité du législateur en l’espèce réside dans l’évitement d’une escalade inutile des griefs et le maintien artificiel du lien conjugal, Circ. min. n° CIV/16/04, 23 nov. 2004.
-
37.
Comme un spécialiste l’explique : « Cet arrêt montre en réalité que la cause du divorce et la reconnaissance de la culpabilité de l’autre demeurent essentielles malgré la volonté du législateur en 2004 de déconnecter la cause des effets en matière de divorce », Coutant-Lapalus C., « Un divorce pour altération définitive du lien conjugal sans séparation », op. cit., p. 77.
-
38.
Cass. 1re civ., 25 nov. 2009, n° 08-17117 : Rép. Defrénois 2010, art. n° 39101, p. 864, note Massip J. ; RTD civ. 2010, p. 88, note Hauser J. ; RJPF 2010, n° 2, p. 22, Garé T. ; AJ fam. 2010, p. 135, obs. David S.
-
39.
Au contraire si la séparation résulte de celle judiciaire. Dans ce cas et comme certaines spécialistes le disent : « la détermination du point de départ ne pose aucune difficulté, celle-ci se situant à la date de la décision qui se prononce sur la résidence séparée : un jugement de séparation de corps ou ordonnance de non-conciliation », Claux P.-J., David S. et a., Droit et pratique du divorce, op. cit., p. 34. n° 121.52.
-
40.
Hauser J., « Première décision sur le divorce pour altération définitive du lien conjugal : le point de départ du délai de séparation, note sous Cass. 1re civ., 25 nov. 2009 », RTD civ. 2010, p. 88.
-
41.
Garé T., « Divorce pour altération définitive du lien conjugal : la preuve de la séparation de fait peut être reportée par tous moyens », RJPF 2010, n° 2, p. 22.
-
42.
Douville T., « Séparation de corps et divorce pour altération définitive du lien conjugal : date d’appréciation de la durée de la cessation de la communauté de vie », Gaz. Pal 2 juill. 2015, n° 228s8, p. 4.
-
43.
Cass. 1re civ., 28 mai 2015, n° 14-10868 : Gaz. Pal 2 juill. 2015, n° 228s8, p. 4, note Douville T. ; AJ fam 2015, p. 491, note Thouret S. ; LEFP sept. 2015, n° 119, p. 4, note Douville T.
-
44.
Thouret S., « Point de départ du délai de deux ans en cas de demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal », AJ fam 2015, p. 492.