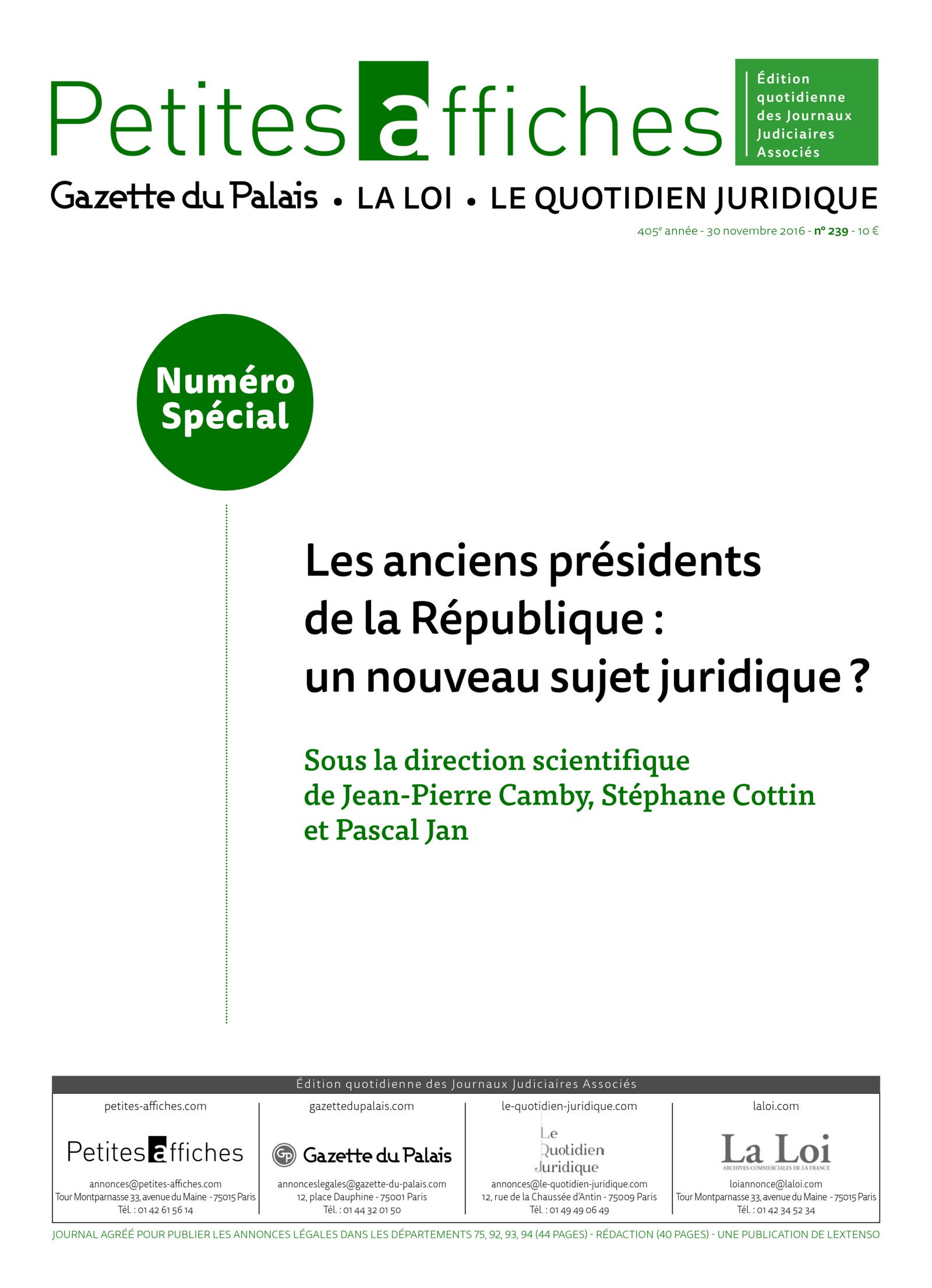Les anciens présidents de la République, membres de droit du Conseil constitutionnel : un anachronisme bien vivant
Imaginerait-on aux États-Unis, Barack Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter et George Bush père et fils, siéger côte à côte à la Cour suprême ? Cette situation est pourtant bien celle qui prévaut, au moins dans le texte constitutionnel, en France, où les anciens présidents sont membres de droit du Conseil constitutionnel, et peuvent ainsi siéger aux côtés de personnes qu’ils ont eux-mêmes nommées et que, dispensés de prestation de serment, ils n’en sont pas moins appelés à s’abstraire ainsi de la vie politique pour cause d’incompatibilité avec toute fonction élective, fonctions qu’ils peuvent cependant choisir de briguer à tout moment. Pourtant le texte de l’article 56, alinéa 2 C est inchangé depuis 1958, en dépit de tentatives dont la dernière, en 2008, était particulièrement argumentée. Mais l’originalité de la Constitution française, en dépit de la cause originelle et presque anecdotique de ce dispositif, prévu à une époque où le Conseil constitutionnel se réunissait fort peu, et de l’évolution de son rôle, ne repose-t-elle pas sur autre chose que la seule volonté de vouloir ménager un statut constitutionnel et reconnaître un rôle de « Sage » aux anciens présidents ? En toute hypothèse, le dispositif n’échappe pas au débat, comme en témoignent les deux points de vue ci-dessous.
I – Contre : une anomalie insupportable
François Hollande, alors candidat à l’élection présidentielle de 2012, s’était rangé à une opinion largement partagée par la doctrine et depuis longtemps par une majorité de parlementaires de mettre fin au privilège des anciens présidents de la République de siéger de droit au Conseil constitutionnel. L’article 56 C énonce en effet que « le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée. En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit, partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens présidents de la République ». À vie… Deux mots dénoncés depuis longtemps comme incongrus par la très grande majorité des spécialistes des questions constitutionnelles à l’heure d’un Conseil constitutionnel qui s’impose sur l’échiquier des pouvoirs publics constitutionnels comme une juridiction gardienne des droits fondamentaux, mais deux mots impossibles à effacer de la Constitution. Un paradoxe… en apparence du moins car si le diagnostic est posé et reconnu, toute la difficulté tient au remède : que faire des anciens présidents de la République. Précisément, et s’il s’agissait de ne rien faire…
A – Les membres de droit justifiés par le statut constitutionnel du président de la République
Le général de Gaulle, alors dernier président du Conseil de la IVe République et totalement engagé dans l’élaboration de la nouvelle Constitution, entend conférer aux anciens présidents de la République un statut particulier. De la sorte, Charles de Gaulle manifeste sa gratitude envers René Coty qui l’a appelé à la tête du Gouvernement et a fait en sorte que les parlementaires lui confient le pouvoir pour ouvrir un nouveau chapitre constitutionnel de la France. Conférer un statut officiel aux anciens chefs de l’État et leur réserver une fonction au sein de l’État, c’était également rompre avec l’absence d’un tel statut sous la IIIe et la IVe République. La rupture avec la République des professeurs, cette République de la déviance parlementaire, est claire. L’innovation républicaine montre certes le souci du général de Gaulle d’assurer ses prédécesseurs de sa reconnaissance mais surtout elle s’inscrit en cohérence avec le statut présidentiel du président sous la Ve République. Si initialement, seuls les anciens présidents de la IVe République sont concernés, à savoir Vincent Auriol (1947-1954) et René Coty (1954-1958), la disposition de l’article 56 de la Constitution concerne évidemment les anciens présidents de la Ve République.
En 1958, la qualité de membre à vie du Conseil constitutionnel pour les anciens présidents de la République est purement honorifique, le Conseil constitutionnel étant considéré comme une institution, certes nécessaire pour garantir les attributions du gouvernement mais secondaire dans le nouveau dispositif institutionnel. Elle offre aux ex-chefs de l’État un complément de retraite qui leur assure une certaine aisance mais aussi témoigne de leurs responsabilités passées comme garants de la Constitution. En effet, la Constitution du 27 octobre 1946 associait le président de la République à la protection de la Constitution. En application de l’article 91, il présidait le Comité constitutionnel en charge du contrôle formel de conformité des lois uniquement dirigé sur le respect de l’organisation des pouvoirs publics. Le Comité constitutionnel n’avait pas compétence pour apprécier la constitutionnalité des lois au regard de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et du Préambule de la Constitution de 1946. Sorte de garant politique de la Constitution, le président de la République pouvait saisir le Comité constitutionnel, conjointement à une demande du président du Conseil de la République, agissant à la suite d’une résolution adoptée en ce sens par cette assemblée, amputée de l’essentiel des prérogatives d’une chambre parlementaire. C’est ainsi, par exemple, qu’à l’occasion de l’adoption d’une résolution introduisant dans le règlement du Conseil de la République une disposition rétablissant la procédure de l’interpellation (1949), le président de l’Assemblée nationale, Édouard Herriot, en appela à Vincent Auriol pour s’opposer à cette initiative susceptible de réactiver la responsabilité politique du gouvernement devant la seconde chambre et de bouleverser l’équilibre institutionnel voulu par les constituants de 1946.
De ce point de vue, la participation de droit des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel n’est pas totalement injustifiée. Elle l’est encore moins avec le statut présidentiel consacré en 1958, puisque l’article 5 de la Constitution de la Ve République attribue expressément au chef de l’État la mission de veiller « au respect de la Constitution ». À cette fin, outre la seconde délibération de la loi qu’il est en droit de demander au Parlement, le président de la République dispose du droit, comme son prédécesseur de la IVe République, de saisir le Conseil constitutionnel d’une loi. Mais, à la différence du régime précédent, le président de la Ve agit sans contreseing ministériel et peut également saisir le Conseil constitutionnel des traités internationaux avant que le législateur ne l’autorise à les ratifier. Son statut arbitral initial, son positionnement revendiqué au-dessus des partis et des contingences politiques quotidiennes, son expérience comme ses responsabilités constituent des atouts précieux pour les anciens présidents de la République pour apprécier la constitutionnalité d’une loi dont l’objet se limite, jusqu’au début des années 1970, à réguler les pouvoirs publics. Il faut par conséquent se garder de tout jugement sévère sur l’article 56, alinéa 2, et rappeler à chaque instant les raisons qui ont présidé à la rédaction de cette disposition constitutionnelle.
Cela étant, la Constitution de 1958 ne se réduit pas à la Constitution en 1958. Le contexte politique et le contexte institutionnel évoluent et induisent des interprétations de la Constitution qui modifient substantiellement non seulement les rapports de force et les relations entre les pouvoirs publics mais encore condamnent des dispositions anodines à évoluer sous peine de s’exposer à des critiques virulentes qui dépassent de beaucoup leur seul objet. Ainsi aujourd’hui, le maintien du statut des anciens présidents de la République comme membres de droit du Conseil constitutionnel rejaillit sur l’autorité du Conseil constitutionnel, alimente la critique d’une institution politisée, éloignée des standards attendus d’une juridiction indépendante et impartiale et ouverte aux justiciables.
B – La disparition des membres de droit justifiée par le statut politique du président de la République : un anachronisme bien vivant
Arbitre, placé au-dessus des formations et des groupements politiques, détaché des contingences quotidiennes du gouvernement, en charge des intérêts supérieurs de l’État, incarnant la nation et son unité et garant du bon fonctionnement des institutions, le président de la Ve République l’est toujours mais il est plus que cela : il est le véritable chef de l’exécutif, le maître du processus législatif, celui qui définit l’orientation des grandes politiques publiques. Cette mutation du rôle présidentiel n’est pas la conséquence de son élection au suffrage universel direct même si cette dernière en accentue les effets. Le peuple ne participe directement à l’élection présidentielle que depuis 1965. La prééminence présidentielle est la conséquence de l’alliance, imprévisible en 1958, entre le président et la majorité législative. 1962 ouvre un nouveau chapitre de la Ve République et transforme durablement le fonctionnement du régime pensé pour protéger l’exécutif des assauts parlementaires. Pivot de la majorité législative, le président de la République est totalement impliqué dans la législation. Il en ordonne les lignes directrices, en valide les principes en conseil des ministres et leur donne force de loi en exerçant son devoir de promulgation. Dans ces conditions, le président de la République est tout sauf désintéressé à la législation qui naît sous sa mandature ou celle qui, antérieure, subit les modifications apportées par son gouvernement appuyé par la majorité législative. Le président est un acteur politique actif. Le comité Balladur mis en place en 2007 par Nicolas Sarkozy pour suggérer des amendements constitutionnels qui interviendront l’année suivante en avait d’ailleurs tiré toutes les conséquences en proposant de modifier l’article 20 de la Constitution qui énonce que le « gouvernement détermine et conduit la politique de la nation » pour lui préférer une rédaction conférant au gouvernement la seule conduite de la politique nationale (art. 20 nouveau) définie par le président de la République (art. 5 nouveau). Mais, heureusement, cette suggestion ne prospéra pas. Elle tenait pour acquis ce qui ne l’est pas : l’impossible retour d’un président minoritaire.
Précisément, en période de cohabitation, le président de la République endosse un autre rôle : chef de l’opposition. Privé de majorité législative, le président de la République ne dispose d’aucune arme décisive pour s’opposer au programme législatif du gouvernement. La Constitution lui reconnaît cependant le droit de déclencher une seconde délibération de la loi (art. 10 C) ou de saisir le Conseil constitutionnel avant sa promulgation (art. 61, al. 2, C). Il agit comme garant politique de la Constitution. La seconde délibération de la loi est politiquement vouée à l’échec et pourrait se retourner contre son initiateur accusé d’empêcher le gouvernement de gouverner. Quant au recours au Conseil constitutionnel pour juger la constitutionnalité de la loi, le président s’en abstiendra soit parce qu’il peut compter sur des forces parlementaires pour saisir le juge constitutionnel, soit parce qu’il veut éviter d’être « désavoué » (pas de censure), ce qui serait de nature à affaiblir davantage sa position politique. Aucune disposition n’interdit cependant au président de la République de critiquer, de contester le bien-fondé des lois d’un gouvernement de cohabitation, voire de soulever des arguments d’inconstitutionnalité à leur encontre sans pour autant mettre en mouvement le contrôle de conformité de la loi assuré par le Conseil constitutionnel.
Chef de l’exécutif ou chef de l’opposition, le président de la République n’est jamais en retrait de la législation adoptée par le Parlement. Garant politique de la Constitution, il n’actionne jamais l’arme du recours constitutionnel pour des raisons politiques, soit de soutien à la législation, soit de sauvegarde et de préservation d’une autorité politique affaiblie. Juridiquement, s’abstenant d’agir auprès du juge constitutionnel, le président de la République présume la conformité à la Constitution des lois qu’il promulgue.
Dès lors, et au vu de tout ce qui vient d’être dit, comment concevoir qu’un ancien président de la République puisse siéger au Conseil constitutionnel et statuer sur des lois dont il a reconnu nécessairement, par son inertie, la constitutionnalité ? Comment concevoir qu’un ancien président de la République, si impliqué dans la législation, puisse se détourner d’arrière-pensées politiques lorsqu’il est conduit à juger d’une loi qui détricote une loi promulguée sous sa mandature ? Comment concevoir qu’un ancien président de la République au rôle politique consacré et assumé s’abstienne de toutes considérations politiques dans son jugement lorsqu’une loi contestée défait un texte législatif qu’il a lui-même désapprouvé comme président minoritaire ? Quand bien même on ne doit pas suspecter a priori un ancien président de la République de partialité, son implication passée mais totale dans la vie politique jette un trouble sur sa totale objectivité au moment du jugement. Pour cette raison, et rien que pour elle, la sauvegarde des apparences d’un procès équitable, pour emprunter un raisonnement mis en avant par la Cour européenne des droits de l’Homme, implique l’abrogation rapide de l’alinéa 2 de l’article 56 de la Constitution de 1958. Mais ce n’est pas le seul argument en faveur de la modification de la Constitution. Une autre tient au Conseil constitutionnel lui-même, plus précisément à ce qu’il est devenu à la suite d’une décision historique (1971) qui, sans deux réformes constitutionnelles majeures (1974, 2008), n’aurait jamais été en mesure, à elle seule, d’entraîner une mutation du Conseil constitutionnel.
C – La disparition des membres de droit justifiée par la mutation du Conseil constitutionnel
L’acte I, l’acte fondateur, est la décision du 16 juillet 1971, par laquelle le Conseil accepte de déterminer la conformité d’une loi à la Constitution en la confrontant à son préambule qui renvoie à la Déclaration de 1789 et au Préambule de la Constitution de 1946. De régulateur de l’action des pouvoirs publics, le Conseil constitutionnel se mue en protecteur des droits et libertés. La réforme constitutionnelle du 29 octobre 1974 qui accorde le droit de saisine à soixante députés ou soixante sénateurs amplifie cette décision rendue après la disparition du général de Gaulle. C’est l’acte II, l’acte accélérateur. L’ouverture de l’office du Conseil constitutionnel à une minorité parlementaire qui exerce régulièrement son droit de recours a donné naissance à une abondante et riche jurisprudence constitutionnelle dont les termes s’imposent aux pouvoirs publics comme aux autorités administratives et juridictionnelles (art. 62 C). Toujours plus sollicité par les opposants à une loi, le Conseil constitutionnel interprète toujours plus souvent et largement les dispositions de la Constitution française, enrichissant régulièrement les normes constitutionnelles opposables au législateur. Ce faisant, le Conseil constitutionnel, tout en garantissant l’équilibre institutionnel entre le Gouvernement et le Parlement, est impliqué dans la défense des droits et libertés de rang constitutionnel au point de concurrencer les juridictions suprêmes ordinaires qui trouvent dans le contrôle de conventionnalité une arme pour réinvestir le champ de la protection des libertés, profitant du vide laissé volontairement et imprudemment par le Conseil constitutionnel1. L’acte III, l’acte conclusif, résulte de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui instaure un contrôle de constitutionnalité a posteriori des dispositions législatives, exclusivement tourné vers la garantie des droits fondamentaux des personnes. L’article 61-1 de la Constitution dispose : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». La mutation est achevée. La question prioritaire de constitutionnalité matérialise, en 2009, l’avancée voulue par le constituant, après une tentative infructueuse vingt ans plus tôt (1990).
Le procès constitutionnel ouvert aux justiciables achève la juridictionnalisation du Conseil constitutionnel qui, désormais, se prononce régulièrement sur des centaines de dispositions législatives litigieuses. Cet accroissement de l’activité contentieuse du Conseil constitutionnel sans précédent ne modifie pas fondamentalement la problématique de la présence des anciens présidents de la République au sein de l’institution. Elle en amplifie la critique d’où certainement la rédaction de l’article 4 du règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité : « (al. 2) Une partie ou son représentant muni à cette fin d’un pouvoir spécial peut demander la récusation d’un membre du Conseil constitutionnel par un écrit spécialement motivé accompagné des pièces propres à la justifier. La demande n’est recevable que si elle est enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel avant la date fixée pour la réception des premières observations / (al. 4) Le seul fait qu’un membre du Conseil constitutionnel a participé à l’élaboration de la disposition législative faisant l’objet de la question de constitutionnalité ne constitue pas en lui-même une cause de récusation ». La récusation est la réponse du Conseil constitutionnel apportée aux détracteurs de la présence des membres de droit. Si une disposition équivalente est absente pour les questions de constitutionnalité posées dans le cadre du contrôle préventif (art. 61, al. 2, C), force est de reconnaître que son inapplication dans le procès constitutionnel depuis 2010 tient davantage au comportement des anciens présidents de la République qu’à l’absence de leur contestation au sein de l’instance de jugement des lois.
Si, à l’époque du seul contrôle préventif de la loi, Vincent Auriol n’a jamais caché son intention de siéger pour faire de la politique autrement (après son choix de ne plus siéger au Conseil à partir de 1960 pour protester contre le refus du général de Gaulle de saisir le Parlement en session extraordinaire, il retournera au Conseil pour participer à la délibération sur le recours du président du Sénat contre la loi référendaire de 1962), René Coty a pour sa part régulièrement participé aux travaux du Conseil constitutionnel mais à une époque où l’activité de l’institution était extrêmement réduite. Quant au général de Gaulle et à François Mitterrand, le temps ne leur a pas permis d’investir la rue de Montpensier. Depuis 2008, Valéry Giscard d’Estaing ne siège pas sur les affaires QPC en raison de son hostilité à cette procédure. Quant à Jacques Chirac, il ne siège plus depuis 2011 pour des raisons de santé et Nicolas Sarkozy s’est mis en retrait du Conseil constitutionnel après la confirmation par le Conseil constitutionnel du rejet de ses comptes de campagne pour l’élection présidentielle de 2012. Quel que soit le Conseil constitutionnel référent (avant ou après 2008-2010), jamais les anciens présidents de la République n’ont rapporté sur un dossier. Pour autant, la présence des anciens présidents de la République a été fortement dénoncée lorsque, faisant fi de leur devoir de réserve, certains anciens chefs de l’État se sont permis de prendre publiquement des positions politiques (tel Valéry Giscard d’Estaing pour Nicolas Sarkozy en 2007 et pour François Fillon en 2016 dans le cadre des primaires de la droite et du centre) ou de siéger alors que le Conseil constitutionnel était saisi d’une affaire les impliquant directement (Jacques Chirac siégeait toujours au Conseil lorsque celui-ci a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité en relation avec les emplois fictifs de la ville de Paris. Cependant, Jacques Chirac n’a pas participé au délibéré de la QPC en question).
Toujours est-il que cette présence de droit jette un trouble sur l’impartialité objective que se doivent de respecter les juridictions et à laquelle la Cour européenne des droits de l’Homme accorde beaucoup d’importance, parfois d’ailleurs de façon excessive. De façon générale, la contrariété de la composition du Conseil constitutionnel aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention EDH n’est toutefois pas à redouter.
D – Quels attributs post-présidentiels pour les anciens présidents de la République ?
Le décret du 4 octobre 2016 relatif au soutien matériel et en personnel apporté aux anciens présidents de la République répond à une exigence de transparence et un souci de doter les anciens présidents de la République d’un statut conforme aux responsabilités exercées. Il intervient à la suite d’une décision du Conseil d’État confirmant la légalité d’un courrier non publié en date du 8 janvier 1985 par lequel le Premier ministre porta à la connaissance de Valéry Giscard d’Estaing, ancien président de la République, les règles fixant de manière permanente le statut dans la nation des anciens présidents de la République et des conjoints des présidents de la République décédés, en ce qui concerne tant leur situation personnelle que les conditions de leur participation à la vie publique. Le décret présidentiel, s’il a le mérite de conférer un statut matériel aux anciens présidents, n’aborde évidemment pas leur statut juridique au sein des institutions qui, aujourd’hui, se « réduit » à siéger au Conseil constitutionnel. La fin de leur présence au sein du Conseil, suggérée par la commission Vedel en 1993, la commission Balladur en 2007, la commission Jospin en 2012, ou encore la commission Bartolone en 2016, soulève la question de leurs attributs post-présidentiels, question rarement abordée par ceux-là mêmes qui réclament la fin de cette aberration française, témoignage d’une survivance d’un Conseil d’un autre temps.
Que faire ? Une première réponse est apportée par une proposition de loi constitutionnelle déposée par le sénateur Patrice Gélard2 : membre de droit à vie du Sénat. Outre l’intérêt d’accueillir une personnalité de prestige, la proposition s’inspire du Sénat italien. L’appartenance de droit à la seconde chambre est certainement moins incongrue que la présence de droit au sein de la juridiction constitutionnelle qui a en charge la protection des droits fondamentaux et pour laquelle le justiciable est en droit d’attendre toute l’objectivité nécessaire. Il n’empêche, la proposition se heurte à une sérieuse objection. En intégrant le Sénat, l’ancien président bénéficierait de nouveau d’un régime d’immunité qui le protège de toutes actions judiciaires sauf décision contraire du bureau du Sénat qui autoriserait les poursuites. Il peut aussi s’y opposer. Une deuxième réponse, moins convaincante mais envisageable, consisterait à maintenir la présence des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel mais en ne leur permettant que de participer aux délibérations des décisions rendues par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 16 de la Constitution (pouvoirs spéciaux du chef de l’État) et de l’article 7 (empêchement constaté du président de la République). Les responsabilités assumées par les anciens présidents de la République militent pour une telle approche. Il serait en revanche privé du droit de décider sur toutes les autres affaires soumises au Conseil constitutionnel. Enfin, une troisième réponse – la plus satisfaisante – est de priver les anciens présidents de la République de toutes attributions post-présidentielles. Citoyen ordinaire, l’ancien président de la République retrouverait une totale et entière liberté de parole et d’action. Responsable politique, il est illusoire et naïf de penser que les anciens présidents peuvent se retirer discrètement de la vie publique. Cette troisième voie est d’autant plus opportune que désormais leur statut matériel est assuré et reconnu.
Pascal Jan
II – Pour une explication et une justification du maintien des anciens présidents au Conseil constitutionnel
Depuis 2012, une déferlante de critiques s’est abattue à l’encontre du maintien des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel. Le 19 mai 2012, Robert Badinter signait dans les colonnes du Monde, une tribune à l’intitulé percutant : « L’exception française de trop »3. L’ancien président de l’institution entendait – dans un contexte marqué par l’intention exprimée par le chef de l’État sortant d’y siéger parallèlement à la reprise d’une activité d’avocat – relancer le débat sur la pertinence de l’article 56, alinéa 2 : « En sus des neuf membres (nommés), font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens présidents de la République ». Dénonçant une « aberration institutionnelle », il appelait le nouveau président à y mettre fin. Quelques mois plus tard, la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, présidée par l’ancien Premier ministre Lionel Jospin, remit au chef de l’État un rapport intitulé : Pour un renouveau démocratique, recommandant à son tour cette suppression. Tel fut l’objet de l’article 2 du projet de loi constitutionnel relatif aux incompatibilités applicables à l’exercice de fonctions gouvernementales et à la composition du Conseil constitutionnel4, déposé le 14 mars 2013 sur le bureau de l’Assemblée nationale. Déjà, le 8 janvier, des députés de la majorité avaient porté une proposition de loi constitutionnelle relative au statut des anciens présidents de la République, qui remplaçait la disposition critiquée par un article disposant : « Les anciens présidents de la République font de droit partie à vie du Sénat »5. Si aucun des deux textes n’a finalement été adopté, ni même été examiné faute d’une majorité suffisante, les dernières vagues sont venues de l’actuel président du Conseil et de son prédécesseur. Sur France Inter, le 17 février 2016, Jean-Louis Debré déclarait : « [La] présence des anciens présidents de la République n’est plus souhaitable »6, tandis que, le 18 avril 2016, Laurent Fabius « enfonçait le clou » dans une interview au Monde : « La présence des ex-présidents au Conseil constitutionnel doit être supprimée »7.
La cause semble ainsi entendue et, pour écarter toute ambiguïté sur la conviction de l’auteur de la présente contribution, celle-ci pourrait se résumer en quatre mots : « Ils ont fondamentalement raison ! ». L’actuel hôte de la rue de Montpensier aura sans doute décoché la flèche la plus éclatante : « Un de mes professeurs de droit aimait répéter que, à la différence des satellites, les institutions demeurent rarement sur l’orbite où leur créateur a voulu les placer. Ce constat s’applique parfaitement au Conseil constitutionnel… Il a changé d’orbite par étapes pour devenir une véritable Cour constitutionnelle ». Pourtant, il serait juste de compléter ce trait en notant que la trajectoire d’une institution, dès lors qu’elle a été créée et se trouve régie par un texte, pourra être appréciée différemment sur le plan juridique, selon qu’elle est le résultat d’une évolution de sa lettre ou de la pratique institutionnelle. Or, s’agissant de l’appartenance de droit des anciens présidents, la position du président Laurent Fabius se heurte à un constat de taille : formellement, le « Conseil » constitutionnel ne constitue toujours pas, en 2016, une « cour » constitutionnelle, l’amendement Badinter proposant cette seconde qualification ayant été rejeté par le Constituant lors de l’examen du projet de loi constitutionnelle devenue celle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République8. Plus largement, le rejet des membres de droit suscite la perplexité en ce qu’il peut donner le sentiment d’une institution « jetée en pâture » et conduire à détourner l’attention d’une réalité plus profonde de l’évolution de la Ve République, que les pouvoirs publics dans leur ensemble éludent depuis longtemps. De même que le pas du passage d’un Conseil constitutionnel à une cour constitutionnelle n’a pas encore été sauté, la page d’un président de la République érigé en garant de la Constitution n’a toujours pas été refermée au profit de celle, unique, d’un chef de l’État ayant préempté la fonction gouvernementale depuis 1962. Ainsi paraît pouvoir être mieux compris l’ajout des termes « de trop », dans le titre choisi par le président Badinter pour son article.
C’est pourquoi, sauf à traiter le sujet dans toute son étendue, c’est-à-dire en soulevant les deux difficultés majeures susmentionnées, la question des membres de droit du Conseil constitutionnel amène à s’interroger, en l’état de la Constitution, sur la pertinence de la suppression plutôt que de l’aménagement de cette survivance. Or si la première option semble devoir s’imposer à terme, la seconde option mérite de retenir pour le moment l’attention, cette institution restant encore, pour l’heure, explicable par l’ambiguïté du rôle de garant dévolu au chef de l’État (A) et justifiable par celle de la mission plurielle attribuée au Conseil constitutionnel (B).
A – Une institution explicable par l’ambiguïté du rôle dévolu au chef de l’État
Le principe de l’appartenance de droit des anciens présidents au Conseil continue à s’expliquer, en droit positif, par la mission dévolue au premier par la Constitution (1), à laquelle ne s’oppose pas une lecture particulière de la séparation des pouvoirs (2).
1 – Une exception expliquée par le rôle dévolu au chef de l’État par la Constitution
L’argument volontiers invoqué à l’encontre de l’article 56, alinéa 2, est l’une des motivations ayant initialement conduit à son adoption. Le président Robert Badinter notait d’emblée en 2012 : « Seule l’histoire explique (…) cette bizarrerie française. En 1958 (…) se posa la question très secondaire de la condition faite aux ex-présidents de la République. Le général de Gaulle entendait que le président René Coty (…) bénéficiât d’une condition convenable sous la Ve République. Or la Ve République traitait avec pingrerie ses anciens présidents ». D’autres auteurs avaient, avant lui, avancé cette explication, telle Anne-Marie Le Bos-Le Pourhiet qui en fit état dès 1986, parmi plusieurs motifs : « il faut sans doute ajouter également, plus prosaïquement, le souci d’assurer une certaine sécurité matérielle aux anciens présidents »9. Mais cette raison, peut-être parce qu’elle apparaît aujourd’hui la plus à même de justifier le caractère aberrant de cette institution, a progressivement pris le pas sur les autres. En 2010, Patrick Wachsmann évoquait une position « (c)onçue par de Gaulle comme devant assurer une retraite confortable aux anciens présidents »10, tandis que Brigitte Vincent écrivait l’année suivante : « La disposition (…) n’est apparue qu’après les travaux du conseil interministériel. Elle a donc surgi lors de cette réunion, sans que l’on ne sache très bien comment, faute de documents relatifs aux débats. Si l’initiateur n’est pas connu avec certitude, tous s’accordent à penser qu’il s’agit du président de la République en exercice, René Coty, qui aurait songé à son propre avenir (…) »11.
La lecture des dernières lignes vient fragiliser l’argument, puisque celui-ci repose sur la mise à disposition tardive des travaux préparatoires à la Constitution. Or l’étude des Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de cette dernière, publiés principalement entre 1987 et 1988, vient nuancer cette première explication. Alors que le Secrétariat général du Gouvernement avait prévu dans l’avant-projet de Constitution du 15 juillet 1958, que : « Les anciens présidents de la République siègent de droit au Conseil constitutionnel », le commissaire du gouvernement Janot précisa, le 31 juillet suivant, devant le comité consultatif constitutionnel, que « les anciens présidents de la République, qui ont l’expérience de ce rôle de gardien de la Constitution – cette fonction qui consiste à veiller au bon fonctionnement des pouvoirs par un arbitrage constant –, (…) font obligatoirement partie [du Conseil constitutionnel] »12. Ainsi, cette position accordée aux anciens présidents se trouvait justifiée non seulement par une raison matérielle, mais aussi par une raison fonctionnelle tenant au rôle voulu pour le chef de l’État dans les institutions de la IVe République. Ce motif ne saurait d’ailleurs être regardé comme une reconstruction faite a posteriori de l’histoire, les travaux préparatoires à la Constitution du 27 octobre 1946 montrant à quel point le principe d’un président protecteur de la Constitution avait été intégré par ses rédacteurs. Dans le rapport élaboré au nom de la Commission de la Constitution de la seconde Assemblée nationale constituante, le rapporteur général Coste-Fleuret avait en effet insisté sur le fait que : « Le président de la République est également le gardien de la Constitution »13. Par la suite, l’idée que le futur comité constitutionnel soit présidé par le président fut tour à tour suggérée par Vincent Auriol, alors président de l’Assemblée nationale constituante, dans une lettre adressée au président de séance, le 3 septembre 194614, puis par le rapporteur, dans un amendement présenté le 5 septembre suivant15.
Mais s’il est vrai que l’appartenance de droit au Conseil aurait pu être limitée aux seuls anciens présidents de la IVe République, la mission attribuée par la Constitution aux présidents de la Ve République permet d’expliquer l’extension du bénéfice de cette position à ceux-ci. Lors des débats devant le comité consultatif constitutionnel réuni le 8 août 1958, le général de Gaulle, fidèle à son Discours de Bayeux, avait lui-même représenté le futur président sous les traits d’un « personnage impartial, qui ne se mêle pas de la conjecture politique », et qui « est là pour que les pouvoirs publics fonctionnent normalement, régulièrement, comme il est prévu dans la Constitution »16. Ce faisant, le chef de l’État républicain devait être une sorte de réminiscence du « pouvoir neutre » théorisé près d’un siècle et demi plus tôt par Benjamin Constant, à propos de la personne du roi sous la Restauration. Il en est ainsi résulté l’insertion, dans la Constitution du 4 octobre 1958, de l’article 5, toujours en vigueur : « Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités ».
2 – Une institution expliquée par une lecture particulière du principe de séparation des pouvoirs
Malgré les développements qui précèdent, il est possible d’admettre que le mouvement de juridictionnalisation dont a bénéficié le Conseil constitutionnel depuis 1958 justifie l’interrogation que formulait le président Robert Badinter en 2012 : « (P)ourquoi appeler les ex-présidents de la République à siéger à vie dans une juridiction constitutionnelle ? ». Pourtant, force est de constater que le système français éprouve encore aujourd’hui des difficultés à s’extraire d’une lecture particulière du principe de séparation des pouvoirs, qui continue à regarder la sphère politique comme un domaine à part. Comme l’expliquait déjà Benjamin Constant en 1814, à propos de son « pouvoir neutre » : « lorsque les pouvoirs publics se divisent et sont prêts à se nuire, il faut une autorité neutre, qui fasse à leur égard ce que fait le pouvoir judiciaire à l’égard des individus (…) Le pouvoir royal est, en quelque sorte, le pouvoir judiciaire des autres pouvoirs »17. Plus tard, pendant les travaux préparatoires à la Constitution du 4 octobre 1958, le président de la République et le Conseil constitutionnel virent leurs missions conçues dans une logique de complémentarité. Dans son article sur Le chef de l’État et le juge constitutionnel, gardiens de la Constitution, paru en 1999, Isabelle Richir soulignait la spécificité du lien existant entre eux : « Avant 1958, si la fonction présidentielle a été malmenée, la fonction juridictionnelle fut tout simplement rejetée. C’est paradoxalement cette douloureuse ambivalence qui détermine la force de leur lien (…) Ces deux “nouvelles” autorités sont donc chargées de veiller sur cette Constitution qui leur offre neuf articles pour se rencontrer »18. Or il est intéressant de souligner, pour s’en tenir à la lettre de la Constitution, que l’addition des compétences du président de la République et du Conseil n’apparaît jamais que comme un moyen de pallier ce dont la France n’a jamais réussi à – ou voulu – se doter jusqu’à ce jour : une véritable cour constitutionnelle qui, à l’instar de celle de Karlsruhe en Allemagne, se trouve chargée y compris de « statue(r) (…) sur l’interprétation de la (…) loi fondamentale, à l’occasion de litiges sur l’étendue des droits et obligations d’un organe fédéral (…) » [art. 93 (1)]. À défaut de réunir au sein d’une même institution l’ensemble des compétences attendues d’un gardien unique de la Constitution, le constituant français les a scindées entre le chef de l’État et le Conseil constitutionnel, tout en leur permettant de se rejoindre organiquement à travers l’appartenance des anciens présidents à ce dernier.
Tout connaisseur des institutions de la Ve République dira toutefois, avec raison, que l’idéal d’un chef de l’État se cantonnant à la mission de l’article 5 de la Constitution a vécu. Depuis l’introduction de l’élection du président de la République au suffrage universel direct, en 1962, la concordance des majorités présidentielle et parlementaire donne à celui-ci l’ascendant sur le Premier ministre et le Parlement. Pourtant, et en dépit de la réforme du quinquennat intervenue en 2000 et de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, la répartition des compétences entre les deuxième et premier personnages de l’État est restée formellement inchangée. Au Gouvernement, dirigé par le Premier ministre, revient le pouvoir de « détermine(r) et (de) condui(re) la politique de la nation » (art. 20). Au président appartient le pouvoir de « veille(r) au respect de la Constitution » et d’« assure(r), par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État » (art. 5). En période de cohabitation, le chef de l’État est ainsi poussé à revenir à la lettre de la Constitution. François Mitterrand n’avait pas manqué de le rappeler en 1986, comme en témoigne cet extrait d’une interview sur Europe 1 : « – F. Mitterrand : “Alors si vous posez une question… quel est le rôle exact du président de la République ? Vous dites, est-ce un arbitre ? Oui, c’est un arbitre dans de nombreux domaines. On dira pour être plus juste, que c’est un peu un juge-arbitre…”. – J.-P. Elkabbach : “Oui, mais est-ce qu’on peut imaginer un président de la République socialiste impartial, arbitre, alors que ce sont des joueurs de droite qui jouent la partie ?”. – F. Mitterrand : “Je demande simplement qu’on fasse confiance dans le sens que j’ai de l’État” »19. En période de concordance des majorités, le chef de l’État va au contraire se comporter en président gouvernant, élu sur un programme. Mais est-ce à dire qu’il ne devrait pas, dans ce contexte, être jugé par les électeurs sur sa volonté et son aptitude à donner un sens à l’article 5, promesse obligatoire prévue par la Constitution elle-même ? Un tel jugement ne semble pas absent du discours concernant l’exigence d’« incarnation » et le rejet de tout « abaissement » de la fonction présidentielle qui, dans l’esprit de ceux qui emploient ces expressions, ne saurait se confondre avec celle d’un « simple » Premier ministre ? De même, cette période pourrait être l’occasion pour les anciens présidents de démontrer leur utilité pour le Conseil constitutionnel, non pas en adoptant des positions motivées par des velléités politiques, mais en rappelant à chaque instant au chef de l’État en exercice que le premier et les anciens premiers magistrats du pays sont d’abord au service de la Constitution.
Cette dernière aptitude, dont il convient d’admettre qu’elle a fait largement défaut depuis 1958, paraît toutefois tributaire d’un autre trait de la culture juridique française. L’exercice antérieur d’une fonction ou d’un mandat proprement politique ne constitue pas, en France, un obstacle rédhibitoire à l’exercice de fonctions juridictionnelles, une sorte de bienveillance prévalant même en la matière. Sans remonter en 1958, cette réalité ressortait encore, pour le seul Conseil, du discours prononcé en 2010 par le président Nicolas Sarkozy, à l’occasion de l’entrée en vigueur de la loi organique sur l’article 61-1. Il affirmait alors : « Il y a une spécificité du contrôle de constitutionnalité des lois, parce que la Constitution n’est pas un texte juridique comme les autres. C’est dire que le Conseil constitutionnel ne saurait être une juridiction comme une autre. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité qu’il ne soit pas composé que de techniciens du droit et que les anciens présidents de la République y conservent leur qualité de membres de droit, parce que l’expérience d’un ancien chef de l’État, qui a fait fonctionner les institutions, peut apporter beaucoup à la qualité des décisions du Conseil, à leur équilibre, à leur réalisme »20. Les nominations qui y sont faites sont révélatrices de cet état d’esprit. La désignation par Jacques Chirac de Jean-Louis Debré, ancien député, ministre et président de l’Assemblée nationale, à la présidence de l’institution, pouvait encore se comprendre en 2007. Mais que dire de la décision de François Hollande de le remplacer en 2016 par Laurent Fabius, personnalité au parcours politique analogue et candidat à la primaire de 2007, alors qu’étaient entre-temps intervenus la révision de 2008 introduisant un système de veto supposé inspiré du modèle américain et le rapport de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique de 2012 ? Que dire également de la publication par Jean-Louis Debré, au lendemain de la fin de son mandat, d’un journal au contenu éminemment politique : Ce que je ne pouvais pas dire21, ou de la volonté de Laurent Fabius de conserver initialement la présidence de la COP21 qu’il assurait en tant que ministre des Affaires étrangères, puis de promouvoir un Pacte mondial pour l’environnement ?
B – Un maintien justifiable par l’ambiguïté du rôle dévolu au Conseil constitutionnel
En dépit de cet état des choses, il appartient néanmoins de se ranger à l’évidence, défendue par le président Robert Badinter, du caractère aujourd’hui difficilement soutenable de la participation des anciens présidents aux fonctions juridictionnelles du Conseil constitutionnel. Mais dès lors que l’on reste dans ce qui n’est pas encore une cour constitutionnelle, il semble également important de réfuter l’idée, parfois avancée, que la qualité de membre de droit serait nécessairement un privilège. Il est en effet possible de se demander si cette appartenance ne devrait pas être regardée comme une obligation, une sorte de servitude attachée à l’exercice de la magistrature suprême. Partant de là, il semble envisageable que le maintien des anciens présidents puisse passer par un aménagement du statut applicable (1) et un aménagement des fonctions exercées (2).
1 – Une présence impliquant un aménagement du statut applicable
La circonstance que l’article 56, alinéa 2, ait été adopté avec autant de facilité lors des travaux préparatoires à la Constitution de 1958 n’est pas totalement étrangère au fait que, derrière les explications déjà avancées, il en existait une autre. Pour Anne-Marie Le Bos-Le Pourhiet en 1986, il s’agissait « surtout (…) de s’assurer de la conjugaison de [la] vie politique [des anciens présidents] au passé, de les empêcher de peser directement ou indirectement sur l’avenir de la nation et de gêner leurs successeurs (…) on les cantonne donc dans un rôle honorifique qui les occupe et canalise, voire supprime, leur liberté d’expression »22. Le même argument fut avancé par Brigitte Vincent vingt-cinq ans plus tard : « Plusieurs auteurs évoquent les arrière-pensées politiques des constituants (…) ils auraient souhaité neutraliser les anciens présidents en les cantonnant au Conseil constitutionnel (…) Élégante façon de s’assurer de leur silence politique ». Quels qu’aient été les motifs inavouables à l’origine de la disposition étudiée, cette volonté d’encadrer les anciens présidents mérite que l’on s’y attarde, dans la mesure où elle aurait dû se traduire par une réflexion sur l’édiction d’un véritable statut, accompagné de la soumission des intéressés à des d’exigences strictes. Or il est paradoxal de constater que les commentaires consacrés aux membres de droit pointent unanimement la propension de ceux-ci à échapper aux règles applicables aux membres nommés, comme à toute règle. Pour autant, le fait que l’encadrement des anciens présidents soit insuffisant ne signifie nullement qu’il ne peut être amélioré.
S’agissant ainsi des obligations et de la discipline, l’appartenance « de droit (…) à vie » prévue par le texte constitutionnel ne saurait être comprise comme faisant obstacle à la soumission des anciens présidents à des devoirs et à la possibilité de les sanctionner. Pour ce qui est des obligations, le Conseil constitutionnel a bien admis dès 1984, que « Sous la seule réserve de la dispense de serment, [les anciens présidents siégeant au Conseil] sont soumis aux mêmes obligations que les autres membres »23. La question de la discipline est plus complexe à saisir. Les anciens chefs de l’État sont en principe soumis aux articles 5 et 6 du décret du 13 novembre 1959 sur les obligations du Conseil constitutionnel, qui confie au collège des membres le soin d’apprécier un éventuel manquement. Mais la doctrine s’accorde traditionnellement sur l’inapplicabilité à leur égard de la procédure de « démission d’office » prévue par les articles 7 du décret et 10 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Cette position semble toutefois pouvoir être nuancée à la lumière des rédactions utilisées dans plusieurs constitutions qui ont jalonné l’histoire constitutionnelle. Ainsi, la circonstance que les « sénateurs inamovibles » – comprendre « à vie » – de la IIIe République, aient été perçus comme irrévocables, s’explique par le silence sur ce point de la loi du 24 février 1875 relative à l’organisation du Sénat. Mais, en sens inverse, la Constitution de la IIe République avait pris soin de prévoir que les juges judiciaires et des comptes : « sont nommés à vie. – Ils ne peuvent être révoqués ou suspendus que par un jugement, ni mis à la retraite que pour les causes et dans les formes déterminées par la loi ». Pour mieux comprendre la situation des anciens présidents vis-à-vis du Conseil constitutionnel, il semble dès lors qu’une distinction devrait être opérée entre le fait d’accéder « de droit » à ce dernier, sans passer par le préalable de la nomination, et le fait d’y être désigné « à vie », ce qui ne fait pas obstacle à leur possible éviction en cas de manquement, pour peu qu’une procédure soit prévue. Reste qu’il n’est pas certain que le mécanisme de « démission d’office » déjà présenté soit approprié, celui-ci ayant montré ses limites entre 1999 et 2000, à l’endroit de l’ancien président « nommé », Roland Dumas.
Il en va de même en matière d’incompatibilités. Dans sa décision du 11 janvier 1995, le Conseil constitutionnel avait déjà étendu aux anciens présidents les règles applicables aux membres nommés, en cas d’exercice parallèle d’un mandat électoral ou d’une fonction figurant au rang des incompatibilités professionnelles applicables aux membres du Parlement24. Mais, suite à l’intention exprimée par le président sortant, Nicolas Sarkozy, d’exercer des activités d’avocat, le président Robert Badinter avait utilement soulevé, dans son article de 2012, le problème des incompatibilités touchant au cumul des fonctions au sein du secteur privé. Une réponse y a finalement été apportée par la loi organique du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui prévoit que l’exercice des fonctions de membre du Conseil est incompatible avec celui de toute fonction publique et de toute autre activité professionnelle ou salariée, en particulier avec l’exercice de la profession d’avocat. Comme l’avait toutefois jugé le Conseil en 1995, il convient tout au plus d’admettre que : « dès lors qu’un ancien président de la République exerce un mandat ou une fonction incompatible avec ses fonctions de membre de droit du Conseil constitutionnel, [les dispositions] doivent être regardées comme faisant seulement obstacle à ce qu’il y siège ». Ce considérant, s’il peut sembler contestable, devrait faire l’objet d’une lecture constructive. Il convient en effet de se demander s’il ne devrait pas être possible de concilier le droit des anciens présidents de faire « partie à vie » du Conseil, avec la faculté pour eux de bénéficier de positions leur permettant d’exercer pendant un temps des fonctions qui ne seraient, ni contraires à la dignité d’ancien président, ni à celle de membre de droit du Conseil. Comment, en effet, pourrait-on décemment refuser à un ancien chef de l’État le bénéfice d’une telle mesure, alors que, dans le même temps, le droit français accepte qu’un membre du Conseil d’État, un magistrat administratif, judiciaire ou financier, puisse être mis en disponibilité ou en détachement dans un très large éventail d’hypothèses, y compris politiques et parfois pendant la presque intégralité de sa carrière, sans avoir à démissionner de la fonction publique ? Personne n’est ainsi choqué à l’idée que François Hollande puisse décider, en cas de non-réélection à la présidence de la République, s’il le souhaite, de réintégrer jusqu’à sa retraite la Cour des comptes, institution dont il est issu et au sein de laquelle il n’a presque jamais exercé au profit de plus de trente années d’implication politique.
2 – Une présence impliquant un aménagement des fonctions exercées
Faute de pouvoir préserver la faculté pour les anciens présidents de participer « de droit » à l’activité de contrôle de constitutionnalité des lois, et plus précisément à celle – juridictionnelle – de l’article 61-1, sans doute serait-il opportun de suggérer une réduction de leur champ de compétence.
En effet, à l’instar du Conseil d’État qui se caractérise par une dualité fonctionnelle combinant des fonctions juridictionnelles et des fonctions consultatives, le Conseil constitutionnel se distingue, lui, par une « trialité » fonctionnelle. Il cumule des fonctions de juge ordinaire, en qualité de juge électoral, des attributions de contrôle de constitutionnalité des lois, en application des articles 61 et 61-1 de la Constitution, et des activités consultatives. Ces dernières fonctions, qui concernent la mise en œuvre des pouvoirs de crise prévus par l’article 16 de la Constitution, ainsi que l’organisation des scrutins présidentiels et référendaires, ne requièrent pas a priori les mêmes qualités que celles attendues pour l’exercice de fonctions juridictionnelles ou assimilées. En témoigne, encore au niveau du Conseil d’État, l’ouverture faite, pour l’accès aux sections administratives, aux membres de l’administration active et aux personnalités œuvrant dans la sphère politique. Les fonctions consultatives exercées au sein du Conseil constitutionnel n’impliquent au demeurant « qu’une faible activité », pour reprendre l’argument employé par le président Robert Badinter25. Ainsi, pourrait-il s’avérer opportun de cantonner les anciens présidents à ces seules attributions consultatives, dans lesquelles leur expertise politique s’avérerait utile sachant que, pour s’inspirer de l’ancien garde des Sceaux : « Si la passion de juger de la constitutionnalité des lois [les] anime (…), ils pourront toujours être nommés membres du Conseil constitutionnel pour neuf ans », sur ces fonctions, « par l’un de leurs successeurs ou le président de l’une ou l’autre des assemblées ».
De même, il semble qu’une distinction doive s’imposer entre le fait d’« appartenir » – faire « partie de droit à vie » – et celui de « siéger » au Conseil constitutionnel. Il serait alors possible d’imaginer, par opposition aux membres nommés qui participent aux différentes fonctions actives du Conseil, que les anciens présidents bénéficient d’une simple qualité de membre, laquelle aurait un caractère essentiellement honorifique et protocolaire, non nécessairement rétribuée, mais entraînant leur adhésion à une certaine éthique partagée avec les membres nommés du Conseil constitutionnel. Si une telle suggestion pourra surprendre, le droit français comporte déjà, pour les Premiers ministres en exercice, une disposition relevant globalement du même esprit. Celle-ci, qui n’étonne plus les juristes, résulte de l’article L. 121-1 du Code de justice administrative issu de l’ordonnance du 4 mai 2000 : « La présidence du Conseil d’État est assurée par le vice-président. L’assemblée générale du Conseil d’État peut être présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le garde des Sceaux, ministre de la Justice ».
Olivier Pluen
Notes de bas de pages
-
1.
Cons. const., 15 janv. 1975, n° 74-54 DC.
-
2.
Gélard P., proposition de loi constitutionnelle n° 186, Sénat 15 févr. 2005. V. aussi Schwartzenberg R.-G., n° 576, AN, 8 janv. 2013.
-
3.
Badinter R., L’exception française de trop, Le Monde, 19 mai 2012.
-
4.
PLC n° 814, 14 mars 2013.
-
5.
PLC n° 576, 8 janv. 2013.
-
6.
Debré J.-L. (propos recueillis par Cohen P.), « Jean-Louis Debré : “La présence des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel n’est plus souhaitable” », France Inter, 17 févr. 2016.
-
7.
Fabius L. (propos recueillis par Jacquin J.-B. et Roger P.), « Laurent Fabius : “La présence des ex-présidents au Conseil constitutionnel doit être supprimée” », Le Monde, 18 avr. 2016.
-
8.
Séance du 24 juin 2008, Compte rendu intégral des débats, JO Sénat, 25 juin 2008.
-
9.
Le Bos-Le Pourhiet A.-M., « Les membres de droit du Conseil constitutionnel », Revue administrative, 1986, n° 233, p. 455.
-
10.
Wachsmann P., Sur la composition du Conseil constitutionnel, Jus Politicum, 2010, n° 5, www.juspoliticum.com.
-
11.
Vincent B., Les membres de droit au Conseil constitutionnel, une singularité française, Institutul European, 2011, www.umk.ro.
-
12.
DPS, vol. 2, 1988, p. 72.
-
13.
Séances de la commission de la Constitution, comptes rendus analytiques, 1946, p. 268-269.
-
14.
Ibid., p. 406.
-
15.
Ibid., p. 428.
-
16.
DPS, vol. 2, 1988, p. 300.
-
17.
Constant B., Réflexions sur la Constitution, la distribution des pouvoirs, et les garanties, dans une monarchie constitutionnelle, 1814, Paris, H. Nicolle, p. 8.
-
18.
Richir I., « Le chef de l’État et le juge constitutionnel, gardiens de la Constitution », RDP 1999, p. 1048, n° 4.
-
19.
Mitterrand F. (propos recueillis par Elkabbach J.-P.), « Interview », Europe 1, 9 déc. 1986.
-
20.
Sarkozy N., « Discours prononcé le 1er mars 2010 », N3C 2010, n° 29, www.conseil-constitutionnel.fr.
-
21.
Debré J.-L., Ce que je ne pouvais pas dire, 2016, Robert Laffont.
-
22.
Le Bos-Le Pourhiet A.-M., « Les membres de droit du Conseil constitutionnel », préc., p. 455.
-
23.
Cons. const., 7 nov. 1984, n° 84-983 L, « A.N. Puy-de-Dôme (2e circ.) », cons. 4, 5 et 6.
-
24.
Cons. const., 11 janv. 1995, n° 94-354 DC, « Déclaration de patrimoine des membres du Parlement et incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel », cons. 12.
-
25.
V. aussi l’amendement n° 321, rectifié au projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République, Sénat, 16 juin 2008.